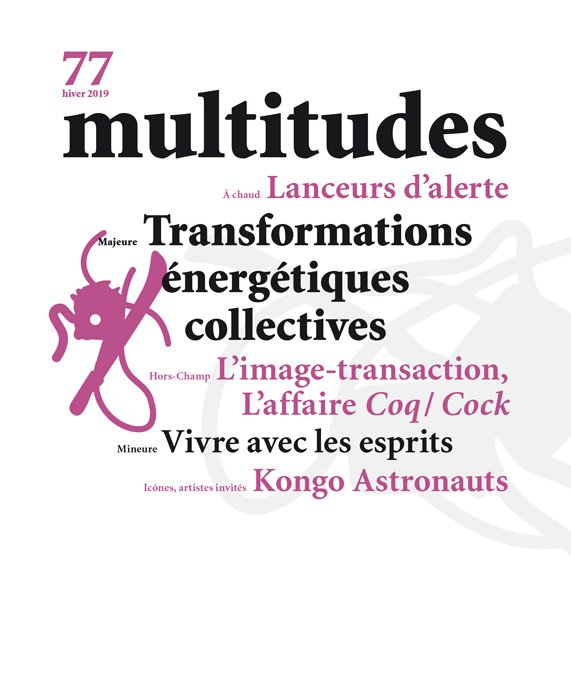« Autrefois les chamanes se seraient réunis pour boire du cachiri 1 et chercher en rêve une réponse des esprits » dit Victor, l’ancien kali’na, alors que nous parlons de l’inquiétude des spécialistes face à l’envasement et la poussée des mangroves qui, d’année en année, érodent les plages de Guyane empêchant les tortues luth de pondre leurs œufs et les pêcheurs de sortir leurs barques en mer près de leurs villages. L’érosion et le banc de vase qui a déjà avalé le sable du village d’Awala près de l’embouchure de la rivière de Mana menacent à présent l’estuaire du Haut Maroni où se trouvent les maisons de Yalimapo. La migration des bancs de vase sur le littoral guyanais, qui a aussi absorbé les plages de Cayenne, est la plus importante du monde. Selon le maire de la commune d’Awala-Yalimapo, Jean-Paul Fereira, son peuple Kali’na s’adaptera à ces transformations géologiques comme il l’a fait depuis les cinq siècles de colonisation française, hollandaise, portugaise ou britannique, ce qui a provoqué le génocide de vingt-huit autres peuples amérindiens habitant l’immense territoire (devenu le département de la Guyane française), et les pays frontaliers du Surinam et du Brésil. Mais une condition est nécessaire à cette adaptation : que les Kali’na puissent retrouver le contrôle de leurs terres et décider de leurs modes d’existence. Une première restitution de 40 000 ha eut lieu en décembre 2018 dans la commune de Bellevue.
Universalité des savoirs chamanes
Victor se souvient du temps où, avant son AVC, il travaillait avec cinq chamanes : « Nous étions forts alors ». Ces dernières années, un mouvement de renouveau culturel des Kali’na a relancé avec succès la pratique un peu oubliée des tambours chamaniques (sampula) accompagnés de chants qui font danser hommes et femmes en cercle pendant des heures. Des clubs de joueurs regroupant toutes les générations se sont multipliés dans les villages. Je demandai à Victor si les anciens chamanes kali’na n’avaient pas de successeurs plus jeunes. Il me dit que c’était trop difficile de devenir chamane aujourd’hui. L’efficacité des anciens supposait sacrifice et isolement, nécessaires à la communication avec les esprits, conditions extrêmes qui ne peuvent être satisfaites aujourd’hui.
J’évoquai avec Victor les trois hommes kali’na, dont deux âgés de plus de soixante ans et un plus jeune, qui avaient participé au Festival de chamanisme de Genac en Charente en 2017 : « C’est autre chose, ils parlent et jouent du tambour mais les vrais chamanes se taisent et n’agissent qu’au sein de leur communauté » me répondit-il. Il reste qu’à Genac, lorsque les trois hommes kali’na ont frappé leur sampula en chantant devant les guérisseurs des autres pays, les trois femmes aborigènes d’Australie à qui ils avaient montré leurs pas de danse dans le gîte que les deux délégations partageaient, ont attrapé par la main des membres d’autres délégations pour faire un grand cercle de danse. Amérindiens des Plaines, du Brésil et de la Colombie ont tourné avec des chamanes de Mongolie et de Sibérie. Je donnai la main à un Pygmée qui, avec les autres membres de sa délégation du Gabon, se mit à chanter les paroles en kali’na. Les participants exultaient de joie, transportés par le partage de leurs singularités, qui affirmait quelque chose d’un rapport au monde commun où l’humain n’est pas au centre de l’univers mais cohabite avec les esprits de la terre en communiquant de diverses manières avec les non humains, animaux, plantes, eau, air, feu et étoiles. Plus tard, au cours des centaines d’ateliers ouverts pendant quatre jours dans les tentes plantées sur un champ boueux, quelque 6 000 visiteurs sont passés, enthousiastes ou sceptiques, mais toujours en demande de ce que ces peuples possédaient encore alors qu’eux, en France, l’avaient également possédé mais perdu.
À l’édition 2019 du festival de chamanisme de Genac, deux wayana du Haut Maroni ont expliqué, comme les Aborigènes d’Australie les années précédentes, qu’eux aussi avaient perdu une grande partie de leurs savoirs et travaillaient, notamment en rêve, à les retrouver. Linia Opoya, potière, et son mari Tasikale Alupki2, collaborateur de nombreux chercheurs, notamment dans le projet de restitution virtuelle des collections du musée du quai Branly, habitent Taluen, village du parc amazonien confronté à l’orpaillage clandestin, qui les empêche de vivre des ressources du fleuve pollué par le mercure et de la forêt razziée par les chercheurs d’or. Les habitants demandent depuis des années un collège sur le fleuve pour ne pas avoir à envoyer leurs enfants en ville où certains se suicident compte tenu des déplorables conditions de vie. Les Aborigènes du nord australien ont également expliqué le suicide de certains de leurs jeunes par le fait que leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents avaient été enlevés à leurs familles sous prétexte qu’ils étaient métissés et devaient être assimilés aux Blancs. Un enfant sur cinq (entre 1905 et les années 1970) a ainsi été enfermé de force, parfois bébé, dans des pensionnats, pour être mis au service de Blancs à l’adolescence, comme domestiques ou garçons de ferme. Et ceci, souvent sans toucher de salaire et dans des situations de maltraitance assimilées à de l’esclavage par les activistes, artistes, juristes ou universitaires aborigènes d’aujourd’hui. Certains Aborigènes, élevés loin des leurs dans ces conditions désastreuses ou des familles d’adoption, sont partis à la recherche de leur ancestralité dans les années 1990, quand une commission royale permit d’identifier l’ampleur de ces « générations volées » et financer des recherches généalogiques pour d’éventuelles retrouvailles. Dans ce processus, certains ont découvert d’où ils venaient, d’autres pas, mais ils se revendiquent aussi Aborigènes. Ceux des villes réapprennent parfois la langue de leurs ancêtres lorsqu’elle est encore parlée ou a été étudiée par des linguistes. Sur les centaines de langues et dialectes australiens, beaucoup ont disparu sans laisser de trace. Mais, pour les Aborigènes, les langues sont la mémoire vivante des territoires, et des mots peuvent venir à nous en rêve quand on dort au bon endroit.
Réinventer les soins rituels qui lient les humains à leur milieu
Chez la plupart des peuples d’Australie, chaque enfant est considéré comme l’incarnation d’un chant qui fut semé par des ancêtres totémiques, hommes-animaux ou femmes-plantes, peuple-pluie ou étoiles. À ce titre, il ou elle a des devoirs à l’égard de certaines terres qu’il doit célébrer par des chants, des danses et des peintures rituelles. Reconstruire son héritage ancestral est devenu en Australie une forme de healing, un processus de soin à la fois individuel et collectif. Pour les Amérindiens de Guyane quelque chose de cet ordre résonne aussi, eux qui ont souffert des agressions et des déplacements, et continuent de souffrir aujourd’hui de tout ce qui menace leurs langues, leurs façons de s’alimenter grâce à la chasse et la pêche, ou d’autres aspects de leur culture. Mais en Guyane comme en Australie, face à ce désarroi, des jeunes se mobilisent dans des luttes contre l’extractivisme et réinvestissent les soins rituels qui lient les humains à leur milieu, « par le milieu » qui les traverse3.
« Les nouveaux concepts de la matière vivante, en particulier dans le travail de Manuel DeLanda, dérangent les distinctions conventionnelles entre la matière et la vie, l’inorganique et l’organique, l’objet passif et le sujet actif. Dans le « réalisme agentiel » de Karen Barad, l’agentivité/agencéité matérielle ne privilégie pas l’humain, tout comme, pour Jane Bennett, « le pouvoir de la chose » met l’emphase sur la base matérielle et la parenté de toute chose, indépendamment de leur statut – humain, animal, végétal, ou minéral […]4 ». Si le nouveau matérialisme refuse l’anthropocentrisme, pour ma part, étant inspirée par les Aborigènes, la parenté entre humain, animal, végétal ou minéral n’est pas un modèle d’équivalence mais, au contraire, un modèle de différentiation de positions relationnelles, différences qui n’impliquent pas nécessairement de la domination mais s’inscrivent souvent dans des négociations d’alliance et des tensions de conflits possibles et inévitables5.
Lors des ateliers du festival de chamanisme à Genac, les Aborigènes de la délégation australienne provenaient des régions côtières de Darwin ou du Kimberley dans le nord australien, ainsi que du désert du Queensland. Tous et toutes étaient métissés avec des ancêtres européens, chinois ou malais engagés dans le commerce de la perle, ou encore pakistanais et afghans engagés avec leurs dromadaires pour coloniser le désert. Ils et elles ont encouragé le public à retrouver comme eux les sources de leurs traces vivantes dans la terre, à se mettre à l’écoute des esprits, en rêve6. À leur façon, c’est ce que tentent de faire les organisateurs du festival qui se définissent comme guérisseurs « déo » celtes7. Bien sûr, la tradition celtique ne s’est pas transmise de génération en génération, ayant été étouffée par les colonisations des Romains, des Francs, des Rois puis d’une certaine République. Il n’y a pas non plus de traces écrites pour savoir comment opéraient les Celtes d’autrefois, mais ces hommes et ces femmes d’aujourd’hui inventent de nouveaux rituels qu’ils disent être inspirés par leurs liens avec les esprits de la terre. Pourquoi pas ?
Starhawk, activiste écoféministe qui participait aux occupations de Wall Street il y a vingt ans, et altermondialistes dans les années 80, a promu le mouvement des sorcières Wicca –, forme de néopaganisme popularisé dans les années 1950 par le Britannique Gerald Gardner – proposant d’ainsi ritualiser ces actions politiques et féministes8. En 2017, Starhawk fut invitée avec Isabelle Stengers à Notre-Dame-des-Landes où elle mit en œuvre un rituel de femmes. Inventer de nouveaux rites est nécessaire pour « sentir-penser avec la terre », comme disent les Amérindiens de Colombie9.
Extension du domaine chamanique
En juin 2018, les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se remettaient doucement de l’offensive d’avril-mai du gouvernement qui avait tenté de les expulser après sa décision d’abandonner le projet d’aéroport. Les 2 500 gendarmes et les blindés envoyés pour les déloger venaient de détruire une trentaine de cabanes qu’ils avaient construites sur les 64 lieux d’habitats occupés, dont des fermes retapées avec l’accord de paysans qui avaient refusé les indemnités pour les terres confisquées par l’État au bénéfice de Vinci, porteur du projet d’aéroport. Parmi les « zadistes » et leurs soutiens paysans ou autres, il y eut des centaines de blessés, agressés violemment par des grenades GLI-F4 (25 g de tolite, et 10 g de lacrymogène), dont l’usage est dénoncé10. Les habitants ont déversé devant la préfecture un immense tas de cartouches de grenades que les gendarmes avaient lancées sur le site noirci par leurs fumées et dégradé par la violence des interventions face aux barricades de fortune. Lorsque l’ultimatum fut donné de présenter des projets à la préfecture, cela créa de terribles conflits sur place, entre ceux qui se sentaient trahis d’avoir vu leur « route des chicanes » iconique démontée, et ceux qui tentaient de négocier pour que tout ne soit pas détruit. La rédaction des fiches de projets agricoles, sous cette pression inouïe, a démontré une intelligence collective et cartographique impressionnante. Sur une quarantaine de projets, la moitié a été acceptée, permettant à la plupart des projets décrits dans les fiches de continuer à fonctionner en réseau collectif. Certains habitants des lieux détruits par les gendarmes, après avoir été hébergés dans les lieux préservés, ont préféré partir ou se sont retranchés dans quelques habitats. Une certaine aigreur s’est installée, parfois envenimée par des personnes extérieures qui n’en comprennent pas tous les enjeux. Tous les lieux de lutte se transforment et la dépression guette les combattants. Mais à la ZAD, une incroyable effervescence a continué à germer avec l’été : des ateliers du groupe Défendre Habiter à l’Ambazada, d’autres à Bellevue et, depuis, des rencontres et des écrits stimulants, y compris le lancement en janvier 2019 d’un fonds de dotation, Terre en commun, pour racheter les terres afin d’empêcher la monoculture industrielle qui détruirait le bocage11.
À la fête de la Saint Jean organisée en juin 2018 dans la ZAD par les habitants de la ferme de Saint Jean, de la Rolandière et de quelques autres lieux, Nidala Barker, ma fille cadette, dont la grand-mère paternelle était Djugun et Jabirr Jabirr, a fait une fumigation rituelle de bien-être à laquelle ont participé tous ceux qui étaient réunis. Elle cueillit avec des habitantes la sauge qui pousse dans les nombreux vergers de la ZAD, plante médicinale et de purification des gens et des lieux utilisée par les Amérindiens des Plaines mais aussi par les traditions rurales européennes12. Dans divers pays d’Europe, des personnes partent seules ou en groupe à la recherche de traces pré-chrétiennes, comme ces jeunes femmes polonaises qui ont créé le Laboratorium piesni, un laboratoire qui vise à retrouver des chants anciens pour les interpréter dans une esthétique chamanique qui rend hommage aux arbres, aux pierres, aux rivières et aux animaux13. Très suivies sur les réseaux sociaux, les chanteuses font des tournées partout. N’est-il pas salutaire que dans cette Pologne majoritairement catholique, où les fondamentalistes attisent le feu d’un antisémitisme historique et d’une xénophobie réactivée par la panique morale face à l’injonction européenne d’accueillir quelques centaines de réfugiés musulmans, de jeunes polonaises choisissent d’explorer un passé pré-chrétien ? Peu importe qu’à l’instar de nombreux autres collectifs en quête d’inspirations traditionnelles, païennes ou chamaniques, leurs formes d’expressions soient réinventées, l’essentiel n’est-il pas de s’ouvrir aux autres, humains et non humains, d’offrir à sentir à nouveau l’histoire enchantée des terres des bisons, des ours et des loups ?
1 Bière de manioc.
2 Alupki fut le coordinateur de la Commission wayana-apalai pour la reconnaissance de l’initiation maraké comme Patrimoine immatériel de l’Unesco.
3 Voir le film Unti, Les origines, 2018, de l’activiste kali’na, Christophe Yanuwana Pierre, qui se bat contre l’impact destructeur de l’extractivisme et pour les droits des Amérindiens de Guyane au Grand conseil coutumier dont il est membre pour la JAG (jeunesse autochtone de Guyane), et au niveau de l’ONU.
4 Environmental Humanities and New Materialisms – The Ethics of Decolonizing Nature and Culture, Unesco 7-9, 2017, colloque organisé par Nathalie Blanc.
5 En ce sens, on ne peut pas synthétiser le totémisme australien en une ontologie de la continuité généralisée telle que proposée par Philippe Descola dans Par delà nature et culture ; voir B. Glowczewski, Totemic Becomings. Cosmopolitics of the Dreaming, Sao Paulo, n-1, 2015. Et « Debout avec la terre », Multitudes no65, 2016.
6 Lance Sullivan, guérisseur Yalarrnga du Queensland : https://vimeo.com/233652286
7 Déo : transcription phonétique du mot « derv » (« chêne » ou « être de la forêt ») qui définit les chamans celtes, http://festival-chamanisme.com/; voir aussi « Chamanes de tous les pays », F. Joignot, Le Monde des Idées, 3/8/2019.
8 Starhawk, Femmes, magie et politique, Empêcheurs de penser en rond (trad. de l’anglais 1982), www.peripheries.net/article215.html
9 Arturo Escobar, Sentir-penser la terre, Seuil, 2018. Voir Terrestre 2 « Le pluriversel à l’ombre de l’universel ».
10 www.youtube.com/watch?v=QlGkqoNbiYQ Des grenades en question, 22 mai 2018, www.dailymotion.com/video/x6k6m3c
11 https://encommun.eco ; conf de presse du 17 janvier 2019 : https://vimeo.com/314732719 ; Voir Prise de terre(s), Notre-Dame-des-Landes, été 2019, https://lundi.am/ZAD ; https://lundi.am/Considerations-sur-la-victoire-et-ses-consequences-depuis-la-zad-de-Notre-Dame
12 « Rites de passage », Zadibao no 2, https://zadibao.net/2018/07/03/rituelle ; Nidala Barker au Taslu, 23 juin 2018, https://vimeo.com/314743651