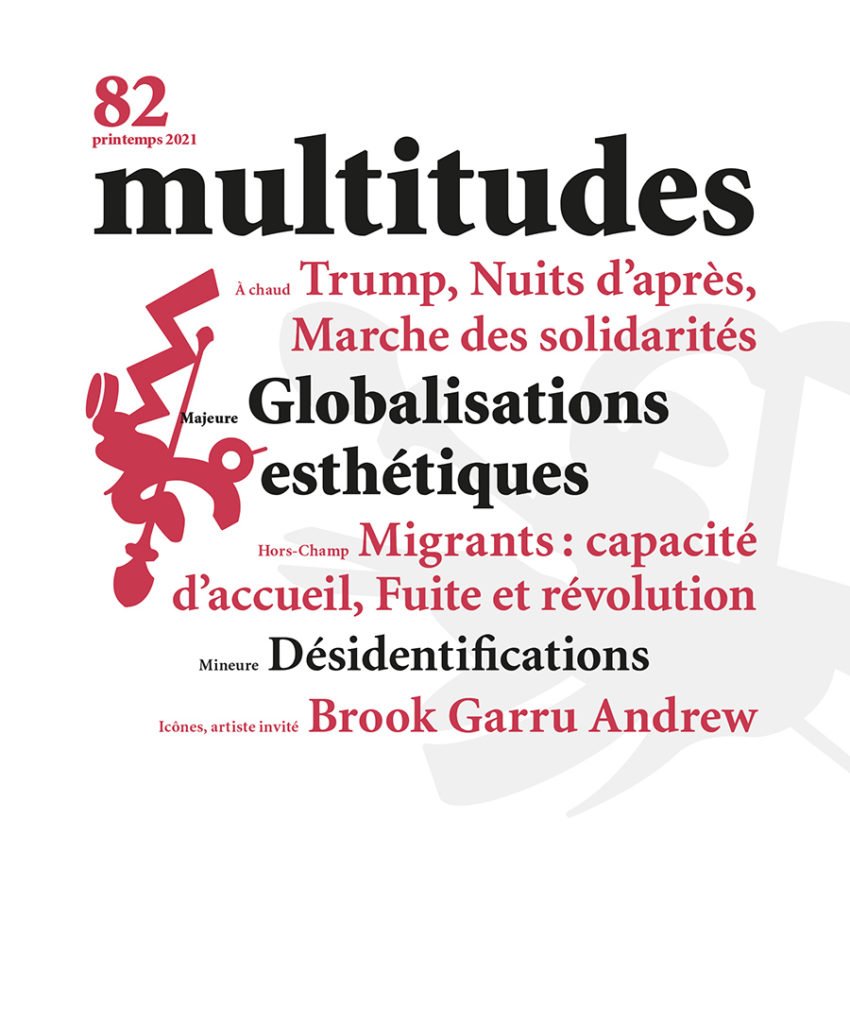Je serre ma conscience contre toi :
– Tu es un, monde, où je est plusieurs1.
– La personne perd en général2.
– L’être vu par autrui est la vérité du voir autrui3.
– Je suis plusieurs4.
– Nous sommes tous des groupuscules5.
– Le moi est une foule6.
– Nous disons « nous » « plutôt que “je”7 ».
– Être soi, c’est être seul avec soi, donc c’est toujours être deux8.
– On n’est jamais tout seul dans sa peau9.
– Ne me dites pas que je suis parmi vous si vous ne voulez pas que je me sente complètement moi.
– Vous interprétez10.
– Tout le temps qui nous reste finit par me démultiplier, tout en me pressant comme si ce n’était pas eux.
– Je me liquéfie, je me mélange, je socialise en abondance. Je n’ai jamais su combien on était au juste11.
Nous nous manifestons, nous existons, « nous nous sommes faits de la destruction par ensevelissons-nous12 », nous décidons d’expérimenter lequel de nous nous réussira le mieux à produire du bon nous.
Expérience
Lorsque je me dis intérieurement « Nous sommes merveilleux » et tout haut, à ceux qui m’estiment, « On est vraiment nul » (de sorte à activer, en même temps que mon réconfort intérieur, leur consolation) ou lorsque je me dis intérieurement « On est complètement nul » et tout haut à ceux qui m’estiment moins « Nous sommes merveilleux » (de manière à activer en même temps que ma dépréciation, leur ironie) ; dans les deux cas, je fais preuve d’une souplesse qui me rend totalement opaque à tous ceux qui pensent qu’on dit ce qu’on se dit et qu’on se dit ce qu’on dit – voire même, précise le plus coquet d’entre moi, qu’on pense ce qu’on se dit et qu’on dit ce qu’on pense. Et qu’il suffirait ainsi de changer l’un pour transformer l’autre. Mais surtout je me rends compte par la même occasion que ce que je me dis n’a pas toujours pour fonction de dire quoi que ce soit, de nous décrire, nous déprécier ou survendre. Mais parfois simplement, de délimiter « toi » et « moi », « moi » en l’occurrence étant a minima celui qui peut entendre simultanément « on est nul et merveilleux » et toi celui qui n’entendra que l’un ou l’autre. Quitte à ce qu’à son tour, précise le coquet, il puisse penser que, disant l’un « je » se pense l’autre, mais sans voir si « je » se ment à lui-même ou qu’à « toi », ni lequel de ces mensonges produira le meilleur nous.
(expérience validée)
Résultats
« La forme du déterminable fait que le nous déterminé se représente la détermination comme un autre13. » Nous ne sommes pas au bout de ta peine.
Si elle nous rend globalement plus ignorants, cette indétermination reste non seulement le fruit de ma complaisance, mais en plus l’éclat de ton ignorance. Qui sont ceux qui croient qu’il faut continuer à faire la différence entre nous et d’autres nous qui se veulent plus serrés qu’un je « à la fois accru et de contours vagues14 » ?
Le « nous » des belles âmes s’auto-affecte par détour et, pour preuve15, se montre pseudo-miséricordieux. Nous ne cachons pas que nous supposons qu’il existe de mauvais « nous » = de faux « nous » = le « je » des belles âmes qui, s’excitant toutes seules devant leurs miroirs, se fantasment plurielles. Nous savons que nous sommes un peu sentencieux, mais elles le méritent. D’autant que, pour se définir si belles, elles redoublent d’efforts émotionnels jusqu’à ce que l’intensité toute singulière de leurs affects suffise à l’image. Complicité curieuse entre les belles âmes et leurs miroirs « qui s’autorise [nt] à parler pour chacun.16 » Elles nous cherchent. Et c’est leur rendre hommage que de les critiquer avec pompe.
« Je est un autre. » demande beaucoup de soin envers l’autre que « je » est par la force d’oublier qui j’aurais pu être. Pourquoi, quand une belle âme dit « Je est un autre. », suppose-t-elle que tel ou tel autre est nécessairement bienveillant ou généreux ou intéressant ou positif ? Et pourquoi tous les autres que nous pourrions devenir s’entendraient ?
Cette façon de dire « Je » cristallise une inextériorisation rassembleuse. « Je est un autre » devient un outil pour que tous les autres que je suis, donnent de la richesse très concrète à ceux que je ne suis pas (ou pas tout de suite ou pas encore…) et que, parfois, on me promet que je redeviendrai. Autrement dit, son ambition – on ne sait plus de qui, c’est normal – est de faire passer l’inextériorisation pour plus intense que toute ré-intériorisation ou l’extériorisation pour moins dialogique qu’elle n’est.
Pour que tous les autres s’entendent bien, la culture psychique nous dit que tous ces autres partagent l’intérêt général de leur développement personnel, parlant d’« une seule et même voix pour tout le multiple aux mille voies17 » all shopping and over-working included. Ainsi, la déraison poétique réduite à un exercice d’auto-coaching : ce qui revient à faire dire à Arthur18 que l’autre qu’il est s’avère mieux que lui. Alors qu’en figure contre-psychique, Ferdinand sent bien que ça peut se gâter, en disant à son futur moi : « Ferdinand dans dix ans, j’ai pas beaucoup de sympathie pour toi en fait. Toute ton enfance est derrière toi. J’espère que t’as pas abandonné tous tes combats19 ».
Point sur la situation actuelle
La culture psychique se globalise. Que nous soyons « nés d’un œuf, d’une matrice, de l’humidité ou spontanément20 », nous participons à l’entreprise qui nous explique ce que nous sommes. Elle nous sollicite. Et quand, re-décentrés, nous voudrions moins reconnaître autrui que de nous « faire reconnaître par21 » lui, quand nous croyons ainsi nous en sortir, nous peaufinons nos méthodes de bonne conduite : je dois écouter la voix intérieure que nous entendons puisqu’« elle seule me révèle notre vérité.22 » Mais, en bon auto-embobineur, je dois aussi « tagueuliser cette petite voix de merde23 » puisqu’elle féconde, en la révélant, la merde.
Un « nous » peut flotter pour faussement échapper au grumelage de ses « je » (serait-ce un « nous » qui essaye d’en sortir24 ou qui matche25 ?). La prononciation du « nous » prend le pas sur les limites de son refus ou de ses adhésions. Quel que soit le mouvement, il vient à « faire écran et bouclier », à « filtrer ses rapports26 ». Bref, on a un gros problème de pronom, remarque un embobineur. Si le problème a une solution, alors il est inutile de s’en inquiéter. S’il n’en a pas, s’en inquiéter n’y changera rien27, prévient le facilitateur. L’embobineur nuance : quand on s’inquiète, c’est qu’on te veut de gros problèmes. Mais comme il n’y a pas de problème sans solution, c’est pour préserver ton problème qu’on ne veut pas de solution. Dans l’espoir de le garder entre nous, j’appelle une nouvelle inquiétude de tes vœux : comment mal poser le problème pour partager toutes ses complications entre nous et nous ?
Atelier « we-design »
Le facilitateur énonce l’objectif de l’atelier : comment garder ses pensées pour soi sans en faire un drame, sans être trop soi ?
Une belle âme dit : plus nous seront reliées, plus nous serons belles ; plus nos liens seront intenses, plus nous brillerons. C’est pourquoi la belle âme trouve que tout chieur bien caressé peut devenir un miroir de vérité.
Sur ce, un facilitateur se permet de proposer un point de lexique : il est sans doute intéressant de distinguer le we design du design du nous. Quand on pense « we design », on pense au « nous » avant de penser au design. (C’est, précise un autre facilitateur en prenant soin de laisser sa phrase en suspens, toute la subtilité de la langue française d’entendre « oui » dans « we »…) Alors qu’en parlant d’un « design du nous », on voit bien que le nous vient après.
Les Anglo-Saxons ne pensent pas comme nous. Ils ont raison de penser différemment, alors que nous avons tort de ne pas penser comme eux. C’est pourtant bien nous qui avons le plus conscience qu’ils ont raison de ne pas penser comme nous et qu’ils ont donc tort de ne pas s’en rendre compte. (Au fond, précise le facilitateur, on se complète assez bien tout le temps où ne s’entend toujours pas, ça crée des ouvertures…)
La belle âme demande : n’est-ce pas un peu réducteur, quand même ? Puisqu’on est entre nous, autant dire les choses franchement. C’est pas parce qu’ils ne pensent pas comme nous, qu’ils ont raison de ne pas penser comme nous. Ceux qui parmi nous sont les mieux disposés à penser comme eux ont sans doute raison de presque plus penser comme nous qui faisons bien de nous soucier de faire la synthèse.
Le coquet bavard s’emporte : bien loin de moi l’idée de vouloir la ramener avec Kleist28 et des Forêts29, mais il existe malgré tout une certaine complaisance à nourrir la passion du débat dans le vide comme mode de célébration du monde entier à travers nos seuls différends toujours différanciants. Je voudrais pas tomber dans une hétérophilie qui reviendrait à valider un principe de non-commutativité des nous, mais reconnaissez que la représentation hyper-réalisante des communautés décomptées sur des critères globalisés, sont limite limit.
Peter Sloterdijk en personne intervient : à propos de limites, « Le trait fondamental de la technique de solitude réside, dans “l’autodédoublement” du contemplant. Elle fournit un stratagème indispensable pour tous les exerçants à mi-parcours : elle leur montre un procédé permettant, après le retrait hors du monde, de se trouver en bonne compagnie, ou du moins en meilleure compagnie que celle dont disposerait le retiré s’il restait seul avec soi-même sans s’être dédoublé30. »
Au contraire, le facilitateur préfère toujours nier les faits dont on est train de débattre en détournant l’attention vers les vétilles hyper-esthétisées des forces d’un monde à uploader : « vous trouvez pas que le Christ est un bon exemple de prise de risque ? »
À quoi, une belle âme répond : « Quel formidable exemple de résilience ! S’il y en a bien un qui a réussi à surmonter son échec… »
Le coquet bavard s’emporte une seconde fois, et hurle : « Est-ce que ça signifie pour autant qu’on doive tous surmonter ses échecs ? Et s’en créer tout spécialement pour les surmonter ? Vous vous rendez compte : j’ai des potes qui sont devenus alcooliques pour célébrer à chaque caisse qu’ils arrivent pas à s’en remettre. Tu parles d’un exemple ! »
En coulisses, pendant ce temps…
Quelqu’un comme toi ne devrait pas garder toute sa conscience pour lui.
Tu sais, personne ne sait vraiment jusqu’où ma conscience ira.
Quelle heure est-il ?
Plus tard que tu ne penses, et à propos, j’ai retrouvé nos clefs.
Tu te félicites que ta conscience change plus vite que toi.
Tu me dois bien ça : il n’y aura rien entre nous qui ne se fera pour toi sans eux.
Exercice d’entre-soi
Tu parles, donc tu penses. Je pense, donc qui êtes-vous ? Tu saisis ta chose pensante, sans la dire, sans la visualiser. Tu vas chercher à vérifier que tu as bien pensé : à savoir, quelque chose de toi, serait mieux exprimé en effet par ces termes, donc il y a en toi quelque chose qui pense. Tu entends bien que tu te dis quelque chose. Tu affirmes la réalité de celui de toi à qui tu as parlé comme extérieur à celui qui a pris la parole en toi. Pourrais-tu dire que c’est toi que l’idée interpelle quand tu nous conçois comme résonnant précisément où ton moi n’est pas ? Le moi qui attribue la pensée au contretemps ponctuel de l’idée, n’est pas celui qui affirme qu’il ne sait plus ce qu’il pensait au moment où il l’a entendue. Cela fait du monde.
Méditation de l’aube
Moi, par exemple, si j’arrive à être un peu plus parmi vous, je risque de mimer vos comportements, de ne plus me reconnaître, de ne plus être moi.
C’est le prix pour faire apparaître la chance de ne plus savoir qui s’agite comme ça. Heureusement, si je pousse encore plus loin le bel égard d’être quelqu’un d’autre parmi nous, je ne me prive pas de répondre à l’incitation d’être activement personne, pourtant hyperconnecté au noyau nôtre.
C’est pourquoi « nous nous préférons aux autres animaux31 », chacun d’entre nous est plus ou moins partie prenante.
Moi, par exemple, t’étant bien occupé de nous, ils sont beaucoup mieux moins moi32 que toi33, mais vous aussi34. Je suis désolé.
« Ce serait extravagance de supposer35 » que nous débordons l’exercice d’exclusion de ce que nous ne voulons garder de nous-mêmes. On te voit venir, on te suit.
Et c’est en plus un plaisir de renouer avec « certains insensés, de qui le cerveau est tellement troublé36 ».
Réunion du matin
Quand on fait une réunion publique, c’est d’abord pour pinailler entre nous sous prétexte de communication vers l’extérieur. Cela contribue à notre notoriété, et nous enfonçons dans le « bourbier des arguties37 ».
Il y a chez nous, paraît-il, certains facilitateurs qui veulent faire passer notre notoriété pour du serrage de coude. Comme si le seul passage d’un nous de majesté à un nous de modestie, pouvait suffire à porter une prophétie. « OK, on va faire une réunion.38 »
Qu’en est-il en 2020 ?
Les deux décennies qui désormais nous séparent tout juste du non-bug de l’an 2000 ont été marquées par un boom de la standardisation psychique mondiale. Exemples facilitateurs : la nouvelle responsable Sourire est-elle elle-même épanouie39 ? ; est-ce que ma soirée team building du jeudi fait partie des 35h40 ? ; es-tu sûr que ton ancien moi est vraiment moins trans-subjectif41 ? ; on rachète quelques sandwichs pour donner à manger à poubellator42 ? ; que pouvons-nous faire cet été pour bien designer nos skills43 ?
Le globe est recouvert d’incubateurs mentaux : thalasso rebirth à Phnom-Pen, stage de psy-mapping DIY au Mali, nuit poésie courageuse en plein air, mots-clés performatifs44 de Hawaï45 ou autre n’importe où. Les pôles dits rhizomatiques s’aimantent et font penser que notre recharge est ailleurs et que le partout est une ressource. Nous commençons à connaître les paramètres qui nous décrivent « avec une précision qui est46 » inférieure à ce qu’on voudrait. Mais les aimants se tiennent dans la contradiction magnétique des pôles.
1 Paul Valéry.
3 Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1943.
4 Friedrich Nietzsche.
5 Felix Guattari, Psychanalyse et transversalité. Essai d’analyse institutionnelle, Paris, François Maspero, 1972.
6 Jean-Paul Sartre.
7 Règles du jeu du « Bloc ». URL : www.1110111.org/articles/bloc
8 Paul Valéry, Cahiers, t. 2, Paris, Gallimard, 1974, p. 248.
9 Henri Michaux.
10 Bingo du troll. URL : https://troll.framasoft.org
11 Henri Michaux, « qui je fus », 1927, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2000, p. 93.
12 Christophe Tarkos, « Le monde magique », in L’Enregistré, Paris, P.O.L, 2014, p. 303.
13 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, éditions de Minuit, 1993, p. 44. (c’est nous qui, à la place de je, avons mis nous et « comme chacun de nous était plusieurs »…)
14 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 35.
15 Pour les besoins de l’exposition de sa grande âme, le jeu déclaratif du Moi passe alors par un élargissement à l’absurde des causes et connexions logiques recouvertes, presque indicibles.
16 Jacques Derrida, Sauf le nom, Paris, Galilée, 1993, p. 76.
17 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 388-389.
19 « Cher Futur Moi #4 Ferdinand », URL : https://frama.link/ferdinand
20 Bouddha, Le Sûtra du Diamant. Soutra de la parfaite sagesse, in Le Silence foudroyant, Paris, Albin Michel, 1997, chap. 3.
21 Julia de Funès, Développement (im)personnel, Paris, Éditions de l’Observatoire/Humensis 2019, chapitre 2 « Symptômes ».
22 « Écouter sa voie intérieure », URL : https://frama.link/chut
23 « Change ton langage intérieur », URL : https://frama.link/disdonc
24 « Les individualités du collectif se reconnaissent dans une démarche commune. » (Le Manifeste des Tiers Lieux, URL : https://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux)
25 « Cette communauté façonne l’âme du Coworking et l’espace en lui-même. Un Coworking sans communauté n’existe pas. […] L’adage qui résume le mieux cette dimension du Coworking est sûrement “Quand je veux, où je veux, avec qui je veux”. Dans un Coworking on travaille comme bon nous semble, à notre rythme. Vous choisissez où vous désirez travailler, si vous voulez travailler seul ou accompagné, vous êtes maître de votre emploi du temps. » (URL : http://lamaisonducoworking.fr/blog/les-fondements-d-un-espace-de-coworking/) [c’est nous qui soulignons]
26 Alain Damasio et Benjamin Mayet, Le Dehors de toute chose, Éditions la Volte, 2016.
27 Proverbe tibétain. URL : www.printempsdeloptimisme.com/ (Incubateur d’énergies positives)
28 Heinrich von Kleist, « De l’élaboration progressive des idées par la parole », traduction, 1 001 Nuits, Paris.
29 Louis-René des Forêts, Le Bavard, Gallimard, Paris, 1946.
30 Peter Sloterdijk, Tu dois changer la vie, Paris, Seuil, 2015, p. 333.
31 Michel de Montaigne, Essais, Livre II, Chapitre XII, Paris, Firmin Didot Frères, 1838, p. 245.
32 Michel Foucault, Dire vrai sur soi-même, Paris, Vrin, 2017.
33 Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1997.
34 Oscar Wilde et Sacha Guitry, Passim.
35 Michel Foucault, Histoire de la folie, Paris, Gallimard, 1972, p. 58.
36 René Descartes, Méditations Métaphysiques, Paris, La Veuve Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1647, p. 9.
37 Erik C. W. Krabbe et Jan Albert van Laar, « Dans le bourbier des arguties », Pinailler. Entre souci de précision et bavardage, revue Sens Public nos 23-24, septembre 2019, Lyon, p. 1 sq.
38 « Message à Caractère Informatif Deux : La Réunion de l’Angoisse », URL : https://frama.link/reu
39 Cf. Edgar Cabanas et Eva Ilouz, Happycratie, Paris, éditions Premier Parallèle, 2018.
40 Cf. offres d’emploi LinkedIn.
41 Juliette Salabert, « Entre Narcisse et Echo. », dossier « À tu et à toi », TRANS – Revue de littérature générale et comparée 8 | 2009. URL : https://frama.link/polymono
42 Nudge in Ouigo, cf. Abad Ain Al-Shams, « Le nudge. Embarras du choix & paternalisme libertarien », dossier « Quand le néo-libéralisme court-circuite nos choix », Multitudes no 68, Paris, automne 2017, p. 44-53.
43 Cf. tous les départements de lifestyle design, professional way managing, biographical incubator, soft skills uberisation, existentialing hub, relationship multiplicator… in business school, coaching unit, creative and fiction thinking club…
44 Exemple : désolé, pardon, merci, je t’aime.
45 Cher lecteur, sens-toi libre de remplacer les régions qui ne correspondent pas à ta perception du globe. Nous t’invitons à ne pas t’arrêter sur la terminologie employée pour aller sur notre planète. (cf. Maria-Elisa Hurtado-Graciet, Petit cahier d’exercices pour pratiquer Ho’oponopono, Saint-Julien-en-Genevois, Editions Jouvence, 2016, p. 3)
46 Aurélien Barrau, « Des trous noirs au multivers », URL : https://frama.link/multivers