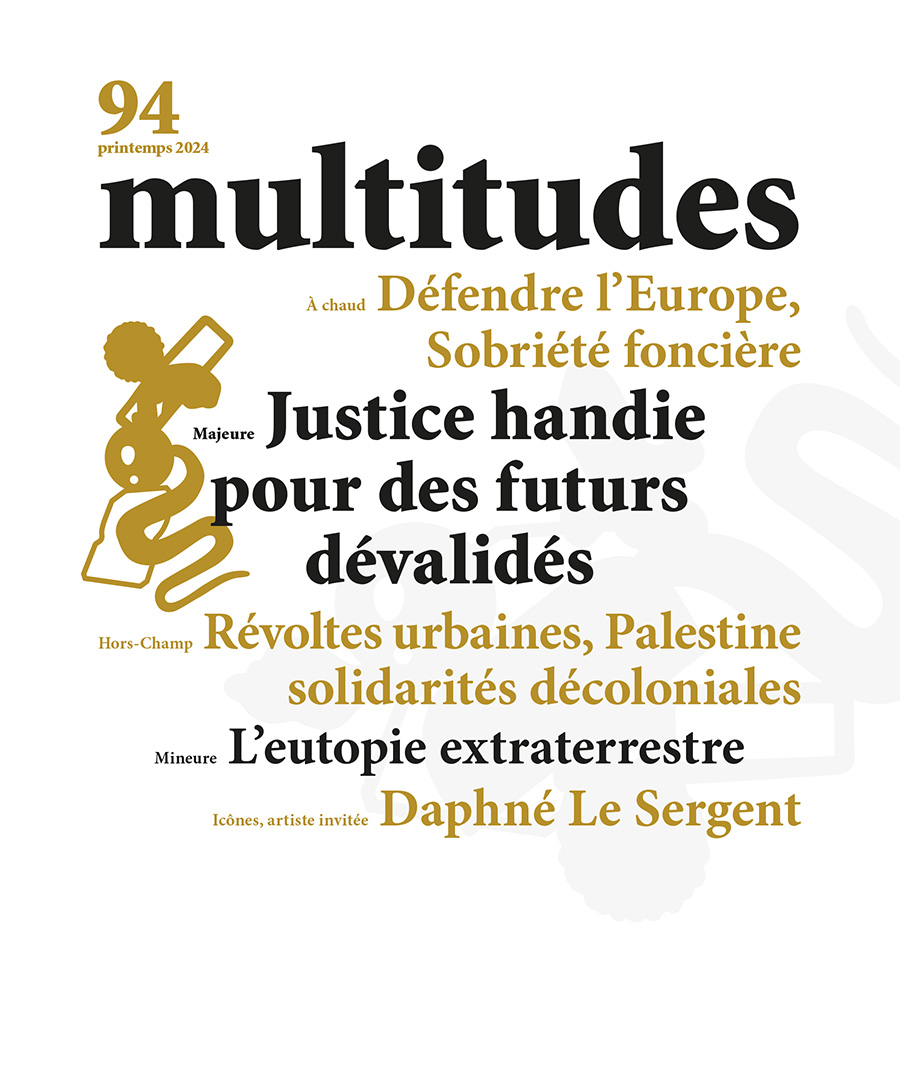Jemma attend sur le quai l’arrivée du train de son fils quand un passant attrape son fauteuil roulant et, malgré ses protestations, l’embarque dans un autre train en lui disant que tout ira bien. Le passant repart, fier d’avoir fait son devoir civique, alors que Jemma se retrouvera seule, en larmes, dans une autre ville.
Amy, malvoyante, partage son expérience quotidienne d’être attrapée par des passants voulant l’aider, qui la traînent ou la poussent au milieu de la rue, la mettant en danger, parfois jusqu’à la blesser physiquement. Quand elle raconte ces histoires, on lui rétorque systématiquement qu’il ne faut pas s’énerver ou leur en vouloir, car ils agissent avec bienveillance.
Ces deux anecdotes sont tirées du projet « Private places, public spaces » [lieux privés, espaces publics] de Hannah Mason-Bish et Amy Kavanagh, qui cherche à illustrer « la manière dont les femmes et les personnes non-binaires [perçues comme] handicapées font l’expérience de touchers non-consensuels1 ». Dans de nombreux témoignages de cette collection, la violence est amplifiée par la fierté et l’assurance des personnes responsables. Non seulement le corps handicapé est manipulé par des inconnus, mais cette action semble aller de soi.
Cet article examine la manière dont le corps handicapé est perçu comme un corps public, en deux sens au moins. 1° En un premier sens, j’examine comment, dès qu’il se trouve dans l’espace public, le corps handicapé devient public à son tour : comment il ne bénéficie pas de l’anonymat du citoyen de la ville, ni même du minimum d’autonomie corporelle garantissant de ne pas être touché et manipulé par des inconnus ; comment il fait l’objet d’une gestion biopolitique constante qui contrôle non seulement ses déplacements mais même sa simple présence. 2° En un second sens, je considère comment le corps handicapé est à la fois plus visiblement dépendant des politiques publiques et plus directement opprimé et aliéné par ces dernières. Cette dépendance offre à la société un pouvoir d’autant plus grand, faisant du « problème du handicap2 » une question de société. Tout débat sur ce thème est donc récupéré par le public, sans considération d’expertise ni de proximité avec le sujet, jusqu’à enlever la possibilité aux concernés de débattre sereinement de leurs conditions matérielles et sociales.
Cet article entend ainsi montrer que sous régime validiste, les corps handicapés sont publics deux fois : individuellement, comme corps manipulables par la logistique des transports ou par la première personne qui passe ; collectivement, comme problèmes biopolitiques objets du management social.
Une anomalie à contrôler
Commençons donc par le premier aspect, et par un constat : le corps handicapé reste une anomalie dans l’espace public. Cet état de fait n’est pas fortuit et ne peut pas être simplement attribué à des problèmes d’accessibilité matérielle (même si ces problèmes sont loin d’être négligeables). En effet, le handicap dans l’époque contemporaine reste un critère majeur de contrôle social et spatial. Au-delà des populations enfermées dans des instituts spécialisés (ou dans les conditions d’exploitation sordides des ESAT3), même les personnes « libres » de leurs déplacements ne le sont pas toujours. La France n’a heureusement pas connu les ugly laws états-uniennes avec des peines de prison prononcées jusqu’en 1974 pour le « délit d’être visiblement handicapé sur la voie publique ». Il n’en reste pas moins que le corps handicapé, comme anomalie, doit être maîtrisé, sous couvert de protection ou de règles de sécurité incendie. Par exemple, la « nécessité » de garantir une faible population d’usagères handicapées (en cas d’évacuation) est un des arguments majeurs opposés à l’usage des transports publics en autonomie (et, par exemple, sans avoir à prévenir la RATP 24 h avant un trajet prévu en RER). Dans le but officiel de préserver la sécurité des usagères vulnérables, un contrôle s’établit donc dans l’espace public : les dispositifs d’accessibilité sont mis sous clé afin d’en prévenir l’usage sauvage en autonomie4. Créer une dépendance obligatoire aux services d’assistance permet non seulement de faire baisser la demande mais aussi de la rendre plus discrète : entrées secondaires, porte dérobées, loges à part dans les lieux de spectacles, ce qui a également pour conséquence d’invisibiliser les corps hors normes.
Les aspects matériels et les règles institutionnelles sont les éléments les plus visibles du contrôle spatial des corps handicapés. Cela ne forme cependant que la première partie du contrôle, la deuxième venant directement des autres usagers de l’espace public. Les nombreux obstacles font que les corps handicapés y sont rares, ce qui renforce leur statut d’anomalie. Par conséquence, la simple présence d’une personne visiblement handicapée dans un lieu public est parfois perçue comme une situation d’urgence et de détresse. Cette détresse imaginée fournit une « bonne » raison non seulement d’aider la personne mais aussi d’ignorer ses protestations. Pour l’aidant potentiel, convaincu de la bienveillance évidente de sa démarche, les personnes qui refusent l’aide ne peuvent être motivées que par la gêne (« non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas de vous aider »), plutôt que par une absence de besoin ou une peur d’être mal aidée par une personne inexperte.
Au lieu d’être interprété comme une revendication légitime de son autonomie, le refus d’aide risque donc d’être perçu comme une remise en question de la bienveillance ou de la capacité d’aider du passant. Dans les mots de Lisa, autre contributrice du projet « Private places, public spaces » : « Une femme a essayé de retirer ma main de la barre du métro et de m’entraîner vers un siège, sans m’adresser la parole ni essayer d’obtenir mon consentement. Quand je lui ai dit que ce n’était pas correct de m’attraper comme ça, elle s’est fâchée et s’est mise à engueuler tout le wagon. » Cette habitude de fournir une aide non sollicitée force la victime à choisir entre défendre son autonomie ou risquer des violences. Elle renforce surtout l’aliénation dans l’espace public et en fait un espace encore plus hostile où simplement exister n’est pas légitime, où avoir un corps divergent est automatiquement considéré comme un état de détresse.
Tu es assise dans ton fauteuil roulant en face d’un bâtiment à essayer de passer un coup de fil. C’est peine perdue. Certaines personnes te poussent ou s’appuient sur ton fauteuil (il est bien connu que les handicapéEs n’ont pas d’espace personnel 5). D’autres t’interrompent pour te demander si tu as besoin d’aide (pour entrer ou juste comme ça). Peut-être qu’on te demande poliment, respectueusement 6 : cela n’empêche rien ; ta simple présence justifie qu’on interrompe ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire peut être interrompu sans conséquence. Avec l’excuse d’une bienveillance évidente, l’interruption peut prendre les formes les plus intrusives. Le corps handicapé étant une anomalie rompant les normes sociales, tous les sujets de conversation sont permis, surtout les plus intimes. S’ensuivent les questions invasives comme l’omniprésent « vous avez quoi ? », parfois décliné dans sa variante « oh vous avez la même maladie que ma cousine » (y compris quand le seul indice est la présence d’un fauteuil ou d’une prothèse).
Comme dit par la rappeuse américaine crip Kalyn Rose Heffernan du groupe Wheelchair Sports Camp « À genoux ils me questionnent à l’infini, veulent connaître mon espérance de vie ». L’oubli des normes sociales et l’absence de filtre qui l’accompagne prennent parfois des proportions surprenantes, notamment dans un contexte où le corps handicapé est désexualisé (on n’imagine pas qu’il peut avoir une sexualité) voire dégenré (on n’arrive pas à lui attribuer un genre). Pour un exemple tiré de l’expérience personnelle de l’autrice, qui faisait une sortie romantique chez un grand chocolatier parisien, la première phrase prononcée par la vendeuse après « bonjour » fut « vous faites comment ? », portant explicitement sur la vie sexuelle du couple.
Ces interruptions fréquentes7 qui exposent ce qui relève de la sphère privée rendent l’espace public moins accueillant, sans nécessairement créer une hostilité directe. Un autre comportement crée cependant cette hostilité : la « vérification » du statut d’handicapé. Les personnes handicapées sont considérées comme ayant des privilèges et des droits supplémentaires − plus ou moins mérités − pour leur permettre de (sur)vivre. Ces privilèges ont un coût pour la société, menant à la peur très commune que des personnes abusent de ces systèmes en se faisant passer pour handicapées. Devant une inaction perçue des pouvoirs publics, de nombreuses personnes se font un devoir personnel d’empêcher ces abus, ce qui se traduit par le harcèlement public des personnes ne correspondant pas aux images les plus communes du handicap. Seront ainsi attaquées les jeunes utilisant cannes ou fauteuil (car on ne peut pas être déjà handicapé à cet âge sans être visiblement difforme). Quelqu’un qui alterne entre utilisation de fauteuil et de béquilles (à cause de problèmes d’équilibre par exemple) sera accusé d’exagérer son handicap. Un jeune sur un scooter électrique PMR [pour « personnes à mobilité réduite »] sera soupçonné de l’avoir volé pour s’amuser. Même avoir une carte officielle ne protège pas : il n’est pas rare d’être accusé d’en avoir une fausse. La focalisation ici sur les handicaps physiques est volontaire : même ceux dont les handicaps sont visibles et tangibles sont ciblés par ce harcèlement − et les conditions ne sont pas meilleures pour les personnes dont le handicap est invisible. Le mythe du « faux handicapé » donne ainsi une occasion rêvée de faire preuve d’une colère juste et d’une violence légitime, de pouvoir se défouler en public tout en faisant une bonne action. La chasse aux faux handicapés sert ainsi d’excuse pour des violences, au profit des valides8.
Biopolitiques validistes et eugénisme
Le discours sur le handicap n’est que rarement produit par les personnes concernées. C’est notamment le cas en France où les associations gestionnaires qui s’occupent des handicapés jouent un rôle majeur dans la circulation des représentations concernant le handicap9. Ces associations, comme beaucoup d’ONGs, privilégient souvent des discours liés à la pitié, censément plus efficaces pour recueillir des dons, avec pour conséquence délétère de ne présenter les personnes handicapées que comme « objets » (de la générosité) et rarement comme « sujets » (de droits)10. De plus, certaines méthodes visant à normaliser le handicap peuvent avoir l’effet inverse, en particulier les « simulations de handicap », souvent organisées par des valides et dans lesquelles les participants utilisent une canne blanche ou un fauteuil roulant pendant un quart d’heure pour « voir ce que ça fait »11. Ces représentations bienveillantes mais mal avisées sont surtout malvenues parce qu’elles prennent une place importante dans le discours alors que peu sont familiers du sujet malgré son impact12.
Elles sont cependant loin d’être les plus nocives. L’État, investi non seulement du droit de « faire mourir ou laisser vivre » mais encore du devoir de « faire vivre » sa population (politiques de santé et d’hygiène, contrôle de la natalité…) emploie souvent l’image du handicap comme un spectre, notamment comme punition pour les comportements à risque. On peut par exemple penser à une campagne publicitaire où des tables de brasserie étaient illustrées de manière à donner l’impression que la personne assise à table est en fauteuil, en prévenant que c’était son destin si elle buvait au volant. Cette menace n’est pas anodine : il est fréquent d’entendre que le handicap est un sort pire que la mort13. La menace de handicap fonctionne ainsi comme un épouvantail, notamment dans des considérations eugénistes : attention à l’alcool et la cigarette qui mènent à des enfants défectueux. Et s’il n’est plus acceptable d’eugéniser les personnes déjà nées, on peut contrôler leurs corps, les stériliser de force ou au moins décourager l’handiparentalité14.
Anti-validisme, anti-sexisme et présences crip
La situation du corps handicapé a souvent été comparée à celle des corps subissant le sexisme, avec beaucoup de mécanismes communs tournant autour du déni de l’autonomie corporelle et de l’infantilisation. Ainsi pour de nombreuses personnes handicapées/sexisées, la meilleure manière d’éviter le harcèlement de rue (tout en restant dans la rue) est d’être accompagnées (par un homme/par un valide). Il y a cependant des différences majeures entre les luttes sociales correspondantes, notamment autour d’une question
fondamentale. La plupart des mouvements qui cherchent à lutter pour l’égalité d’un groupe opprimé le font en remettant en question la catégorisation arbitraire et en annonçant l’égalité des différentes catégories.
Or ce discours d’égalité radicale, qui est devenu plus fréquent dans les luttes contre le sexisme, le racisme ou la queerphobie, reste rare sur les questions de handicap, où il reste perçu comme un marqueur de déficience voire d’infériorité ontologique, justifiant tantôt l’assistance (consentie ou pas), tantôt l’éradication. Il y a à peine vingt ans, Harriet McBryde Johnson, militante nord-américaine, relatait ainsi son débat avec le philosophe utilitariste Peter Singer : « Il insiste sur le fait qu’il ne veut pas me tuer. Il pense simplement que, toutes choses étant égales par ailleurs, il aurait été mieux que mes parents aient eu le choix de tuer le bébé que j’étais, et que d’autres parents aient le choix de tuer des bébés similaires, afin d’éviter la souffrance liée aux existences comme la mienne tout en satisfaisant la préférence des parents pour un autre type d’enfant15. » Présenter le corps handicapé comme inférieur justifie ainsi un état perpétuel de dette : tout corps handicapé est redevable du coût qu’il impose au reste de la société16. L’équilibre entre intérêt sociétal et liberté individuelle est trouvé en accordant un minimum vital mais en exigeant une déférence particulière et un contrôle accru sur ces corps qui « coûtent si cher17 ».
Comment, étant donné cet antagonisme généralisé à l’égard des corps handicapés, survivre à l’espace public ? Comme pour d’autres identités discriminées, la question du passing se pose, parfois quotidiennement, qui prend la forme tantôt d’une adoption des clichés du handicap, tantôt au contraire d’un effacement de ses signes extérieurs. La première accentue le pathos, la dépendance, le besoin d’aide, suivant la représentation hégémonique diffusée par les associations caritatives. Une personne utilisant un fauteuil roulant hésitera donc à faire le moindre effort physique en public (comme se lever pour attraper un objet en hauteur) pour ne pas briser cette image (ce qui l’exposerait aux violences mentionnées plus haut). Dans la deuxième version, il faut au contraire être un exemple qui arrive à « dépasser » son handicap (par la pratique sportive notamment), jusqu’à ne plus se revendiquer handicapé. Il devient alors impossible de demander la moindre aide ou le moindre aménagement (sans quoi on risque de détruire cette image et d’être durablement traité avec la pitié et l’infantilisation du premier modèle).
À ce choix binaire entre héroïsme et pathétisme s’oppose enfin une riposte crip qui confronte le public au statut d’anomalie du corps handicapé. Cette riposte a parfois un pan humoristique, de la canne blanche de cinq mètres de long de l’artiste Carmen Papalia, aux prothèses de pied sur lesquelles sont collés des yeux en plastique, laissant le spectateur se rendre compte qu’il les fixe du regard (notamment utilisées par Ashley Shew). Elle peut aussi être plus revendicative, plus punk, fière de sa différence et souvent de sa sexualité : Connie Panzarino manifestant avec une pancarte déclarant « les gouines avec une trachéo[tomie] broutent des chattes sans pause pour respirer », ou Bob Flanagan (longtemps doyen des personnes vivant avec une mucoviscidose, mort en 1996) qui focalisait ses performances artistiques sur des actes de masochisme extrême.
Plus généralement, les ripostes crip proposent de reprendre et d’inverser les outils et marqueurs de dépendance et d’infériorité. Plutôt qu’un traitement de repigmentation, le tatouage de Tiffany Posteraro revendiquant son anormalité : « It’s called Vitiligo » [ça s’appelle du vitiligo] au sein d’une zone dépigmentée mise en valeur. Plutôt qu’une population Sourde apprenant à oraliser pour le confort du public, une conférence entière en langue des signes (les non-locuteurs n’ayant qu’à amener leurs interprètes). Plutôt qu’un fauteuil que tout le monde peut attraper sans consentement, des clous plantés dans les poignées qui dissuadent toute approche, tel un blouson punk. Bref : plutôt que de subir le malaise que projette une société handiphobe sur les corps handicapés, faire insister leur présence publique jusqu’à retourner le malaise, acte de défiance et de libération.
1https://privateplacespublicspacesblog.wordpress.com ; Pourquoi utiliser ici l’expression « perçue comme handicapée » ? Parce qu’il n’est pas ici question d’une « situation de handicap », c’est-à-dire d’une inadéquation entre des réalités corporelles, un environnement matériel et des normes sociales. Au contraire, c’est le public qui impose à une personne une identité de « personne handicapée » ainsi que toutes ses connotations.
2Le « problème du handicap » est souvent inconsciemment traité comme un problème transitoire, entre des sociétés passées où les personnes concernées mourraient jeunes et des sociétés futures où la technologie permet une guérison universelle. Pour une analyse plus approfondie de la question, voir « 404 Not Found: Quantitative Methods in Disability Studies » (Blanchard, Blanchard et Shew, disponible sur koliaza.com et à paraître dans le Sage Handbook on Data and Society, 2024).
3Pour les résultats d’une longue enquête critique sur les Établissements ou Services d’Aide par le Travail, racontés par leurs « employés » (qui n’ont pas ce statut), voir Petit T., Handicap à Vendre, Les Arènes, 2023.
4Les règles les concernant sont souvent contradictoires, changées régulièrement, et mal maîtrisées par les agents d’assistance, ce qui dissuade les plaintes et pousse à obéir (ou à se voir refuser l’accès au lieu/service public).
5Voir Enka Blanchard, « Spatialités et temporalités du handicap I : des corps discrets dans un monde discret », EspacesTemps.net, 2020.
6Dans un atelier de recherche sur le handicap auquel participait l’autrice en 2019, les douze intervenants étaient arrivés au consensus qu’il était préférable de ne pas fournir ou proposer d’aide non sollicitée à une personne handicapée en public. Une exception était faite pour les cas de détresse évidente (comme une personne venant de se blesser), ce qui n’incluait justement pas les cas où la personne semble en difficulté (pour ouvrir une porte par exemple).
7Elles sont quotidiennes pour certaines personnes, mais la réclusion de nombreuses personnes handicapées leur « évite » ce problème.
8Cf. par exemple Gouge, H. (de), « À qui profite la chasse aux “faux handicapés” ? », post de blog, 21 juin 2023 ; www.harrietdegouge.fr
9Ces associations ne sont pas toujours des gestionnaires désintéressées : tout en annonçant lutter pour les droits des handicapés, APF France Handicap gère aujourd’hui un des plus grands réseaux d’ESATs. Pour une histoire de ces institutions et des luttes qui les accompagnent, voir par exemple Bas, J. « Des paralysés étudiants aux handicapés méchants », Genèses, vol. 107, 2017.
10Une des rares chercheuses ayant analysé en France le statut du handicap avec un œil critique est justement Charlotte Puiseux, ancienne égérie du Téléthon, dont l’expérience personnelle est relatée dans l’ouvrage De chair et de fer (La Découverte, 2022).
11Voir principalement Nario-Redmond, M. R.; Gospodinov, D. & Cobb, A. « Crip for a day: The unintended negative consequences of disability simulations », Rehabilitation psychology, American Psychological Association, 2017, 62, 324-333.
12Selon une étude de 2014 de H. S. Aiden et A. McCarthy, 43 % du public britannique admettait ne pas personnellement connaître de personne handicapée (alors même que celles-ci représentent autour de 20 % de la population).
13Selon un sondage étasunien de Kelton Research en 2008, une faible majorité de participants annonçait préférer mourir à perdre la capacité de vivre indépendamment. La proportion est à prendre avec un grain de sel (à cause de multiples facteurs méthodologiques), mais cela reste révélateur de la prévalence de l’idée.
14Les politiques de stérilisation forcée ont une longue histoire en Amérique du Nord où l’eugénisme anti-handicap servait aussi d’excuse pour stériliser les populations natives à grande échelle, ce qui restait pratiqué au Canada au moins jusqu’en 2018.
15McBryde Johnson, H., « Unspeakable Conversations », The New York Times, 16 février 2003.
16La peur de ce coût, principalement sur les systèmes de santé, est un motif de refus d’immigration dans beaucoup de pays (notamment le Canada qui avait jusqu’à récemment des règles particulièrement drastiques sur ce point).
17Ce minimum concerne à la fois les investissements publics et les allocations individuelles (qui sont souvent en dessous d’un revenu permettant de survivre indépendamment). Ces considérations budgétaires affectent aussi les choix de santé public : pendant la crise du COVID-19, les patients handicapés étaient considérés comme ayant la priorité minimale en cas de manque d’équipement (quasi-indépendamment de leur âge ou de leur état de santé), même si ces politiques ont été très rarement appliquées en France. cf. sur ce point www.espacestemps.net/en/articles/la-covid-au-prisme-des-minorites-vulnerables