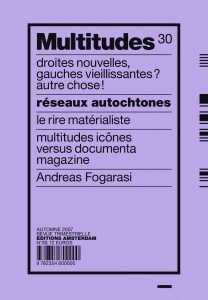“We Got to Move on”, disent les aborigènes de Palm Island
Ces dernières années, j’en suis venue à considérer les Aborigènes d’Australie comme des « réfugiés de l’intérieur », car beaucoup d’entre eux — descendants directs ou métissés de plusieurs centaines de groupes aborigènes de langues différentes — souffrent d’exil dans leur propre pays, et affichent des blessures psychiques cumulées sur des générations. Cette souffrance, qui s’accompagne souvent d’un désespoir autodestructeur notamment chez les plus jeunes, génère aussi une résistance tant par la création — succès mondial de l’art aborigène — que la lutte pour la justice. Les Aborigènes, censés disparaître dans les années 1960, ont démontré ces trente dernières années une formidable capacité d’invention de formes sociales. Comme les Indiens d’Amérique, ils se sont organisés localement, nationalement et internationalement, créant des réseaux pour partager leurs expériences. Toutefois une nouvelle vague de violence les guette, qui concerne aussi l’avenir biopolitique de la planète. Le question autochtone n’est pas un hobby de salon, ou un passe-temps de vacances exotiques : nous avons tous à en apprendre pour la survie de l’humanité.
La colonisation de l’Australie s’est étalée selon les régions entre 1788 et le milieu du XXe siècle. Certains anciens du désert central et du Kimberley, avec lesquels j’ai travaillé, ont fui des massacres dans leur enfance et furent sédentarisés de force dans les années 1950. Dès 1905, le gouvernement avait commencé à systématiquement traquer les enfants métis nés de viols de colons, ou d’histoires d’amour, notamment avec les chameliers afghans ou pakistanais guides des explorateurs britanniques qui traversaient le désert, ou les pêcheurs asiatiques importés par les maîtres perliers dans le nord de l’Australie. Les unions mixtes étant interdites, les enfants métis étaient retirés à leurs familles aborigènes pour mettre en application la politique de « blanchiment » de la population autochtone, consistant non seulement à élever ces enfants comme des Blancs, mais surtout à les marier à moins foncés qu’eux pour breed the black out, soit « sortir le noir de leur peau » et rendre ainsi invisible leur ancestralité. Les enfants de ces unions mixtes appelés par les Aborigènes du nord yellow fellas ou coloured people et par l’administration half caste ou quadroon selon le degré de métissage, ont parfois souffert d’un double rejet. Pour avoir le droit de travailler contre un salaire, on les forçait à signer un certificat d’« exemption » où ils devaient renier leur ascendance et s’engager à ne pas fréquenter leurs familles aborigènes. S’ils étaient pris en compagnie de leurs proches, leur carte était confisquée, ils étaient fichés et leurs conjoints et enfants avaient alors des difficultés pour obtenir leurs papiers. Bien sûr, ce système créa du ressentiment. Rejetés par les Blancs, les métis « exemptés » subirent souvent la suspicion des Aborigènes qui travaillaient sans toucher de salaires. Ces salaires étaient payés par leurs employeurs à l’État qui gardait les sommes et en disposait à sa guise : des Aborigènes ont récemment lancé une campagne de revendication de ces « salaires volés »[1]. La politique d’apartheid a duré jusqu’aux années 1970, et a fait l’objet d’enquêtes systématiques dans les années 1990 grâce à la Commission royale sur ce qu’on a appelé la « génération volée ». En conséquence, les descendants d’Aborigènes dont l’apparence physique ne laisse pas deviner l’ancestralité se revendiquent aujourd’hui pour la plupart comme Aborigènes au nom d’une histoire douloureuse, souvent présentée comme un génocide, qu’un mouvement révisionniste peine à contester[2]. En effet, outre l’hécatombe démographique — les 500 000 habitants autochtones estimés à l’arrivée des colons furent réduits à quelques dizaines de milliers au siècle dernier —, la politique eugéniste a cherché à effacer la mémoire de la culture en empêchant la transmission de la langue et des coutumes dans certaines missions et réserves, ou encore en déportant et séparant les familles dans des centres de détention dits de « punition », comme à Palm Island.
Les habitants de cette île située au large de Townsville sur la côte nord-est du Queensland sont les descendants des déportés de quarante tribus de langues différentes qui, entre 1918 et les années 1970, furent arrachés à leurs terres d’origine sur le continent. Le prétexte pour ces déportations punitives : ils tuaient le bétail des colons qui venaient polluer leurs sources, demandaient à être payés pour leur travail d’esclave, ou étaient nés métis ou d’un parent lépreux. Sur l’île, garçons et filles étaient séparés et punis de cachot s’ils étaient vus ensemble. Tout le monde était soumis aux travaux forcés en échange de maigres rations. En 1957, une grève éclata, demandant plus de justice. Dix-huit grévistes furent exilés de l’île et dispersés dans d’autres réserves. L’île est devenue le foyer de quelque trois mille Aborigènes qui essaient de vivre en gérant leurs ressources avec des budgets toujours insuffisants. Des conflits envenimés par la bureaucratie opposent parfois les familles des anciens déportés à celles d’autres résidents originaires des îles Torres qui, ayant bénéficié de meilleures formations, ont pu trouver des emplois sur Palm Island. Il y a aussi des tensions, communes à toute l’Australie, entre ceux qui se désignent eux-mêmes comme les populations « historiques » car installés dans un lieu par l’administration et les traditional owners — minoritaires à Palm, car les familles des habitants traditionnels de l’île vivent aujourd’hui sur le continent. Du point de vue de la loi Mabo de 1993 sur la reconnaissance d’un titre foncier indigène (Native Title), seules ces familles d’origine sont officiellement reconnues comme propriétaires traditionnels de l’île, et autorisées à ce titre à décider des projets de développement. Les autres habitants ne peuvent obtenir de bail ou de titre foncier pour avoir une maison ou monter une entreprise. L’île n’a qu’un magasin — pour l’instant géré par le gouvernement, où tout coûte quatre fois plus cher que sur le continent situé à deux heures en bateau —, un bar où la vente d’alcool est limitée en heures et par personne, deux écoles, des services sociaux, un hôpital et une station de police. Le Guinness Book of Records de 1999 listait l’île Palm comme l’endroit le plus dangereux du monde en dehors des zones de guerre. De quel danger s’agit-il ? Ce n’est pas le 1 % de la population non aborigène — instituteurs, infirmiers, ouvriers — qui est en danger d’un risque quelconque, comme on s’y attendrait dans le contexte d’une histoire de conflits raciaux, religieux ou politiques. Ici, au contraire, ce sont des Aborigènes qui semblent mettre en scène l’enfer pour eux-mêmes, envers leur parentèle la plus proche, sur laquelle ils rabattent une détresse et une ivrognerie sauvage qui ravage tout, bâtiments et corps. Beaucoup d’hommes et de femmes indigènes vivant à Palm ont tenté depuis des années de changer ces conditions, mais ils ne sont pas entendus — comme dans d’autres communautés — car il est plus facile pour la police de laisser les choses dégénérer, voire d’encourager les trafics illicites d’alcool et de drogue, plutôt que d’intervenir là où ils sont attendus par la population, notamment pour faire respecter la justice sociale et combattre la discrimination raciale qui est quotidienne lorsque les Aborigènes vont en ville.
C’était encore récemment un jeu pour certains Blancs à Townsville d’accélérer leur voiture quand un Aborigène traversait la rue. Un jeune garçon fut ainsi tué en 2003 et le conducteur, non aborigène, ne fut condamné que pour conduite éthylique. Placé trois mois en prison, il passa le reste de sa peine dans une ferme. La famille de la victime a fait campagne et monté avec un cabinet d’avocats à Sydney une fondation pour la justice sociale portant le nom du jeune garçon, Errol Wyles[3]. Les Aborigènes représentent 78 % des effectifs de la prison de Townsville, 25 000 habitants, alors qu’ils sont moins de 20 % à y vivre, en majorité comme résidents installés et travaillant dans des administrations et des commerces, et d’autres en transit régulier pour leurs affaires, des soins à l’hôpital ou simplement pour y boire, car l’alcool est interdit ou limité dans diverses communautés aborigènes. Il est aussi interdit de boire en ville dans la rue. La plupart des Aborigènes sont en prison pour conduite sans permis, violence domestique ou possession illégale d’alcool.
Des centaines d’Aborigènes et de non-Aborigènes sont morts en garde à vue ou en prison depuis trente ans. D’après la Commission royale d’enquête des années 1990, un certain nombre d’entre eux ont été retrouvés pendus en cellule, d’autres sont morts sans explication. Un rapport comportant 336 recommandations rédigées par des représentants aborigènes au terme d’un long processus de rencontres intercommunautaires fut alors soumis au Parlement pour améliorer non seulement les conditions d’emprisonnement mais aussi pour trouver des solutions de prévention destinées à réduire les arrestations en prenant en compte tous les aspects de la vie des Aborigènes. Très peu de ces recommandations ont été appliquées, notamment au niveau de la police, la justice, la santé, l’éducation ou le logement[4]. En 1983, des leaders aborigènes, dont Mick Miller du North Queensland Land Council (organisation aborigène chargée des affaires foncières) m’avaient emmenée à Yarrabah, communauté qui connaissait alors un taux élevé de suicide, avec des hommes qui se coupaient les veines en lançant leurs bras à travers les lamelles en verre ou en métal des fenêtres à volets. Je fus déboussolée face à cette autodestruction car j’arrivais d’Australie centrale où j’avais partagé l’enthousiasme et l’incroyable créativité des Warlpiri du désert Tanami. Ils venaient juste de gagner leurs droits à la terre, sous la nouvelle législation du Land Rights Act 1976 qui, au terme d’un procès de deux ans, leur restituait l’usage de terres ancestrales. Aussitôt, ils s’étaient mis à installer des outstations, campements satellites sur les terres retrouvées, élisant leur propre conseil, croyant être libres de gérer leurs communautés, négociant des droits et des vetos avec des compagnies d’exploration minière à la recherche d’or, voyageant dans le monde avec leur art, enseignant à leurs enfants une culture double grâce aux programmes bilingues de l’école qui impliquaient des anciens, des rituels et des camps en brousse. Les Warlpiri et leurs voisins du désert passaient des heures à danser et chanter leurs cérémonies et voyageaient pour soutenir la résistance politique de leurs alliées distants pour s’opposer par exemple à la destruction d’un site sacré par une compagnie pétrolière à Noonkanbah. J’ai rencontré en vingt-sept ans des hommes et des femmes extraordinaires et partagé beaucoup de moments remplis de leurs espoirs pour le futur. Les Aborigènes m’ont semblé offrir des leçons à notre monde globalisé : un succès d’une mixture hybride de technologie moderne et d’un mode de vie nomade. Or, depuis le nouveau millénaire, certaines de ces communautés du désert — regroupant des locuteurs de la même langue — semblent se confronter au même type de problèmes que Palm Island, qui accueille une diaspora de quarante langues aborigènes. Comment expliquer que les Aborigènes qui sont restés entre eux et ceux qui furent dispersés puissent vivre la même désolation aujourd’hui ?
Pour répondre à cette question qui touche tous les peuples autochtones en Australie ou ailleurs, il convient, à mon avis, de se placer dans la perspective d’une anthropologie de la survie au désastre, non comme esthétique du malheur et de la « vie nue » mais comme éthique d’espoir. Le désastre, qu’il soit au départ naturel, comme le Tsunami, un tremblement de terre ou une sécheresse, technique comme l’explosion nucléaire de Tchernobyl, ou social comme une guerre, engendre toujours une réaction en chaîne qui peut durer des générations. En Australie, les effets cumulés sur deux siècles du choc colonial, de l’injustice sociale et du racisme quotidien ont produit statistiquement et émotionnellement l’équivalent d’un désastre de guerre, suivi d’un désastre naturel et technique. En effet, après les massacres et les épidémies, la terre des peuples indigènes a été détruite par l’installation des colons — mines, villes, bétail —, ne leur permettant pas de se reconnecter dans un mode de survie économique traditionnel lorsque cette terre est restituée. Les gens qui campaient en plein air, sans tente, se virent enfermés dans les maisons. Les puits à éoliennes ont rendu dépendants ceux qui vivaient au rythme de l’accès saisonnier à l’eau. Beaucoup de groupes aborigènes ont tenté pendant des années de rejeter cette logique de dépendance en refusant les cadeaux « empoisonnés » de l’assistance sociale (welfare, « bien-être » comme disent les Canadiens), le sitting-down money, l’« argent pour rester assis » qui a souvent paralysé leur champ d’action. J’ai été témoin de nombreuses situations où les gens refusaient le prix à payer pour le développement matériel. Des mères préféraient abandonner une voiture qui avait tué leur fils dans un accident plutôt que de la réparer. Les maisons de personnes décédées étaient abandonnées dans les années 1980, plutôt que d’avoir à faire face à la mémoire hantée par les fantômes. Les chasseurs-cueilleurs vivaient sans vêtements, maisons ou cumul de biens autres que ceux qu’ils pouvaient porter en se déplaçant à pied. Leur réaction aux nouveaux biens — à utiliser et jeter comme n’importe quelle ressource de l’environnement naturel — était pour beaucoup une forme de comportement protecteur à l’égard d’un certain style de vie : rester détaché pour être libre, en jouant l’argent aux cartes plutôt que de le penser dans une logique d’accumulation.
Les mesures administratives, les directives des bureaucrates et les expertises des consultants n’ont pas cessé de demander aux Aborigènes de gérer les budgets municipaux, régionaux ou fédéraux alloués selon des directives très précises. Mais lorsque les membres des conseils autochtones essayaient de créer un consensus dans la communauté pour décider comment dépenser l’argent, ces décisions étaient souvent bloquées par la bureaucratie du système, ou sa corruption interne ou externe. Avec ces dysfonctionnements, l’argent est devenu source de convoitise dans une vie qui fonctionnait sans argent. L’afflux de biens a transformé l’environnement sans donner aux gens le moyen de le réparer. La nourriture conditionnée, l’électricité et la télévision injectées de force dans les communautés ont changé le paysage en une décharge de consommation. Les forages miniers polluent et parfois assèchent les réserves d’eau de la nappe phréatique. La maladie et la faim poussent les gens à se rassembler là où il y a des services et où certains emplois sont créés pour faire marcher ces services. La surpopulation ne permet pas de satisfaire l’inflation des demandes et bloque la possibilité pour ces petites communautés reculées d’être économiquement viables, transformant les habitants en victimes (casualties) que le gouvernement recense comme des populations à problèmes qu’il faut soit enfermer, soit rendre invisibles. Comment interpréter l’autodestruction dans les communautés aborigènes qui atteint les corps, et les esprits. Serait-ce la seule manière pour certains Aborigènes de signifier leur existence ? Quel sens a toute cette souffrance corporelle et psychique que subissent ou s’infligent sous des formes nouvelles — pour nous pathologiques et criminelles — aussi bien les Aborigènes déportés de leur terre que ceux qui continuent à y vivre, dans une forme de clochardisation provoquée par la sédentarisation. Privés de tout, beaucoup d’Aborigènes n’auraient-ils rien d’autre que ce débordement de violence sur soi et leurs proches pour s’assurer de l’appartenance collective au groupe ? Lorsqu’une fille ou un garçon mineur porte plainte pour viol, les proches souvent se taisent ou défendent les inculpés de viol, comme s’ils cherchaient à défendre la loi du groupe, donnant autorité à tel ou tel tenant de la coutume qui défend les mariages arrangés avec des fillettes de douze ans ou le secret de l’initiation des garçons. S’agirait-il d’un mécanisme vicieux où la société ne pourrait plus que reproduire la même violence génération après génération, la victime violant à son tour ? Peut-être que la morale justifie ce diagnostic, mais, en pratique, raisonner de cette manière, c’est saper toute résistance aborigène, c’est nier qu’ils puissent survivre à leur souffrance, alors même qu’ils sont nombreux à vouloir et pouvoir prouver le contraire.
Des expériences sont tentées par diverses organisations aborigènes, par exemple les cercles de jugement (circle sentencing) inspirés par des procédures amérindiennes, qui se fondent sur le principe d’un shaming culturel, soit « faire honte » aux inculpés pour violences, notamment domestiques, dans le but de transformer la honte en empathie avec les siens[5]. Sur les 500 000 Aborigènes recensés, métis inclus, les anciennes réserves comme les ghettos urbains ont généré des milliers d’Aborigènes devenus célèbres pour leurs activités artistiques, culturelles, sportives, politiques ou sociales[6] Il y a des centaines de journalistes et réalisateurs, des radios et des télévisions aborigènes, des avocats, des travailleurs sociaux, soignants ou guérisseurs. Leur marche est souvent entravée par l’apartheid de la société australienne et le dysfonctionnement des communautés aborigènes, mais ils avancent avec une créativité qui n’en finit pas de nous étonner. La question est peut-être non pas de juger si la violence sur soi et les autres est ou non de la résistance politique, mais si cette violence peut être transformée en autre chose. Et il est certain que les individus qui l’ont subie, voire pratiquée, ont démontré que cette transformation est possible.
Si la violence et le désespoir font rage au point que certains anthropologues soutiennent l’idée qu’il serait mieux de fermer les communautés aborigènes, beaucoup d’Aborigènes sont contre car ils s’ancrent dans la terre pour continuer à inventer des formes sociales. Je fais confiance au pouvoir du local : dans la brousse d’Australie, dans les plaines d’Amérique, dans les glaces du Nunavut, mais aussi dans les villages ruraux de France, ainsi que dans les quartiers des banlieues ou des centres de n’importe quelle ville. La vie sociale est porteuse d’alternatives lorsque les gens s’impliquent dans leur voisinage en créant une fabrique sociale d’intérêts partagés, d’abord en agissant contre la corruption de tous les pouvoirs.
Lex Wotton est accusé d’être le ring leader de la rébellion qui a éclaté sur l’île Palm une semaine après la mort en garde à vue de Doomadgee, alias Mulrunji, arrêté le 19 novembre 2004 pour ivresse et « désordre public » : il avait chanté dans la rue en se plaignant de l’arrestation de son neveu. Moins d’une heure plus tard, Mulrunji était mort d’hémorragie interne provoquée par la rupture d’une veine, quatre côtes cassées et le foie scindé en deux. Les émeutiers furent arrêtés par une brigade spéciale d’intervention, car accusés d’avoir mis le feu aux baraques de la station de police. Il n’y avait eu aucun blessé, mais les vingt-sept personnes arrêtées pour émeute et incendie, dont la mère de Lex Wotton et un garçon de quatorze ans, furent traitées comme des terroristes pendant des mois, alors que l’officier de police responsable de l’arrestation, le Senior Sergent Chris Hurley ne fut inculpé que deux ans plus tard. Lorsque la juge Christine Clements, chargée de la commission d’enquête, déclara le policier passible d’inculpation en septembre 2006, son avis fut contesté par le procureur d’État jusqu’à ce que, suite à une campagne de protestation nationale et internationale, le premier ministre du Queensland confie le dossier à un magistrat indépendant, Sir Lawrence Street, qui, le 25 janvier 2007, considéra qu’il y avait assez de preuves pour arrêter le policier pour homicide involontaire et agression. La police protesta à nouveau et, au terme des dix jours de procès où le policier admit avoir provoqué la mort de Mulrunji par ses actes et être « tombé » sur lui, et non à côté comme dit dans sa déposition, un jury de douze personnes allait l’acquitter, le 20 juin 2007. Il serait tombé en forçant la victime à entrer au poste avant de le traîner par les bras, le laissant couché sur le sol de la cellule sous l’œil d’une caméra de surveillance qui enregistra les vingt dernières minutes de son agonie, y compris une vérification de l’état du prisonnier où le policier le poussa du « bout » du pied[7]. Au tribunal d’enquête, le policier avait reconnu que la « technique » du pied était courante, et qu’il n’avait pas tenté de ressuscitation car il ne l’avait pas pratiquée depuis des années. Le seul témoin des derniers instants de la victime dans la cellule, Patrick Bramwell, s’est suicidé avant le procès, le 17 janvier 2007, six mois après le suicide du fils de Mulrunji, âgé de seize ans lors de la mort de son père.
Interviewé par la presse et la télévision, Lex Wotton, qui a suivi le procès en attendant le sien pour émeute, a dit « Justice has a colour, and it’s white » (la justice a une couleur et elle est blanche), la communauté de Palm Island est dévastée, mais doit accepter le verdict du jury[8] . Le lendemain, alors que je l’appelais de Paris, il me dit avoir passé la nuit à réfléchir au moyen d’aider les siens à surmonter tout cela : « We’ve got to move on (on doit avancer), mes pensées sont positives, la loi est ce qu’elle est, nous avons peut-être perdu, là, mais nous allons gagner. » Il partait pour Sydney, invité à parler de Palm dans un grand forum public[9].
Un politique a proposé de résoudre la supposée « crise » de Palm Island en déplaçant toute la population vers le continent. L’île est très convoitée, tant pour son potentiel touristique que par sa position stratégique comme portail militaire du Pacifique. Les Aborigènes continuent à être malmenés et déplacés avec l’excuse de l’impératif de gestion des ressources qui suppose celle des flux humains. Après un siècle de sédentarisation dans des réserves, le gouvernement et quelques galeries d’art encouragent aujourd’hui le déplacement de nombreuses familles vers les villes[10]. Les propriétaires de galeries louent ou même achètent des maisons pour encourager le déménagement des artistes, alors que le gouvernement s’en remet au recyclage pour faire face à la crise du logement qui entasse dans de petites maisons délabrées jusqu’à vingt personnes[11]. En 2006, pour loger des Aborigènes dormant sans abri aux abords de la ville d’Alice Springs, quatre-vingts cabines furent transportées depuis le camp de Woomera dans le désert (Australie du Sud), fermé après une série de scandales sur les conditions de détention inhumaines des demandeurs d’asile qui y avaient été retenus avec leurs enfants pendant quatre ans, de 1999 à avril 2003. Les premiers Australiens ont souffert dans leur propre pays la dépossession de leurs terres et la déportation sous le prétexte gouvernemental soit de les assimiler par éradication de leurs différences en les séparant de leurs familles pour les élever comme pupilles de la nation dans des orphelinats, soit de les « protéger » (le département chargé des Aborigènes s’appelait Protection Board) en les enfermant dans des réserves d’où ils n’avaient souvent pas le droit de sortir, même pour chasser. Cette gestion schizophrène qui hésite entre assimilation et rejet de l’altérité — ici autochtone — se retrouve aujourd’hui à l’égard des étrangers. Les demandeurs d’asile arrivés en Australie avec des papiers de touristes ou clandestinement sont définis comme les « mauvais » réfugiés que l’on doit enfermer dans des centres de détention versus les « bons » qui ont été recrutés directement dans les camps du HCR à l’extérieur de l’Australie et bénéficient de divers avantages sociaux pour intégrer au plus vite la société australienne en apprenant la langue, recevant un emploi et un logement. La métamorphose des gens en nombres déshumanisés a été le sort de nombreux peuples autochtones à travers le monde, mais elle devient aussi aujourd’hui le sort des demandeurs d’asile qui, en attente d’un statut de réfugiés ou simples migrants, se trouvent sans papiers. Des milliers de camps se répandent à travers le monde à la fois comme « réserves » de travailleurs à la carte et centres de détention de potentiels « fauteurs de trouble ». Le début du XXIe siècle a consacré comme business international l’aide humanitaire gérée par quelques pouvoirs transnationaux qui se cachent souvent dans le déguisement d’une multitude d’ONG.
Les communautés aborigènes deviennent de plus en plus comme ces nouveaux camps de réfugiés. Elles sont non seulement assaillies par les consultants des très nombreuses instances du gouvernement australien mais, de plus en plus, par des pouvoirs ou des représentants du marché global : galeries et circuits de vente d’art aux enchères comme Sotheby’s, organisations des Nations unies, Amnesty International, fondations humanitaires comme Caritas, et bien sûr tout le réseau mondialisé des églises, catholiques, protestantes, mouvements charismatiques et, plus récemment (notamment via les prisons), des organisations islamiques. Le parallèle entre camps et réserves pourrait expliquer pourquoi les migrants et les Aborigènes se sont trouvés sous la bannière du même ministère en 2005. Le gouvernement procédait à une supposée « assimilation » en créant des institutions générées par l’apartheid où les gens désignés comme « autres » peuvent être soit « traités » (processed) jusqu’à ce qu’ils deviennent d’un « type » supposé correct, soit considérés comme « intraitables » et enfermés dans les centres de détention. Il n’est pas surprenant dans ce parallèle que le premier ministre John Howard ait refusé depuis des années de prononcer un pardon symbolique (sorry) à la Génération volée des Aborigènes (un enfant sur cinq fut enlevé à ses parents entre 1905 et les années 1970) autant qu’à Cornelia Rau, naturalisée australienne depuis dix-neuf ans et mère de deux enfants, retrouvée en 2005 dans un camp de détention pour réfugiés où elle avait passé dix mois en 2005 par erreur, privée de son traitement pour schizophrénie. Demander pardon aux Aborigènes pour le vol de leurs enfants ou à Cornelia Rau et aux deux cent trente Australiens retrouvés dans les camps depuis questionnerait-il la légitimité de l’État ? Amanda Vanstone, alors ministre à la fois des affaires aborigènes et de l’immigration, justifia cette position en déclarant au Parlement qu’une personne est présumée suspecte jusqu’à ce que son innocence soit prouvée. Renversement kafkaïen du système de justice démocratique auquel nous avons été habitués en Europe. Mais ne serait-ce pas plutôt, comme disent les Aborigènes, qu’il y a une justice pour les Blancs — les policiers jusque-là toujours innocents des violences commises — et une pour les Autres[12] ?
Post-scriptum
15 En juin 2007, le gouvernement fédéral australien a déclaré l’état d’urgence dans 73 communautés aborigènes du Territoire du Nord et commencé le 9 juillet à envoyer main dans la main l’armée, la police sécuritaire d’urgence et des équipes de médecins pour examiner tous les enfants et les retirer aux parents s’ils présentaient des maladies sexuelles. Le premier général nommé à la tête des troupes envoyées à Alice Springs a démissionné, le second a déclaré que le travail serait plus dur que son intervention à Aceh après le Tsunami de 2004, car il ne s’agissait pas d’une urgence militaire mais d’un travail d’éducation de fond. L’État d’Australie de l’Ouest refusait le 11 juillet la proposition fédérale d’étendre le plan aux communautés du Kimberley. L’urgence est d’écouter et laisser agir ces peuples autochtones qui — guerriers pour la paix — résistent au désastre avec une inventivité quotidienne en travaillant pour la justice sociale et le respect des droits humains.
Notes
[ 1] Pour la campagne Stolen Wages voir le site de Australians for Native Title and Reconciliation, ANTAR : www.antar.org.au/
[ 2] Vanessa Castejon, Les Aborigènes et l’apartheid politique australien, L’Harmattan, 2005 ; Bain Attwood et S. G. Foster, Frontier Conflict : the Australian experience, National Museum of Australia, 2003 ; Henry Reynolds, Why Weren’t We Told ?, Penguin, 2000 ; Bringing Them Home — Community Guide, Human Rights and Equal Opportunity Commission : www. austlii. edu. au/ au/ special/ rsjproject/ rsjlibrary/ hreoc/ stolen_summary/ index.html.
[ 3] La fondation Errol Wyles finance les procès des familles aborigènes souffrant d’injustice sociale (www.levittrobinson.com/donate.asp).
[ 4] Pour télécharger le rapport de la Royal Commission into Aboriginal Death in Custody (RCIADIC) www.austlii.edu.au/au/special/rsjproject/rsjlibrary/rciadic/index.html.
[ 5] B. Glowczewski, « Les réfugiés de l’intérieur. Les syndromes de victimes de désastre des Aborigènes australiens », Conférence de L’unebévue, revue de psychanalyse, Galerie L’Entrepôt, 10 mars 2007.
[ 6] Voir par exemple l’interview de la poétesse Romaine Moreton dans Multitudes, été 2007, n°29, ou bien l’article du commissaire d’exposition aborigène Djon Mundine dans cette majeure « Réseaux autochtones : résonances anthropologiques ».
[ 7] Tony Koch, « Another Black Stain. An Aboriginal man dies in custody of internal injuries. His son and cellmate commit suicide. The arresting officer walks free », The Australian, 21 juin 2007.
[ 8] www.theage.com.au/news/national/family-in-shock-after-palm-island-verdict/2007/06/20/1182019201449.html
[ 9] Voir Barbara Glowczewski, Lex Wotton et Lise Garond, Guerriers pour la paix. Les Aborigènes de Palm Island, Éditions Indigènes (à paraître, octobre 2007).
[ 10] Des galeristes sans scrupules font aussi peindre à la chaîne des Aborigènes contre de l’alcool : une enquête du Parlement fédéral est en cours sur les « carpetbaggers » qui, selon le quotidien national The Australian du 14 juin 2007, « sapent l’industrie artistique aborigène qui rapporte plus de 500 millions de dollars par an ».
[ 11] Selon le rapport Human Rights Survey, 2006.
[ 12] Une partie de ce texte a été présentée en anglais à la table ronde « Spectacle and the Substance of Riots and Other Violences », lors de la conférence annuelle des anthropologues australiens (AAS, 27-30 septembre 2006, JCU, Cairns).