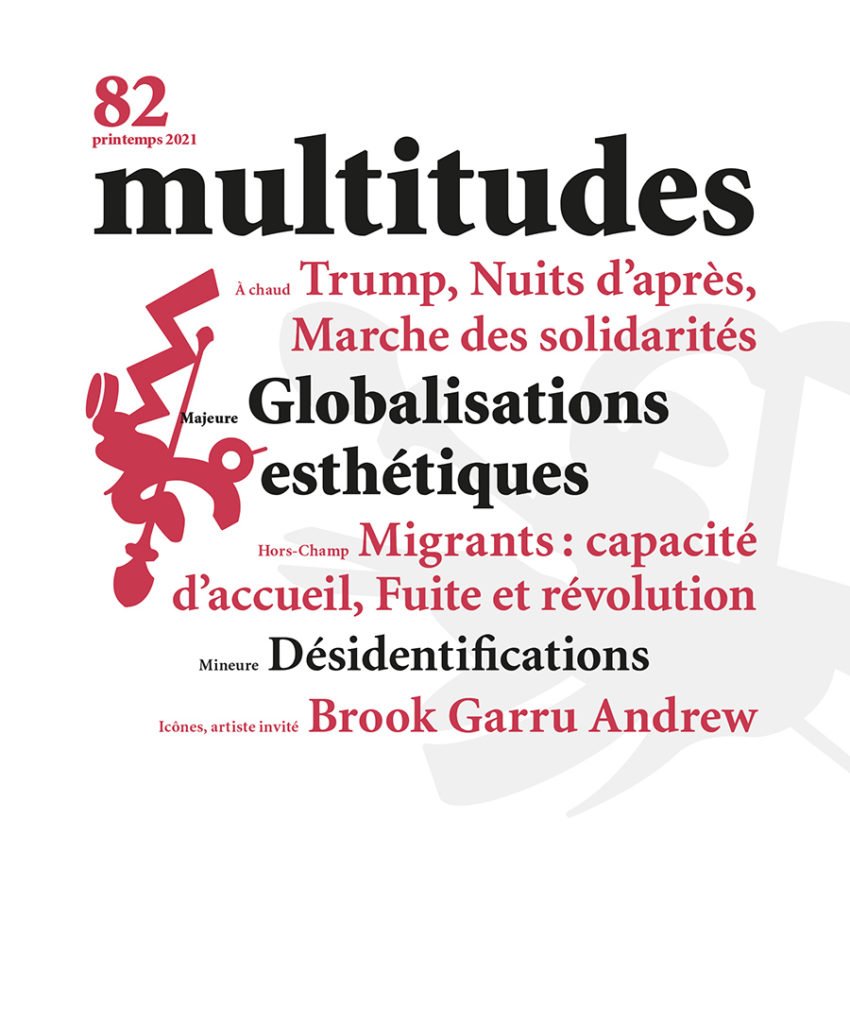Un langage commun doit être retrouvé dans la praxis qui rassemble en elle l’activité directe et son langage. Il s’agit de posséder effectivement la communauté du dialogue.
Guy Debord, La Société du spectacle, thèse 187
Ce que tu fais, je pourrais très bien le faire, tes consignes à la Prévert ou avec Perec, les poèmes à trous, c’est facile.
?
Oui, ce que tu proposes aux élèves, avec ta créativité, je pourrais le faire en tant que prof de français, animer ces ateliers, j’en suis capable autant que toi.
Je retranscris ici la conversation que j’ai eue avec un enseignant en 1998, qui me demandait pourquoi on fait intervenir des auteurs dans les classes (bien rémunérés), dans leur classe, alors que les enseignants pourraient faire le boulot eux-mêmes (ils le feraient peut-être mieux, proposer des consignes de poésie, ils savent le faire, oui…). L’enseignant possède la pédagogie, la technique, il connaît bien ses élèves, tandis que l’auteur intervenant débarque pour quelques séances, coiffé de la couronne de l’ÉCRIVAIN, la couronne pailletée de l’art et de la littérature, il arrive… et à peine son manteau enlevé, il resplendit (son aura est indéfinissable devant les élèves).
La scène se passe au collège Jean Moulin de Champigny, après cinquante minutes de métro, vingt-cinq minutes de RER, quelques minutes de marche, lorsque l’auteur arrive dans une classe, le pantalon froissé du matin, hirsute (mais charismatique). Les élèves ont la poésie vivante devant les yeux, une poésie incarnée avec des jambes, des bras, une tête et la fatigue du matin, parce qu’il a fallu se lever (trop tôt) pour l’atelier d’écriture du collège Jean Moulin de Champigny (loin).
Plus sérieusement, la place de l’écrivain (fonction, statut, légitimité), à l’école, en médiathèque, à l’hôpital, en maison d’arrêt), est à redéfinir à chaque intervention. Sa présence n’est pas une évidence, son hésitation (masquée), ses propositions (comme il a l’air sûr de lui !), le situent dans une zone floue, face à l’institution.
Mon expérience à l’hôpital (à l’Institut Gustave Roussy depuis 2007, en Ehpad depuis 2016), est emblématique de la place évanescente de l’auteur dans l’espace public, toujours à réinventer… Auprès des jeunes patients atteints de cancer, j’ai improvisé ma méthode au jour le jour, substituant à l’atelier collectif (la classe, le groupe), une relation interpersonnelle d’individu à individu (le patient, l’écrivain). Il n’est jamais naturel de faire intrusion dans la chambre où un malade se repose (souffre), il n’est pas facile de percevoir ses attentes, ses capacités d’invention, son désir de participer à une activité, culturelle, entre deux consultations ou après une épuisante chimiothérapie.
J’avance progressivement, j’apprivoise la personne, sachant que le désir d’écrire ne peut être transmis que de l’intérieur, du questionnement de l’écrivain, à partir de ses maladresses, de ses incertitudes. La différence entre auteur et professeur réside peut-être dans ce doute, qui m’oblige à adapter des outils créatifs à une situation.
Je cite Guy Debord, parce que l’espace-temps d’un atelier d’écriture s’inscrit dans une configuration très spéciale, une situation, à l’intérieur de laquelle prend forme une communauté de dialogue, de dépassement (dépassement du langage des médias, de la rentabilité, donc du spectacle mortifère de la globalisation, pour paraphraser David Christoffel).
Les moments partagés avec le patient constituent une aventure (une situation, donc…), l’atelier se construit comme un laboratoire, les consignes n’étant pas systématiquement décidées à l’avance. Un enfant passionné de foot fera peut-être un poème sur le sport, spontanément nous le décidons ensemble et je tiens compte de sa disponibilité ou de sa fatigue, ou même de l’indifférence. L’échec fait partie du processus.
Je ne connaissais pas cette personne et je franchis sa solitude simplement pour la convaincre d’écrire un petit texte à partir d’une citation, une image, une ambiance issue d’une lecture. Ainsi Elsa, après la lecture du Télégramme de Dakar, d’Henri Michaux, écrit ceci :
« À force de penser aux girafes aux longs cils
J’ai voulu leur ressembler.
Dans mes rêves les plus fous, je me transformais en girafe,
Parcourant les paysages arides, me mêlant à mes congénères.
Le temps des gambades ne me paraissait pas si éloigné,
Au réveil, je me sentais libre, heureuse, légère,
Le rêve ne me semblait pas si loin de la réalité,
Et la frontière entre les deux semblait dissoute, rompue, anéantie. »
Elsa, 19 ans, 3/04/2009.
À l’hôpital, comme partout désormais, école, entreprise, administration, s’est posée la question de l’évaluation parce qu’il fallait rendre des comptes, témoigner de résultats auprès des partenaires financiers de l’atelier d’écriture. J’ai répondu qu’un poème n’a pas de valeur quantifiable. Loin de toute idéologie qui consiste à rentabiliser une action à court terme, les effets d’une pratique créative se perçoivent à long terme, dans une dimension de fantaisie, d’irrationnel, une qualité inquantifiable. Mon rôle consiste à court-circuiter les habitudes prises avec le langage, la pédagogie, les réflexes scolaires.
Un texte d’atelier d’écriture ne peut être soumis à une valeur, une note, un degré de compétence. Il est aléatoire, non obligatoire, l’improvisation y est constante (le chantier, l’œuvre en cours).
L’écrivain qui accompagne le patient n’est pas un poète inspiré par un idéal (sa couronne pailletée…), il porte le bleu de travail de la littérature, pour accompagner, faire naître quelque chose.
« La tour d’ivoire a pris la dimension du monde. Paraître dans le monde en tant qu’auteur, les outils à la main, par la voix et le corps, revendiquer l’écriture comme pratique commune.1 »
Par ailleurs, il a rarement été signalé dans les ouvrages de théorie, de pratique, que les ateliers d’écriture pourraient se définir comme un genre en soi, un genre artistique autonome, évolutif, au même titre que le roman, la poésie, l’art conceptuel, la performance. Que l’atelier d’écriture comme genre littéraire (en soi), processus esthétique, comportemental, élan performatif, happening, mise en scène de textes, mise en voix de la personne de l’auteur et des participants comme personnages, ce trait spécifique a été peu analysé, me semble-t-il.
Il est important d’établir une mise au point à l’heure où cet engagement gagne en diversité, en expérimentation, dans le champ des universités et des écoles d’art. Le développement récent des Master de création littéraire, à l’image des enseignements de Creative writing proposés dans les universités américaines, offre aux étudiants la possibilité d’accéder à des ateliers-laboratoires, d’envisager la littérature comme une pratique culturelle, de développer un esprit critique.
En école d’art, l’écriture devient un médium autonome comme la peinture, la vidéo, l’installation, le son, le design, la performance.
L’atelier d’écriture acquiert dès lors une légitimité artistique, et on évitera de le cantonner à un moment passager d’animation, de bien-être, d’épanouissement utile pour jeunes de banlieue, prisonniers, malades, personnes âgées, auxquels on injecte de temps en temps des petites recettes oulipiennes (Prévert ou Perec ?).
Autonomie et improvisation… Je pense aux avant-gardes qui prônaient la fusion entre l’art et la vie (Dada, Fluxus), lorsque chaque proposition déclenchait un événement (event, happening), une petite aventure de langage, de détournement. Si Dada pose la question de savoir ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas, un poème d’atelier d’écriture, maladroit ou mal ficelé, peut agir comme un ready-made, une création hors des codes de l’expertise, du grand art, de la littérature autorisée (publiée…). À l’instar de Robert Filliou qui avait créé une galerie dans son chapeau (la galerie légitime), faisant de sa tête un lieu d’exposition mobile, le texte d’atelier devient une mini édition, mouvante, qui fait sauter les barrières entre l’art et la vie, qui n’a pas besoin d’être validée.
Parce qu’ils ont l’ego modeste, les participants créent une chaîne générative de petites créations, comme Les longs poèmes courts à terminer chez soi de Robert Filliou. Ainsi Jason, 16 ans, écrit un haïku par jour à l’hôpital, et chez lui :
« Sommeil qui charme
Ondée d’argent
Doucement pénètre son âme
Que ton baiser l’apaise »
Un texte d’amateur n’est pas forcément moins bon que celui d’un auteur professionnel. Selon un terme de marketing cher aux évaluations attendues, je dirais que la poésie possède un effet transformateur et crée du lien, un autre rapport au savoir, à la culture, à l’émancipation.
Un langage commun doit être retrouvé, oui. Debord affirmait par ailleurs : « À quoi bon écrire ou faire de l’art, dans une époque du manque où le temps est gelé… » Il est possible, cependant, de combattre l’hypnotisante aliénation du flux (le règne des BFM, tweets, GAFA, que Debord n’a pas connu, quelle chance pour lui !), par des petites guérillas personnelles et salutaires, parce que l’hôpital est un espace qui permet d’aller au-delà des contraintes et des obligations de résultat, un espace où on ne devrait pas compter (les lits, les participants, la qualité d’un poème).
1 François Bon, Enjeu social de l’écrivain intervenant, remue net, cf. http://www.tierslivre.net.