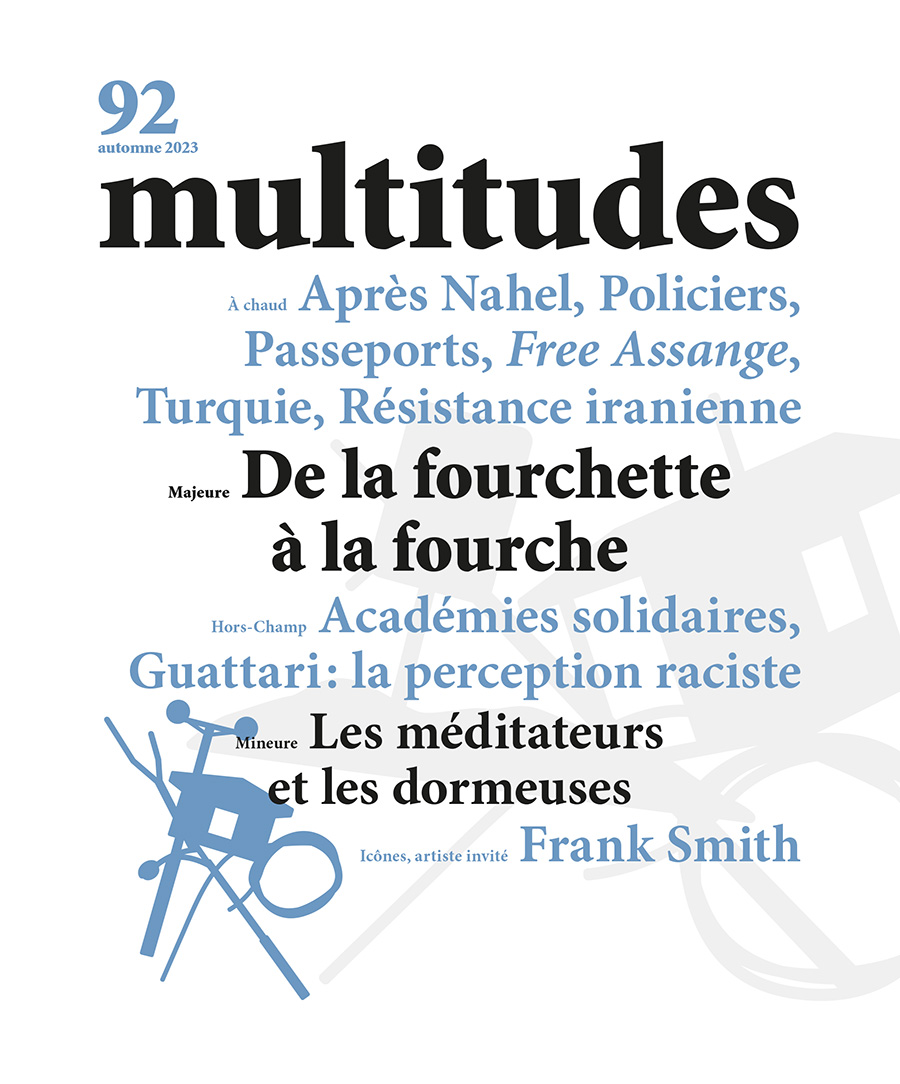Au delà de l’irréductible lutte écologique pour l’abandon du projet d’aéroport, le bocage de Notre-Dame-des-Landes a constitué un terrain d’expérimentation pour transformer l’occupation militante en droit pérenne d’usage des terres.
Foncièrement déterminés
De fait, la question du foncier et celle de l’agriculture ont été centrales. Les « zadistes1 » se sont battus pour devenir agriculteurs et exploiter collectivement les terres au service d’une agriculture écolo et non Monsanto. À l’abandon du projet en 2018, suite à des discussions régulières en « assemblée des usages2 », ils ont proposé à l’État propriétaire (représenté par la préfète des Pays de la Loire), de bénéficier d’un droit d’usage collectif et d’une entité commune de gestion des terres avec un bail amphytéotique comme au Larzac, de manière à unifier cette zone de 1 650 ha qui est un millefeuille d’usages passés et de nouveaux à définir3. Refusant vigoureusement de considérer un projet de mise en valeur en commun des terres, la préfète somme les porteurs de projets d’agir séparément en déposant des « fiches individuelles » de projets quelle que soit leur nature, maraîchers, agricoles, d’apiculture ou de plantes aromatiques, d’élevage de bovins ou d’ovins, mais le tout dans un temps contraint pour éviter une nouvelle évacuation. Un groupe de la Zad accepte d’entrer en négociation avec la préfecture pour s’assurer du soutien des paysans historiques et éviter l’expulsion des partisans de l’autonomie hors droit4. Ces zadistes parient sur le fait de mener une bataille sur le droit face à l’administration.
Le processus d’élaboration des fiches individuelles démontre la résistance des zadistes aux injonctions bureaucratiques. Un Bureau d’autodéfense administrative est ouvert pour constituer les dossiers de présentation des projets, démêler leur complexité et « créer un manteau » juridique de protection. Le dépôt des projets a donné lieu à de vives oppositions. Ceux qui étaient déterminés à rester et à occuper les terres ne voulaient pas que ce soient des « cumulards »5 qui reprennent ces terres, ni que ce soit la gestion classique de la forêt qui en reprenne l’usage, etc. D’autres ont refusé toute cette diplomatie juridique des fiches, d’où la vague d’expulsion qui les a touchés particulièrement6. Au final, sur les 28 projets déposés, seuls 15 sont acceptés mais la stratégie des dépositaires aboutit très vite à la signature de quinze Conventions d’occupation précaire (COP) qui leur offrent une trêve de six mois en mettant temporairement à l’abri un réseau de lieux dispersés sur la Zad, dont les projets, essentiellement agricoles, sont interconnectés. En 2019, le projet collectif des 150 habitants de la Zad réussit à tranformer la légitimité temporaire des Cop en un fermage sur 350 ha avec des baux de neuf ans (renouvelables)7.
La Terre en commun
Compte-tenu de la dimension politique du conflit, les transactions pour l’usage des terres sont directement menées par la préfète, représentante de l’État propriétaire, sans passer par l’intermédiation des SAFER. Mais le mouvement souhaite pérenniser l’« occupation » en achetant collectivement des terres et bâtis. En 2019 est créé un fonds de dotation8 La terre en commun. Le dispositif permet la propriété collective, mais « pour s’affranchir de la propriété ». Personne n’est nominalement propriétaire, les dons ne donnent aucun droit sur ce qui est acheté, ni aux donneurs ni aux membres du fond. Après l’achat, il confie sous des formes variées (baux, conventions, etc.) l’usage des terres, habitats, forêts et autre à des structures s’organisant collectivement et s’engageant à respecter les objectifs du fonds9. Le fonds a réussi à réunir consensuellement des administrateurs aux intérêts à priori divergents : naturalistes en lutte, paysans historiques, zadistes, membres d’associations de défense de la Zad. Il s’agit donc de penser en commun des alternatives foncières. La question foncière est en ce sens une « guerre sociale et territoriale10 ».
Cinq ans après l’abandon du projet d’aéroport, 200 personnes vivent toujours sur place. Sur les 29 agriculteurs ayant finalement pu s’installer sur le territoire depuis 2018, 21 sont issus de l’ancienne Zad, occupants illégaux pour l’administration, mais prioritaires à l’installation en tant que jeunes agriculteurs ; 26 sont retourné sur leurs terres11, l’ensemble bénéficiant de baux ruraux de neuf ans, les terres ayant été régularisées par un comité de pilotage présidé par la préfète et réunissant chambre d’agriculture, syndicats agricoles (qui considèrent avoir été baillonnés), élus, fonctionnaires et habitants de la Zad. Les baux ruraux comportent tous des clauses environnementales. L’influence de l’alternative proposée par les zadistes a été, semble-t-il, déterminante, puisque le département de Loire-Atlantique souhaite « tester sur ce territoire des pratiques agricoles novatrices, notamment face au changement climatique » et que la plupart des agriculteurs sont installés en bio. Le Fonds de dotation réunit aujourd’hui 3 millions d’euros, mais la lutte fait rage car le foncier est une denrée rare de nos jours et le département, à qui l’État a rétrocédé plus de la moitié des surfaces (environ 1 000 ha) est réticent à céder des parcelles à des occupants « illégaux ». Il a fallu que les zadistes fassent des concessions. Les nouveaux baux ruraux sont accordés au nom d’une personne et non d’un collectif, même si « les terres sont exploitées en commun ». Le projet collectif d’autonomie complète vis-à-vis des institutions s’est étiolé. Les usages de la terre et les méthodes culturales sont diverses : 450 ha sont utilisés par les militants anciens zadistes, 400 par les paysans historiques récalcitrants qui ont refusé l’indemnisation d’expropriation et 400 sont exploités par les paysans « cumulards » qui sont revenus après leur expropriation et ont agrandi leurs terres12. Les anciens zadistes ont réussi à soustraire 450 ha à l’agriculture productiviste, cogèrent avec l’ONF la forêt de Rohanne, inventent des formes de vie collectives, rachètent lentement mais régulièrement avec le fonds de dotation terres, autoconstructions, lieux collectifs. C’est une belle victoire.
Pour aller plus loin
Collectif Reprise des terres, adossé à la revue d’écologie politique Terrestres, enquêtes permanentes sur l’état des « reprise des terres » pour une autre agriculture face à l’enjeu foncier à venir de la remise en jeu des terres du quart du territoire par le départ à la retraite de la moitié des agriculteurs français
Barbara Glowczewski, Réveiller les esprits de la terre, Éditions Dehors, 2021
Geneviève Pruvost, « Critique en acte de la vie quotidienne à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (2013-2014) » in Politix, 2017/1 (no 117), p. 35-62
Sylvaine Bulle, Irréductibles. Enquêtes sur les milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes, UGA Éditions, 2020
1Occupants de la Zad, devenue « zone à défendre » en remplacement de la Zone d’aménagement différé décrétée par l’État pour réaliser l’aéroport.
2Ces discussions ont fabriqué une base commune en six points où la question d’une alternative culturale et foncière apparaît prégnante. « Ça fait bien depuis quatre ans que l’on réfléchit à l’avenir de la Zad au-delà de l’aéroport… depuis quatre ans, les paysans, les naturalistes, les nouveaux habitants de la Zad et les habitants historiques se retrouvent régulièrement pour discuter de nos usages, des terres, quelles terres on occupe, comment on les cultive, etc.». Barbara Glowczewski, Réveiller les esprits dela terre, « Devenir bocage à Notre-Dame-des-Landes », Éditions Dehos, 2021, p. 241.
3Barbara Glowczewski, Réveiller les esprits dela terre, op. cit., p. 250.
4Barbara Glowczewski, op. cit., p. 250.
5Paysans présents sur le périmètre de la Zad ayant reçu une indemnité d’expropriation et profitant des négociations pour revenir, le cas échéant, en s’agrandissant.
6Barbara Glowczewski, op. cit., p. 264.
7Barbara Glowczewski, op. cit., p. 265.
8Cette structure juridique particulière, entre l’association et la fondation permet une propriété privée, mais collective. Les administrateurs ont une égalité de droits et de devoirs. Le fonds de dotation donne un avantage fiscal : une réduction d’impôts de 66 % du revenu imposable du particulier ; et pour les entreprises, une défiscalisation de 60 % du versement.
9Barbara Glowczewski, op. cit., p. 259.
10Prises de terre(s), Notre-Dame-des-Landes, été 2019. Brochure manifeste : https://lundi.am > zad
11Sous la pression de l’Amelaza, Association pour le maintien des exploitations légales sur l’ancienne zone aéroportuaire.
12Ouest-France, 1er août 2021.