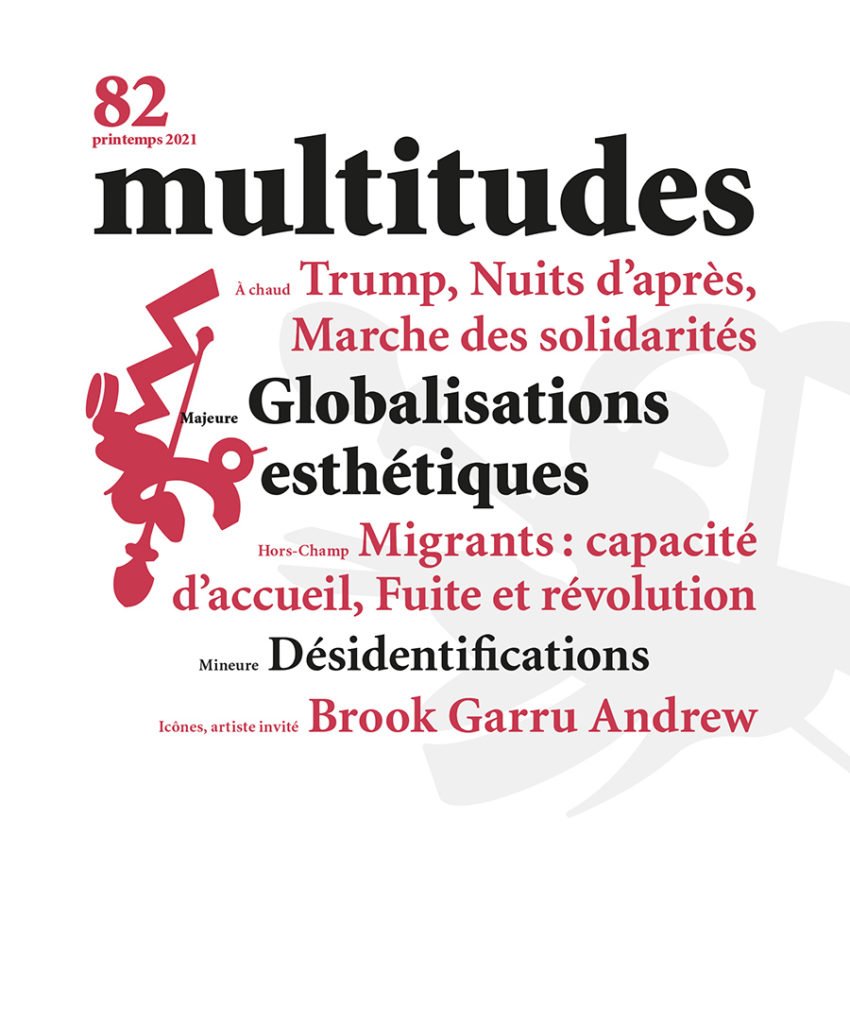Au XXe siècle, nous nous sommes habitués à des politiques d’écologie de production – comme la production d’objets, de citoyennetés, de savoir-faire – dans lesquelles d’autres non-invités, ou autorisés, n’ont pas de place utile car ils se placent comme des obstacles pour une expansion perçue comme nécessaire pour notre bien-être1. L’expansion se positionna comme progrès, et la diversité biologique et culturelle comme son ennemi. Il m’apparaissait alors important de demander : quelle était cette croissance ? Et quel héritage nous-a-t-elle laissé aujourd’hui ?
L’expansion n’est pas juste une volonté de pouvoir. L’expansion – de la façon dont elle est perçue ici –, est un problème technique, demandant une ingéniosité considérable en matière de design. Ordinairement, les choses qui se propagent tendent à se transformer lorsqu’elles s’étendent à de nouveaux matériaux ou de nouvelles relations. Disons que j’étends mon réseau académique pour inclure des collègues d’autres pays ou d’autres disciplines. Ma vision académique globale va alors se modifier en acquérant un nouveau savoir, ce qui constitue une forme d’expansion à laquelle nous ne nous intéresserons pas ici. L’expansion qui fut considérée comme progrès n’autorisait pas de transformations dans la nature du projet en expansion. L’idée première était justement d’étendre un projet sans le transformer du tout, ou cela n’aurait pas participé à la prouesse universelle considérée comme progrès. Il s’agissait d’une prouesse technique incluant la notion d’échelle, c’est-à-dire la relation entretenue entre le petit et le grand. […]
Quand de petits objets parviennent à devenir grands sans changer la nature du projet, nous appelons cette caractéristique du design, « scalabilité », ou extensibilité. Il s’agit d’un terme déroutant car il semble signifier une idée large, la capacité à user de principes d’échelles, alors que cela n’est pas la signification technique du mot. Les projets « scalables », extensibles, sont uniquement ceux ayant la capacité de s’étendre sans transformations. Ce qui m’intéresse en particulier est l’exclusion des formes de diversités culturelles et biologiques au sein des designs scalables. La scalabilité n’est possible que si les éléments d’un projet ne construisent pas de relations qui les modifieraient, ce qui modifierait alors le projet au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux éléments. […]
Concevoir des projets scalables demande beaucoup de travail. Cependant nous prenons ce travail tellement pour acquis que les chercheurs s’imaginent souvent que sans designs de recherche scalables nous serions dans l’impossibilité de changer d’échelle, de nous étendre, coincés dans de minuscules micro-univers. Pour ce changement d’échelle, il faut se reposer sur la possibilité de scalabilité et donc sur la possibilité de modifier les échelles sans modifier la trame des savoir-faire ou de l’action. Il existe pourtant des alternatives pour changer le cours des choses et pour être capables ainsi de raconter autant de petites que de grandes histoires. La théorie de la non-scalabilité est une alternative pour une conceptualisation du monde. Mais je dois d’abord expliquer la scalabilité plus en profondeur.
Un domaine d’application de la scalabilité devrait aider. Les technologies numériques des cinquante dernières années nous ont démontré les plaisirs du zoom numérique : nous escaladons depuis les plus petits détails jusqu’aux plans larges en juste quelques clics. Sur nos écrans, nous élargissons du texte, et l’alphabet semble rester identique. Nos photographies numériques se prêtent à la recherche de détails – ou à la réalisation de panoramiques. Sur le site Paris 26 Gigapixels, nous pouvons choisir de visualiser Paris en entier ou bien seulement l’intérieur d’une chambre à travers une fenêtre2. Cette capacité semblant relever de la magie, c’est la scalabilité. Pour les fichiers numériques, il s’agit de la capacité de changer d’échelles sans modifier la forme des images. Il est possible de faire cela grâce à la stabilité du pixel, unité élémentaire d’une image. L’image numérique change d’échelle du grand au petit en redimensionnant les pixels. Bien sûr, cela suppose que les pixels demeurent uniformes, distincts, et autonomes ; ils ne peuvent ni se contaminer ni se transformer l’un l’autre. Les artistes se plaignent de la pixellisation, qui fragmente notre vision du monde. La plupart d’entre nous ne la remarquent pas, peut-être à cause de la qualité pixelisée de notre monde en recherche d’expansion – mais il s’agit de quelque chose que l’on devrait remarquer. […]
Le terme de scalabilité est né non pas dans les domaines technologiques mais dans ceux du business. En business, il s’agit de la capacité d’une entreprise à se développer sans changer la nature de son activité. « Économies d’échelle » désigne par exemple une organisation de pratiques visant à produire des biens moins chers car produits en masse, et constitue donc une forme de « business scalabilité ». Se situant à l’opposé des technologies du numérique, l’idée n’est alors pas d’agrandir en zoomant ; seule l’expansion importe. La scalabilité dans le business recherche l’expansion pour la croissance et les profits. Il s’agit d’un principe fondamental du progrès au XXe siècle. Sous l’hégémonie des États-Unis, plus grand signifiait toujours meilleur. Tout comme le business, le développement devait devenir toujours plus grand. La Banque Mondiale ne finançait de projets à l’échelle de villages que s’ils étaient scalables, c’est-à-dire si la possibilité pour ces projets de s’étendre sur d’autres villages sans que l’on ait à modifier d’éléments était déjà là. En effet, la clé pour déterminer si une institution était moderne et développée plutôt que l’inverse, c’était sa taille. La grandeur était synonyme de progrès.
Il est aisé de nos jours de prendre du recul sur ce programme du XXe siècle car il a été contesté par les changements qui se sont opérés dans l’économie politique globale. Au XXIe siècle, l’hégémonie des économies d’échelle s’est effondrée devant l’avancement des chaînes mondiales d’approvisionnement au sein desquelles les activités économiques s’étendent sur de nombreuses entreprises et en de nombreux lieux. Beaucoup d’entreprises puissantes ne prospèrent plus uniquement grâce à leur taille ; à la place, elles tentent d’utiliser leurs « compétences » stratégiquement. Compétence ici étant une façon de signifier privilège. Les entreprises venant de nations puissantes usent de leur position pour obtenir des contrats avec des entreprises de pays pauvres, et les élites nationales usent des leurs pour contracter avec les gens désavantagés de ces mêmes pays. Compétence est aussi une façon de parler de mobilisation culturelle. Des entreprises à tout niveau font des économies en obtenant des travailleurs qu’ils fassent leur travail pour des raisons culturelles et non pas pour le salaire ou les bénéfices de l’emploi. Le virage vers la création de niches culturelles dans l’économie globale est surprenant d’un point de vue des idéaux de scalabilité du XXIe siècle, qui dépendaient de la régularisation et de la discipline du travail comme moteur d’expansion. Aujourd’hui, les inventaires sont scalables, mais le travail et la gestion des ressources naturelles s’éloignent tous deux des pratiques de scalabilité. Les chaînes d’approvisionnement se doivent de porter une attention particulière aux relations inter-entreprises plutôt que de juste accroître les intrants. Cela nous permet de nous pencher sur les projets de scalabilité du XXe siècle en gardant un œil attentif sur leurs limitations et leurs échecs – incluant le rejet de la diversité3.
Qu’en est-il de la non-scalabilité ? En aucun cas elle ne peut être meilleure que la scalabilité juste en étant « non-scalable », non-extensible. Les aspects non-scalables de l’économie politique du XXIe siècle ne représentent pas une amélioration par rapport au XXe siècle ; en effet, ils stimulent tout d’abord une forme de nostalgie vis-à-vis d’une époque où l’on pouvait dire le mot « régulation » sans que les politiciens prennent l’air horrifié. De bonnes choses comme de moins bonnes peuvent être non-scalables. Le service féodal était une forme de travail non-scalable mais pas pour autant plus recommandable. Abattre une forêt est certes non-scalable mais ce qui en résulte n’est certainement pas mieux que ce que l’on obtient grâce aux sciences forestières. Ou encore, la complexité écologique est quelque chose de non-scalable, tout comme l’amour ; et nous considérons pourtant ces choses précieuses. La différence entre des designs scalables et non-scalables ne peut donc être perçue a priori sur une échelle normative. La non-scalabilité se définit en négatif ; si la scalabilité est une caractéristique spécifique du design, alors la non-scalabilité se réfère à tout ce qui ne présente pas cette caractéristique, en bien ou en mal. Mais le simple fait que quelque chose ne soit pas ce que l’on désire ne suffit pas comme raison pour l’ignorer. La théorie de la non-scalabilité en devient ce dispositif d’analyse qui nous aide à remarquer les phénomènes non-scalables4.
La théorie de la non-scalabilité permet aux différentes échelles de naître des relations formées au sein d’un projet, d’une scène ou d’un événement spécifique. Pour le chercheur ou pour celui qui « crée le monde », beaucoup de ces projets « producteurs d’échelles » concourent pour attirer l’attention ; l’astuce est de tracer ou de créer des relations entre eux. En faisant ce travail, nous trouvons aussi bien de petites histoires à raconter que de grandes. Les échelles ne se fixeront pas nécessairement, tout comme il n’est pas inévitable que quelqu’un, soudainement, grâce à un tour de magie, permette la conversion d’une échelle en une autre sans opérer de distorsion. Les échelles d’un projet se bousculent et se surpassent les unes les autres. Étant donné que les relations sont des rencontres excédant les différences, elles présentent une certaine indétermination. Les relations sont transformatrices, et personne ne peut savoir ce qu’il en résultera. En conséquence, elles comportent toujours un potentiel de diversité. La théorie de la non-scalabilité exige de porter une attention particulière à la contingence historique, aux conjonctures inattendues, et aux façons dont les ponts enjambants les différences peuvent résulter en de nouveaux programmes. Dans des travaux antérieurs, j’ai nommé ces procédés « friction5 ». Cette forme de friction est une caractéristique importante de la théorie de la non-scalabilité. […]
Un modèle important du design scalable fut la plantation, et particulièrement les exploitations européennes de canne à sucre dans le Nouveau Monde. Ces exploitations développèrent les éléments de paysage standardisés, asociaux et isolés qui démontrèrent comment la scalabilité pourrait générer du profit – et du progrès. Ces exploitations nous donnèrent l’équivalent du pixel pour le territoire. Cependant, au contraire du pixel, elles ne virent pas le jour à travers une esthétique préexistante de la scalabilité. Au contraire, elles titubèrent à travers l’Histoire et devinrent un modèle a posteriori pour de futurs designs de scalabilité. Prêtons attention à leurs chancèlements, aux imprévus et aux conjonctures qui nourrirent leur design et qui sont semblables à l’approche non-scalable que je choisis d’utiliser à mon tour pour comprendre où leur plan a pu échouer à satisfaire leurs attentes. La scalabilité n’est jamais achevée, parfaite. Si le monde aujourd’hui est encore diversifié et dynamique, c’est bien parce que la scalabilité ne parvient jamais à respecter ses promesses.
La théorie de la non-scalabilité est même utile pour mettre en avant les temps forts de la scalabilité. Au lieu de prendre la scalabilité pour acquis comme un outil nécessaire au progrès, la théorie de la non-scalabilité porte sur le travail de contingence et d’échec. La théorie de la non-scalabilité expose la scalabilité en action.
Les plantations comme modèle de scalabilité
On pourrait avancer que la scalabilité est apparue avec les exploitations coloniales européennes qui ont émergé entre le XVe et le XVIIe siècle6. Les plantations de canne à sucre peuvent ainsi servir d’exemple7. Les premières ne suivaient pas de plans modernes et menèrent à de nombreuses impasses. Quand, par exemple, les Espagnols essayèrent pour la première fois de planter de la canne à sucre dans les Caraïbes, ils employèrent des Amérindiens et utilisèrent leurs procédés de plantation par monticules8. La canne poussa mais les résultats étaient très ordinaires, et donc non-scalables. Quand les Espagnols virent ce que les Portugais étaient en train de faire au Brésil, ils abandonnèrent les monticules et les Amérindiens et recopièrent les plantations brésiliennes. Il nous faut donc nous intéresser aux expérimentations portugaises pour comprendre comment des éléments de paysage stables furent formés par contingence et friction.
Considérons la nature de la canne à sucre telle que les Européens la connaissaient alors. La canne à sucre dite « domestique » n’est pas une espèce en soi mais un groupe d’organismes issus de métissage9. Ce que Linnaeus nomma Saccharum Officinarum, canne à sucre domestique, est en réalité un groupe de clones multipliés par voie végétative. La canne à sucre était cultivée en plantant une tige dans le sol puis en attendant qu’elle germe. Chaque plante était un clone, et les Européens n’avaient aucune idée de comment reproduire cette espèce tropicale. L’interchangeabilité des plants était une caractéristique de la canne et non une volonté européenne. S’ils avaient su comment choisir leurs variétés, comme en Asie du Sud-Est, ils n’auraient pas eu à travailler si dur pour cultiver celles qu’ils avaient – ce qui les força à expérimenter de nouvelles formes de préparation des sols qui menèrent par chance à des formes avancées d’isolation des plants. Par ailleurs, dans le Nouveau Monde, la canne à sucre n’avait jamais été au contact d’espèces similaires ou d’espèces porteuses de maladies : elle était isolée. Des individus génétiquement isolés sans liens interspécifiques : la canne clonée du Nouveau Monde constitue les « nonsoels » premiers, des éléments de paysage sans relations transformatrices. Elle créa des champs prêts pour l’expansion.
L’impulsion première pour les exploitations européennes de canne à sucre était l’obtention d’un sucre qui ne serait pas contrôlé par les Musulmans. Cependant, l’Europe au climat trop froid ne permettait pas de planter de la canne. Quand les voyages des grandes découvertes européennes révélèrent de nouvelles terres au climat chaud, les investisseurs se ruèrent pour financer la plantation de canne. Par chance, une des premières expériences portugaises était sur l’île de Madère dans l’Océan Atlantique, ou un climat sec les força à la construction d’un vaste réseau d’irrigation, modifiant entièrement le paysage10. Le succès de cette expérience redirigea les efforts portugais vers la terraformation et l’irrigation. De fait, aucune d’elles n’était nécessaire pour faire pousser de la canne à sucre dans le climat tropical du Nouveau Monde où des terres plates et humides étaient facilement trouvables. Mais il s’avéra que ces technologies permettaient d’exercer un meilleur contrôle sur la croissance de la canne, facilitant ainsi l’interchangeabilité des éléments, et donc éventuellement la scalabilité. L’irrigation aida à coordonner une croissance synchronisée, facilitant la scalabilité à la fois de la gestion des ressources et de la main-d’œuvre.
[…] Au début du XVIIIe siècle, les Européens se mirent à penser que refaçonner le monde comme une plantation était une condition nécessaire au progrès. Ils élaborèrent des systèmes de gouvernance dans lesquels les potentielles mains d’œuvre et ressources naturelles étaient préparées pour une interchangeabilité intra-projet commandée pour des décrets administratifs. Ils inventèrent des machines qui permettaient une gestion de l’interface entre travail et nature encore plus rigoureuse, facilitant des projets à économie scalable. Les usines furent calquées sur les plantations, intégrant dans leurs plans11 la séparation du travail et de la nature, et l’aliénation de l’une comme de l’autre.
[…] Au XXe siècle, l’un des rôles du gouvernement aux États-Unis était d’éduquer les citoyens afin qu’ils puissent assumer une position interchangeable de travail dans l’industrie ; un autre était de réguler les ressources naturelles, comme l’eau et les forêts, pour faciliter leur usage comme des matières premières scalables. De telles œuvres de gouvernance étaient supposées bâtir prospérité et bien-être en facilitant les économies d’échelle. Par conséquent, les projets de formation et de régulation furent propagés à travers le monde, dans un XXe siècle exalté à l’idée du développement mondial. Les nouvelles nations du Sud voulaient toutes refaçonner leurs citoyens et leurs ressources pour des projets scalables. L’expansion signifiait le progrès12.
Dans le dernier tiers du XXe siècle, des mouvements sociaux très critiques prirent de l’ampleur. Les minorités réclamaient des droits. Les écologistes enrageaient de la profanation de la nature. Les populations indigènes se mobilisaient. Aux alentours des années 1990, la notion de « diversité » comme enjeu problématique avait pris assez de poids pour obtenir des gouvernements et des industries à la fois de belles paroles et une certaine cooptation, et ce dans le monde entier. Pourtant la scalabilité semblait alors inarrêtable. Beaucoup de critiques pointaient du doigt les problèmes posés : la scalabilité ne prenait pas en compte les besoins humains. Elle ne s’inquiétait pas de la destruction de la nature. Elle ne connaissait aucune limite – il n’y avait que l’expansion qui comptait. Mais la prise de conscience généralisée des horreurs de la scalabilité ne parvint pas à la ralentir.
L’opinion publique participa aussi d’une prise de conscience d’un autre ordre ; la scalabilité n’est jamais achevée, complète. Les éléments de projets ne sont jamais entièrement sous contrôle. Même au temps des exploitations de canne à sucre, certains esclaves parvenaient à s’enfuir et à se constituer en communautés de Marrons, ou bien des pousses de canne porteuses de formes de putréfaction fongiques clandestines arrivaient et contaminaient le champ entier. Au mieux, les projets scalables articulent en réalité des éléments scalables et d’autres non-scalables tout en cachant aux investisseurs les effets des éléments non-scalables. Au sortir des XIXe et XXe siècles et de leur enthousiasme pour la scalabilité, le monde est désormais parcouru de telles articulations dressées entre scalable et non scalable. De nombreux « projets de vie » – humains ou non – se dressent dans les ruines des designs de scalabilité.
Le développement de la diversité réduit la scalabilité
La facilité avec laquelle nos ordinateurs parviennent à zoomer entre les échelles nous mène à la fausse croyance que les savoir-faire et les choses du monde existent à des échelles de précision incorporées naturellement. La scalabilité, rappelons-le, est la capacité à s’étendre sans distorsion de la trame de travail. Mais beaucoup de travail est nécessaire pour rendre des savoir-faire, paysages, ou projets, scalables. Cet article a démontré comment ce travail, par son design, efface et tente de bloquer les relations sociales porteuses de diversité transformatrice. Depuis cette perspective, l’histoire de la scalabilité doit être considérée en relation à la fois à ses moments de succès et à ses échecs parfois heureux.
[…] Le grand progrès que les projets des derniers siècles ont bâti depuis l’héritage des plantations colonialistes pour créer de la scalabilité marche encore dans la technologie, les gouvernements, le business. Mais la scalabilité n’a jamais été achevée. Ces dernières années, les changements dans le capitalisme mondial ont mis à mal l’hypothèse de la scalabilité pour la main-d’œuvre et la gestion des ressources naturelles. Pendant ce temps, les critiques de la scalabilité tentent d’alarmer le monde quant au destin de la diversité culturelle et biologique sur Terre. Nous sommes dans un moment clé pour développer la théorie de non-scalabilité comme moyen de re-conceptualiser le monde – et peut-être le reconstruire.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Louise Julien
1 Je remercie Helge Jordheim et les participants·es de la conférence Conceptualizing the World à l’Univer-sité d’Oslo en 2011, qui ont stimulé ma réflexion sur ces questions. Elle a été pubiée dans une version un peu différente dans « On Nonscalability: The Living World Is Not Amenable to Precision-Nested Scales », Common Knowledge 18, no. 3 (2012): 505–24. Cette recherche s’appuie sur les travaux du Matsutake Worlds Research Group, composé de Timothy Choy, Lieba Faier, Michael Hathaway, Miyako Inoue, Shiho Satsuka, et moi-même.
2 Visiter le site de Paris 26 Gigapixels à l’adresse www.paris26gigapixels.com/indexen.html
3 Pour des éléments de discussion supplémentaires à propos des chaines d’approvisionnement du capitalisme, voir Anna Tsing, « Supply Chains and the Human Condition », Rethinking Marxism 21, no 2, 2009, p. 148-176.
4 Au contraire, la théorie de la scalabilité tient le désir de scalabilité pour acquis et se demande comment produire des systèmes plus scalables. Comme celle de la non-scalabilité, la théorie de la scalabilité trace les problèmes de design dans la création de choses scalables; voir, par exemple, Martin Abbott et Michael Fisher, The Art of Scalability: Scalable Web Architecture, Processes, and Organizations for the Modern Enterprise (Upper Saddle River, 2010). Cependant, son but n’est pas seulement d’améliorer mais aussi de naturaliser la scalabilité. Un système viable se doit d’être conçu sur une trame scalable ; les systèmes non-scalables sont défectueux. Le premier pas dans la construction d’une théorie de la non-scalabilité est donc la dénaturalisation de la scalabilité ainsi que la démonstration de son historicité et des alternatives qui l’entourent.
5 Anna Lowenhaupt Tsing, Délires et faux-semblants de la globalité, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2020.
6 Pour approfondir la discussion sur le colonialisme, voir le numéro 84 de la revue Multitudes, à venir.
7 Une littérature riche et interdisciplinaire s’est assemblée autour de l’histoire des plantations de canne à sucre. Mon propos est nourri par le travail, entre autres, de l’anthropologiste Sidney Mintz (Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History [New York, 1986] ; Worker in the Cane: A Puerto Rican Life History [New Haven, 1960]), du géographe J. H. Galloway (The Sugar Cane Industry: An Historical Geography from Its Origins to 1914 [Cambridge, 1991]) ; de l’historien d’art Jill Casid (Sowing Empire: Landscape and Colonization [Minneapolis, 2005]) et de l’agronome historique Jonathan Sauer (A Historical Geography of Crop Plants: A Select Roster [Boca Raton, 1993]).
8 Eric R. Wolf, Europe and the People without History, Berkeley, 1982.
9 Beaucoup de variétés de canne à sucre domestique ne peuvent se reproduire ; les éleveurs ne peuvent se servir d’elle pour développer de nouvelles variétés. Cependant, dans le pays natal de la canne à sucre, en Nouvelle-Guinée et en Asie du Sud-Est, l’on parvient depuis longtemps à produire de nouvelles variétés en choisissant précautionneusement des hybrides très utiles de Saccharum robustum et de S. spontaneum. Les Européens n’ont découvert ce savoir-faire que très tard, une fois qu’ils avaient déjà conquis le monde à la recherche de sucre. Avant le XXe siècle, les Européens n’obtenaient de nouvelles variétés qu’en prenant des échantillons aux personnes qui les cultivaient. Voir Sauer, Historical Geography, p. 236-250.
10 Les prisonniers de guerre devaient se suspendre aux parois des falaises pour creuser des canaux dans la roche ; beaucoup y perdirent la vie. L’expérience de la préparation de la canne à sucre de Madère préfigura ainsi le travail forcé de l’agro-business scalable ; voire Sidney Greenfield, « Madeira and the Beginnings of New World Sugar Cane Cultivation and Plantation Slavery: A Study in Institution Building », Annals of the New York Academy of Sciences 292, 1977, p. 536-552. Christophe Colomb alla visiter les plantations de sucre de Madère et emporta de la canne dans ses voyages vers le Nouveau Monde, où la re-manufacture du paysage pour la culture de la canne devint vite la norme.
11 Pour une analyse de la canne à sucre comme modèle de discipline pour les usines, voir Mintz, Sweetness and Power, 47ff.; et, Wolf, Europe.
12 Pour une analyse du même ordre, voir James C. Scott, L’Œil de l’État, La Découverte, Paris, 2021.