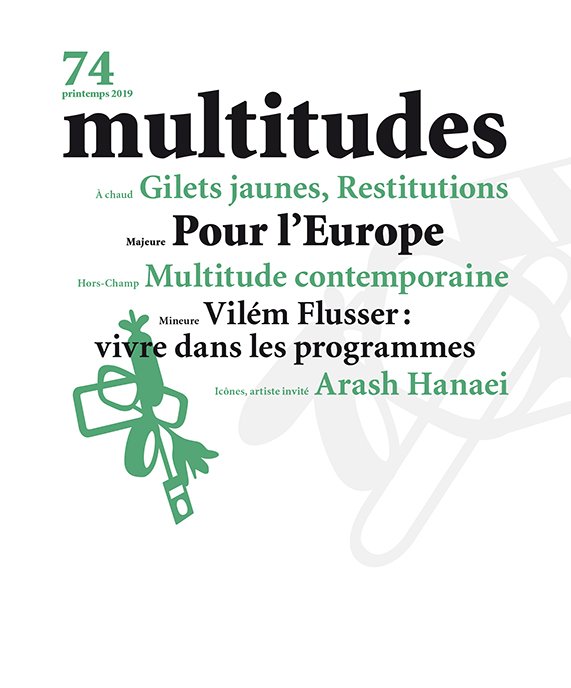Dans la pensée libérale, la multitude1 survit comme dimension privée. Le Nombre est aphasique et écarté des affaires publiques. […] Dans les formes actuelles de la vie on a la perception directe du fait que tant le couple public-privé que le couple collectif-individuel ne marchent plus, ne reposent plus sur rien, explosent. Ce qui était strictement divisé se confond et se superpose. Il est difficile de dire où finit l’expérience collective et où commence l’expérience individuelle. Il est difficile de séparer l’expérience publique de celle que l’on appelle privée. Dans ce brouillage du tracé des frontières, s’évanouissent aussi, ou en tous les cas deviennent bien peu fiables, les deux catégories de citoyens et de producteurs si importantes chez Rousseau, Smith, Hegel et, plus tard, chez Marx lui-même, ne serait-ce que d’un point de vue polémique.
L’individuation de l’universel
La multitude contemporaine n’est composée ni de « citoyens » ni de « producteurs » ; elle occupe une région médiane entre « individuel » et « collectif » ; pour elle, la distinction entre « public » et « privé » ne convient d’aucune façon. Et c’est précisément à cause de la dissolution de ces couples que l’on a tenus si longtemps pour évidents, que l’on ne peut plus parler d’un peuple convergeant dans l’unité de l’État. […] L’unité n’est plus quelque chose (l’État, le souverain) vers quoi l’on converge, comme dans le cas du peuple, mais quelque chose que l’on a derrière nous, comme un fond ou un présupposé. Le Nombre doit être pensé comme l’individuation de l’universel, du générique, de ce qui est partagé. Ainsi, de façon symétrique, il faut concevoir un Un qui, loin d’être quelque chose de conclusif, soit la base qui autorise la différenciation, ou encore qui consente l’existence politico-sociale du Nombre en tant que Nombre.
L’ambivalence de la multitude
Les formes de peur et les formes correspondantes de protection qui étaient liées à la notion de « peuple » ont disparu. C’est une dialectique crainte-protection très différente qui prévaut : elle définit certains traits caractéristiques de la multitude d’aujourd’hui. Peur-sécurité : c’est là une grille ou un révélateur pertinent au plan philosophique et sociologique pour montrer que la figure de la multitude n’est pas complètement « rose » ; pour identifier les poisons particuliers qui s’y cachent. La multitude est une manière d’être, la manière d’être qui prévaut aujourd’hui ; mais, comme toutes les manières d’être, elle est ambivalente, c’est-à-dire qu’elle contient la perte et le salut, l’acquiescement et le conflit, la servilité et la liberté. Ce qui est crucial, cependant, c’est que ces possibilités alternatives ont une physionomie particulière, différente de celles qu’elles revêtaient dans la constellation peuple/volonté générale/État.
Avoir peur à l’abri : la demande de sécurité
Selon Kant, quand j’observe une avalanche terrifiante en étant à l’abri, je suis envahi par un sentiment agréable de sécurité auquel se mêle cependant la perception aiguë de ma vulnérabilité. Partant de la protection empirique dont j’ai joui par hasard, je suis porté à me demander ce qui pourrait garantir à mon existence une protection absolue et systématique. Je me demande donc ce qui protège, non pas de tel ou tel danger déterminé, mais du risque inscrit dans l’être-au-monde même. Où trouver un abri sans condition ? […] Kant offre un modèle très limpide de la façon dont on a conçu la dialectique crainte-protection depuis deux cents ans. On est en présence d’une bifurcation nette : d’un côté, un danger particulier (l’avalanche, les intentions malveillantes du ministère de l’Intérieur, la perte de son poste de travail, etc.) ; de l’autre, par contre, le danger absolu, relié à notre propre être-au-monde. À ces deux formes de risque (et de crainte) correspondent deux formes de protection (et de sécurité). Face à un malheur factuel, il y a des remèdes concrets (par exemple le refuge de montagne quand l’avalanche se déclenche). Le danger absolu requiert en revanche une protection par rapport au monde lui-même.
L’exposition plurilatérale au monde
Aujourd’hui, toutes les formes de vie expérimentent ce « ne-pas-se-sentir-chez-soi », qui, selon Heidegger, serait à l’origine de l’angoisse. Il n’y a rien de plus partagé et de plus commun, dans un certain sens, de plus public, que le sentiment de « ne-pas-se-sentir-chez-soi ». Personne n’est moins isolé que celui qui ressent l’effrayante pression du monde indéterminé. En d’autres termes, le sentiment où convergent peur et angoisse est immédiatement l’affaire du Nombre. On pourrait peut-être dire que « ne-pas-se-sentir-chez-soi » est vraiment un trait distinctif du concept de multitude, tandis que la séparation entre le « dedans » et le « dehors », entre la peur et l’angoisse, marquait l’idée hobbesienne (et pas seulement hobbesienne) de peuple. Le peuple est un, parce que la communauté substantielle coopère pour calmer les peurs qui naissent de dangers circonscrits. La multitude, par contre, est réunie par le danger qui dérive du « ne-pas-se-sentir-chez-soi », de l’exposition plurilatérale au monde. […] Le « Nombre » en tant que « Nombre », c’est ceux qui partagent le « ne-pas-se-sentir-chez-soi » et donc mettent cette expérience au centre de leur propre praxis sociale et politique. De plus, dans la manière d’être de la multitude, on peut observer à l’œil nu une oscillation continuelle entre des stratégies d’assurance différentes, parfois même diamétralement opposées (oscillation que le « peuple », faisant corps avec l’État ne connaît pas).
Les lieux communs
Aujourd’hui, les « lieux spéciaux » du discours et de l’argumentation dépérissent et se dissolvent, tandis que les « lieux communs » acquièrent une immédiate visibilité – les « lieux communs » c’est-à-dire les formes logico-linguistiques génériques qui fondent tous les discours. Cela signifie que pour nous orienter dans le monde et nous protéger de ses dangers, nous ne pouvons compter sur des formes de pensée, de raisonnement, de discours qui ont leur niche dans tel ou tel autre contexte particulier. Le clan des supporters, la communauté religieuse, la section du parti, le poste de travail, tous ces « lieux » continuent évidemment d’exister, mais aucun d’entre eux n’est suffisamment caractérisé et caractérisant pour offrir une « rose des vents » c’est-à-dire un critère d’orientation, une boussole fiable, un ensemble d’habitudes spécifiques, de façons spécifiques de parler/penser. Partout, dans toutes les occasions, nous parlons/pensons de la même manière, sur la base de constructions logico-linguistiques à la fois fondamentales et très générales. Les « lieux communs » prennent le devant de la scène : le rapport entre plus et moins, l’opposition des contraires, la relation de réciprocité, etc. Ce sont eux, et seulement eux, qui offrent un critère d’orientation et donc une certaine protection par rapport au cours du monde.
On a recours à des catégories très générales pour se débrouiller dans les situations déterminées les plus variées, puisqu’on ne dispose plus de codes éthico-communicationnels « spéciaux », sectoriels. Ne-pas-se-sentir-chez-soi et prééminence des « lieux communs » vont de pair. L’intellect comme tel, l’intellect pur, devient la boussole concrète là où disparaissent les communautés substantielles et où l’on s’est toujours exposé au monde ensemble. L’intellect, même dans ses fonctions les plus raréfiées, se présente comme quelque chose de commun et d’émergent. Les « lieux communs » ne sont plus le fond inaperçu, ils ne sont plus dissimulés par la prolifération des « lieux spéciaux ». Ils représentent une ressource partagée à laquelle le Nombre puise dans n’importe quelle situation. La « vie de l’esprit », c’est l’Un qui est soumis au mode d’être de la multitude. […]
Être sans chez soi exige de penser
Être étranger, c’est-à-dire ne-pas-se-sentir-chez-soi, est aujourd’hui la condition commune du Nombre, condition inéluctable et partagée. Eh bien, ceux qui ne se sentent pas chez eux, pour s’orienter et se protéger, doivent recourir aux « lieux communs », c’est-à-dire aux catégories très générales de l’intellect linguistique ; en ce sens les étrangers sont toujours des penseurs. Comme on le voit, j’inverse la direction de la comparaison ; ce n’est pas le penseur qui devient étranger par rapport à sa communauté d’appartenance, mais les étrangers, la multitude des « sans chez-soi », qui parviennent nécessairement au statut de penseurs. Les « sans chez-soi » ne peuvent que se comporter comme des penseurs parce qu’ils ont recours aux catégories les plus essentielles de l’intellect abstrait pour parer aux coups du hasard, pour se protéger de la contingence et de l’imprévu. […]
La dépendance de l’intellect non rattaché à une sphère publique
Si l’aspect public de l’intellect, c’est-à-dire son partage, d’un côté envoie valser les quatre fers en l’air toute division rigide du travail, de l’autre, il fomente la dépendance personnelle. General intellect, fin de la division du travail, dépendance personnelle : les trois aspects sont reliés. L’aspect public de l’intellect, quand il ne l’articule pas à une sphère publique, se traduit par une prolifération incontrôlée de hiérarchies, aussi infondées que robustes. La dépendance est personnelle, dans un double sens : au travail, on dépend de telle ou telle personne et non de règles dotées d’un pouvoir anonyme de coercition ; de plus, c’est la personne tout entière qui est soumise, son attitude communicationnelle et cognitive de base. Des hiérarchies proliférantes, minutieuses, personnalisées : c’est le revers négatif de l’aspect public/partagé de l’intellect. […]
La virtuosité du travail post-fordiste
La subsomption dans le processus de travail, de ce qui auparavant garantissait à l’action publique sa physionomie particulière peut être clarifiée à l’aide d’une catégorie vétuste mais très efficace : la virtuosité.
Si l’on s’en tient pour le moment à l’acception ordinaire, j’entends par virtuosité les capacités particulières d’un artiste-interprète. Est virtuose, par exemple, le pianiste qui nous offre une exécution mémorable de Schubert, ou le danseur expérimenté, ou l’orateur convaincant, ou le professeur jamais ennuyeux, ou le prêtre faisant un sermon suggestif. Considérons attentivement ce qui distingue l’activité des virtuoses, c’est-à-dire des artistes-interprètes. En premier lieu, leur activité est de celles qui trouvent leur propre accomplissement (ou leur propre fin) en elles-mêmes, sans s’objectiver dans une œuvre pérenne, sans se déposer dans un « produit fini », ou dans un objet qui survive à l’exécution. En second lieu, c’est une activité qui exige la présence des autres, qui existe seulement en présence d’un public.
Activité sans œuvre : l’exécution d’un pianiste ou d’un danseur ne laisse pas derrière elle un objet déterminé, séparable de l’exécution même, capable de rester quand celle-ci s’achève. Une activité qui exige la présence d’autrui : la performance n’a de sens que dans la mesure où on la voit ou on l’entend. Intuitivement, on sent que ces deux caractéristiques sont reliées : le virtuose a besoin de la présence d’un public, justement parce qu’il ne produit pas une œuvre, un objet qui fasse le tour du monde alors que l’activité a cessé. En l’absence d’un produit extrinsèque spécifique, le virtuose doit compter sur les témoins. […] On pourrait dire que chaque action politique relève de la virtuosité. Elle partage avec la virtuosité en effet, la contingence, l’absence d’un « produit fini », l’immédiate et incontournable relation avec la présence d’autrui. […]
L’espace à structure publique de la coopération productive
Tandis que la coopération « subjective » devient la principale force productive, les gestes du travail montrent clairement un caractère linguistico-cognitif, impliquent l’exposition aux yeux des autres. Le caractère monologique du travail diminue : la relation avec les autres est un élément originel, de base, et non quelque chose d’accessoire. Là où le travail apparaît à côté du processus de production immédiat, au lieu d’en être une composante, la coopération productive est un « espace à structure publique ». Cet « espace à structure publique » – ancré dans le processus de travail – mobilise des attitudes traditionnellement politiques. La politique (au sens large) devient force productive, fonction, « boîte à outils ». On pourrait dire que la devise héraldique du post-fordisme est, sarcastiquement, « politique avant tout ». Du reste, que peut vouloir dire le discours sur la « qualité totale », si ce n’est requérir que l’on mette à la disposition de la production le goût pour l’action, l’attitude qui affronte le possible et l’imprévu, la capacité de commencer quelque chose de nouveau ? Quand le travail sous l’autorité d’un patron met en jeu le goût pour l’action, la capacité de relation, l’exposition aux yeux des autres – toutes choses que les générations précédentes expérimentaient dans la section du parti –, nous pouvons dire que certains traits distinctifs de l’animal humain, surtout le fait qu’il est doté de langage, sont subsumés dans la production capitaliste. […]
L’hybridation des diverses sphères (pensée pure, vie politique et travail) commence quand l’Intellect, en tant que principale force productive, devient public. C’est à ce moment-là seulement que le travail prend les apparences de la virtuosité et, donc, se colore de tonalités « politiques ». […]
Artiste-interprète ou serviteur ?
L’affinité entre le pianiste et le serviteur, que Marx avait notée, trouve une confirmation inopinée à l’époque où tout travailleur salarié a quelque chose de l’« artiste-interprète ». Sauf que c’est le travail même, producteur de la plus-value, qui prend les allures du travail servile. Quand « le produit est inséparable de l’acte de produire », cet acte met en cause la personne qui l’accomplit, et surtout le rapport entre celle-ci et celle qui l’a ordonné ou à qui il est destiné. La mise au travail de ce qui est commun, c’est-à-dire de l’intellect et du langage, d’un côté rend fictive l’impersonnelle division technique des tâches, mais de l’autre, en ne traduisant pas cette communauté dans une sphère publique (ou dans une communauté politique), induit une personnalisation visqueuse de l’assujettissement.
La question cruciale se pose ainsi : est-il possible de séparer ce qui aujourd’hui est uni, c’est-à-dire l’Intellect (le general intellect) et le Travail (salarié), et d’unir ce qui est aujourd’hui séparé, c’est-à-dire l’Intellect et l’Action politique ? Est-il possible de passer de la « vieille alliance » Intellect/Travail à une « nouvelle alliance » Intellect/Action politique ?
Le caractère public de l’intellect en dehors du travail salarié
Soustraire l’agir politique à la paralysie actuelle, ce n’est pas autre chose que développer le caractère public de l’Intellect en dehors du Travail salarié, en opposition à celui-ci. Cela présente deux profils distincts entre lesquels subsiste cependant la complémentarité la plus stricte. D’une part, le general intellect s’affirme comme sphère publique autonome seulement si on coupe le lien qui l’attache à la production de marchandises et au travail salarié. D’autre part, la subversion des rapports capitalistes de production peut se manifester, désormais, seulement avec l’institution d’une sphère publique non étatique, d’une communauté politique qui ait le general intellect comme pivot. Les traits saillants de l’expérience post-fordiste (virtuosité servile, valorisation des facultés langagières propres l’immanquable relation avec la « présence d’autrui », etc.) postulent, comme loi du talion conflictuelle, rien de moins qu’une forme radicalement nouvelle de démocratie.
Élargissement de la sphère publique non étatique
La sphère publique non étatique est la sphère publique qui se conforme au mode d’être de la multitude. Elle profite du « caractère public » du langage/pensée, du caractère extrinsèque, émergeant, partagé, de l’Intellect en tant que partition des virtuoses. Il s’agit d’un caractère public – comme on l’a déjà observé – tout à fait hétérogène par rapport à celui qui est institué par la souveraineté de l’État ou, pour le dire comme Hobbes, par l’« unité du corps politique ». Ce caractère public, qui se manifeste aujourd’hui comme une éminente ressource productive, peut devenir un principe constitutionnel, une sphère publique, justement.
Comment la virtuosité peut-elle être non servile ? Comment passe-t-on, hypothétiquement, de la virtuosité servile à une virtuosité « républicaine » (en entendant par « république de la multitude » un domaine des affaires communes qui ne serait plus étatique) ? Comment concevoir, en principe, l’action politique fondée sur le general intellect ?
La désobéissance civile
La désobéissance civile représente, peut-être, la forme d’action politique fondamentale de la multitude. À condition toutefois de l’émanciper de la tradition libérale dans laquelle elle est insérée. Il ne s’agit pas de ne pas suivre telle loi particulière parce qu’incohérente ou contradictoire par rapport à d’autres normes fondamentales, par exemple par rapport à la Constitution : dans un cas semblable, en fait, l’insoumission témoignerait seulement d’une loyauté plus profonde envers le commandement de l’État. À l’inverse, la désobéissance radicale qui nous intéresse ici remet en question la faculté même de commander de l’État. […]
La multitude prend pour cible précisément l’obéissance préliminaire et sans contenu, base sur laquelle on ne peut que développer une mélancolie dialectique entre acquiescement et « transgression ». En s’opposant à une prescription particulière sur le démantèlement de l’assistance médicale ou sur l’arrêt de l’immigration, la multitude remonte au présupposé caché de toute prescription impérative et en entame la mise en vigueur. La désobéissance radicale « précède les lois civiles », puisqu’elle ne se borne pas à les violer, mais qu’elle met en cause le fondement même de leur validité.
La richesse du possible
Le bouillon de culture de la désobéissance civile, ce sont les conflits sociaux qui ne se manifestent pas uniquement comme protestation, mais comme abstention, comme fuite.
Il suffit de penser – qu’on se souvienne de ce que l’on a dit plus haut à ce propos – à la fuite massive par rapport au régime de l’usine, mise en acte par les ouvriers américains au milieu du XIXe siècle : s’avançant au-delà de la « frontière » pour coloniser des terres à peu de frais, ils saisirent l’occasion de rendre réversible leur propre condition de départ. Quelque chose de similaire est arrivé en Italie à la fin des années 1970, quand la force de travail des jeunes, contre toute attente, préféra le travail précaire et à mi-temps à l’emploi fixe de la grande entreprise. L’exode, ou la défection, est aux antipodes du désespoir contenu dans la formule : « on n’a rien à perdre que ses propres chaînes » ; il se fonde, donc, sur une richesse latente, sur une exubérance de possibilités, bref sur le principe du tertium datur. Mais quelle est, pour la multitude contemporaine, l’abondance virtuelle qui sollicite l’option fuite au détriment de l’option résistance ? Ce qui est en jeu, ce n’est évidemment pas une « frontière » spatiale, mais le surplus de savoirs, de communication, d’action commune virtuose qui sont impliqués dans le caractère public du general intellect. La défection donne une expression autonome, affirmative, en haut-relief à ce surplus, empêchant ainsi son transfert vers le pouvoir de l’administration étatique, ou sa configuration en tant que ressource productive de l’entreprise capitaliste. […]
Une socialisation en dehors du travail
La situation émotive de la multitude post-fordiste se caractérise par l’immédiate coïncidence de la production et de l’éthicité, « structure » et « superstructure », chambardement du processus de travail, technologies et tonalités émotives, développement matériel et culturel. Arrêtons-nous un instant sur cette coïncidence. Quelles sont les principales qualités que l’on exige d’un travailleur dépendant aujourd’hui ? L’habitude de la mobilité, la capacité à s’adapter aux reconversions les plus brutales, l’adaptabilité associée à un peu de débrouillardise, la souplesse dans le passage d’un ensemble de règles à un autre, l’aptitude à une interaction linguistique aussi banalisée que plurilatérale, la familiarité à se repérer au milieu d’un nombre limité de solutions alternatives. Ces qualités ne sont pas le fruit de la mise au pas industrielle, mais plutôt le résultat d’une socialisation qui a son centre de gravité en dehors du travail. Le « professionnalisme » effectivement requis et offert se compose de qualités qui s’acquièrent dans un séjour prolongé à un stade pré-travail ou précaire. En d’autres termes : dans l’attente d’un emploi, se développent des talents génériquement sociaux et ces habitudes de ne pas prendre d’habitudes durables, qui deviendront, une fois qu’on aura trouvé un emploi, de véritables « outils de travail ».
L’entreprise post-fordiste met à profit cette habitude de ne pas avoir d’habitudes, cet entraînement à la précarité et à la variabilité. Mais ce qui est décisif, c’est la socialisation (par ce terme je désigne le rapport au monde, aux autres et à soi-même) qui advient essentiellement à l’extérieur du travail, une socialisation essentiellement hors travail. Ce sont ces chocs urbains dont parlait Walter Benjamin, la prolifération des jeux de langage, la variation infinie des règles et des techniques qui constituent le gymnase où l’on forge les qualités et les exigences qui, par la suite seulement, deviendront qualités et exigences « professionnelles ». […]
L’opportunisme au travail comme dans l’action politique
L’opportunisme prend racine dans cette socialisation hors travail marquée par des virages brusques, des chocs perceptifs, des innovations permanentes, par une instabilité chronique. Est opportuniste celui qui affronte un flux de possibilités toujours interchangeables, en étant disponible au plus grand nombre d’entre elles, en se pliant à la plus proche pour ensuite passer promptement de l’une à l’autre. C’est là une définition structurelle, sobre, non moraliste de l’opportunisme. Ce qui est en question, c’est une sensibilité aiguë pour les chances passagères, une familiarité avec le kaléidoscope de l’opportunité, une relation intime avec le possible en tant que tel. Dans le mode de production post-fordiste, l’opportunisme acquiert un incontestable relief technique. C’est la réaction cognitive et comportementale de la multitude contemporaine au fait que la praxis n’est plus ordonnée selon des directives uniformes, mais présente un degré élevé d’indétermination. À l’heure actuelle, justement, la capacité de se débrouiller au milieu d’opportunités abstraites et interchangeables constitue une qualité professionnelle dans certains secteurs de la production post-fordiste, là où le processus de travail n’est pas réglé en fonction d’un seul objectif particulier, mais d’une classe de possibilités équivalentes, à spécifier au fur et à mesure. La machine informatique n’est pas un moyen pour arriver à une fin univoque, mais prémisse à des élaborations successives et « opportunistes ». L’opportunisme se fait valoir comme l’indispensable ressource chaque fois que le processus de travail concret est envahi par un « agir communicationnel » généralisé, sans plus s’identifier, donc, avec le seul « agir instrumental » muet; ou aussi, reprenant un thème que j’ai déjà abordé, chaque fois que le Travail inclut les traits saillants de l’Action politique. Au fond, qu’est-ce que l’opportunisme si ce n’est une qualité de l’homme politique ?
L’affirmation de soi en dernière instance
Le cynisme aussi est lié à l’instabilité chronique des formes de vie et des jeux de langage. Cette instabilité chronique met en lumière, au travail comme dans le temps libre, les règles strictes qui structurent artificiellement les champs d’action. La situation émotive de la multitude se caractérise justement par l’extrême proximité du « Nombre » par rapport aux règles qui innervent les contextes particuliers. À la base du cynisme contemporain, il y a le fait que les hommes et les femmes font surtout l’expérience de règles plus que de « faits », et cela bien avant que d’expérimenter des événements concrets. Mais faire l’expérience directe de règles, signifie aussi reconnaître qu’elles sont conventionnelles et infondées. Donc, on n’est plus immergés dans un « jeu » prédéfini auquel on participe avec une adhésion réelle, mais on n’aperçoit plus désormais dans les « jeux » particuliers, destitués de toute évidence et de tout sérieux que le lieu de l’immédiate affirmation de soi. Affirmation de soi d’autant plus brutale et arrogante, en somme cynique, qu’on se sert, sans illusion, mais avec une adhésion parfaite dans l’instant, de ces mêmes règles dont on a perçu le caractère conventionnel et instable. […]
Le bavardage
contemporain
La crise du paradigme référentialiste est à l’origine des mass media. Une fois libérés de la charge de correspondre point par point au monde non linguistique, les énoncés peuvent se multiplier indéfiniment, en se générant entre eux. Le bavardage est non fondé. Et cela explique le caractère labile, et quelquefois vide, de l’interaction quotidienne. Toutefois, ce non-fondé autorise aussi, à chaque instant, l’invention et l’expérimentation de nouveaux discours. En plus de refléter et de transmettre ce qui est, la communication produit elle-même un état des choses, des expériences inédites, des faits nouveaux. Je suis tenté de dire que le bavardage ressemble à un bruit de fond : insignifiant en soi (à la différence des bruits liés à des phénomènes particuliers, par exemple une moto à pleine vitesse ou une perceuse), il offre pourtant une trame dont on peut tirer des variantes significatives, des modulations inédites, des articulations imprévues.
Le bavardage est performatif : les mots y déterminent les faits, les événements, l’état des choses. Ou, si on veut, c’est dans le bavardage que l’on peut reconnaître le performatif de base : pas « Je parie » ou « Je jure » ou « Je prends cette femme pour épouse », mais, avant tout, « Je parle ». Dans l’assertion : « Je parle », je fais quelque chose en le disant, et, en plus, je déclare ce que je fais pendant que je le fais. […]
On n’exige pas du travailleur des phrases standard mais un agir communicationnel informel, souple, susceptible d’affronter les éventualités les plus diverses (avec une bonne dose d’opportunisme, attention !). Pour utiliser les termes de la philosophie du langage, je dirais que ce qui est mobilisé, ce n’est pas la parole mais la langue ; la faculté même de langage, pas ses applications spécifiques. Cette faculté, c’est-à-dire la capacité générique d’articuler toute sorte d’énoncés, acquiert une importance empirique précisément dans le bavardage informatique. Là, en fait, ce n’est pas tellement « ce que l’on dit » qui importe, mais le « pouvoir-dire » pur et simple. […]
Le travail post-fordiste demande de la curiosité
Pour Walter Benjamin, la curiosité en tant que rapprochement par rapport au monde, dilate et enrichit les capacités perceptives des hommes. La vision mobile du curieux, qui s’effectue par l’intermédiaire des mass media, ne se limite pas à recevoir passivement tel spectacle donné, mais au contraire, reconsidère chaque fois quoi voir, ce qui mérite d’être au premier plan et ce qui doit rester à l’arrière-plan. Les médias exercent les sens à considérer le connu comme si c’était de l’inconnu, c’est-à-dire à entrevoir « une marge de liberté énorme et imprévue » jusque dans les aspects les plus infimes et les plus répétitifs de l’expérience quotidienne. Mais en même temps, ils exercent les sens à la tâche inverse : considérer l’inconnu comme du connu, acquérir une certaine familiarité avec l’inattendu et le surprenant, s’habituer à l’absence d’habitudes solides. […] La curiosité médiatique est l’apprentissage sensoriel d’artifices techniquement reproductibles, perception immédiate de produits intellectuels, vision corporelle de paradigmes scientifiques. Les sens – ou, mieux, la « concupiscence de la vue » – s’approprient une réalité abstraite, c’est-à-dire des concepts matérialisés en techniques, sans s’avancer avec attention mais en faisant montre de distraction. […]
Le travail est interaction
Le processus de travail n’est plus taciturne, il est loquace. L’« agir communicationnel » n’a plus son terrain privilégié dans les relations éthico-culturelles et dans la politique. Il déborde au contraire du contexte de la reproduction matérielle de la vie. Inversement, la parole dialogique s’installe au cœur même de la production capitaliste. Saussure et Wittgenstein, puisqu’ils ont réfléchi à fond sur l’expérience linguistique, ont davantage à nous apprendre sur l’ « usine loquace » que les économistes professionnels.
Une partie du temps de travail de l’individu est destinée à enrichir et à développer la coopération productive, c’est-à-dire la mosaïque dont elle constitue une pièce. Le devoir du travailleur, c’est d’améliorer et de faire varier le lien entre son propre travail et les prestations des autres. C’est ce caractère réflexif de l’activité de travail qui fait qu’en elle les aspects linguistico-relationnels prennent une importance grandissante ; qui fait aussi que l’opportunisme et le bavardage deviennent des outils de premier plan. […]
L’intellectualité de masse ou la multitude
L’intellect en général, c’est-à-dire les attitudes les plus génériques de l’esprit : la faculté de langage, la disposition à l’apprentissage, la mémoire, la capacité d’abstraction et de faire des corrélations, la propension à l’autoréflexion, n’a rien à faire avec les œuvres de la pensée (livres, formules algébriques, etc.) mais plutôt avec la simple faculté de penser et de parler. La langue (comme l’intellect et la mémoire) est ce que l’on peut concevoir de plus courant et de moins « spécialisé ». Ce n’est pas l’homme de science, mais le simple locuteur qui est un bon exemple d’intellectualité de masse. Cette dernière n’a rien à voir non plus avec une nouvelle « aristocratie ouvrière » et, en fait, elle en est même aux antipodes. À y regarder de plus près, l’intellectualité de masse ne fait que donner toute sa vérité, pour la première fois, à la définition de la force de travail par Marx « la somme de toutes les attitudes physiques et intellectuelles qui existent dans la corporéité ». […] Les aspects caractéristiques de l’intellectualité de masse, disons son identité, ne peuvent pas être repérés en relation avec le travail, mais, en premier lieu, sur le plan des formes de vie, de la consommation culturelle, des usages linguistiques. Toutefois, et c’est l’autre face de la médaille, quand la production n’est plus du tout le lieu spécifique de l’identité, à ce moment-là précisément, elle se projette sur tous les aspects de l’expérience, subsumant en elle les compétences linguistiques, les penchants éthiques, les nuances de la subjectivité.
L’intellectualité de masse est une composante fondamentale de l’accumulation capitaliste actuelle. L’intellectualité de masse (un autre nom pour la multitude) est au centre de l’économie post-fordiste précisément parce que son mode d’être échappe complètement aux concepts de l’économie politique.
Références bibliographiques
Arendt H. (1958), « Qu’est-ce que la liberté ? », dans La Crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972
Arendt H. (1961), Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, Paris, 1961
Austin J. (1962), Quand dire, c’est faire, Seuil, Paris, 1970
Benjamin W. (1936), « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », in Œuvres III, « Folio Essais », Gallimard, Paris, 2000.
Benveniste E. (1970), « L’appareil formel de l’énonciation », in Problèmes de linguistique générale, II, Gallimard, Paris, 1974
Bianciardi L. (1962), La vita agra, Rizzoli, Milan, 1962
Debord, G. (1967), La Société du spectacle, Buchet-Chastel (première édition) ; Gallimard, Paris, 1992
Foucault M. (1989 post.), Résumé des cours 1970-1984, Julliard, Paris, 1989
Freud S. (1919), « L’inquiétante étrangeté » in Essais de psychanalyse appliquée, Gallimard, 1933
Gorz A. (1997), Misère du présent, richesse du possible, Galilée, Paris, 1997
Habermas J. (1968), « Travail et interaction » in La Technique et la science comme « idéologie », traduit de l’allemand et préfacé par Jean-René Ladmiral, Gallimard, Paris, 1973
Hirschman A. O. (1970), Défection et prise de parole, Fayard, Paris, 1995
Kant I. (1790), Critique de la faculté de juger in Œuvres philosophiques II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1984
Marx K. (1867), « La théorie moderne de la colonisation », Le Capital, livre I in Œuvres/Économie I, édition établie par M. Rubel, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968
Marx K. (1905), « Principes d’une critique de l’économie politique », in Œuvres/Économie II,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968
Marx K. (1932 post.), « Les Manuscrits de 1844 », in Œuvres/Économie II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968
Marx K. (1933 post.), Le Capital, Livre I, chapitre VI inédit, in Œuvres/Économie II, « Matériaux pour l’économie », Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968
Marx K. (1939-1941 post.), « Grundrisse » in Œuvres/Économie II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968
Merleau-Ponty M. (1945), Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945
Rifkin J. (1995), La Fin du travail, La Découverte, Paris, 1996
Virno P. (1994), Miracle, virtuosité et « déjà vu ». Trois essais sur l’idée de « monde », éditions de l’éclat, Combas, 1996
Virno P. (1999), Le souvenir du présent. Essai sur le temps historique, éditions de l’éclat, Paris, 1999
Weber M. (1919), « Le métier et la vocation d’homme politique » in Le Savant et le politique, Librairie Plon, Paris, 1959
1 Cet article est composé d’extraits du livre de Paolo Virno, Grammaire de la Multitude, Pour une analyse des formes de vie contemporaines, traduit de l’italien par Véronique Dassas, et publié en France par Les Éditions de l’Éclat. Version lyber : www.lyber-eclat.net/lyber/virno4/grammaire01.html
Extraits sélectionnés par Anne Querrien