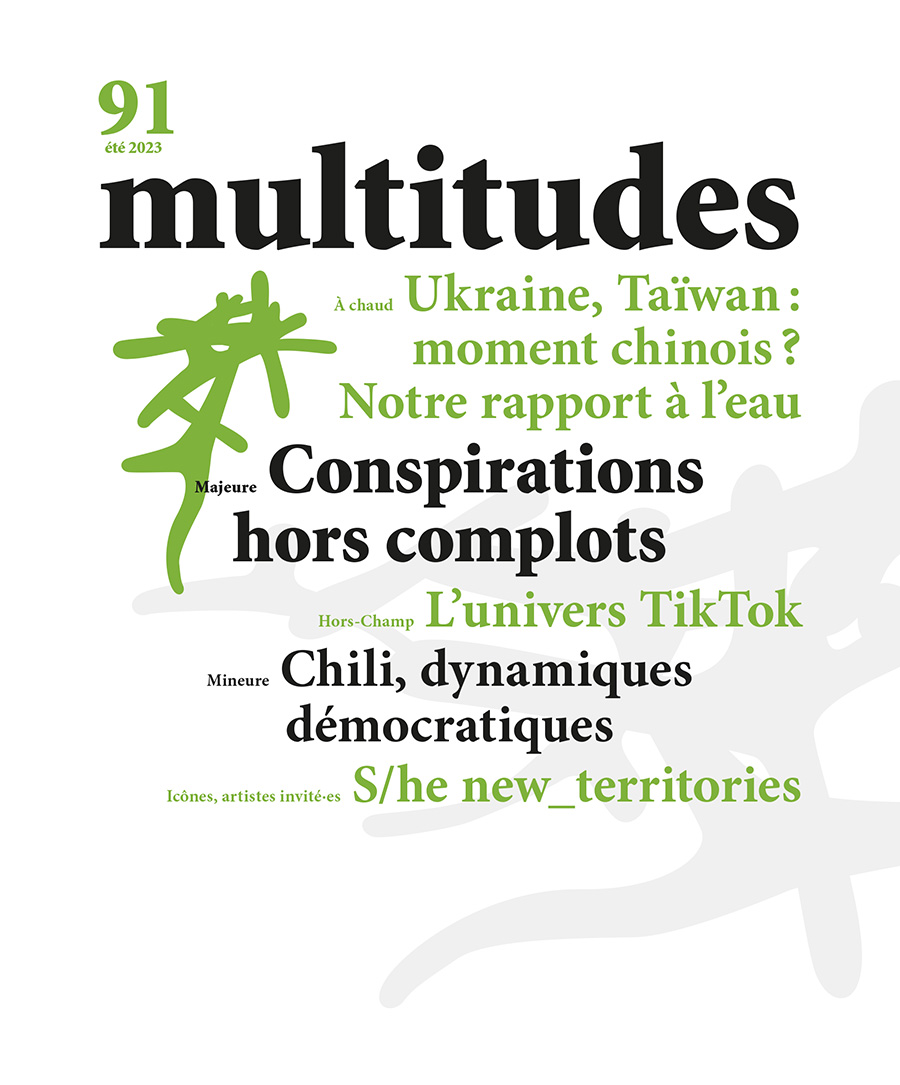Ce qui caractérise notre époque de changements et de transitions apparents, c’est l’incertitude et notre capacité à éviter les dissensions1. La combinaison des vestiges d’une pandémie en constante mutation et d’une société hyper-digitalisée, avec l’action non coordonnée des mouvements sociaux qui tentent de remettre en question l’ordre planétaire, nous amène à penser que nous vivons sur un seuil. D’une part, l’épuisement des catégories qui façonnent nos formes et nos liens, et donc nos relations avec les autres êtres vivants, la technologie et l’espace. D’autre part, l’impuissance qui s’accumule lorsque nous percevons que les structures restent intactes, bien que tout change et s’épuise.
Au Chili, après le 18 octobre 2019, les tensions qui fracturaient secrètement la coexistence sociale depuis la dictature de Pinochet se sont accentuées. Les revendications exprimées dans l’occupation massive et ininterrompue des rues ont été institutionnellement canalisées dans un accord signé le 15 novembre par la majorité des partis politiques, dont le seul objectif déclaré était d’initier un processus constituant. La classe politique a réagi avec désespoir au délire violent manifesté dans les rues par les forces publiques et les groupes de choc, le président Piñera a déclaré la guerre au peuple et le Congrès a rapidement proposé la rédaction d’une nouvelle constitution comme porte de sortie.
Dans ce contexte, la 15e Biennale des arts médiatiques s’est proposée d’aborder les relations entre art, science et société. Parallèlement à l’installation d’œuvres donnant forme à l’image du « Seuil », une nouvelle version de la Mandragore, une technologie de conversation utilisée auparavant pour faciliter et guider la conversation autour de thèmes socialement urgents comme, par exemple, la crise écologique, a été installée dans une salle rebaptisée « Jardín Editorial » du Museo de Arte Contemporáneo de Chile (MAC). À cette occasion, elle a été intitulée Mandrágora Constituyente (Mandragore constituante), car elle se concentre sur le processus politique en cours et a été conçue sur la base de deux idées : la première est que le désaccord n’annule pas la conversation, mais la favorise, et la seconde est que la connaissance de la réalité n’est pas indépendante de la manière dont elle est lue.
Conformément aux instructions découlant de ces idées, d’innombrables parties (de jeu) – à l’intérieur et à l’extérieur du musée – ont été organisées. L’ invitation à y participer étant ouverte, la Mandragore Constituante a permis à tout un chacun, sans aucune exigence, d’utiliser le langage constitutionnel. Ainsi, la pratique même du jeu a montré que le sens des mots avec lesquels une Constitution est écrite n’est pas fixé à l’avance, mais est déterminé par une collectivité dont les membres n’ont pas besoin d’accréditer une quelconque expertise. Chacun des jeux a été enregistré sur des supports variés afin de constituer une archive.
Habiter le seuil
Au Chili, d’octobre 2019 à aujourd’hui, huit élections ont été organisées. Le plébiscite du 25 octobre 2020 était inédit : il s’agissait de décider si nous devions écrire une nouvelle Constitution et, dans l’affirmative, quelle devait être la composition de l’organe appelé à rédiger la proposition au nom du peuple. Cependant, pour atteindre le chiffre écrasant de 78,31 % de votant·es en faveur de la rédaction d’une nouvelle constitution, le chemin à parcourir a été semé d’embûches. La méfiance à l’égard de la classe politique, les plaintes pour violation des droits de l’homme contre les forces de l’ordre et les accusations contre des citoyen·nes d’avoir organisé l’incendie des stations de métro de Santiago n’ont pas disparu. L’ émergence de la pandémie de Covid‑19 a été présentée comme l’excuse idéale pour le gouvernement de prolonger l’état d’urgence déjà déclaré en raison des manifestations qui, à l’image des chorégraphies, avaient lieu tous les vendredis sur la « Plaza de la Dignidad », ainsi rebaptisée.
L’ atmosphère nébuleuse ressentie dans diverses parties du pays avait atteint la 14e version de la Biennale elle-même, qui a commencé son cycle d’exposition en août 2019 avec l’installation de la sculpture restituée de Carlos Ortúzar, El cuarto mundo (Le quatrième monde). Cette sculpture en fer de plus de quatre mètres de haut a été volée par la junte militaire le 12 septembre 1973 sur la façade de la CNUCED III, le bâtiment qui servait de centre d’opérations de la junte après la destruction du Palacio de La Moneda.
La Biennale a ensuite pris le nom de la sculpture comme une invocation de la tentative de l’Unité Populaire de dépasser la notion de tiers monde, et de positionner le projet politique et économique de Salvador Allende comme une méthode pour cesser de comprendre la biodiversité comme une ressource infinie.
Le 17 octobre, l’exposition officielle de la Biennale s’ouvre au Museo Nacional de Bellas Artes, et le lendemain, c’est l’explosion sociale. Le quatrième monde et les notions qui l’entourent se déploient chaotiquement dans les rues comme une mosaïque de revendications, sans narration claire, perturbant la vie quotidienne d’une communauté catatonique, réclamant d’une part la fin de la transition, et d’autre part, vénérant simplement le chaos.
Un mois avant l’« Estallido », dans la salle d’exposition du Centro Cultural Gabriela Mistral2 – adjacente à la sculpture – à quelques mètres de la Plaza de la Dignidad, la Biennale avait organisé une rétrospective de l’artiste allemande Cornelia Koch, exposition qui a dû être retirée immédiatement après le 18 octobre. Plusieurs tentatives de destruction du bâtiment du centre culturel en ont fait l’un des épicentres des vives protestations. La salle étant vide, il fut décidé de fonder un atelier éditorial appelé Búnker, qui la reconvertit en dépôt où l’on commença à compiler secrètement des vidéos, des photos, des toiles et des boucliers, parmi d’autres débris laissés par les manifestations hebdomadaires. Cet exercice de collecte a lentement conduit à l’identification d’un modèle, d’une trace ténue au milieu du chaos.
Pour situer l’opération et ordonner les preuves, une généalogie de l’émancipation a été esquissée sur l’un des murs du Bunker, cartographiant les différentes tentatives historiques de créer une constitution participative, et identifiant les explications de leurs échecs, afin de situer les raisons de l’explosion (l’« Estallido ») dans le temps. Afin de comprendre l’inconscient collectif de la nation, à l’instar de l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, les images de l’histoire de l’art ont été remplacées par les histoires officielles et alternatives du Chili, pour conclure avec une représentation visuelle anonyme et spontanée de la révolte.
Après plusieurs semaines de compilation de matériel, d’assemblées, de discussions et de contestations qui ont tenté de rassembler les matériaux graphiques qui se déversaient dans les rues sans direction claire, la possibilité s’est ouverte que l’entropie soit considérée comme le seul fil conducteur qui permette à la Biennale de maintenir une ligne éditoriale. De cette compilation d’images et de l’urgence de démêler les tensions qui se développaient, est née la nécessité de créer des espaces de conversation.
Le dispositif de la Escuela de Mediación (École de médiation) « Mandrágora », est alors réapparu pour éditer conceptuellement et visuellement le moment historique qui débordait, alors que la chronologie esquissée dans le Búnker montrait la proximité de la commémoration du 50e anniversaire du coup d’État. Une explosion future semblait inévitable. C’est la gestation de la « Mandragore Constituante », qui a dû attendre plusieurs mois pour se concrétiser : la promesse d’une Nouvelle Constitution qui a momentanément dilué le délire a dû être reportée en raison de l’incertitude provoquée par la propagation du virus. L’ itinéraire orchestré par les partis politiques – qui considéraient que le premier jalon était la décision du peuple chilien de laisser derrière lui la Constitution léguée par la dictature – a dû être reporté de six mois. Entre-temps, il a fallu faire face aux effets mortels de la pandémie.
Les quarantaines prolongées nous ont contraints à réduire nos interactions à ce qui peut être supporté par des écrans, changeant ainsi nos modes de relation. En un clin d’œil, l’absence et la virtualité ont remplacé l’effervescence inhabituelle qui régnait dans les rues. Mais nous avons aussi été témoins d’effets inattendus : certaines villes vidées par la maladie ont accueilli des hordes d’êtres vivants qui, il n’y a pas si longtemps, se distinguaient par le fait d’être déclarés en état d’extinction.
On a ressenti une dynamique d’altération plus prononcée que celle à laquelle nous sommes habitués. Une sorte de passage d’un seuil dont on ne connaît pas l’au-delà et que l’on imagine donc avec autant d’anxiété que d’inquiétude.
La rigidité des mesures sanitaires s’étant partiellement atténuée et le parcours constitutionnel ayant avancé, la 15e Biennale des arts médiatiques s’est interrogé, fin 2021, sur les manières d’habiter cet espace diffus. Ainsi, elle a été configurée sur la base d’œuvres qui, pour paraphraser le texte de son conseil d’administration, convoquent des discursivités critiques qui deviennent le matériau de cette instabilité des limites à tous les niveaux de la production culturelle, en particulier celles qui séparent l’humain du non-humain, la vie de la mort, le religieux du profane, les transformant en zones sensibles pour l’articulation de techniques de coexistence et de modèles politiques transformés3.
Dans ce contexte, la Mandrágora Constituyente était un jeu qui opérait ces limites : les personnes qui visitaient le « Jardín Editorial » étaient confrontées à une scénographie formée par une table à quatre étages en bois sur laquelle étaient placés un plateau et trois jeux, des cartes vierges, un sablier, quelques crayons et de la laine colorée, un dépliant avec des instructions et un quartz au centre. Ces éléments étaient entourés de plusieurs pupitres-ardoises sur lesquels on lisait des phrases écrites à la craie, exprimant la vivacité des conversations qui étaient enregistrées et, par conséquent, qui changeaient au fur et à mesure que le temps de l’exposition s’écoulait.
De cette manière, la Mandragore est devenue une instance charnière entre le Musée et la Convention constitutionnelle. Ainsi, pendant que le corps constitutif siégeait, de multiples jeux ont été organisés, à l’intérieur et à l’extérieur du « Jardin éditorial », qui ont permis de convertir l’esprit incarné par les œuvres du Seuil en une pratique ludique ouverte à tous ceux qui souhaitaient y participer.
Dans le cas des jeux organisés à l’intérieur du « Jardin éditorial », afin d’inspirer la conversation entre les participants, la salle a été complétée par une vitrine et une projection de l’exposition Momento Constituyente, del pueblo a la ciudadanía, qui s’est tenue entre 2017 et 2018 dans la Sala Museo Gabriela Mistral de la Casa Central de l’Universidad de Chile. Cette exposition, organisée par les Archives centrales Andrés Bello de la même université, rassemblait une série de documents tels que les lettres originales de l’« Occupation de l’Araucanie », ainsi que d’autres publications telles que les « Livres de questions et de constitutionnalistes ».
Les racines de la Mandragore
La « Mandrágora Constituyente » a été une tentative de poursuivre la séquence commencée en 2019 à partir du travail de l’École de l’Intuition de la Corporation chilienne des Arts Vidéo et Électroniques. Cette plateforme de communautés et d’apprentissage a promu un programme qui crée et développe des artefacts pour faciliter les processus de conversation autour de questions de pertinence sociale, politique, éducative, environnementale et culturelle. Les éditions précédentes se sont concentrées sur des questions telles que la configuration des villes, l’éducation artistique et les défis de l’anthropocène et de la crise climatique.
Grâce à un plateau de jeu, à des paquets de cartes et à des dynamiques qui articulent les connaissances, les opinions et les propositions des participants, la « Mandrágora » ouvre des espaces de rencontre qui favorisent un échange non seulement dialogique, mais aussi sensible et intuitif. Le jeu s’inspire du mouvement « Mandragorista », un collectif de poètes chiliens des années 1930 formé par Teófilo Cid, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa et Jorge Cáceres, qui visait à intégrer la poésie et l’intuition dans la production de la pensée politique. Son nom fait référence à la plante aux vertus psychomagiques qui était très populaire au Moyen-Âge. « Elle engourdit le premier jour et rend fou le second », disait-on à l’époque. La conversation, comme la technologie végétale de ces plantes, a le pouvoir d’ouvrir nos sens vers quelque chose qui dépasse les individus qui y participent.
S’inspirant de ces deux références, la « Mandrágora » propose des pistes d’édition collective, intégrant des langages contemporains à des savoirs divers, des héritages symboliques et des poétiques ancestrales. Sa condition d’artefact ludique, avec des règles conçues à partir de ce que le thème dicte, permet aux gens de se rencontrer dans une conversation nourrie par leurs propres connaissances et affections et, par conséquent, exempte de la crainte – très répandue depuis la dictature jusqu’à l’explosion – qu’un désaccord puisse surgir.
Dans sa première édition, Mandrágora, los secretos de la naturaleza (les secrets de la nature), l’invitation était de créer une histoire collective et de générer des recommandations pour les écoles, les musées, les centres culturels et les institutions publiques et privées en général, sur notre relation avec les écosystèmes dans une perspective d’éducation intégrée et artistique. Elle a été mise en œuvre dans le cadre de la célébration de la 7e Semaine de l’éducation artistique, organisée sous le slogan « Art et nature. Conscience en action » (2019), par le ministère des Cultures, des Arts et du Patrimoine, l’UNESCO, le ministère de l’Éducation, Balmaceda Arte Joven et l’Université du Chili.
Par la suite, s’est développé le projet Mandrágora, ville créative dans le but de définir des propositions pour transformer Santiago en une ville créative des arts numériques selon les lignes directrices de l’UNESCO. À cette fin, les concepts clés à intégrer dans le jeu étaient « ville », « arts », « sciences » et « culture numérique ».
Ensuite, dans le contexte de l’explosion sociale d’octobre 2019, « Mandrágora devenirs ». Cette édition a cherché à observer l’événement et son déroulement dans un éternel présent, en prenant conscience de l’impossibilité de s’en distancier. Nous avons été invités à le regarder comme un moment suspendu dans le temps, dans lequel s’exprime la puissance de l’instituant et du constituant : la violence, la mort et la peur émergent, mais aussi l’éveil, le mutualisme et la symbiogenèse. Le montage, l’amour, le lumpen et le quotidien sont montrés en profonde friction pour mobiliser et faire circuler un imaginaire collectif renouvelé.
En 2020, lors de sa quatrième édition, quelques minutes avant le déclenchement de l’expérience pandémique, « Mandragore, art et science » est parue. L’objectif était de cartographier les acteurs locaux pertinents pour la production de connaissances entre ces deux disciplines, d’identifier les relations existantes et inexistantes et d’esquisser des lignes directrices, des recommandations et des propositions.
La conception du jeu dans chacune des éditions de la Mandrágora est déterminée par la thématique et surtout par les croisements qu’elles favorisent4. C’est l’objet de la conversation lui-même qui dicte les règles et la dynamique du jeu : la technologie est modifiée en fonction de ce que la situation exige, de sorte que la méthodologie n’est pas quelque chose d’imposé de l’extérieur, mais s’écoule en fonction de la réalité du moment, qui est à la fois son objet et son produit.
Expérience ludique constituante
Forte de cette expérience accumulée, la dernière édition de la « Mandrágora » a été une invitation à la réflexion et au dialogue sur le processus constituant en cours entre les années 2021 et 2022 dans une perspective ludique. Par l’association de différents concepts, faits et droits, elle favorise la construction d’histoires qui expriment le point de vue de chaque acteur sur les possibilités d’organisation collective et sur l’impact de ces visions sur la vie quotidienne.
Les participants sont appelés à rassembler leurs connaissances, leurs idées, leurs expériences et leurs propositions dans un espace de communication ritualisé, afin d’analyser les possibilités d’imaginer une nouvelle façon de vivre ensemble dans le cadre du processus constituant. L’ objectif est ici de mobiliser les réflexions autour des trois axes proposés dans des jeux de cartes crées pour l’occasion : les faits, les concepts et les droits. Les lectures qui émanent des relations possibles ou des dissonances des cartes placées sur le plateau cherchent à générer un dialogue et/ou un débat sur les histoires que chaque joueur exprime, élargissant ainsi les limites de ce qui est pensé, ressenti ou imaginé dans l’espace constituant. La méthodologie a une durée moyenne de 1 heure 30 et le kit de jeu se compose d’un plateau dessiné avec six cercles concentriques, d’un sablier pour placer les interventions dans un cadre temporel et de trois paquets de cartes5.
Le premier paquet est composé de 50 concepts, tels que « solidarité », « culture », « terrorisme » et « famille ». Les idées qui émergent de l’interprétation de ces concepts par ceux qui jouent ont pour rôle de dessiner initialement certaines coordonnées de sens. Le deuxième jeu correspond à 32 événements récents connus de la population qui ont été extraits des archives de l’actualité et qui mettent de la tension dans le jeu. Ces événements sont présentés comme des vestiges de la vie sociale qui renvoient à la fois aux problèmes des citoyens et à des événements spécifiques qui peuvent être lus à plusieurs niveaux. Le troisième jeu contient une batterie de 32 droits fondamentaux tirés de différentes constitutions en vigueur dans divers pays du monde, présentes dans les archives numériques de la Bibliothèque nationale du Chili, et dont l’objectif est de projeter le concept et la lecture du fait vers l’exercice constituant. Un groupe d’étudiants en droit de l’Université du Chili a participé à la création des platines et à la création des jeux au MAC (musée d’art contemporain), dans le cadre du collectif « Estudios Carnelutti » : Milán Palma, José Duque Vega, Ignacia Yanes, Cinthya Cortés, Sebastián Aguilera, Sebastián Diez de Medina, Sofía Sameshima.
Certaines idées sont des concepts et ont des prétentions à la définition, à l’établissement de coordonnées et de priorités. Les concepts servent à organiser la pensée. Les droits se réfèrent à la normativité, à ce à quoi nous aspirons dans différents sens. Les droits sont l’allusion la plus intense au monde que nous espérons et ils avaient (et ont) un rôle central dans le processus. Les faits, quant à eux, concernent la rétrospection : des événements dans le temps et l’espace qui peuvent être connus grâce au langage. Les concepts, les droits et les faits permettent de comprendre à la fois le jeu, le langage de l’époque et le langage de la dispute et du processus constituant.
Le jeu commence lorsque le modérateur étale le terrain de jeu (plateau) et que les joueurs s’assoient autour, en plaçant leur laine (chaque joueur ou joueuse participe avec un bout de laine différente) dans le cercle le plus étroit. Au fur et à mesure des déplacements, les traces du désaccord ouvrent les traces de ce qui a été dit. Ainsi, l’idée que le désaccord est le mobilisateur des transformations est exprimée visuellement. Les joueurs choisissent une carte dans chaque paquet, les retournent et, en attendant leur tour, ils les disent d’abord et articulent ensuite leur propre récit, l’expression d’un point de vue particulier qui émerge de leurs propres connaissances, idées et expériences. Ce récit peut être le fruit d’une vision affirmative, critique ou dissonante de la relation entre les trois cartes.
Après avoir présenté son histoire aux autres participants, le joueur doit l’écrire de manière synthétique sur une carte vierge, en la laissant comme toile de fond du jeu et, à son tour, comme argument auxiliaire disponible pour être mis en relation avec les suivants. L’ espace de débat, de questions et de contre-questions est ouvert, et enfin un vote est organisé pour déterminer si l’histoire est convaincante, et elle doit être approuvée par les 2/3 des joueurs. En cas d’égalité, le modérateur est la personne qui peut trancher.
À la fin des trois tours d’histoires, les joueurs et joueuses choisissent l’une des « cartes à remplir d’histoires constituantes » qu’ils considèrent comme la plus pertinente pour le jeu, en la mettant en avant comme témoignage d’un processus de réflexion critique et de dialogue autour des accords et des désaccords de ceux et celles qui ont participé au jeu de la mandragore constituante et de sa confluence dans un espace éditorial en construction permanente.
Les réunions se sont déroulées dans divers espaces tels que le Musée d’art contemporain et le Palacio Pereira, bâtiment où se déroulait parallèlement la vraie Convention Constituante. Outre la pratique d’une version « oraculaire » dans l’espace public, la dynamique consistait à inviter les passants à se confronter au hasard des cartes et à explorer un concept présenté de manière aléatoire. Ils étaient ensuite invités à partager leur point de vue personnel sur la carte et à l’incorporer dans un enregistrement anonyme. Cette expérience a permis de constituer une vaste archive sonore, désormais transformée en mémoire de l’impulsion réfléchie du moment dans les rues de Santiago.
Pour une raison ou une autre, la partie n’a pas été terminée. Une grande majorité d’électeurs a rejeté le projet de constitution. Ce document ne contenait aucun droit susceptible d’être transformé en acte. Les raisons de cette défaite sont multiples et continuent de se manifester sous nos yeux. Il se peut que le ton doctoral de certains acteurs et actrices du processus ait été trop sophistiqué et obscène face aux réalités des pauvres et des marginaux qui regardaient à la maison la télévision ou Tik Tok. Tout était rempli de mensonges et d’exagérations, mais personne n’a été à l’abri de mentir.
Aujourd’hui, un autre jeu est en train de se jouer, celui-ci a des bords, douze piliers qui sont comme les douze tables de la loi ou les douze jeux avec lesquels Alphonse X, appelé « le Sage », voulait finir de compiler toutes les règles. Peut-être que ce processus est le même : une tentative de rassembler ce qu’il y a pour que tout continue, pour que la vie soit une impulsion à la pure inertie de notre propre destin.
1Nous remercions le groupe d’étude Carnelutti formé par Milán Palma, José Duque Vega, Ignacia Yanes, Cinthya Cortés, Sebastián Aguilera, Sebastián Diez de Medina, Sofía Sameshima, car leur collaboration a été cruciale pour la conception de la mandragore constitutive.
2Il est à noter que ce centre culturel à été construit dans le même emplacement que celui utilisé par la junte militaire après le coup d’état et qui correspondait, a son tour, au projet de ministère de la culture envisagé par Allende auparavant.
3Pour plus d’informations sur la Biennale, voir https://15.bienaldeartesmediales.cl/
4Pour plus d’information sur chaque édition et pour accéder gratuitement à leurs composantes, voir https://cchv.cl/madragoras-tecnologias-para-la-conversacion/
5Le manuel, les cartes et le tableau de la « Mandrágora constituyente » peuvent être téléchargés gratuitement à l’adresse suivante : https://cchv.cl/pestanas/mandragora-constitucional/