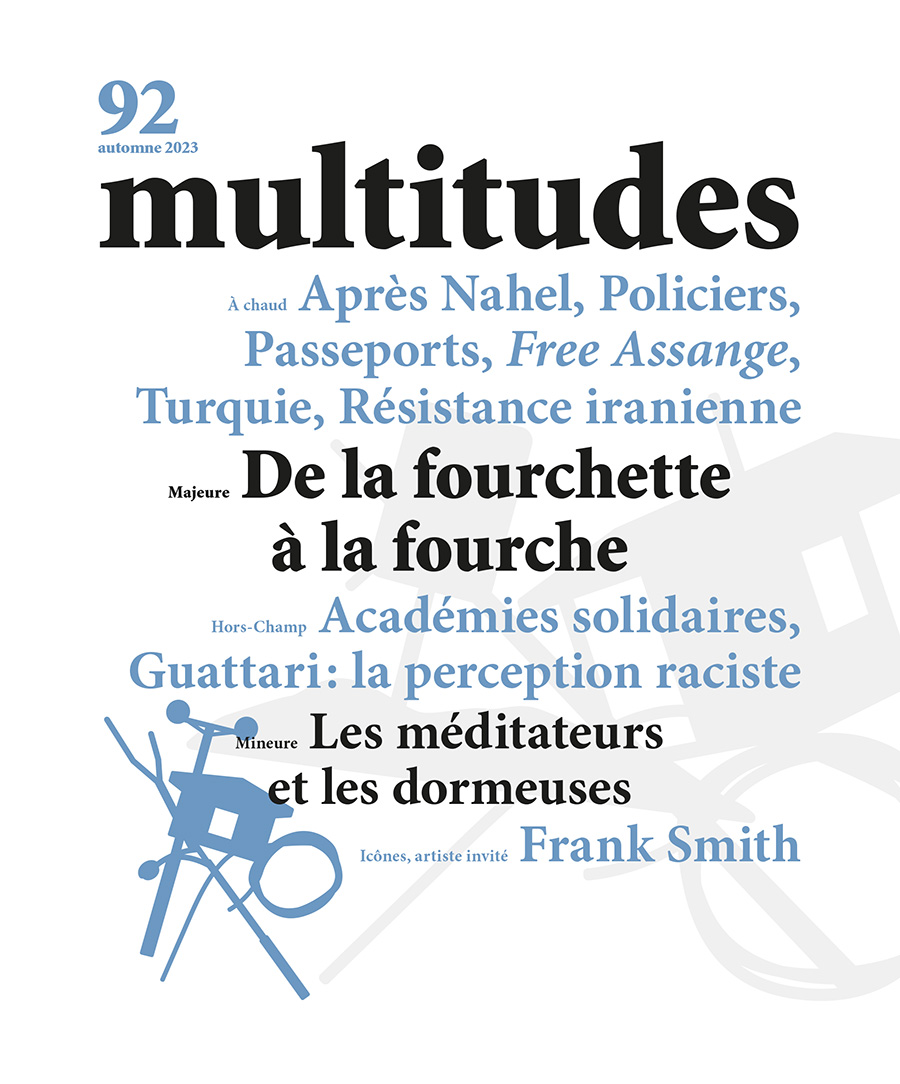Étroite bande de terre longue de quelque 248 km, la zone tampon séparant la République de Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée du Nord coupe la péninsule en deux depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Bordé de part et d’autre de pièges antichars, de clôtures électriques, de mines et de miradors, et gardé par deux armées prêtes au combat, l’endroit est interdit d’accès à toute présence civile.
Le Film du 38 e parallèle (56 minutes, 2023) se concentre sur la réalité plurielle, morcelée et discontinue de cette zone démilitarisée, afin d’interroger ses potentiels visuels, et par là même épuiser tout ce qui s’y donne à voir – à la limite des restrictions militaires, de l’accessibilité aux lieux et dans un contexte géopolitique tendu (tirs réguliers de missiles balistiques intercontinentaux par la Corée du Nord en direction de la mer du Japon). Le Film du 38 e parallèle tente ainsi de répondre à la question : que peut-on voir quand on n’en a pas le droit ?
Construit à partir d’une série de plans fixes de paysages, d’une durée de deux minutes chacun, tous orientés comme autant de points d’observation depuis le sud vers le nord, Le Film du 38 e parallèle a été réalisé au cours d’une douzaine d’incursions le long de la frontière, parcourue d’ouest en est. Des cartons noirs viennent briser ces relevés topographiques visuels pour témoigner de l’impossibilité de prendre des images à certaines positions : officiellement, il est interdit de filmer la Corée du Nord mais il est encouragé de « prier pour la paix à venir entre les deux pays ».
Du point de vue cinématographique, Le Film du 38 e parallèle consiste à évaluer le terme « borderscape » dans le contexte coréen, notion qui renvoie au complexe, ambigu et multiple, de la frontière et des paysages qui la constituent. Composé du mot « border » et du suffixe « -scape », le terme suggère, tout d’abord, une image mobile de la frontière, une réalité en devenir, qui change dans l’espace et dans le temps. En second lieu, le terme renvoie aux modalités de perception de cette frontière, au rôle des représentations visuelles, narratives et performatives dans la constitution de ses sens et de ses effets, à sa nature culturellement – et ici militairement – construite. Donner voix aux dynamiques frontalières, les rendre visibles, devient ainsi une pratique dissensuelle dans le sens proposé par Jacques Rancière : une pratique qui « fait voir ce qui n’a pas lieu d’être vu ». Dans l’effort de voir la séparation, invisible à l’œil nu, ce film veut montrer ce que la frontière elle-même a à montrer. Enregistrer des images là où cela a été possible, clandestinement, avec une caméra sur pied, en proximité de la ligne de démarcation militaire pour en détecter les vibrations visuelles et sonores. Se retrouver confronté à l’évidence de son existence physique, aux obstacles liés au passage des checks-points, aux multiples tours de contrôle, à la présence intimidante de l’armée et subir plusieurs interpellations militaires. Ces difficultés soulignent le sens de la séparation, de l’aliénation et de l’isolement forcé que le mur de barbelés édifié tout le long de la frontière crée entre les deux Corées. Le film veut déconstruire la matérialité de cette barrière frontalière pour en souligner la nature polymorphe et surtout le potentiel de sa pénétrabilité, son ouverture possible au passage.
Le Film du 38 e parallèle voudrait aussi rendre hommage à la cinéaste Chantal Akerman, réalisatrice du film documentaire De l’autre côté (2002), qui traite de la ligne de séparation érigée entre les États-Unis et le Mexique. Il a été présenté en avant-première le 22 juin 2023 au Centre Pompidou-Paris dans le cadre des rencontres « Trajectoire ».