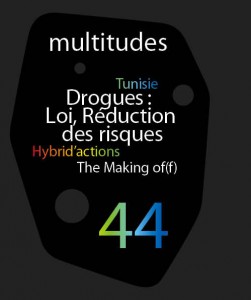Nous sommes dans l’ère du mix. Nous vivons et pensons sur une table de mixage, plus encore que de dissection[1]. Le mix n’est pas seulement stylistique, mais ontologique. En esthétique, il n’est pas seulement inhérent à chaque art, ne se contente pas de mêler éclectiquement différents styles ou genres (ce qu’en musique, par exemple, on appelle la « fusion », jazz-rock, rock-rap, etc.). Plus profondément, il va jusqu’à traverser les frontières entre les différents arts eux-mêmes. Jean-Luc Godard disait du cinéma qu’il est « l’art de faire de la musique avec de la peinture ». Il faudrait appliquer le même type de formule à toutes les pratiques artistiques nouvelles, souvent innommées, qui expriment l’esprit de notre temps. Notre art est ontologiquement hybride.
Hétérosis esthétique

Il n’y a rien de plus ancien que la recherche de synesthésies par lesquelles les ressources respectives des différents arts se prêtent mutuellement renfort, en faisant résonner les puissances du son, de l’image, du geste et de la parole les unes par les autres. L’art hybride de notre temps, s’il n’est certes pas radicalement nouveau, est cependant aussi loin que possible d’accomplir l’idéal romantique d’un « art total ». Dans la vision romantique, la séparation des arts était le symptôme d’une division plus profonde, celle de l’Un indifférencié originaire. Depuis le mot de Wagner, la Gesamtkunstwerk a ainsi été investie d’une valeur à la fois anthropologique et politique : contre la modernité mécanique, elle était censée restaurer l’unité organique de la vie, en réconciliant les différentes facultés de l’homme divisé entre elles et les différents hommes entre eux. Nietzsche a vu à Bayreuth comment ce fantasme de fusion tourne nécessairement à la domination du spectacle. La scène théâtrale soumet la musique et la poésie à la loi optique de la représentation, détournant leur puissance au service du symbolisme moral qui les surcode. L’interdisciplinarité contemporaine n’est pas une telle totalisation. Nous ne rêvons plus de l’Un. L’homme contemporain n’est pas divisé, mais morcelé, échantillonné, composé de fragments hétéroclites dont il se bricole une humanité d’arlequin. De même, le corps social connaît des conflits insolubles, des poussées de cruauté excroissante ou d’autodestruction qui le déchirent. L’hybride accède à une autonomie en tant que tel : il n’a pas besoin pour vivre d’intégrer les différences qui le constituent dans une totalité organique.
Le mix est-il un signe de vitalité ? Y a-t-il un effet d’hétérosis esthétique, une vigueur hybride ? « Dans les arts, les genres mêlés témoignent de la méfiance que leurs auteurs ont eue à l’égard de leur propre force : ils ont recherché des puissances alliées, des intercesseurs, des couvertures, – tel le poète qui appelle à son aide la philosophie, le musicien qui a recours au drame et le penseur qui s’allie à la rhétorique[2] ». C’est une pathologie typique du cinéma, qui couvre parfois sa méfiance à l’égard de la puissance propre de l’image derrière la puissance annexée de la musique, qu’il se soumet sans vraiment la transformer. Plus généralement, le credo bien-pensant du métissage qui domine l’époque relève en réalité d’une faiblesse du style[3]. L’effet d’hétérosis esthétique est le contraste. L’intensité du contraste ne se trouve pas seulement dans la conscience critique de l’ironie et du détournement, comme quand Guy Debord remplit les bulles des bandes dessinées d’aventure de textes situationnistes, ou comme dans les courts-métrages de George Franju, où le ton détaché de la voix off et la légèreté de la bande sonore sont en décalage avec la violence des images. C’est l’œuvre la plus propre de l’art hybride que de transmuer en contraste intense l’incompatibilité entre les ressources expressives hétérogènes qu’il emprunte, sans inhiber l’une par l’autre et sans les homogénéiser[4]. Tous les récits fantastiques du devenir sont des expériences de lutte à mort entre ce qui devient et ce que l’on devient. Le loup-garou n’atteint son point critique d’inquiétante étrangeté que dans les phases intermédiaires de sa mutation, où la bête et l’homme se chevauchent, quand la voix humaine s’enroue et s’enraye, quand les yeux jaunes percent dans le visage juvénile.
La BD comme art mineur
Les hybrides hommes-animaux ont toujours existé dans l’imaginaire artistique : hommes-lions, hommes-ours, hommes-fauves, femmes-poissons, femmes-léopards, etc. Mais leur force de suggestion a le plus souvent été ordonnée à une fonction symbolique, allégorique ou morale. Ils n’ont pu regagner toute leur intensité émotionnelle qu’en étant investis par l’art hybride. Il n’est en effet pas fortuit que les formes bâtardes d’expression artistique, rejetées comme marginales par la culture légitime normative, cinéma de genre, bande dessinée, roman de science-fiction, etc., se soient réappropriées ces figures ambiguës de notre imaginaire, comme si elles y trouvaient spontanément l’emblème de leur propre langage.
La bande dessinée est un art mineur par excellence. Il n’y a pas de technologie propre à la BD, comme, par exemple, le procédé cinématographique est propre au cinéma en tant qu’art. Le langage de la BD est impur : comme les guérilleros se font une artillerie hétéroclite des armes et des munitions qu’ils volent à l’armée qu’ils combattent, la forme BD est une symbiose de techniques disparates et parcellaires, à cheval sur le texte, le dessin, la couleur. Faut-il d’abord regarder le dessin ou lire le texte ? Au XIXe siècle, le précurseur Rodolphe Töpffer répond par avance à cette question, quand il commente ses « histoires en estampes » en écrivant : « Ce petit livre est d’une nature mixte. ( ). Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien ». La recherche d’une généalogie prestigieuse de la BD (fresques de Lascaux, peinture murale égyptienne, tapisserie de Bayeux[5]) indique peut-être que cette mixité, déniée par les clivages de la pensée moderne, est à la source de toute expression humaine. En voulant donner des lettres de noblesse à la BD, la tentation persiste cependant de la réduire à autre chose qu’elle-même, de réduire son hétérogénéité constitutive en surdéterminant l’une ou l’autre de ses dimensions : tentation picturale par l’usage expressionniste de la couleur (par exemple chez Barbier, Mattoti ou Blutch), ou, à l’inverse, tentation romanesque par le primat de la narration (« roman graphique », « littérature dessinée[6] »).
Quels que soient les efforts des auteurs pour la rendre adulte ou majeure, la force propre de la BD vient de ce qu’elle est essentiellement adolescente, toujours prise entre chien et loup, comme l’ado entre deux âges et entre deux états de son corps muant. Non pas qu’elle puisse être lue seulement par des mineurs, mais sa forme-protée épouse le processus adolescent dans tout son polymorphisme. Par le type de lecture polymorphe et rythmique qu’elle suscite, une BD fait entrer l’esprit dans un devenir-minoritaire dont l’adolescence éternelle est le prototype. Les mutants comme les X-Men expriment le rapport ambigu du devenir avec la norme de l’Homme majeur qu’il affecte. Tandis que le Pr Charles Xavier représente la tendance intégrationniste, Magnéto, autour de qui les « mauvais mutants » se rassemblent en confrérie, représente au contraire une tendance séparatiste, antihumaine[7]. Survivant de la Shoah, Magnéto est déchiré entre le spectre de la stigmatisation et de la persécution qui hante toutes les minorités, et le fantasme de purification raciale qui en est le contrecoup réactif. L’adolescence connaît également l’ambiguïté vitale qui la déchire entre l’exaltation narcissique de la santé virile et l’étrangeté monstrueuse de la mutation qui la repousse dans la solitude.
À la suite de Didier Anzieu, une psychanalyse de la BD interprète les cases, les cadres et les limites qui structurent la planche comme autant de contenants sur lesquels les enveloppes psychiques peuvent s’étayer, permettant aux adolescents de « se donner des représentations figurées de sensations, d’émotions et d’angoisses qu’ils éprouvent face aux transformations physiques dont leur corps est l’objet et aux mutations sociales où ils s’apprêtent à s’engager[8] ». Peut-on se satisfaire d’une telle interprétation ? Il est vrai que la ligne de plomb du dessin donne forme et contour à des forces pulsionnelles sub-représentatives. Mais loin de les soumettre à la cohésion du moi, la BD fait passer ces forces à travers la structure, la déstructurant de l’intérieur. À travers la surface du dessin, l’énergie libidinale circule, se transformant insensiblement d’une vignette à l’autre. La planche n’est pas un milieu organique étanche, chaque case y est ouverte, poreuse, comme le montrent les jeux formels avec les limites, par exemple la célèbre planche 21 dans Simbabbad de Batbad de Fred, ou « l’anti-case » dans L’origine de Marc-Antoine Mathieu. La BD n’est pas seulement un « art séquentiel[9] », c’est un art rythmique[10]. De même que la mutation génétique se définit comme modification de la séquence du génome, de même la BD est mutante en tant que déphasage ou syncope de la séquence structurelle qui l’encadre. Le rythme ne se définit pas par le découpage métrique de la durée en unités syntaxiques homogènes – les « vignettes » –, mais comme processus d’hétérogenèse. La répétition rythmique n’est pas uniformément pulsée par le quadrillage abstrait, elle est dédiée à une transformation continue qu’elle déploie invisiblement à travers la discontinuité des images. Les sauts par-dessus le « caniveau » qui sépare les vignettes font fluer la différence de potentiel d’une image à l’autre, comme le désir polymorphe d’un organe tumescent à l’autre.
La peste des ados
Black Hole de Charles Burns est typiquement un chef-d’œuvre mineur. Burns intensifie la « ligne claire » par le contraste avec la noirceur du contenu dont il l’investit. Dans ce noir et blanc de cauchemar, c’est comme s’il était toujours minuit. Les eaux où l’on se baigne sont noires comme la nuit intérieure qu’elles reflètent. Chez Burns, même Tintin aura la houppe noire. Black Hole mêle à l’angoisse pubertaire celle de l’épidémie : la mutation devient le symptôme imprévisible d’une maladie contagieuse, sexuellement transmissible, surnommée la « crève » (« The Bug ») ou « la peste des ados » (« The Teen Plague »). On tombe amoureux comme on tombe malade. Tandis que les ados dont les difformités sont les moins visibles peuvent continuer de participer à la vie sociale, les plus touchés, têtes sans visage, sont contraints de se cacher dans les bois, vivant une vie errante de pestiférés. Le trombinoscope du lycée est subverti par l’humour noir du dessin, qui, à travers les clichés photographiques souriants, imagine les excroissances, les protubérances et les éruptions varioliques les plus impressionnantes. Mais l’humour qui joue avec les codes du « teen horror genre » abrite ici le trouble de l’identité. La sexualité adolescente dans Black Hole n’est pas encore organisée par la loi génitale. Étranger à la coupe anatomique qui le schématise, le sexe féminin apparaît plutôt comme le ventre ouvert d’une grenouille disséquée en cours de biologie. Il s’ouvre dans le corps comme un organe indéterminé, comme une plaie dans la plante du pied ou une longue déchirure dans la peau du dos. Contrairement à une interprétation freudienne trop facile, les lèvres, les plaies, les estafilades et les branches enchevêtrées dans les bois ne se ramènent pas toutes symboliquement au sexe féminin comme unique foyer fantasmatique ; c’est à l’inverse l’organe sexuel qui apparaît au milieu d’un polymorphisme fondamental dont il n’est qu’un avatar, occurrence d’un trou noir vertigineux et aléatoire, qui peut soudain s’ouvrir n’importe où dans la matière du corps.
Le malaise de Black Hole détruit notre représentation anthropomorphique du sexe. Combien de devenirs-animaux silencieux traversent notre sexualité ! Combien d’animaux pullulent, combien d’essaims et de meutes vrombissent et vagissent sous les abominables aboiements humanoïdes des amants ! Faire l’amour, ce n’est pas ne faire qu’un. C’est composer une bête mutante à deux dos, à trois, à n dos, n pattes, n bouches sphinctériennes qui respirent machinalement, orifices polyvalents, toutes griffes dehors. La vie sexuelle n’est pas solaire, mais lunaire, lycanthropique. Elle est inséparable de l’inquiétante étrangeté de ces devenirs-animaux que l’Homme normal, adulte et sain, cherche à conjurer par le plaisir, en pliant la sexualité à la loi de l’organisme. L’homme aux loups analysé par Freud voit les jambes de Grouscha à quatre pattes sur le plancher s’ouvrir comme des ailes de papillon. De même, l’étreinte enveloppe un devenir-pieuvre aux membres tentaculaires et aux organes-ventouses, bouches, anus, lèvres. Le rêve de la femme du pêcheur peint par Hokusaï n’est pas un rêve, c’est la réalité même de la nuit sexuelle. Dans Black Hole, les devenirs-animaux contagieux sont reptiliens ou batraciens, à la fois horrifiques et érotiques : appendices et (h)or(r)ifices, bouche autonome qui s’ouvre dans le cou, mains palmées, mues de femme-squamate, queue frétillante qui pousse sur le coccyx d’une femme-lézard, têtards sous la peau de l’amant qu’elle initie à l’ambiguïté du désir. Burns met certes en scène deux couples, mais c’est pour libérer les combinaisons multiples qui les unissent. La sexualité adolescente n’est pas encore divisée suivant une partition posturale binaire des rôles entre partenaires. La bouche érogène dans le cou de Rob, vagin denté miniature et bijou indiscret somniloque, lui découvre une sensation électrique sous le french kiss de sa petite amie Chris. Inversement, c’est la queue d’Éliza, ondulant sous sa jupe comme un fouet, qui attire Keith et polarise l’intensité pendant l’amour. Ces permutations entre masculin et féminin n’expriment pas un désir homosexuel latent, ni même une bisexualité originelle, mais une transsexualité processuelle qui est l’adolescence même. Le statut ontologique hybride de la BD lui donne une affinité avec ce processus non humain dont elle invente une Image rythmique.
La transversalité que la pensée libertaire opposait dans les années 60 et 70 à la rigidité des structures institutionnelles a été récupérée au profit du « nouvel esprit » du capitalisme, mobiliste et connexionniste, contre lequel elle croit encore parfois lutter. La bonne conscience postmoderne se repaît d’un éclectisme facile qui semble ignorer son tribut au Pouvoir. L’homme mixé, fluidifié, flexibilisé, adaptable et transformable, est prêt pour tous les assujettissements. Il faut aujourd’hui être arriéré pour critiquer en son nom un prétendu statisme qui n’est en réalité que le leurre qui nous soumet insidieusement à ce que le pouvoir a de plus désirable. Comment l’art hybride peut-il donc résister à ce pouvoir dont il semble un reflet ? Il s’agit de sortir ses épines, de devenir viral. Répandre une peste des ados dans nos pratiques : tel est le modèle de la résistance, qui extrait des clichés et des mélanges les contrastes intenses qui les subvertissent en images et en affects.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Le partage du sensible
- L’institution de la prostitution de masse en Catalogne
- Le suicide de Deleuze : son dernier acte de liberté»
- Les Musiciens de Brême, une interprétation sociale