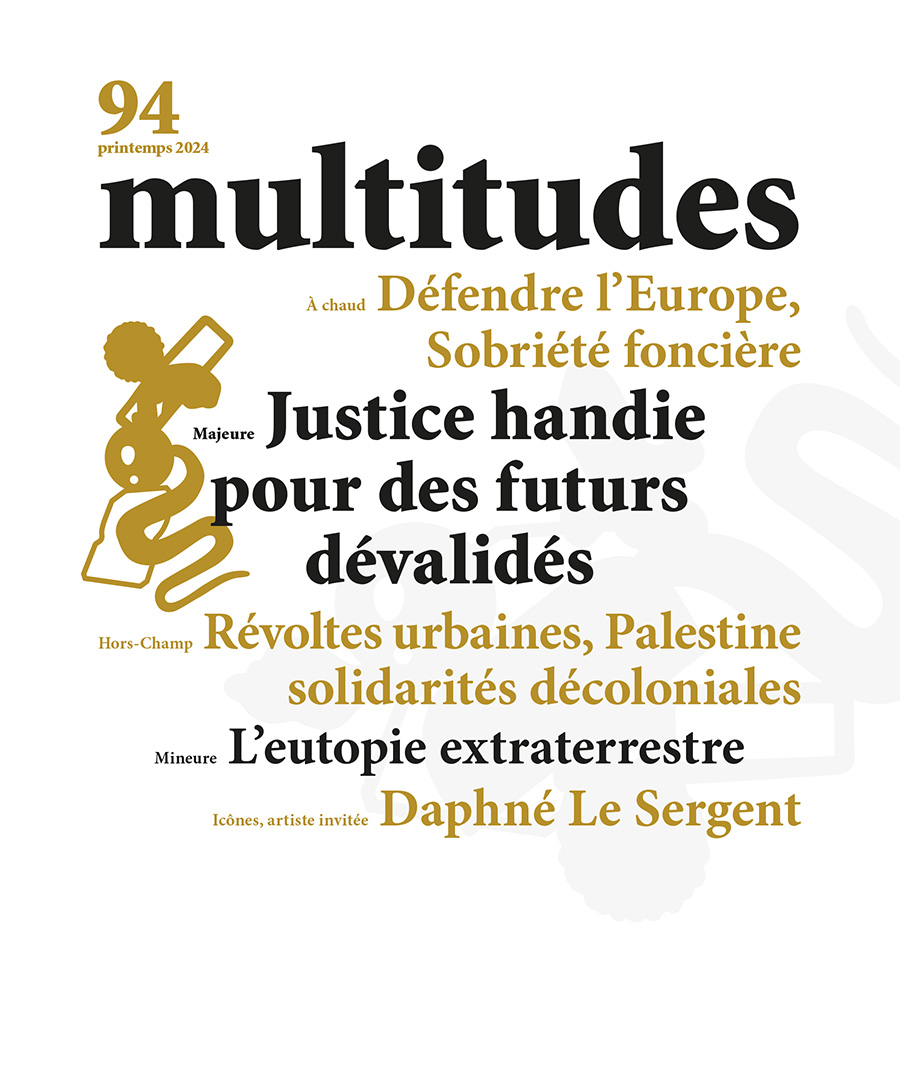L’extraterrestre est un concept spéculatif désignant un être vivant provenant d’ailleurs que la Terre. Figure clé de la science-fiction, il apparaît dès le IIe siècle dans Histoires vraies de Lucien de Samosate et est aujourd’hui l’objet d’une science, l’exobiologie (ou astrobiologie). En science-fiction, son traitement suit principalement deux tendances : la transposition de formes de vie terrestres et la spéculation sur des formes de vie alternatives. Jusqu’au XIXe siècle, à l’exception de Johannes Kepler dans Le Songe ou l’Astronomie lunaire (16341), c’est la première tendance qui domine : ainsi, les extraterrestres de L’Autre Monde (1657) de Cyrano de Bergerac ou de Micromégas (1752) de Voltaire sont des transpositions d’hommes ou d’animaux, le but des auteurs étant surtout de faire entrer les lecteurs dans le jeu de l’utopie ou de la satire. On retrouve cette tendance non seulement dans les premiers pulps américains2 où les extraterrestres, comme les Martiens d’Edgar Rice Burroughs, ressemblent à des êtres humains avec des différences relativement superficielles, ou sont inspirés d’animaux (mammifères, reptiles, arthropodes, etc.), mais plus généralement tout au long de l’histoire de la science-fiction.
L’idée de formes de vie radicalement autres n’émerge vraiment que dans la deuxième partie du XIXe siècle à la suite de la formulation de la théorie de l’évolution. Les premiers auteurs à en envisager les conséquences possibles sont Camille Flammarion dans Lumen (1872) et J.-H. Rosny aîné dans « Les Xipéhuz » (1887) qui met en scène une espèce vivante minérale de l’ère néolithique anéantie par les hommes. Mais c’est Stanley G. Weinbaum qui est considéré comme l’auteur ayant définitivement ouvert la voie de la tendance spéculative avec son « Odyssée martienne » (1934) dans laquelle il imagine une écologie très différente du modèle terrestre. Dans cette veine, Hal Clement crée dans Question de poids (1953) la planète Mesklin dont les effets combinés de masse et de rotation produisent des différences de gravité entre l’équateur et les pôles qui impactent la physiologie de ses habitants, tandis que Robert Forward met en scène dans L’Œuf du Dragon (1980) les Cheelas qui vivent sur une étoile à neutrons. Les extraterrestres peuvent aussi se distinguer par leurs dimensions spectaculaires, comme les vers des sables de Dune (1963-1964) de Frank Herbert ou les AnimauxVilles qui voguent à travers l’espace dans Étoiles mourantes (1999) d’Ayerdhal et Jean-Claude Dunyach. Stanislas Lem explore dans Solaris (1961) la possibilité d’un organisme planétaire unique, tandis que les étoiles elles-mêmes sont vivantes dans Créateur d’étoiles (1937) d’Olaf Stapledon. On trouve encore un nuage de gaz interstellaire intelligent dans Le Nuage noir (1957) de Fred Hoyle et un trou noir intelligent dans « Sucre d’orge et bébé noir » (1977) de John Varley. Mais les extraterrestres peuvent aussi être des cyborgs, tels les membres du collectif Borg des séries Star Trek (Gene Roddenberry, 1966-…), ou même des machines, tels les Hypothétiques de la trilogie Spin (Robert Charles Wilson, 2005-2011).
Si les formes de vie exotiques demeurent au cœur de la deuxième tendance, rien n’oblige cependant les auteurs à délaisser les modèles inspirés de la Terre, puisqu’ils peuvent s’appuyer, explicitement ou non, sur les hypothèses de la panspermie ou de la convergence biologique (Fred Hoyle, Hommes et Galaxies, 1964). C’est par exemple le cas de Jack Vance dans La Planète géante (1957), d’Ursula K. Le Guin dans Le Cycle de l’Ekumen (1966-2002) ou de Brian W. Aldiss dans la Trilogie d’Helliconia (1982-1985). C’est encore la biosphère terrestre qui guide les nombreuses variations sur le thème du parasite, comme « Discord in Scarlet » (1939) d’A. E. van Vogt (chapitres 13 à 21 de La Faune de l’espace, 1950) ou le film Alien, le huitième passager (1979) de Ridley Scott. Autre source d’inspiration : les fourmilières et les ruches, qui fournissent le modèle d’intelligences collectives comme dans Les Seigneurs de l’Hydre (1980) de C. J. Cherryh ou La Stratégie Ender (1985) d’Orson Scott Card. Si les auteurs mettent souvent en scène des espèces intelligentes, qui peuvent même être de nature végétale, comme chez John Brunner dans Le Creuset du temps (1983), ils se concentrent parfois sur les aspects plus spécifiquement biologiques, comme Ray Nayler qui imagine un écosystème entier sans prédation dans « Les Yeux de la forêt » (2020), ou Brian Stableford qui pousse très loin la spéculation génétique et écologique dans Dark Ararat (2002). Mettre en scène des formes de vie extraterrestres réellement autres constitue en fait un immense défi tant spéculatif que narratif compte tenu de la technicité que peuvent rapidement revêtir les spéculations biologiques et du rôle crucial des processus d’identification dans la fiction. Une voie possible semble alors se trouver du côté des textes courts flirtant avec la poésie, comme dans Le Commerce des mondes (1985) de Charles Dobzynski ou « Le Livre chez diverses espèces » (2012) de Ken Liu.
Il se peut d’ailleurs que certaines formes de vie ou d’intelligence soient si différentes qu’elles ne soient pas en mesure de se reconnaître mutuellement comme telles, ce qui pose d’intéressantes questions éthiques3. De fait, cette reconnaissance est souvent conditionnée par la possibilité d’établir une forme de communication. Dans le monde de La Guerre des étoiles de George Lucas, diverses langues extraterrestres sont ainsi esquissées, et ce dès le premier opus (1977), mais il existe aussi une langue véhiculaire galactique. Les séries Star Trek et Farscape (Rockne S. O’Bannon, 1999-2003) résolvent le problème en recourant respectivement à un traducteur universel et à des microbes traducteurs4. Même lorsque les extraterrestres sont vraiment différents, comme les Trafalmadoriens qui perçoivent le temps de façon instantanée dans Abattoir 5 (1969) de Kurt Vonnegut, Jr., ou les Para-Hommes divisés en Fluides et en Solides dans Les Dieux eux-mêmes (1972) d’Isaac Asimov, des moyens de communiquer sont établis, qui peuvent aller jusqu’à l’adoption par les extraterrestres de la forme humaine, comme le font les Négociants dans Le Canal Ophite (1977) de John Varley ou les membres du Continuum Q dans Star Trek. Parfois, la télépathie sert de vecteur, comme dans le Cycle de Tyranaël (1994-1997) d’Élisabeth Vonarburg. Mais d’autres fois l’interaction est impossible ou minimale, comme avec les Dra’Azon dans Une forme de guerre (1987) de Iain M. Banks ou les Indifférents dans À dos de crocodile (2005) de Greg Egan. Les films 2001, l’Odyssée de l’espace (1968), réalisé par Stanley Kubrick sur un scénario co-écrit avec Arthur C. Clarke, et Premier Contact (2016) de Denis Villeneuve, adapté de la novella « L’Histoire de ta vie » (1998) de Ted Chiang, s’efforcent quant à eux de faire partager l’étrangeté que pourrait revêtir une expérience de communication avec des extraterrestres aux limites des facultés humaines de perception.
Qu’il y ait communication ou non, les relations avec les extraterrestres sont souvent décrites comme conflictuelles : invasion (H. G. Wells, La Guerre des mondes, 1898), guerre interstellaire (Robert A. Heinlein, Étoiles, garde-à-vous !, 1959), asservissement (Stefan Wul, Oms en séries, 1957), etc. Liu Cixin dans sa Trilogie des Trois Corps (2006-2008) explore la piste ultime de l’annihilation préventive, déjà formulée par Gérard Klein sur un mode comique dans sa nouvelle « Réhabilitation » (1973). Mais les relations peuvent aussi être plus pacifiques. Outre la possibilité de relations amoureuses (Philip José Farmer, Les amants étrangers, 1961), différentes formes d’hybridation sont notamment envisagées, comme dans la trilogie Xenogenesis (1987-1989) d’Octavia Butler ou Rossignol (2023) d’Audrey Pleynet, et peuvent même aller jusqu’à la transformation volontaire d’une espèce en une autre (Clifford D. Simak, « Désertion »,1952). Dans « L’Opéra de Shaya » (2014) de Sylvie Laîné, l’environnement extraterrestre s’adapte à sa visiteuse humaine, tandis que, dans Apprendre, si par bonheur (2019) de Becky Chambers, la physiologie des astronautes est modifiée de façon à ne pas perturber l’écosystème des planètes explorées. Mais il peut aussi y avoir une incompatibilité radicale entre espèces, comme dans Isolation (1992) de Greg Egan, où une Bulle isole mystérieusement le système solaire du reste de l’univers.
On le voit, les formes de vie ou de contact extraterrestres sont d’une infinie diversité, et il en reste certainement de nombreuses autres à imaginer, ou à découvrir…
1Les dates indiquées tout au long de l’article correspondent aux dates de parution de la première version publiée en langue originale même quand il y a eu des remaniements ultérieurs ou que le titre indiqué est celui de sa traduction française.
2Les pulps sont des magazines américains bon marché et bas de gamme publiant des feuilletons ou des nouvelles de fiction.
3Cf. mon article « Imaginer et reconnaître l’“autrui totalement autre” : extraterrestres, intelligences artificielles, etc. » publié en ligne sur le site Multitudes à l’occasion de la parution de ce numéro.
4L’article cité dans la note précédente propose quelques développements sur ce point.