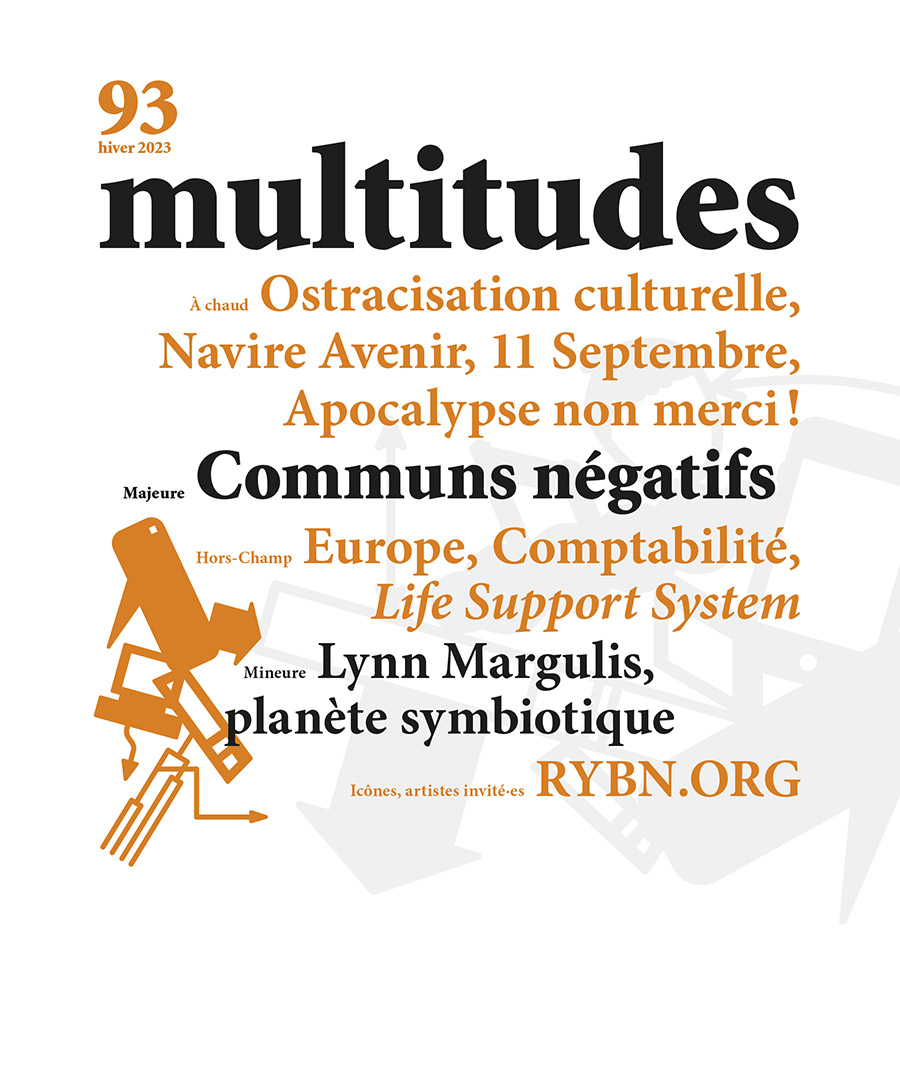« Il y a des mots qui résonnent comme des cris de bataille », disait la biologiste Lynn Margulis à propos du concept de symbiose (Margulis 1990). Et en effet, tout au long du deuxième XXe siècle, Lynn Margulis fait partie de ces pionnières qui se sont vigoureusement battues pour montrer que la symbiose était une clef non seulement pour comprendre le monde vivant et l’origine des espèces, mais aussi pour décrire les effets des comportements humains et plus qu’humains sur la planète.
On retient le plus souvent le nom de Lynn Margulis pour son rôle dans l’élaboration de « l’hypothèse Gaïa », la formulation scientifique qui permet de penser et de calculer la manière dont l’atmosphère terrestre est régulée par les vivants, et qui permet notamment d’établir la réalité du changement climatique (Margulis et Lovelock 1974). Développée conjointement avec l’astrogéologue James E. Lovelock (qui avait judicieusement constaté que la température à la surface de la Terre ne pouvait s’expliquer à partir de sa distance d’avec le Soleil), l’hypothèse Gaïa doit à la bactériologie de Lynn Margulis l’idée que ce sont les vivantes qui se fournissent les unes aux autres nos conditions mutuelles d’existence (l’air que nous respirons, l’eau qui nous entoure, le sol sur lequel nous marchons).
Ce qu’on oublie souvent de mentionner, c’est l’autre grande contribution de Lynn Margulis à la biologie : le concept d’endosymbiogenèse (Margulis 1967), l’idée selon laquelle, à l’origine des cellules à noyau, on trouve non pas la mutation accidentelle de bactéries unicellulaires, mais une symbiose d’un type particulier – l’ingestion, puis la convivance, de bactéries respirant du dioxygène par des bactéries qui n’avaient pas cette capacité. Autrement dit, c’est la stabilisation d’une relation initialement prédatrice qui a mené à la formation des premières cellules eucaryotes. La philosophe Donna Haraway (2016), qui fait de Lynn Margulis une de ses alliées, résumera ce fantastique épisode de l’apparition de la vie sur Terre en disant que « nous sommes toustes le fruit d’une indigestion ».
De cette découverte, longtemps défendue grâce à des faisceaux d’indices concordants, et aujourd’hui validée par les études sur l’ADN, Lynn Margulis tisse des fils qui ramifient bien au-delà de l’origine des êtres multicellulaires. Elle en tire notamment une hypothèse plus large, la théorie de l’évolution symbiogénétique en série (Margulis 1981), qui défend l’idée selon laquelle l’apparition de nouveaux tissus, de nouveaux organes, de nouvelles caractéristiques, voire de nouvelles espèces est le résultat d’une suite de symbioses enchâssées les unes dans les autres. C’est, autrement dit, à force de vivre et de faire les unes avec/dans/aux côtés des autres que les espèces évoluent, et non seulement en raison de mutations accidentelles individuelles. La symbiologie de Lynn Margulis est ainsi une sorte, dit-elle, de néolamarckisme symbiotique où la survie n’est pas celle de l’individu devenu, accidentellement, le plus apte, mais bien celle des collectifs symbiotiques devenus, à force de négociations, les mieux intriqués.
Sans nier l’antagonisme au cœur du processus, Lynn Margulis écarte l’idée et l’image anthropocentrée de la compétition comme unique facteur évolutif. Cela lui vaut, toute sa vie, d’être fermement combattue. C’est que les théories de Lynn Margulis remettent en question les fondations spécistes, militaromasculinistes et plantationnaires de la pensée scientifique. Contre le spécisme, elle nous apprend que nous sommes des « holobiontes », des sommes d’espèces intriquées, jamais monospécifiques, toujours « plusieurs » (Margulis et al. 2013). Contre le militaromasculinisme, elle défend des pratiques de la science qui se rendent responsables de ses usages (Barad 2023 ; Wynter et McKittrick 2015). Contre l’imaginaire de la plantation, elle refuse de penser les vivants coupés de leurs milieux, déportables et scalables à l’envi, et propose constamment de se laisser influencer par l’échelle à laquelle les vivants qu’elle étudie existent (Tsing 2015 ; Touam Bona 2021). Contestant ainsi la théodicée religieuse de l’individualisme extractiviste devenue biodicée scientiste (d’Adam figuré en maître et possesseur de la nature jusqu’à Homo bioeconomicus figuré en héros d’une course pour la survie), Lynn Margulis ouvre la voie à une pensée de la vie comme vivre-avec : pas une paix totale, illusion fixiste d’une nature idéalisée, mais plutôt une précarité partagée, un agencement multi-espèces aux conséquences pas toujours prévisibles. Avec elle, le vivant est fait d’ingestions, d’enchevêtrements mutuels, d’embrouilles et de composts.
Quelles conséquences ces récits de l’interdépendance peuvent-ils avoir sur les idées que nous nous faisons sur les vivants, sur les individus et sur les collectifs, humains et pas qu’humains ? Comment cet « autre facteur de l’évolution » qu’est la symbiose peut-il nous apprendre à penser autrement les relations des êtres humains entre eux et avec les autres vivants ?
Lynn Margulis elle-même, avec son fils Dorion Sagan, a tenté d’étudier les implications de sa théorie : sur l’origine des espèces, sur l’épistémologie des sciences, sur l’écologie comme science-activisme, et même sur les origines du sexe et sur les inégalités entre les genres. À sa suite, de nombreux·ses biologistes, philosophes, artistes, écologues et écoactivistes ont tenté, depuis plusieurs décennies, de déployer les puissantes hypothèses de sa symbiologie.
Cette mineure entend donner la voix à ces héritages multiples de Lynn Margulis, à la recherche des implications politiques, métaphysiques et militantes de son œuvre qui, malgré la traduction récente de Microcosmos (Margulis et Sagan [1986] 2022), reste encore trop peu connue dans le monde francophone. Elle s’ouvre sur les lectures féministes Noires et décoloniales que la biologiste Kriti Sharma et la poétesse Alexis Pauline Gumbs ont donné des formes de vies collaboratives : comment désapprendre les logiques du capitalisme racial et du monde de la compétition qui définissent certaines vies comme valant moins d’être vécues et comment apprendre à célébrer les formes de vies non-conformes au récit de l’individualisme ? Suivant leurs leçons, le texte de la philosophe transféministe Emma Bigé revient sur les héritages queer de Lynn Margulis : quelles histoires sur le sexe, le genre, la famille, l’individu et le collectif une perspective symbiotique nous oblige-t-elle à raconter ? La théoricienne féministe Nathalie Grandjean, dans le même sens, propose une archéologie philosophique de l’influence de Lynn Margulis sur l’œuvre et l’onto/éthique de Donna J. Haraway. L’artiste-chercheureuse Alice Cuvelier, quant à iel, revient sur les promesses dissidentes des visions symbiologiques : comment représenter l’interdépendance sans s’arrêter aux images qui représentent les vivants comme une somme d’individus séparés les uns des autres et de leurs milieux ? Enfin, le texte de l’écrivain-chercheur Ewen Chardronnet et de l’artiste culinaire Maya Minder ouvre sur une fiction spéculative : à quoi ressemblerait un futur où Homo Photosyntheticus, ayant appris à vivre en symbiose avec des créatures autotrophes dans son tube digestif, nous déplacerait vers une relation différente au monde ?
Autant de perspectives, de la microbiologie, à la poésie, à l’épistémologie, à la théorie queer et à la fiction spéculative qui nous apprennent à sentir-penser et à vivre sur une planète symbiotique.
Références
Barad, Karen. Frankenstein, la grenouille et l’électron. Les sciences et la performativité queer de la nature, traduit de l’anglais (États-Unis) par Luigi Balice et Christophe Degoutin, Asinamali, 2023.
Escobar, Arturo. Sentir-penser avec la terre.
L’écologie au-delà de l’Occident, traduit de l’espagnol
(Colombie/États-Unis) par l’Atelier La Minga, Seuil, 2018.
Haraway, Donna J. Vivre avec le trouble, (2016), traduit de l’anglais (États-Unis) par Vivien García, Éditions des mondes à faire, 2021.
Margulis (Sagan), Lynn. « On the origin of mitosing cells », Journal of Theoretical Biology, vol. 14.3, 1967.
Margulis, Lynn et Lovelock, James E. « Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the Gaia hypothesis », Tellus, vol. 26.1-2, 1974.
Margulis, Lynn. Symbiosis in Cell Evolution:
Life and its Environment on the Early Earth, Freeman, 1981.
Margulis, Lynn et Sagan, Dorion. Microcosmos.
4 milliards d’années de symbiose terrestre, (1986), traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard Blanc et Anne de Beer, Wildproject, 2022.
Margulis, Lynn. « Words as battle cries:
symbiogenesis and the new field of endocytobiology », Bioscience, vol. 40.9, 1990.
Margulis, Lynn, Guerrero, Ricardo, et Berlanga, Mercedes. « Symbiogenesis: the holobiont as a unit of evolution », Int Microbiol, vol. 16.3, 2013.
Touam Bona, Dénétèm. Sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge. Post-Éditions, 2021.
Tsing, Anna Lowenhaupt. Le champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme (2015), traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe Pignarre, La Découverte, 2017.
Sharma, Kriti. Interdependence: Biology and Beyond, Fordham University Press, 2015.
Wynter, Sylvia et McKittrick, Katherine. Sylvia Wynter: On Being Human As Praxis. Duke University Press, 2015.