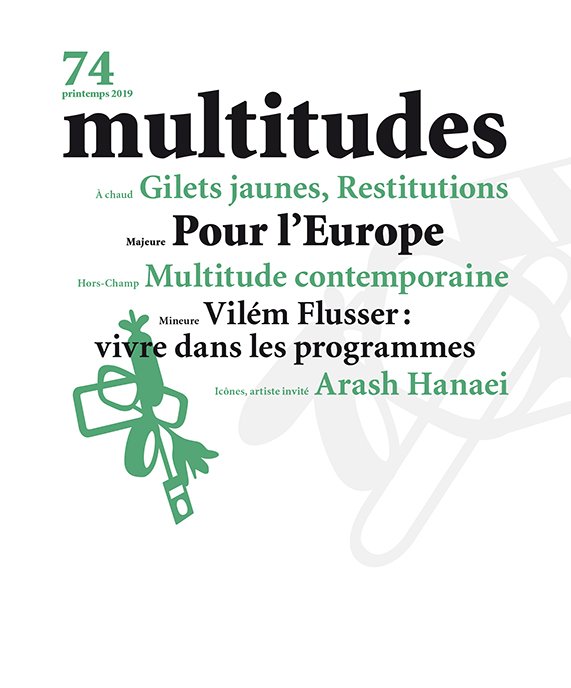La crise ouverte par les Gilets Jaunes sur la question européenne est bien plus intéressante que les ronds de jambe (avec ou sans veste) hexagonaux. Si nous ne savons pas encore quel sera, in fine, l’effet des Gilets jaunes sur l’état de la bannière tricolore, plusieurs signes augurent paradoxalement de conséquences positives sur l’ensemble de l’Union de cette crise si conforme au « folklore français ».
Quatre résultats directs ou indirects de cette révolte sociale méritent en effet d’être notés : la réappropriation de la veste des Gilets Jaunes en Belgique et récemment à Stuttgart ; l’inquiétude sur la situation française, de l’ordre d’une salutaire prise de conscience, de celle qui a succédé à Angela Merkel à la tête du Parti Démocrate Chrétien en Allemagne et qui devrait être la future chancelière, Annegret Kramp-Karrenbauer ; l’indulgence de l’Union, face à l’urgence sociale, quant à un dépassement, et du déficit budgétaire primaire de la barre des 3 %, et des 60 % d’endettement les dépenses publiques d’équipement ; enfin, l’accélération de la mise en place d’une taxe sur les GAFAMI (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IMB) américaines et autres BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) chinoises.
Autant d’évolutions qui s’ajoutent à un contexte européen pas si sombre que ça, au regard de quatre autres constats : l’unité des Vingt-Sept contre la politique de division jouée par le Royaume-Uni pour arracher un Brexit le plus avantageux possible (le beurre de la mondialisation, l’argent du beurre du Marché Unique et le sourire de la crémière espagnole à Gibraltar et Irlandaise à Belfast) ; le vote du Parlement européen condamnant la Pologne et la Hongrie pour violation des Traités, envisageant de rendre inéligibles aux fonds structurels les démocraties « illibérales » (euphémisme pour « autoritaires et plébiscitaires ») comme la Roumanie, la Hongrie, la Pologne ; la prolongation de la politique de « quantitative easing », assouplissement de la création monétaire de la BCE (Banque centrale européenne) face au fléchissement de la croissance dans la zone euro ; et puis le consentement tardif mais indubitable de l’Allemagne à un budget autonome tangible de la zone euro en tant que telle, même s’il est encore très limité.
L’ascension des populismes d’extrême droite enfin freinée
L’Europe revient de loin. Après la montée générale des populismes de diverses couleurs, très souvent anti-européens à l’exception notable de Podemos en Espagne, puis le référendum du Brexit en 2016, la victoire de la coalition hétéroclite 5 étoiles et Ligue en Italie, celles de l’extrême droite autrichienne, des Orban et autres Polonais, Tchèques, Slovaques, le tout dans une interminable crise de la dette grecque, la guerre d’Ukraine sur fond de prophéties intéressées de souverainistes pro Trump ou pro-russes, on ne donnait pas cher de la construction européenne, frégate en perdition se transformant en Radeau de la Méduse de Géricault.
La première éclaircie est pourtant venue de la France, ce qu’on n’attendait plus après le camouflet du « non » au traité constitutionnel de 2005. Alors que les Nations européennes fragmentaient la représentation démocratique en cinq ou six partis rassemblant chacun entre 5 et 20 %, y compris dans les pays réputés stables, ouvrant ainsi la voie à des coalitions avec l’extrême-droite jusque dans le bastion auparavant socialiste de l’Andalousie, la France a élu un président « centriste », se déclarant sans ambiguïté pour une relance de la construction européenne. Face au Brexit qui a fait voler en éclats le bipartisme britannique, à la coalition désastreuse du groupe de Visegrad conduite par la Pologne et la Hongrie contre la politique migratoire de l’Union, face à l’Espagne empêtrée dans le séparatisme catalan, face à l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en Autriche, depuis mai 2017 l’Europe recommence à espérer.
Casser les réflexes néo-libéraux
grâce à plus d’Europe fédérale
L’Europe respire donc à nouveau, mais avec l’urgente nécessité de prendre acte de la responsabilité des politiques néo-libérales, paupérisant trop de monde jusqu’au cœur des classes moyennes, dans la montée des populismes, puis d’agir contre la cause primordiale et pourtant non avouée de cette fabrique généralisée de précarité : le déséquilibre croissant dans les institutions de l’Union européenne. La phase du marché commun, qui longtemps tînt lieu de seule politique commune, ne suffit plus. Un destin partagé, de construction plutôt que de destructions sociales, exige désormais une véritable intégration politique. Contrôler à l’échelle européenne un marché mondialisé implique des règles fédérales, une protection sociale européenne reposant sur une fiscalité et une politique économique et industrielle enfin unifiées. Comment ? En dotant l’Union d’un budget de 15 % du PIB de tous ses États. Ce qui signifie une réduction radicale du rôle des États-Nations qui s’accrochent vaille que vaille à leur droit de veto au sein du Conseil européen. Si l’Union européenne n’accouche que d’un néolibéralisme perpétuellement ravalé à chaque catastrophe, c’est parce qu’il s’agit de l’unique plus petit commun dénominateur des États-Nations confédérés avec un zeste de lutte contre la corruption. La mise en place d’une politique industrielle cohérente et bien outillée au niveau européen semble une évidence. Mais les bureaucraties nationales n’en veulent à aucun prix. Que ce soit en matière de politique migratoire, de politique industrielle ou de protection sociale, elles opposent toujours la même rengaine : elles ont été « élues », au contraire de ce bouc émissaire qu’est pour elles la « bureaucratie de Bruxelles ». Sauf que ce sont bel et bien les États-Nations, d’ailleurs pas tous si « démocratiques », qui freinent toute avancée par leur rôle délétère au sein du Conseil de l’Europe, s’opposant souvent au Parlement européen quant à lui « démocratiquement » élu.
Depuis juillet 2017 et les élections législatives ayant donné au Président français la majorité intérieure, l’Europe s’oriente à l’inverse vers une refondation institutionnelle pour laquelle la Banque centrale européenne n’a jamais cessé de plaider. Emmanuel Macron est en effet parvenu à rallier l’Allemagne à l’idée d’un budget européen, principe essentiel, même si la somme accordée reste pour le moment très loin des ambitions initiales. De fait, l’idéologie du marché masque une lente évolution de l’Europe vers le fédéralisme. Les Britanniques, qui s’y connaissent en pouvoir déduit du marché, n’avaient pas tardé à se rendre compte que, malgré le frein du référendum de 2005 sur le Traité Constitutionnel, la marche vers le fédéralisme et la constitution d’une Union politique avait repris son cours via le Traité de Lisbonne : les Européens avaient cédé sur le drapeau, l’hymne, bref sur des symboles, mais absolument pas sur la substance, c’est-à-dire la progression inexorable des questions d’intérêt commun réglée à la majorité qualifiée et non plus à l’unanimité, comme la tentative de définition commune d’une politique migratoire l’a montré. C’est parce qu’ils ne sont pas parvenus à bloquer cette fédéralisation « rampante » que les Conservateurs britanniques ont tenté le chantage au référendum (retenez-nous sinon nous allons sortir) qui, manque de chance pour eux, a abouti au résultat invraisemblable du Brexit. À partir de 2016, les anti-fédéralistes, qui veulent restaurer la souveraineté nationale selon eux abandonnée à Bruxelles, ont cru leur heure arrivée (Marine Le Pen la première). La claque de l’élection d’Emmanuel Macron s’est jouée pendant son face à face sur la question de la sortie de l’Euro, prélude à la dislocation et au retour à une vague zone de libre-échange, projet jamais abandonné par le Royaume-Uni. Sauf que l’électorat du FN (ou du RN désormais), est massivement composé de retraités qui ne veulent pas plus que les Grecs d’une sortie de l’Euro suivi d’une dévaluation d’au moins 35 % de la monnaie « nationale ».
Vote pro-européen et anti FN, la victoire de Macron au second tour a ouvert la voie à l’urgente réforme des institutions européennes, préalable indispensable à l’abandon des politiques d’austérité néolibérale, réflexes à court terme d’imbéciles sans la moindre intelligence stratégique, ayant une calculette à la place du cerveau. À leur obsession comptable, il convient d’opposer une vision politique, par exemple capable d’initier la création d’Euro-obligations pour financer une politique ambitieuse de transition écologique et numérique, la mise en place d’une entreprise de TGV européenne à la façon d’Airbus dans l’aviation, et bien sûr une politique sociale ambitieuse.
Grâce aux Gilets jaunes une deuxième défaite
des anti-européens ?
Malgré les apparences, la crise des Gilets jaunes et leur spectacle « révolutionnaire » de la France « trouble-fête » n’est peut-être pas le désastre populiste que d’aucuns lisent un peu vite. Au regard de l’histoire de la Ve République, et ce malgré l’ampleur des violences policières et la loi anti-casseur, l’État français a été plutôt souple. La réactivité d’Emmanuel Macron depuis janvier est au moins aussi sidérante que le côté systématique de la contestation des Gilets jaunes. On pourrait d’ailleurs suspecter le gouvernement de miser sur la séparation des gilets jaunes « pacifiques » d’avec les « enragés », voire subodorer un machiavélisme du pouvoir utilisant ses « maladresses » pour jeter de l’huile sur le feu et mieux hâter la constitution d’un mouvement politique se présentant aux Européennes sur des listes à part, ce qui aurait pour effet d’affaiblir essentiellement la France Insoumise (c’est déjà en cours) et le Rassemblement National. Les deux extrêmes pourraient bien rire jaune le 27 mai au matin.
Mais l’essentiel est ailleurs. Au contraire de bien des souverainismes, de l’extrême-droite des anciens pays de l’Est au néofascisme en culottes courtes de l’Italie (« l’Italia fara da se » comme le beugle virilement le taureau Matteo Salvini), le populisme à la française n’est pas systématiquement réactionnaire, identitaire et xénophobe : s’il met l’État sur la sellette, c’est au nom de la lutte contre les inégalités sociales, les revendications sur la fiscalité et le pouvoir d’achat en étant les deux manifestations les plus palpables. À force d’avoir été une bonne élève des politiques d’austérité salariale (même si elle a trainé longtemps), la France est devenu un pays de salaire médiocre, cumulant à la fois un salaire minimum élevé (1188 euros net) si on le compare à l’Allemagne, au Royaume-Uni ou à l’Italie et un salaire médian assez bas : selon l’INSEE en 2018, 50 % des Français auraient un salaire net au-dessous de 1710 euros. Le salaire moyen net est quant à lui de 2 250 euros. Autrement dit : puisqu’il n’y a que 10 % de salariés au SMIC, cela signifie que 40 % des Français (et surtout des Françaises) gagnent entre 1188 et 1710 euros. Cette caractéristique française d’un faible écart entre le salaire minimum et le salaire des 50 % de la population les moins riches tient également au poids croissant du travail à temps partiel féminin, ou étudiant, bref à la part du « précariat ».
Signe des temps : le début de l’année 2018 avait été occupé à la réforme du statut des travailleurs détachés. Mais l’Europe doit encore résoudre la question des saisonniers et intermittents de toutes sortes. On sent bien qu’il ne saurait y avoir de destin commun européen sans une Europe sociale dotée de moyens, à même de lutter pour une agriculture écologique et contre la mal bouffe industrielle, dont les scandales du bœuf polonais récemment ou de la viande de cheval roumaine il y a deux ans le symbole. L’Europe fiscale est aussi en jeu. Et pour cause : la contestation des injustices sociales, après avoir touché la France, risque de se répandre dans le reste de l’Union, au sein de pays en réalité bien plus inégalitaires – la Scandinavie faisant exception par sa plus grande équité, tandis que l’Espagne vient d’augmenter massivement le salaire minimum.
En France, la plupart des salariés des troisième, quatrième et cinquième déciles de la population active (tranches se situant entre les 20 % les plus pauvres et les 40 % les plus riches) ne payent pas d’impôt sur le revenu, tout comme ces indépendants qui ne se rémunèrent qu’un SMIC. En effet, suite aux mesures adoptées sous la présidence de François Hollande, six ménages sur 10 ont été exonérés de l’impôt sur le revenu en 2018 (ils étaient plus de 19,2 millions à l’acquitter, ils sont descendus à 16,12 millions). La CSG s’applique en revanche à tous les Français, et ponctionne 7,5 % du revenu, y compris celui des retraités. Ses ressources représentent 96 milliards d’euros. En 2018, comme à la veille de la révolution française, les impôts indirects représentaient donc 72 % des 288 milliards collectés par l’État, dont 193 milliards pour la TVA, et 14 milliards pour la taxe sur les produits pétroliers. L’effet sur les plus pauvres, qui forcément dépensent moins, est donc celui d’un impôt progressif à l’envers. On remarquera que le mouvement des Gilets jaunes, qui se bat pour le pouvoir d’achat, n’a pas exprimé des revendications de hausses de salaires auprès des employeurs, mais auprès de l’État. Il a manifesté un ras-le-bol fiscal, comme le fit en 1953-56 le mouvement de Pierre Poujade, revendiquant une répartition différente de l’impôt sur le revenu (faire payer les riches, la finance, les multinationales). Il réclame en particulier le rétablissement de l’impôt sur les grandes fortunes, même si ce dernier ne rapportait pas grand chose à l’État (une dizaine de milliards) contre 58 milliards pour l’impôt sur les sociétés. Ce n’est donc pas un hasard si Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances a pris son bâton de pèlerin pour persuader les Suédois et les Allemands de mettre en place rapidement une taxe sur les grands acteurs du numérique, même si les montants demeurent encore très faibles, parce qu’ils sont liés à la taxe sur les profits réalisés et non sur le chiffre d’affaires ou les clics de connexions, véritable base de la richesse créée.
Autre signal d’un changement d’époque : en décembre, juste après l’annonce solennelle par Emmanuel Macron qu’une dizaine de milliards d’euros allaient être débloqués (renoncement à la taxe sur le carburant pour les moteurs diesels, et augmentation de la Prime d’activité, sorte de prime du SMIC) et donc que la limite des 3 % de déficit allait être dépassée, le Commissaire européen, Pierre Moscovici a expliqué que l’Union n’allait pas mettre la France sous une procédure pour dépassement. La crise sociale est donc trop sérieuse pour jouer avec un poids lourd de l’Europe ! Même réaction du côté allemand. Ce qui évidemment servira aux États membres de moindre taille pour revenir sur la règle des 3 % de Maastricht.
Enfin, le samedi 2 février 2019 s’est tenu à Stuttgart, en Rhénanie-Westphalie, l’une des régions les plus prospères d’Allemagne, la première manifestation de Gilets Jaunes allemands contre la pénalisation des propriétaires de véhicules roulant au diesel, interdits de circulation dans plusieurs grandes villes comme Leipzig ou Hambourg. Base très similaire à la France apparemment, sauf que l’initiateur est un mécanicien immigré macédonien, salarié parlant parfaitement l’allemand qui s’est tourné contre l’État, mais aussi les constructeurs automobiles. Ses arguments, très justes, n’étaient pas tournés contre les écologistes mais contre les employeurs et l’État qui avaient mis en place le système incitant les gens à acheter des véhicules au diesel, avaient empochés les bénéfices, et qui entendaient faire payer aux ménages consommateurs les pollutions qu’ils avaient eux-mêmes contribué à installer. Soit une revendication nettement plus ciblée que le refus générique des augmentations de gazole, car elle remet en cause les employeurs de l’industrie automobile, déjà sur la sellette avec les logiciels trompant le contrôle sur les particules fines. Et là, le jaune se mêle de vert…
Autrement dit : ce populisme-là, ce prurit jaune exigeant d’abord une véritable justice sociale, pourrait tourner « pro-européen » plutôt qu’euro-sceptique. Du moins si la France, l’Allemagne et les décideurs de l’Europe en tirent les leçons et remettent en cause la religion néo-libérale de l’austérité budgétaire. Mais pour aller où ? Vers quelle révolution fiscale ? Et comment ?
Un revenu d’existence financé
par un nouveau système fiscal d’emblée européen ?
La situation de l’Europe, le Royaume-d’ores-et-déjà-désuni inclus, est très sérieuse sur le plan de l’emploi. Partout, y compris en Allemagne, les rares emplois qui se créent dans l’industrie sont précaires, souvent via des contrats d’intérimaires. En Hongrie, par exemple, Orban affronte sa première opposition de masse à la loi cynique sur les heures supplémentaires. Et le reste de l’Europe de l’Est risque de suivre, tant les emplois d’avenir semblent limités. La domination des transnationales chinoises et américaines est écrasante dans l’économie numérique. Et l’intelligence artificielle est en train d’opérer une deuxième saignée d’emploi, ce coup-ci vers des secteurs nettement plus qualifiés que celui des cols bleus de la mondialisation, avec la Chine en atelier du monde. Dans ce contexte, comment croire que l’abaissement du coût du travail, qui fabrique du Gilet Jaune à la pelle, soit une solution ?
De fait, la garantie d’un revenu décent permettant de vivre est à la base de la revendication des Gilets jaunes, bien plus que le refus des écotaxes. Dès lors, subordonner les améliorations de revenus aux augmentations salariales, qui se limitent fatalement à ceux qui ont et auront un emploi lié le plus souvent à un contrat à durée déterminée, est doublement illusoire : d’abord parce qu’au regard du niveau de qualification des bas salaires, cela ne marche que par une socialisation très forte du SMIC sous toutes ses formes, l’État subventionnant les bas salaires pour que les employeurs privés acceptent d’en créer encore ; ensuite parce que les pauvres qui ne sont pas des travailleurs, dont notamment les 10 à 30 % de la population active au chômage, parmi laquelle beaucoup de jeunes, restent à l’écart des mécanismes protecteurs classiques hérités de l’État Providence du fordisme d’après guerre. Les systèmes de protection « nationaux », au sein de l’Union Européenne, sont de plus en plus des passoires trouées. D’où la nécessité d’un filet protecteur qui garantisse le revenu de tous, autrement dit un revenu d’existence universel… tel que détaillé dans plusieurs numéros de Multitudes.
L’économiste Aurore Lalucq propose un revenu de 175 euros par mois pour tout citoyen de l’Union, financé par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ce pourrait être un symbole fort de l’Europe, et bien plus : une façon d’engager le chemin vers la perspective d’un revenu universel d’un montant « décent », correspondant au niveau des salaires minimum dans chacun des États membres, plus un correctif fédéral tendant à faire converger ce niveau.
Mais on se doute bien qu’un tel effort de redistribution au sein de chaque État et dans l’Union, ferait autant exploser les budgets de l’aide sociale que l’instauration de la Sécurité sociale après guerre, qui avait doublé l’échelle de la dépense publique. C’est là que l’on se heurte à l’archaïsme du système français, européen, mais aussi mondial. Dans un monde où la richesse se crée majoritairement dans la circulation (et plus dans la seule fabrication), des impôts comme la TVA constituent un impôt progressif sur les pauvres beaucoup plus important que les quelques milliards de l’ISF. Jean Pisani Ferry notait que l’ISF rapportait globalement 8,5 milliards, tandis que les seuls 1 % les plus riches avaient dans le même temps gagné 70 milliards par diverses réduction d’impôt. Nous avons expliqué comment, dans une économie de pollinisation, il fallait taxer la circulation par une « flat taxe » faible (de 2 à 5 %) sur toutes les transactions financières et monétaires, pouvant remplacer tous les autres impôts avec une grande efficacité de redistribution – proposition recoupant celle de l’économiste suisse Marc Cheney.
En France, nous avançons de façon détournée vers un tel système de socialisation du revenu par l’intermédiaire du financement public des emplois aux revenus les plus bas. Mais il reste un verrou à faire sauter, qui concerne non seulement la droite moraliste et la gauche travailliste, mais aussi La République en Marche et le Président Macron. La majorité des « politiques » restent en effet accrochés à une représentation totalement dépassée de la productivité et de la modernité d’une économie. Pour eux, la production de richesse passe seulement par les entreprises privées, et le travail salarié ou indépendant. Il faut, disent-ils, inciter au travail, rétablir la valeur-travail, activer les dépenses d’indemnisation du chômage version molle à la française ou version dure à la sauce italienne du prétendu revenu d’existence des 5 Étoiles. La vérité cruelle est qu’il faudrait pour une économie performante passer par une phase intensive de destruction massive des emplois inutiles, en particulier de la vieille industrie, pour se concentrer sur les emplois riches en valeur ajoutée, en incorporation de l’économie de la connaissance. C’est une vérité que Michel Rocard avait eu le courage de dire en annonçant qu’il n’y aurait plus jamais de retour au plein emploi. Allons, Président Macron, un dernier effort pour abandonner l’éloge de l’effort… et être moderne !
Bien entendu ce genre d’annonce qui ne se met pas la tête dans le sables comme les autruches n’est possible et tolérable que si l’on met en place un revenu d’existence cumulable avec le chômage, la formation, l’activité dans des secteurs d’économie solidaire. Soit un revenu à un niveau qui permette à chacun de vivre décemment, de l’ordre de 1 200 euros net par personne en France.
Et si en demandant la justice et l’égalité, le Mouvement des Gilets Jaunes avait mis sur le tapis français et européen la seule voie possible d’une réforme du contenu social de l’Union face au vide intersidéral de la mise en concurrence indéfinie d’un néo-libéralisme qui nous conduit tout droit vers la démocratie autoritaire ?