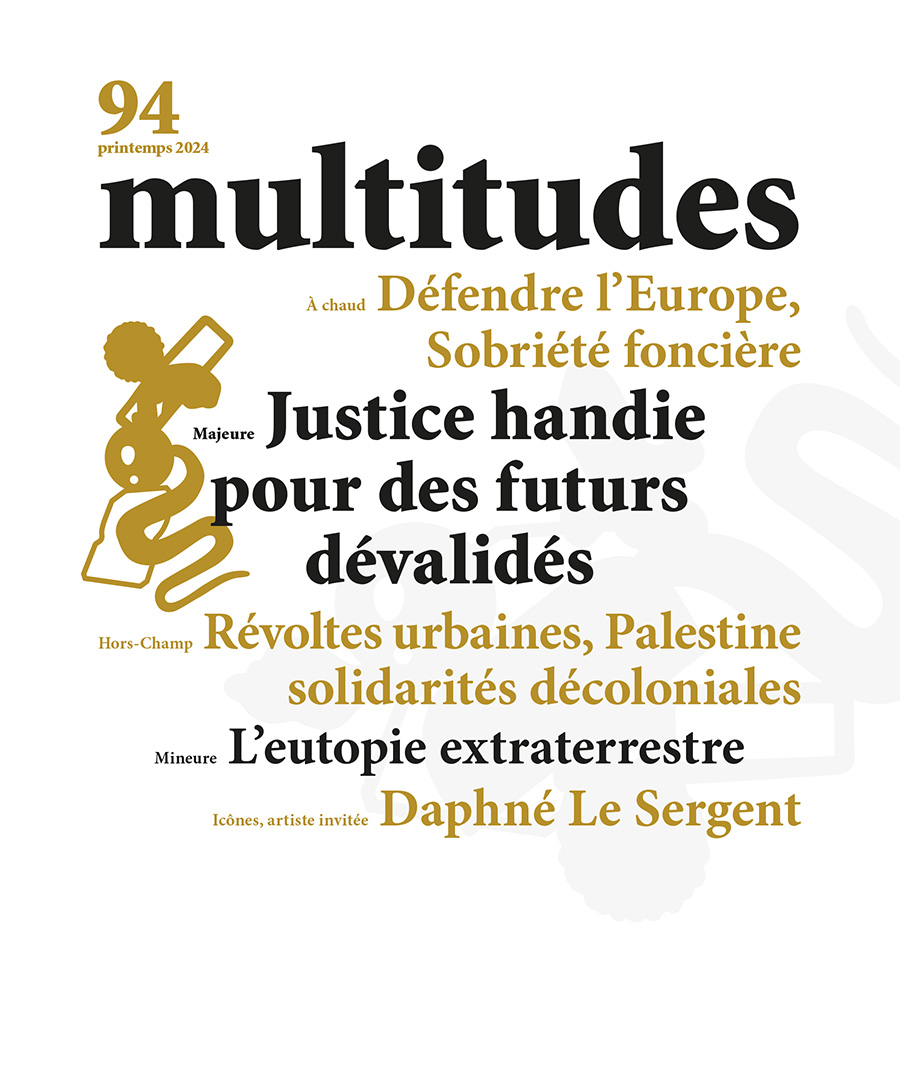« Sois sage. Je t’aime. »
Alex, 2007
Lorsque les scientifiques se mettent en quête d’extraterrestres, que désirent-ils trouver ? Des êtres qui leurs ressembleraient ou qui seraient radicalement différents ? Et qu’en est-il des extraterrestres qui peuplent les récits de science-fiction ? Servent-ils à rassurer les lectrices et les lecteurs sur le caractère exceptionnel de l’Humanité ? Servent-ils à flatter leur goût pour l’exotisme ou, au contraire, à les remettre à leur place parmi les autres espèces ? Tels sont les problèmes soulevés par Ted Chiang dans un texte poignant de 2014 intitulé « Le Grand Silence »1. Il s’agit d’une fable racontée du point de vue de quelqu’un d’autre, un être habituellement rangé dans la catégorie « animal ». Voici comment s’ouvre le récit : « Les humains se servent d’Arecibo pour chercher des formes d’intelligence extraterrestre. Leur désir d’entrer en contact est si fort qu’ils ont créé une oreille capable d’entendre à travers l’univers. Mais mes compagnons perroquets et moi-même sommes sous leurs yeux. Pourquoi ne s’efforcent-ils pas à écouter nos voix ? Nous sommes une espèce non humaine capable de communiquer avec eux. Ne sommes-nous pas précisément ce qu’ils cherchent ? »
Il suffit de ces quelques mots à l’écrivain de science-fiction pour mettre en regard deux phénomènes, deux histoires qui semblent n’avoir rien en commun, sinon une proximité géographique fortuite. D’un côté, un édifice scientifique exceptionnel : le radiotélescope d’Arecibo, construit au début des années 1960 au nord de l’île de Porto Rico. Il s’agit de la plus grande antenne convergente incurvée au monde (jusqu’à la mise en service, en 2016, du radiotélescope FAST au sud-ouest de la Chine). Arecibo a fait de belles découvertes, comme celle du premier pulsar binaire. Il a été utilisé par les chercheurs du programme SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) dans l’espoir − comme le rappelle le narrateur − de détecter de potentielles communications extraterrestres. En 1974, il a même transmis le premier message de l’humanité à des intelligences extraterrestres, en direction de l’amas globulaire M13 (dans la constellation d’Hercule).
D’un autre côté, l’île est le théâtre d’une véritable catastrophe écologique. Une espèce de perroquets qui n’existe nulle part ailleurs, l’Amazone de Porto Rico (ou Amazona Vittata), dont le dernier refuge se trouve être la forêt bordant le radiotélescope d’Arecibo, est sur le point de disparaître. Si aujourd’hui seuls quelques dizaines de spécimens sont encore en vie, c’est que les humains ont, inlassablement et pendant plus d’un siècle, abattu les forêts où autrefois ces oiseaux s’épanouissaient. La destruction systématique de leur habitat a toujours eu la même fin : exploiter intensivement les sols et produire des quantités croissantes de sucre, de coton, de maïs et de riz…
Ted Chiang montre que ce qui rapproche ces deux histoires est plus profond qu’il n’y paraît. L’expression donnant son titre au texte, Le Grand Silence, est une métaphore qui désigne ce que les scientifiques appellent le paradoxe de Fermi : « L’univers devrait être une cacophonie de voix, mais il est au contraire d’un silence déconcertant ». Malgré avoir sondé les étoiles pendant plusieurs décennies, Arecibo n’a jamais détecté une seule communication extraterrestre. Mais ici, la métaphore désigne également le sort que les humains, sans trop y prêter attention, réservent à l’Amazone de Porto Rico : « Il y a des centaines d’années, mon espèce était si foisonnante que la forêt de Rio Abajo résonnait de nos voix. Aujourd’hui, nous avons presque tous disparu. Bientôt, cette forêt tropicale sera peut-être aussi silencieuse que le reste de l’univers. »
Le texte de Ted Chiang est-il vraiment une fable ? Cette forme littéraire consiste à raconter une histoire avec des personnages à l’aspect animal, mais dont les comportements sont humains. Le dispositif narratif auquel elle a recours est donc l’anthropomorphisme, c’est-à-dire l’attribution de propriétés humaines aux animaux. Et sa visée est purement allégorique : les personnages animaux ne valent pas pour eux-mêmes, mais seulement en tant qu’ils représentent des humains. Sauf que l’écrivain de science-fiction fait un détour par l’éthologie, science du comportement animal, et rappelle à ses congénères une réalité qu’ils ont trop souvent tendance à ignorer ou à ne pas prendre au sérieux : les perroquets possèdent leur propre voix et sont capables de parler en leur nom.
« Il y avait un perroquet gris africain qui s’appelait Alex. Il était célèbre pour ses capacités cognitives. Célèbre parmi les humains, j’entends.
Une chercheuse humaine nommée Irene Pepperberg passa trente ans à étudier Alex. Elle découvrit qu’Alex connaissait non seulement les mots désignant les formes et les couleurs, mais qu’il comprenait également leur concept.
De nombreux scientifiques étaient sceptiques à l’idée qu’un oiseau soit capable de saisir des concepts abstraits. Les humains aiment à se penser uniques. Mais Pepperberg finit par les convaincre, Alex ne faisait pas que répéter les mots, il comprenait ce qu’il disait.
De tous mes cousins, Alex fut celui qui s’approcha le plus du statut d’interlocuteur aux yeux des humains.
Alex mourut brusquement, il était encore relativement jeune. La veille de sa mort, le soir, il dit à Pepperberg : “Sois sage. Je t’aime.”
Si les humains cherchent à entrer en contact avec une intelligence non humaine, que peuvent-ils vouloir de plus que ça ? »
Il est vrai qu’aucun perroquet ne peut être l’auteur d’un tel récit. Malgré son intelligence, Alex n’en a jamais écrit de lui-même. Cependant, cette fable ne fait pas tout à fait de l’animal un humain, puisqu’elle suggère des capacités langagières qu’il possède réellement. La parole que Ted Chiang prête à son narrateur sert à montrer que ce que nous pensions être le propre de l’humanité ne l’est pas. Ainsi, il rend problématique la frontière symbolique qui sépare l’humain de l’animal en les rapprochant l’un de l’autre :
« Les perroquets apprennent par le son : nous pouvons apprendre à faire de nouveaux bruits après les avoir entendus. C’est une aptitude que peu d’animaux possèdent. Un chien peut comprendre des dizaines d’ordres, mais il ne fera jamais rien d’autre qu’aboyer.
Les humains apprennent par le son, eux aussi. Nous avons cela en commun. Les humains et les perroquets partagent donc une relation particulière au son. Nous ne nous contentons pas de crier. Nous prononçons. Nous énonçons. […] Lorsque nous parlons, nous utilisons l’air de nos poumons pour donner à nos pensées une forme physique. Les sons que nous créons sont simultanément nos intentions et notre force vitale.
Je parle donc je suis. Ceux qui apprennent par le son, comme les perroquets et les humains, sont peut-être les seuls à vraiment comprendre cette vérité. »
En faisant un tel détour par l’éthologie, l’écrivain de science-fiction souligne le décalage et, même, la complicité insoupçonnée entre, d’un côté, les efforts extraordinaires que les humains déploient pour s’assurer de ne pas être seuls dans l’univers et, de l’autre, l’indifférence brutale avec laquelle ils éradiquent les autres espèces de leur planète. En effet, notre désir d’entrer en contact avec une intelligence extraterrestre n’est-il pas d’autant plus fort que nous nions la leur aux êtres non humains qui peuplent la Terre ? Ce que propose Ted Chiang n’est rien d’autre qu’une solution inédite au paradoxe de Fermi, en montrant qu’il n’a pas lieu d’être. Car comment pouvons-nous reconnaître l’intelligence d’une forme de vie extraterrestre, alors que nous ne sommes même pas capables de reconnaître celles qui se trouvent déjà si près de nous ?
« Les humains côtoient les perroquets depuis des milliers d’années, et ce n’est que récemment qu’ils ont envisagé que nous puissions être intelligents.
J’imagine que je ne peux pas leur en vouloir. Nous, les perroquets, avons longtemps pensé que les humains n’étaient pas très malins. Il est difficile de comprendre un comportement si différent du vôtre.
Mais les perroquets sont plus semblables aux humains que n’importe quelle espèce extraterrestre ne le sera jamais, et les humains peuvent nous observer de près ; ils peuvent nous regarder droit dans les yeux. Comment peuvent-ils espérer reconnaître une intelligence extraterrestre s’ils ne peuvent qu’écouter aux portes à des centaines d’années-lumière de distance ? »
Toutefois, ce texte ne se présente pas comme une critique à charge de la recherche d’intelligences extraterrestres. Il s’en inspire, au contraire, pour nous montrer le chemin vers une société plus respectueuse des êtres vivants, quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, quelle que soit leur planète d’origine. Une société non pas « animiste », mais véritablement antispéciste. Peut-être gagnerions-nous à prêter la même attention et la même fascination aux êtres que nous rangeons habituellement dans la catégorie « animal » que celles que nous portons actuellement aux extraterrestres que nous rêvons de rencontrer un jour. Peut-être devrions-nous traiter les premiers de la même façon que les seconds.
Si le perroquet était, à nos yeux, un extraterrestre comme les autres, serait-il aujourd’hui sur le point de disparaître ? N’aurions-nous pas pris plus grand soin de lui et de son habitat ? C’est la raison pour laquelle le narrateur profite de sa proximité avec le radiotélescope d’Arecibo et en détourne l’usage pour en faire un outil de communication inter-espèce :
« L’activité humaine a poussé mon espèce à l’extinction, mais je ne leur en veux pas. Ils ne l’ont pas fait méchamment. Ils ne faisaient simplement pas attention. […] Mon espèce ne sera sans doute plus là très longtemps ; nous mourrons probablement avant notre heure et irons rejoindre le Grand Silence. Mais avant de partir, nous voulons envoyer un message à l’Humanité. Nous espérons seulement que le télescope d’Arecibo lui permettra de l’entendre.
Le message est le suivant :
Sois sage. Je t’aime. »
C’est ainsi que le narrateur tente de rassurer l’Humanité : non, nous ne sommes pas seuls dans l’univers. Il suffit, pour nous en rendre compte, d’écouter les voix qui résonnent encore ici-bas sur Terre, avant qu’elles ne s’éteignent à jamais par notre faute.
1Chiang Ted, 2020 [2019], Expiration, Paris, Gallimard / Folio SF, p. 317-325. « Le Grand Silence » est issu d’une collaboration de l’écrivain de science-fiction avec le duo d’artistes composé par Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla, dans le cadre d’une installation vidéo qui a été présentée en 2014 au Fabric Workshop and Museum à Philadelphie.