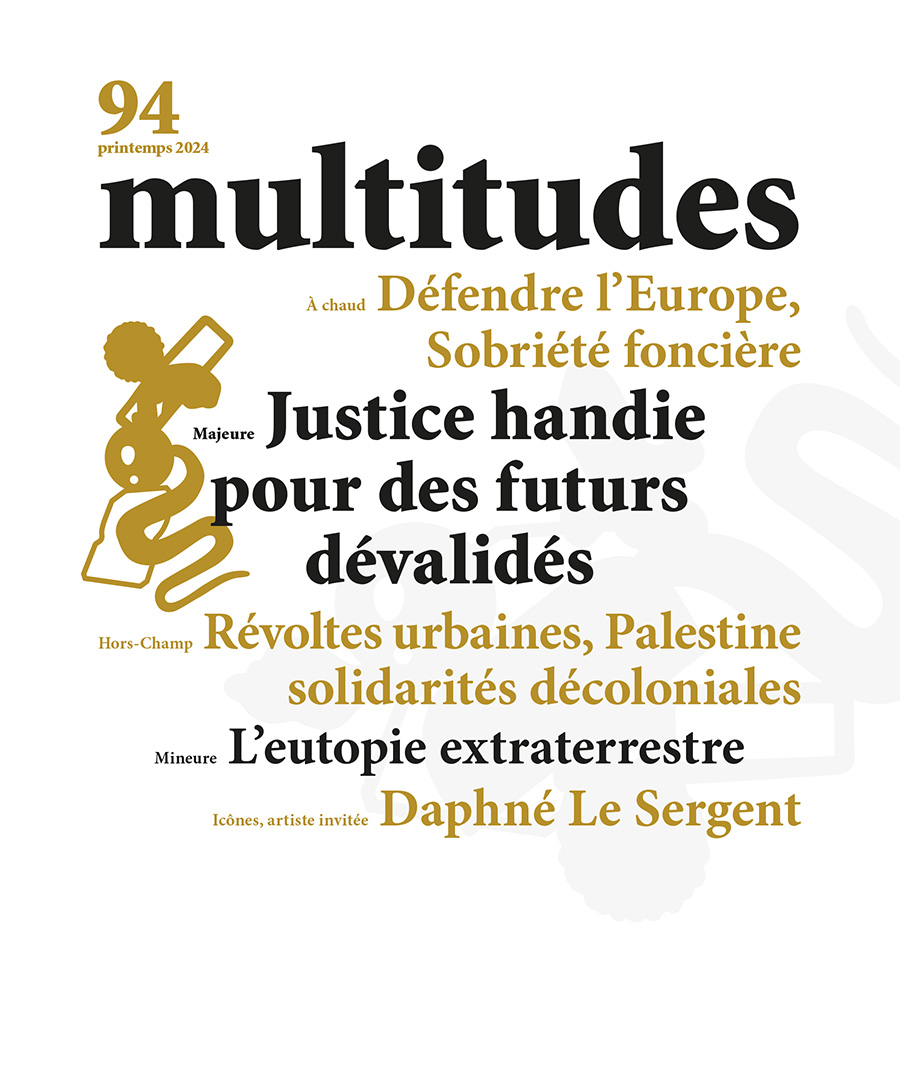Est-ce le chaos climatique qui lui aurait fait franchir la Méditerranée ? Issa n’a pas de papiers. Il vit dans un camp de réfugiés. Il ressemble à un adolescent timide, évanescent, et semble pouvoir disparaître en un swap à tout moment. Il est inséparable de trois jeunes migrants, habillés dans des guenilles tout comme lui : il y a Medhi et Wissam, d’origine irakienne, et Joseph l’Érythréen, efflanqué. Personnage mystérieux, porteur d’un immense espoir pour l’humanité, Issa Elohim est l’extraterrestre, soudainement apparu sur Terre, qui donne son titre à un court roman de l’écrivain de science-fiction Laurent Kloetzer1. Il est l’étranger radical, et pourtant il fascine. Dans la novella, Issa séduit même l’un des dirigeants d’un grand parti populiste, sans aucunement l’avoir cherché bien sûr. L’extraterrestre est en effet une figure éminemment politique. C’est ce que montrent dans ce dossier les articles d’Alice Caradébian, « Le vaisseau alien de Iain M. Banks : une utopie radicale », et de Frédéric Neyrat, « Qu’est-ce que l’alienocène ? ». L’alien peut être vécu tel un envahisseur, un ennemi, un danger pour notre identité humaine, mais il représente tout à l’inverse, et de plus en plus souvent dans les imaginaires contemporains, la nécessité d’un contact avec l’ailleurs. Quel est le sens de sa présence, en une époque d’urgence environnementale mais aussi de régression xénophobe − dont des lois en Europe, telle en France celle dite « Immigration » votée en décembre 2023, sont de tristes exemples ? L’extraterrestre est l’Autre absolu, figure clé de toute transformation de société, politique, sociale et écologique.
Aujourd’hui, l’extraterrestre a mauvaise presse
Malgré l’espoir qu’il incarne, il est rejeté par les penseurs et les penseuses du vivant, élaborant pour le présent et le futur des perspectives dites « terrestres ». Issa Elohim, dans le camp de réfugiés, est pourtant un personnage on ne peut plus terrestre, et il est « extra », porteur d’une magie créatrice de liens. Peut-être est-il, sous ce regard, bien plus qu’un simple extraterrestre : un Extra-Terrestre ? Ce second qualificatif, Extra, permettrait de faire surgir par sa graphie une proximité, une connexion à explorer avec le terrestre. Relier la question Extra-Terrestre à l’actualité du terrestre est en effet l’ambition de ce dossier. L’eutopie Extra-Terrestre se tient précisément sur Terre, et les terrestres, dont les conceptions sont en cours d’élaboration théorique, ne devraient pas la balayer d’un revers de main ironique comme l’a fait non sans humour Bruno Latour2.
L’Extra-Terrestre est oublié, tant par les théories terrestres, dont Bruno Latour serait le symbole, que par les pratiques et soulèvements terrestres, dont le site Terrestres3 incarnerait les archives. Si bien que dans ces deux modalités et visions du terrestre, parfois antagonistes, l’Extra-Terrestre n’entre aucunement en jeu, n’existe pas, n’est doté d’aucune efficace. Les enjeux d’une vie humaine ailleurs que sur terre ont pourtant toujours été au centre des utopies du grand auteur de science-fiction Kim Stanley Robinson. Comme il l’explique dans notre entretien, l’exploration du système solaire n’est pas forcément contraire au défi majeur de notre temps, qui est celui de son dernier roman Le Ministère du futur : le dépassement du capitalisme extractiviste par une métamorphose terrestre, autant des individus que des sociétés.
À l’opposé des futurs proches imaginés par Kim Stanley Robinson, les aventures spatiales d’Elon Musk, de Jeff Bezos et de leurs semblables de la Silicon Valley trompent la perspective Extra-Terrestre. Car leurs ambitions sont « modernes », ou plutôt, en restituant à cet adjectif sa majuscule impériale, si pleinement Modernes. Il ne s’agit pas pour eux d’explorer l’inconnu, ou si peu, mais de conquérir, voire de fuir, de quitter une Terre de moins en moins habitable. Musk, Bezos et tant d’autres en deviennent des extraterrestres au sens de non-terrestres. Il ne faudrait pas déconsidérer l’Extra-
Terrestre en raison de ce qu’ils font et de ce qu’ils envisagent. C’est ce qu’évoquent en filigrane Sandra Laugier et Ariel Kyrou dans leur conversation sur la série For All Mankind, en se demandant si l’exploration spatiale de cette uchronie se rapproche plutôt d’une dystopie ou d’une utopie extraterrestre.
Pourquoi faudrait-il choisir, sur un mode strictement binaire, entre l’exploration terrestre et l’exploration extraterrestre ? Pourquoi ne pas accueillir avec bienveillance la figure de l’Extra-Terrestre, l’étudier comme une potentialité ? Pourquoi ne pas s’interroger sur l’effet de cette figure, et sur les Modernes du XXe siècle, et sur les terrestres à venir ? L’enjeu de ce dossier, une fois énoncé ce constat qui paraîtra bizarre à qui n’y a pas pensé auparavant, est d’effectuer le rapprochement entre terrestre et Extra-Terrestre. À cette fin, il nous semble intéressant de mobiliser le terme d’Eutopie, ou « lieu du meilleur ».
Le lieu du meilleur
L’Eutopie Extra-Terrestre n’est pas une utopie, au sens du « lieu de nulle part ». Les Extra-Terrestres ont déjà produit des effets sur Terre depuis 1947, via les humains qui disent avoir perçu des phénomènes identifiés comme des soucoupes volantes, ou par d’autres, moins nombreux, qui affirment avoir été enlevés par des êtres venus d’ailleurs. Le sociologue Pierre Lagrange, qui a travaillé avec Bruno Latour sans vraiment réussir à le convaincre, montre dans son article « Quand les ovnis nous invitent à atterrir » à quel point ces témoignages-là parlent moins de l’espace intersidéral que de la Terre peu à peu défigurée, détruite par des humains et leur fièvre capitaliste. Et si les soucoupes volantes nous ramenaient sur Terre ? Il ne s’agit pas de croire les témoignages d’enlèvements comme s’ils étaient vrais. L’enjeu serait plutôt, à la façon de la romancière Amélie Lucas-Gary se rendant dans « les réunions ovnis du premier mardi » du mois afin de préparer un livre, d’écouter, de suspendre les jugements sans appel qui nient la réalité humaine de ces visions.
Le philosophe Bertrand Méheust a raison de rappeler que l’imagination des écrivains du merveilleux scientifique et de la science-fiction a précédé le phénomène ufologique apparu en 1947. De la même façon qu’il dévoile un lien entre certaines fictions et des événements vécus ultérieurement, l’interview par notre collaborateur extraterrestre de l’autrice de science-fiction Émilie Querbalec et de l’astrophysicien Roland Lehoucq montre à quel point L’Extra-Terrestre est une figure majeure, et de la recherche scientifique via l’exobiologie et la découverte d’exoplanètes notamment4, et de la science-fiction − ce que confirme la philosophe Sylvie Allouche dans son décryptage des multiples facettes de l’E. T. en SF.
Quelles qu’en soient les formes, qu’il soit perçu sur Terre par des témoins humains, imaginé par des personnes créatrices ou recherché par des scientifiques, l’Extra-Terrestre est une figure aujourd’hui très présente. Elle n’est pas réelle telle un poulpe, mais elle ne produit pas moins des effets. Sa présence est curieuse et parfois ambiguë. Elle vibre dans les musiques d’inspiration spatiale, évoquées par le duo Contre-culture psychique dans le sujet « Les aliens, la musique et nous » et qui parlent beaucoup plus de nos quêtes sonores, émotionnelles et relationnelles à nous autres, humains, que de ce que pourraient vraiment écouter des extraterrestres. Cette présence est encore plus paradoxale dans la nouvelle de Ted Chiang, « Le Grand silence », relue par Julien Wacquez et Chiara Mengozzi, où la disparition d’une espèce de perroquet, y témoignant tel un extraterrestre que l’on entendrait enfin, est révélée par sa proximité au radiotélescope d’Arecibo à Porto-Rico utilisé pour le projet SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Enfin, dès lors que l’on casse le mur de séparation entre ladite fiction et ledit réel, et qu’on accepte, comme Dominiq Jenvrey l’explique dans son article de conclusion, d’entrer dans un nouveau régime d’imagination, il nous devient plus aisé d’accueillir l’impossible des agents de Gaïa, du migrant comme de la soucoupe volante, c’est-à-dire d’Issa Elohim, venu d’on ne sait où.
La question Extra-Terrestre est différente de celle des esprits, des fantômes, des revenants, des phénomènes parapsychiques et parascientifiques que l’anthropologie étudie sans les juger chez des peuples lointains ou même au sein des sociétés occidentales. À leur manière, les scientifiques y sont impliqués. À leur manière, les écrivains de SF y sont créatifs. Cette dualité, scientifique et fictionnelle, est à interroger ensemble, en y ajoutant la dimension anthropologique. Si bien que pour être complète, la figure de l’Extra-Terrestre est à interroger par ces trois manières et disciplines : la science, avec ses programmes d’exobiologie et de recherche de vie dans l’Univers ; la fiction avec ses créateurs et créatrices au sein de la science-fiction ; et puis l’anthropologie et la sociologie avec leurs enquêtes sur de nombreux phénomènes terrestres… ou extraterrestres.
Notre propos est ici de signifier l’importance contemporaine de la figure de l’Extra-Terrestre. C’est le sens de l’eutopie : il y a du bon à envisager le futur avec elle, elle peut nous orienter vers un meilleur. En ce sens, elle est une parente de la figure du terrestre.
1Laurent Kloetzer, Issa Elohim, Le Bélial / Une heure lumière, 2018.
2Bruno Latour, lorsqu’il choisir le terme « terrestre » au milieu des années 2010, exclut de l’ambition terrestre la figure de l’Extra-Terrestre. Dans Face à Gaïa (La Découverte, Les Empêcheurs de penser en rond, 2015, p. 320), il rejette le terme « Terriens » car trop lié à une science-fiction qu’il déjuge. Cf. Élie During, « Bruno Latour et les extraterrestes », Critique, no 903-904, août septembre 2022.
3Le site Terrestres, créé en 2018, et le livre La condition terrestre, Seuil, 2022, de Sophie Gosselin et David Gé Bartoli, co-fondateurs du site avec Christophe Bonneuil et plusieurs chercheuses et chercheurs, sont les marqueurs de l’usage du terme terrestre. Terrestre est, pour le moment, le terme retenu afin de qualifier les conceptions en cours d’élaboration qui viendraient après le Moderne, afin de le remplacer.
4Depuis la découverte des premières exoplanètes en 1995, la recherche de formes de vie dans l’Espace a pris une place essentielle comme l’atteste l’importance nouvelle de l’exobiologie. Puis, se souvenir que l’innovation de James Lovelock, dont sera issue sa pensée de Gaïa, provient directement d’une recherche de la vie sur la planète Mars à partir de son atmosphère. Ce qui permet de considérer que la recherche de la vie dans l’Espace, et donc de formes Extra-Terrestres, a exercé une influence sur la manière d’envisager le vivant sur Terre.
Sur le même sujet
Articles les plus consultés
- Il faut défendre les invulnérables. Lecture critique de ce qu’on s’est laissé dire, à gauche, sur la pandémie de covid
- Genre is Obsolete
- Le revenu garanti ou salariat affaibli, condition structurelle d’un régime vivable de capitalisme cognitif
- Des génies accueillants au Laos
- Manifeste accélérationniste