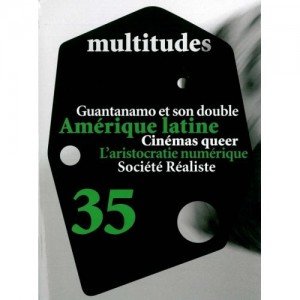Invité en 2001-2002 à un groupe de travail visant à re-qualifier Bruxelles en tant que « Capitale de l’Europe », le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas avait vigoureusement attaqué la communication et l’image défaillantes de la Communauté européenne, en les comparant – horreur ! – à la stratégie marketing de McDonald’s. Il avait ensuite proposé de présenter de manière « plus attrayante, ironique et légère » la diversité et la richesse de l’Europe, grâce à un nouveau drapeau européen frappé d’étoiles dansant sur un fond bleu et un code à barres combinant les couleurs des divers drapeaux nationaux, ce qui prenait toute sa signification avec l’incorporation en cours des nations de l’Est. Rem Koolhaas, ainsi, avait tenté de forcer par ces propositions attractives l’émergence d’une nouvelle imagerie des symboles européens, dans une opération de branding (marquage, en français) de Bruxelles, liée au concept économique de city marketing utilisé depuis les années 1980.
C’est dans ce contexte, contemporain, du design politique et de ses régimes de représentation que sont entrées en jeu les entreprises de Société Réaliste. Entreprises au pluriel. Koolhaas l’a fait aussi, séparant son OMA (Office for Metropolitan Architecture) de son AMO (think-tank abordant les questions sociologiques, médiatiques, politiques), laissant opportunément de côté un dernier acronyme, celui de MAO (l’architecte travaille beaucoup en Chine). Le site web de Société Réaliste, de même, annonce différentes structures. Soit : Marka ; EU Green Card Lottery ; un Ministère de l’Architecture ; PONZI’S ; Transitioners ; Cabinet Société Réaliste Conseil… Et la liste, qui sait, n’est peut-être pas exhaustive. Mais le modèle de ces antennes brassant plusieurs langues n’est sans doute pas tout à fait celui de Koolhaas. Il est bien plutôt, à mon sens, celui du « Musée d’Art moderne (Section XIXe siècle) Département des Aigles ». Ouvert par Marcel Broodthaers dans son appartement bruxellois en 1968, inscrivant le nom du musée sur ses fenêtres et peuplant l’appartement de caisses de transport, de sorte que la présentation muséale indexât à la fois les œuvres et leur absence, il allait se prolonger par l’ouverture de différentes « Sections » jusqu’à la fermeture en 1972, déclarée pour cause de faillite. Jusques et y compris dans cette ultime vicissitude de l’aventure fictionnelle, l’invention d’une institution œuvrant à une programmation et à des ensembles de textes – qu’il s’agisse de tracts ou de lettres –, produisant une traduction poétique du langage institutionnel (ou réciproquement), permettait de mimer l’amalgame de l’expression individuelle avec ce qui la diffuse et de décrire précisément l’avènement d’un art devenu art par l’effet singulier de son cadre de présentation artistique. Cette esthétique des procédures, Société Réaliste l’a importée dans l’examen, également mimétique et critique, des territoires de la gestion et de la technocratie. Les entreprises de Société Réaliste n’interviennent pas pour réparer des institutions en petite forme ou enthousiasmer par les séductions d’un schème rénovateur global et local. Société Réaliste met, toute en férocité, le doigt, la main et quoi encore ! dans les organismes politiques présents ou passés, pour y retrouver des connivences étymologiques et iconographiques : celles qui, par exemple, ont amené la Communauté européenne à commettre l’idée, sur le modèle de la green card américaine, d’une « carte bleue » qui validerait la fusion en un document unique des permis de séjour et de travail. Chez Société Réaliste, il ne s’agit pas de répondre à des problèmes mais d’identifier de nouvelles questions : ainsi, l’îlot Marka a fait émerger des discussions idéologiques, politiques, représentationnelles, posées par les formes matérielles de l’argent européen, non plus liées à un prince ni une nation souveraine mais à une unité supranationale.
Ainsi que l’énoncent ses deux membres, Jean-Baptiste Naudy et Ferenc Gróf, le nom de cette coopérative agissant, depuis 2004, dans le champ de la recherche et la production artistiques – Société Réaliste, donc – provient de l’inversion du Réalisme Socialiste. Faut-il le rappeler, la doctrine du Réalisme Socialiste fut formulée officiellement en 1934 (au Congrès des écrivains d’URSS), établissant son titre à partir d’une simple réflexion à propos de l’écrivain Maxime Gorki : « son réalisme est socialiste ». Elle allait étendre son idéal de transformation esthético-politique, de façon hégémonique, sur une partie du monde, tout en restant périphérique aux débats artistiques de la modernité, et largement écartée de ceux concernant les sources du post-moderne. Vers les années 1960, on a vu brièvement surgir, dans un magasin de meubles à Düsseldorf une « manifestation en faveur du Réalisme Capitaliste » par Gerhard Richter, Sigmar Polke, Konrad Lueg et Manfred Kuttner, artistes venus de l’Est et mélangeant les pinceaux de leur équivoque adoption du pop art occidental. Dans les deux cas – celui du Socialiste comme du Capitaliste – le mot de Réalisme est resté : une identité esthétique forgée au XIXe siècle, non sur un principe moral d’imitation de la réalité, mais comme une qualité de représentation du réel dans sa singularité.
Affirmer le Réalisme Socialiste comme point de vue – et de plus, inversé – n’est pas une façon de manifester un intérêt stylistique pour des images rétro désormais plus ou moins versées du côté du camp, au mieux. C’est s’intéresser d’abord à l’usage contemporain, dans les pratiques expérimentales de l’art, de constructions nées dans l’utopie transformatrice d’une révolution culturelle. C’est aussi ancrer une stratégie par une figure collective : une société n’est pas un duo, ni un groupe d’artistes et elle conduit d’emblée vers un modèle d’organisation et d’interrelations. Ici, le réalisme apparaît comme qualificatif.
Ce point de vue, Société Réaliste, en a également énoncé les caractéristiques instrumentales et le champ d’orientation dans une conférence intitulée « Spéculums pour Spéculations » (2007) fouillant dans l’étymologie du spéculaire et ses modes de présentation, le spectacle, qui allait jusqu’à « faire chanter les images » (ce qui pourrait nous amener à caractériser les bons artistes comme d’excellents maîtres-chanteurs). Qu’est-ce qu’un spéculum, en effet ? C’est un outil propre à dilater l’entrée de certaines cavités – vagin, anus, gorge –, de manière à ce qu’on puisse en regarder l’état intérieur, notamment au moyen de la surface réfléchissante de l’instrument, en miroir. « Le spéculum est à la fois un instrument qui pointe et qui se montre », dit Société Réaliste, tout en réfléchissant, à partir du verbe latin specere (dans sa forme archaïque : regarder) l’articulation entre connaissance spéculative et spéculation financière.
Ainsi, invitée à Kassel, pendant la Documenta XII, par le workshop et contre-projet de Multitudes-Icônes, Société Réaliste a effectivement spéculé sur les trois questions/leitmotive émises par l’institution. Pour « La modernité est-elle notre antiquité ? », elle produisait un appel à donation pour Société Réaliste ; pour « La vie nue ? », elle présentait l’identité bancaire du compte ouvert par Société Réaliste ; enfin, « Que faire ? » donnait lieu à la diffusion du numéro d’utilisateur et du mot de passe permettant à qui le voulait d’accéder au compte bancaire de Société Réaliste à la Société Générale (Over the counter (OTC), 2007).
Fabriquer des objets « spéculaires », qui se montrent et qui montrent en même temps. Tel est l’office, également, du bureau de tendances Transitioners, inspiré à la fois par la création en matière de mode (un bureau de tendances impulse, littéralement, de la mode à la mode) et par le créationnisme politique contemporain. En effet, la série de mouvements développée dans les sociétés post-communistes d’Europe centrale et orientale ou d’Asie centrale a pris des noms de fleurs (peut être depuis la « Révolution des œillets » au Portugal en 1974) ou endossé une couleur, afin de qualifier ce qui leur semblait relever d’une « transition démocratique ». La protestation contre des gouvernements vus comme corrompus et autoritaires et la promotion de la démocratie et l’indépendance nationales (principalement vis-à-vis de Moscou) ont donc produit la notion d’une nouvelle catégorie politique, en lui conférant une couleur, une texture ou un parfum spécifiques, tous relativement agréables et plutôt « non violents », qu’il s’agisse des roses en Géorgie (2003), de l’orange en Ukraine (2004) ou des tulipes au Kirghizistan (2005), sans compter les manifestations et contre-manifestations entre rouge et jaune à Bangkok (fin 2008)… Qu’est-ce qu’une couleur politique ? La métaphore, généralisante, s’est donc trouvée spécifiée par une littéralisation des faits.
Le caractère « chanté » de la Révolution est aussi une façon de signifier, à la jonction de l’individuel et du collectif, la marche vers l’indépendance. Ainsi ces festivals de chœurs aux pays baltes, où affluèrent des centaines de milliers de personnes après la Chute du mur, pour exiger en chantant la sécession d’avec l’empire Russe. Entre ces festivals de chants et le sifflage de la Marseillaise, il y a effectivement la commune mesure battue par la voix chorale. D’où, sans doute, la familiarité mais aussi l’étrangeté de ce projet qu’on peut aujourd’hui considérer dans les pages de Multitudes : ce livret à chanter, où figurent les paroles, toutes traduites en anglais, des hymnes nationaux de tous les pays représentant les paradis fiscaux du monde mondialisé. Ici, toutes les références singulières aux noms de ces pays ont été remplacées par le lieu commun de la « freedom », de la liberté. Le « poème anglais », comme l’appellent, non sans réalisme, Jean-Baptiste Naudy et Ferenc Gróf, est ici déplié sous forme d’une partition, terme qui laisse apparaître à la fois ses connotations musicales et géopolitiques : d’ailleurs, les fuseaux horaires et les latitudes, comme formes communes d’appréhension du monde, en formulent le cadre et vectorisent la lecture, de la nuit au jour et du grand Nord au plein Sud.
Cette façon d’appréhender la carte, ainsi que l’image de bas-relief fragmenté en partitions triangulaires, rapprochent les deux projets icono-éditoriaux, de l’aveu même de Société Réaliste, qui s’y réfère, de Buckminster Fuller. Célèbre pour avoir imaginé Manhattan écologiquement couvert d’un dôme géodésique, Buckminster Fuller exposait, dès 1929, dans un grand magasin de Chicago sa Dymaxion House (mot composé par un publicitaire-maison à partir de : « dynamic », « maximum », et « ion ») : une inversion de la maison traditionnelle, avec son mât central et ses élévations au sol hexagonales, entourées non de murs mais de membranes pneumatiques tenues par des tenseurs. La maison devait être produite n’importe où n’importe quand. Après la Dymaxion maison et la Dymaxion automobile (1933), « Bucky » Fuller, professeur au Black Mountain College (avec John Cage, Merce Cunningham, et Josef et Anni Albers) allait produire ses fameux dômes géodésiques – « une stratégie, une méthode pour produire la triangulation des sphères », selon ses exégètes. Vers 1954, il mit au point sa Dymaxion Map, la seule carte plate qui se plaçât en alternative viable à celle de Mercator, laquelle consacrait une représentation du globe contenant de nombreuses distorsions en matière de formes, de distances, ou de territoires (ainsi le Groenland ou l’Antarctique). Au contraire de cette cartographie traditionnelle, renforçant l’isolement territorial d’une humanité n’apparaissant préoccupée que de son « moi pas toi ; il n’y a pas assez pour deux », la carte Dymaxion entreprit de construire une dynamique pour les ressources et besoins globaux et, voyant plus loin encore, une cartographie généralisée permettant d’« interpréter » à chaque minute et par chacun l’état du monde. En effet, l’objectif de ses « World Games » présentés à l’Exposition universelle de 1967, n’était rien moins, selon Fuller, que « d’explorer de nouvelles façons pour chacun et pour tout le monde au sein de toute la famille humaine, afin de jouir du territoire terrestre dans sa totalité (…) sans qu’aucun humain ne prenne avantage sur un autre ». L’architecture avait disparu.
L’universalisme de Buckminster Fuller est ici rejoué à la lumière de la mondialisation postcoloniale. L’expérience proposée est celle d’une « remise en globe » – à la façon contemporaine d’un do it yourself, un prêt-à-fabriquer – de quelques détails prélevés photographiquement à la frise sculptée de l’ancien Palais de la Porte Dorée. Seul vestige monumental de l’Exposition coloniale de 1931 à Paris, devenu musée permanent des territoires d’Outre-Mer, puis Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie, il abrite aujourd’hui la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Ces variations d’étiquette apparaissent, ainsi que les mots et les figures découpées dans l’expérience cartographique de Société Réaliste, comme des traductions actualisées et naturalisées d’une représentation, linéaire comme une frise, celle d’une impasse politique, d’un passage qui ne passe pas.