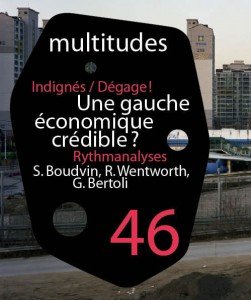Rap et contestation au Sénégal
Thiat & Sidy Cissokho
Le 23 juin 2011 était prévu le vote d’une loi modifiant le mode de scrutin de l’élection présidentielle sénégalaise de 2012. Cette loi devait permettre au futur président d’être élu en même temps que son vice-président, au premier tour, avec 25 % des voix. Des manifestations ont eu lieu dans les plus grandes villes du pays, menant au retrait du projet le soir même. Porté par un climat social tendu par les coupures d’électricité, la hausse des prix des denrées de première nécessité et le chômage de masse, la protestation a ensuite continué en prenant la forme de saccages de bâtiments et de biens publics ou de maisons de hauts fonctionnaires. Les événements du 23 juin ont donné naissance à un mouvement éponyme rassemblant les acteurs de la société civile et les membres de l’opposition derrière une revendication : la non-candidature d’Abdoulaye Wade aux prochaines élections. Ce dernier, après avoir fait réviser la constitution pour limiter le nombre de mandats à deux, entend briguer un troisième mandat et soutient que la réforme ne s’appliquera qu’à son successeur.
Dès les premières heures des manifestations, deux rappeurs, Thiat[1] et Fou malade, ont été emprisonnés avant d’être relâchés quelques jours plus tard. Ces deux rappeurs sont les principales figures médiatiques du mouvement « Y’en a marre » né au début de l’année, et prolongeant le phénomène culturel Bul Faale[2]. En partie inspirés de la culture de rue américaine, les jeunes Sénégalais réinventent le rapport à la réussite, à la religion ou encore à l’africanité, en rompant avec les figures mythiques de la réussite telles celles de l’intellectuel incarné par le premier président socialiste Léopold Sedar Senghor. Les principales incarnations de ces bouleversements sont les lutteurs et les rappeurs. Le mouvement « Y’en a marre » est l’héritier direct de ces bouleversements et aussi leur traduction politique dans des formules habiles comme le NTS (Nouveau Type de Sénégalais) ou encore le Dass fananal[3] pour pousser la jeunesse à s’inscrire sur les listes électorales. Critiques à l’égard des marabouts et de leurs Ndiguel[4], ils affichent la volonté de rester à équidistance du parti au pouvoir et de l’opposition largement majoritaire au sein des collectivités locales. Leur travail de mobilisation a contribué largement au succès des manifestations du 23 juin.
Sidy Cissokho : Comment en es-tu venu au rap ?
Thiat : J’ai moi même écrit beaucoup de textes avant la formation du groupe Keur-Gui. J’écrivais des textes que je jouais durant les festivals, en classe et dans les foyers scolaires. J’écrivais mes lyrics sur les tables, les murs de l’école ou tout simplement dans mes cahiers à la place de mes cours. En revanche, la formation du groupe remonte à 1996, pendant la grève de l’UNES (Union nationale des élèves du Sénégal). Durant cette grève, tous les lycées du Sénégal ont fait la grève en même temps. Nous avons stoppé les cours pendant trois mois. On a parlé d’année blanche. Le groupe s’est créé à cette période. Kilifa[5], moi et un autre membre du groupe de l’époque étions grévistes. Je suis venu trouver Kilifa en lui proposant d’élargir nos revendications à l’échelle régionale, nationale ou pourquoi pas continentale. À cette époque, nous avons scellé un pacte de sang marquant la création du groupe. Nous étions alors influencés par les films de Shaolin et leur idéal d’honneur et de dignité. Il y avait beaucoup de choses à dire et de qui tenir. Kaolack, notre ville d’origine, est une ville qui a une culture de l’engagement politique. L’histoire de Kaolack est pleine de résistants et je suis un petit-fils de ces gens-là. Je me retrouve bien dans ces combats. Servir son peuple, se battre pour lui, il n’y a pas plus noble que ça.
S. C. : Pourquoi choisir ce mode d’expression plutôt qu’un autre ?
T. : En 1996, je me suis dit que je n’avais pas de connaissance dans la religion. Je ne sais pas réciter le Coran, y trouver les subtilités qui permettent de galvaniser, de conscientiser les populations. Bien que musulman, je ne suis pas un érudit. Je n’avais aucune maîtrise de la philosophie, qui elle aussi peut être une arme pour mener des combats et conscientiser. En revanche, j’ai deux diplômes que, même en étudiant cent ans, tu ne pourras pas avoir. J’ai le respect et le pouvoir. Ces deux diplômes, tu ne peux les obtenir que dans l’école de la rue. Je me suis forgé pour obtenir ces deux attributs qui, pour moi, sont les deux plus grands diplômes. Quand tu te donnes à la rue, elle te donne du respect. Si tu lui donnes encore plus, alors elle te donne du pouvoir. Ce pouvoir, je le rends au peuple en le représentant, en le défendant et en servant de haut-parleur à ses revendications. À partir de ces grèves, c’est ce qu’on a décidé de faire avec Keur-Gui. On a aussi choisi le wolof, une langue plus riche que le français ou l’anglais. En wolof, il y a plus de métaphores, plus de punch, plus de rimes.
S. C. : Quelles étaient vos revendications ?
T. : Au tout début, on a commencé au niveau local, en essayant de cerner les problèmes de la ville de Kaolack. À l’époque, le maire jetait des potions magiques, que le marabout lui avait données, dans les réserves d’eau de la ville. Il faisait des sacrifices dans les mosquées avec les imams et il enterrait vivant des moutons. Tout ça pour avoir la mainmise sur les esprits et les biens de la ville. En réalité, il tenait les gens en les payant ou en les aidant matériellement lors des cérémonies. On a grandi dans cette atmosphère. Nous, on lui a dit merde à travers nos chansons, les concerts de sensibilisation et les médias de Kaolack. Si aujourd’hui à Kaolack les gens ont la liberté de dire ce qu’ils veulent dans les médias, c’est grâce à nous. Nous fûmes les premiers à dire au maire « Va te faire foutre ! » à la radio. L’argent de Kaolack est à Kaolack et ne doit pas aller dans ses poches. On avait recensé tout ce qui se passait dans la ville. Le seul endroit où on trouvait des bouches d’incendie dans cette ville, c’était au lycée. Kaolack a l’un des plus grands marchés de l’Afrique de l’Ouest et ce marché n’a même pas de bouche d’incendie ! Un souk ou une cantine prend feu et tout le reste s’enflamme. Les routes ne sont pas bien goudronnées et il n’y a aucune infrastructure. Les pompiers n’ont pas de moyens. La police est en panne d’effectifs. Les policiers présents ont un gros ventre et de grosses fesses car ils auraient dû partir à la retraite depuis déjà quinze ans. Pour passer les concours pour être policier, ils ont pour beaucoup trafiqué leur extrait de naissance afin de se faire passer pour plus jeunes qu’ils n’étaient. Ce sont des flics qui dorment au poste, qui ne foutent absolument rien, qui sont corrompus. Ils prennent des 100 francs CFA ou des 200 francs CFA aux usagers de la route. Au niveau des services d’hygiène, la situation était catastrophique. À l’hôpital, il n’y avait pas d’ambulance et pour transporter un malade, on lui demandait de payer le gasoil. Il n’y avait aucune infrastructure culturelle ou sportive. À l’époque, si on pouvait se vanter d’avoir quatre usines, aujourd’hui seule une continue de fonctionner. Nous avons pourtant des ressources et de la matière première dans la région. Une usine saline existe encore mais elle n’appartient pas au Sénégal, elle appartient à un Français. De plus, l’État est venu dire aux travailleuses artisanales qui produisaient de l’huile d’arrêter car elles faisaient concurrence à un monopole de la Sonacos, la société étatique de production d’huile.
S. C. : A-t-on essayé de vous faire taire ?
T. : Avec toutes ces revendications, le maire nous a mis en prison trois fois pour quelques jours à chaque fois. Avant cela, il avait essayé de nous corrompre. Ils ont appelé la mère de Kilifa pour le forcer à partir en Europe. Ils nous ont tabassés, nous avons fait chacun plusieurs semaines d’hospitalisation. Pendant deux ans on nous a presque interdit de faire des scènes. À chaque fois que le nom Keur-Gui apparaissait sur une affiche, quelqu’un appelait les organisateurs pour leur dire qu’on ne devait pas jouer. Tous les premiers mercredis de chaque mois, on devait se rendre au tribunal pour signer et montrer qu’on n’avait pas quitté le pays. On a dû payer une amende de 500 000 francs CFA chacun. Personne ne voulait plus nous inviter à des concerts parce que c’était sûr qu’on allait nous empêcher de jouer. On a vraiment galéré pendant ces deux années. On a quand même commencé à se faire un nom au niveau national parce que Kaolack est une ville importante au Sénégal et aussi une ville où il y a beaucoup de passage. Les gens savaient qu’à Kaolack il y avait un groupe qui bougeait, dénonçait et revendiquait parce que très tôt on a fait des concerts. La censure existait aussi pour nos sorties CD. On a même été un des premiers groupes sinon le premier groupe à se faire censurer. À l’époque, pour sortir un album, il fallait que l’album soit écouté par le Haut Conseil de l’Audiovisuel. Cette autorité était chargée d’évaluer si un album était conforme au droit et pouvait sortir. Ils ont censuré cinq des chansons de l’album, autant dire tout l’album. Il n’a jamais vu le jour. C’était juste avant les élections. On avait pourtant commencé à faire la tournée des radios avec le premier extrait. On venait juste d’avoir 18 ans. Les jeunes s’identifiaient à nous. On a quand même joué un rôle important dans la campagne en 2000.
S. C. : Vous avez pourtant connu un succès important depuis, quelles en sont les raisons ?
T. : Pour le premier album qu’on nous a laissé sortir après l’alternance, on a opté pour le même principe qu’en France avec un grand distributeur et on s’est fait arnaquer. Pour le second aussi d’ailleurs…On n’était pas au courant des vrais chiffres de vente. Lors de l’échec de notre premier album, on avait du mal à rentrer chez nous. On a dormi dans les rues, sur les plages pendant des mois. Le fruitier nous donnait des cartons pour que l’on se couche. Pendant l’hivernage, on mettait nos sacs à dos dans un fast food la nuit. On mangeait des restes au déjeuner et au petit déjeuner. Entre temps, on allait en ville pour voir les producteurs, pour voir les contacts. Une fois, on a même quitté Kaolack pour jouer sur Dakar pour être payés 400 FCFA et être remerciés à la moitié de la première chanson. On marchait 18 km pour sortir de Kaolack et avoir des transports moins chers pour aller à Dakar et jouer dans des festivals. Même en studio, jamais aucune réduction. Mais on y a cru. À force de persévérance, on est passé d’un simple groupe régional à un groupe avec une stature nationale. C’est notamment dû à nos stratégies de distribution. Avec notre dernier album sorti en 2008 Nos connes doléances, on a innové. Avant que l’album ne sorte, on a fait de la promo en prévenant que l’album allait sortir. Le jour de la sortie de l’album, on a fait des « concerts + vente ». Avant que l’album ne sorte, on avait programmé sept ou huit dates. Le premier concert, on l’a fait à Kaolack. On a vendu 2 000 CD à 2 500 FCFA. Les gens paient leur ticket à 2 500 FCFA le concert et ils ont en plus le CD. On a sillonné tout le Sénégal pour servir tout le monde. On a ensuite terminé par Dakar. En parallèle, on a aussi fait appel à des groupes de jeunes constitués en sociétés. Ces groupes ont leur propre réseau de distribution. Ils viennent te voir et disent qu’ils veulent 200 albums au prix du grossiste. Eux le vendent ensuite aux artistes, aux rappeurs, aux gens qui sont renommés. Ce sont des gens passionnés. Je fais aussi partie de leur clientèle et j’ai acheté depuis 2007 tous les albums rap bons ou mauvais. On me l’impose. Chez moi j’ai une tonne de CD de groupes que je ne connais même pas. Seulement si un jour la rumeur se répand que j’ai refusé d’acheter tel ou tel album, je prends le risque d’être boycotté. Les artistes sont forcés d’acheter. S’il y a 3 000 rappeurs qui achètent, alors le groupe s’en sort. Voilà pourquoi en 2 000, on a fait les meilleures ventes, meilleurs albums, etc. Alors si tu ajoutes en plus les marchés en dépôt-vente ou encore les boys qui vendent nos CD au feu rouge…
S. C. : Après avoir appelé à voter pour Abdoulaye Wade en 2000, aujourd’hui vous appelez à voter contre lui ?
T. : Oui, on a appelé à voter pour le « Sopi[6] ». Sopi, Sopi on a tellement crié Sopi dans notre vie… Mais on n’a pas voté pour Wade. Les Sénégalais non plus d’ailleurs. Les Sénégalais ont voté contre Diouf, il y a une nuance. En 2000, il fallait changer, donc on a voté contre Diouf et pour le changement. Qui devenait président à sa place, ça ne comptait pas. L’essentiel était que Diouf s’en aille. Le mieux placé a été Wade. Il est arrivé au pouvoir par défaut finalement. Diouf nous a été imposé par Senghor. Mais Wade, c’est les populations qui l’ont choisi. On y a vraiment cru et on a été extrêmement déçus, cette déception est incommensurable.
S. C. : Pourtant dans une interview tu semblais dire que la liberté d’expression s’était améliorée depuis l’arrivée du PDS (Parti démocratique sénégalais) ?
T. : Aujourd’hui, la censure dont je parlais tout à l’heure est plus insidieuse et même pire. Le régime socialiste agissait par la force. Eux fonctionnent aujourd’hui par tentative de corruption. C’est encore pire. Ils te proposent l’argent du contribuable, des centaines de millions. Autant dire qu’ils sont vraiment généreux… Aux dernières élections locales par exemple, on a essayé de nous corrompre en nous proposant d’emmener nos parents à la Mecque en échange de notre soutien à la mouvance du fils du président, Karim Wade. On nous a même proposé de l’argent. J’espère que plus tard on pourra traduire ces personnes en justice.
S. C. : Comment pouvez-vous dénoncer tout cela sans parler des élites religieuses qui jouent une rôle important dans la vie politique sénégalaise ?
T. : Nous sommes conscients de ce problème. Nous avions lancé un appel aux marabouts pour qu’ils s’en tiennent aux relations entre Dieu et les talibés[7]. Les marabouts des différentes confréries du Sénégal nous les respectons, certains n’ont pas de poche. Cependant on s’est tous rendu compte que beaucoup ont des comptes bancaires, des passeports diplomatiques, beaucoup d’argent. Si eux ne sont pas exemplaires alors ils ne peuvent pas nous demander de renoncer à la belle vie. Ils ont une lourde responsabilité par rapport à la société qui est en majorité musulmane.
S. C. : Pourquoi être passé d’un mode d’expression artistique à une forme d’expression plus directement politique ?
T. : J’ai fait mon rap. J’ai eu plein de choses positives, de tournées au Sénégal mais aussi dans toute l’Afrique et en Europe. J’ai gagné aussi des trophées mais je n’avais pas trouvé de sens à ma vie. « Y’en a marre », c’est ma raison de vivre. Jamais je ne me suis senti aussi utile de toute ma vie. À l’époque, je me disais que j’étais seulement un microbe, je ne pouvais apporter que des maladies. Mais aujourd’hui, je suis le médicament à la maladie que j’ai participé à propager. Le CD n’est pas accessible à tout le monde. Le CD, la musique va toucher une tranche d’âge qui aime le hip hop. Traduire les paroles en acte à travers la création d’un mouvement permet d’arrondir les angles, d’évacuer les clivages liés aux goûts et aux couleurs pour ne plus laisser que le message. Toutes les tranches d’âge peuvent se retrouver si le discours est cohérent, si le discours est le discours du peuple. Si le discours traduit le ras-le-bol de ces peuples, si ton discours traduit celui de ceux qui n’ont pas de bouche. C’est un terrain glissant. Tu es exposé, ta carrière est hypothéquée. C’est pétri d’embûches mais nous sommes prêts à en courir les risques.
S. C. : Quelque chose me choque dans la posture de beaucoup de rappeurs sénégalais. Ils passent très facilement de la revendication au « bizness ». Quel rôle tient le bizness, la vente, dans votre démarche ?
T. : Je vais prendre l’exemple du CD qu’on a fait avec le CADTM[8]. Ce CD devait normalement suivre le circuit habituel des CD. La vente de ces CD a servi à sponsoriser des concerts dans toute l’Afrique afin d’éviter qu’on soit sponsorisé par une multinationale alors qu’on les dénonçait. Quand on vend des tee-shirts « Y’en a marre », c’est une façon de financer notre combat. Ces ventes nous servent à acheter du crédit, des groupes électrogènes, à payer des transports ou convoyer des journalistes quand on va manifester par exemple. Ce mouvement, on n’a pas envie de le monnayer. On sait que pourtant tout mouvement a besoin d’argent. Or ceux qui ont l’argent aujourd’hui, c’est qui ? Ce sont les politiques. Ils nous prêteraient 100 FCFA, mais demain ils nous demanderaient de nous trahir. Pour garder notre indépendance, notre intégrité, on vend nos tee-shirts. Celui qui veut acheter nous permet de continuer notre combat. On n’a pas voulu faire de carte de membre. Le principe du mouvement, c’est d’être ouvert à tous ceux qui en ont marre. On vend simplement quelque chose qui nous appartient pour mener notre propre combat et rester indépendant. D’autres initiatives ne sont pas destinées à la vente. Fou Malade et Simon ont mis à disposition leur studio et on a enregistré une chanson intitulée « Y’en a marre ». Les rappeurs sont venus gratuitement. La chanson n’est pas vendue, elle est distribuée dans les radios et beaucoup jouée en plus. Les gens peuvent se l’approprier comme ils veulent. On va pas vendre un single c’est pas possible.
S. C. : Quel est l’objectif du mouvement à court et à moyen terme ?
T. : Pas la violence comme elle se développe en ce moment. On ne fera jamais de la violence gratuitement. Lorsqu’il s’est agi de salir notre constitution on s’est levé pour dire «non». Nous croyons en notre patrie, nous aimons notre pays. En ce moment nous appelons au calme. Il faut lutter, mais lutter pour l’essentiel. Si on casse les bus ou n’importe quelle infrastructure alors qu’il n’y en a pas assez alors c’est nous qui allons être les perdants. Eux ça ne les touche pas. La violence règle un problème sur le court terme mais elle ne règle rien du fond. Nous n’allons pas exiger un départ immédiat de Wade. Ce n’est pas possible, nous sommes des démocrates. Il doit terminer son mandat. Cependant il n’est plus présidentiable. Il y a beaucoup de façon de lutter. Si la violence s’impose, il faut voir à quel degré et à quel niveau. Brûler deux ou trois pneus cela ne nous intéresse pas. Nous voulons surtout la stabilité, nous ne voulons pas qu’à cause de débordements on inscrive le Sénégal sur la liste des pays ayant connu un régime militaire ou une conférence nationale. Nous voulons que notre mouvement soit un modèle pour l’Afrique. Nous voulons que le monde entier ait un autre regard sur le continent. L’Afrique, c’est aussi des jeunes conscients, qui réfléchissent et qui sont maîtres de leur destin. C’est des jeunes qui s’intéressent à l’avenir et au devenir de leur peuple. L’engagement en Afrique se traduit trop souvent par des épurations ethniques, des coups d’État. Nous voulons montrer au monde entier que tu peux mener un combat qui est pacifique, intelligent et citoyen. Amener les gens à changer de comportement, à changer de façon de voir. « Y’en a marre », après les élections en 2012, a l’ambition de s’internationaliser.
S. C. : Et pour les élections présidentielles ?
T. : En attendant pour 2012, 70 % de l’électorat repose entre nos mains. Il y a déjà plus de trois millions de jeunes qui doivent voter et trois millions, c’est par rien. On est d’ailleurs en train de mener une campagne pour que les jeunes s’inscrivent sur les listes. Voilà pourquoi l’État est assis sur un œuf aujourd’hui. Nous comptons faire ce qu’on appelle le Welep : c’est un mot wolof qui veut dire « sortir, fouiller ». On va tout décortiquer : les faits, les gestes, les prises de position et les revirements de chaque candidat. Nous allons définir une série de critères qui nous semblent correspondre à l’idée qu’on se fait d’un bon candidat, une sorte de prototype de Président. Nous voudrions par exemple qu’il soit jeune.