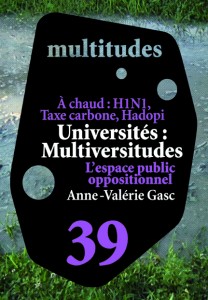Le concept d’espace public a été utilisé dans les années 1970-80 dans le cadre de la politique dite de la ville, c’est à dire des recherches et actions politiques locales visant à réintégrer dans la société des quartiers marginalisés jugés trop violents. Les chercheurs et responsables de ces actions ont essayé de mettre ensemble des habitants qui s’insultaient voire se battaient. Ils ont cherché à rendre compatibles des différences ethniques ou d’âge jugées irréductibles. Le concept d’espace public de Jürgen Habermas fut d’un grand secours pour prendre à bras le corps des situations auxquelles élus locaux et travailleurs sociaux ne voyaient plus comment faire face. Dans la virulente critique d’Oscar Negt parue sous le titre « L’espace public oppositionnel », l’accent est mis sur le caractère bourgeois de l’espace public habermassien, devenu un instrument de médiation obligatoire et une machine à fabriquer du consensus social sur tout. Les espaces publics de médiation sociale dans les grands ensembles et les quartiers de banlieue méritaient peut-être aussi la qualification de bourgeois, du fait des modalités de fonctionnement régulées auxquels ils tendaient, mais ils ne pouvaient pas être qualifiés de bourgeois dans l’identité sociale de ceux qui les fréquentaient. Rassemblements de personnes issues de toutes les immigrations, de toutes les périodes d’occupation des grands ensembles, ces petits espaces publics, ces permanences, ces lieux de concertation autour des travaux de réparations et de développement social, ces petits espaces publics pratiques n’avaient nulle prétention au devenir prolétarien de l’espace oppositionnel de Negt. Cette modestie était parfois traversée d’événements dramatiques, en général des heurts violents de jeunes avec la police après un accident mortel, et les micro-espaces publics de gestion se transformaient en lieux d’organisation d’une riposte provisoire dont l’initiative passaient aux jeunes et aux habitants.
L’espace public du quartier disputé entre habitants différents et face à la police semblait à ceux en charge de le « développer », de le ramener dans le giron de la société, un exemple de la réunion en un même lieu concret de l’ensemble des membres d’un même espace politique potentiel, celui des citoyens habitant le même territoire, afin qu’ils puissent présenter leurs revendications, en discuter, et apprendre quels moyens seraient consacrés à les satisfaire. Par exemple dans une cité HLM à la périphérie de Marseille que se disputaient des habitants appartenant à plusieurs groupes ethniques et historiques de la ville (provençaux, gitans, maghrébins et autres originaires du bassin méditerranéen), une permanence, instituée par les chercheurs et les architectes chargés de la réhabilitation, était ouverte aux plaintes de tous, et une véritable mise en scène, ordonnée par les animateurs de la réhabilitation, transformait les plaintes et en captait l’énergie pour construire un programme concret de travaux de réhabilitation, organiser la réfection des logements avec la participation des habitants. L’absence de confiance des uns envers les autres fut vaincue par un travail original : chaque famille fut invitée à se faire photographier dans son intérieur, dans son décor préféré. Et les photographies ainsi réalisées furent exposées en pied d’immeuble comme autant de présentations des uns aux autres. De cette mise bout à bout des décors intimes découla une conclusion évidente : ces habitants qui se croyaient si différents vivaient tous dans les mêmes décors, ceux de la Méditerranée. La cité fit pour un moment corps, ensemble, espace public, puisque publicisé par cette exposition photographique.
Cet espace public aurait pu être décrit comme oppositionnel par rapport aux règles du bon goût bourgeois de l’aménagement de l’habitat. L’idée à l’époque n’en vint même pas ; une certaine joie couronna un travail rassembleur, rationnel, synthétiseur, organisateur, ce qu’on peut dire avec Habermas être le travail de l’espace public bourgeois.
Une multiplicité d’expériences du même type fit conclure que, dans la reconversion de la notion d’espace public d’Habermas à la solution des problèmes des périphéries urbaines, l’essentiel était moins la similitude morale et sociale des participants de l’espace public – dans laquelle Habermas voyait la condition du fonctionnement de l’espace public – que l’existence d’animateurs compétents, soit si l’on reprend le texte d’Habermas l’existence d’un maître ou d’une maîtresse de maison gérant matériellement, et aussi dans ses rites, l’espace public, et décidé à faire tenir ensemble des groupes de gens qui livrés à eux-mêmes tiennent à n’avoir qu’un commerce minimum. L’espace public était une sorte de prouesse quotidienne contre le racisme, qu’il soit celui des personnes ou des institutions, et un dispositif opérationnel pour produire des programmes de travail bénéfiques à tous. Et dans la politique de la ville française ce dispositif a marché dans certaines circonstances, a fait la preuve de sa défaillance aussi assez souvent, notamment à l’automne 2005. Du côté des animateurs de la politique de la ville, on dira que les moyens ne leur avaient pas été maintenus à la même hauteur et qu’ils ne pouvaient plus exercer leur ministère. L’expérience a montré en effet que l’activation de l’espace public devait être permanente pour que le mouvement des particules humaines soient aimantées vers des configurations ordonnées ; sitôt le quartier réhabilité et les animateurs partis puisqu’ils payés qu’en tant que programmateurs et surveillants de travaux, le quartier retombait dans ses errements ordinaires, dans les conflits, les passe-droits et l’incitation à l’intervention policière. D’un point de vue habermassien, on remarquera que l’espace politique constitué autour des opérations de la politique de la ville avait comme acteur-phare les mères de famille qui ne présentent aucune similitude, sinon d’origine, avec les jeunes des mêmes quartiers, qui restent seuls visibles une fois les animateurs partis. Les émeutes de 2005 dessinèrent derrière quelques incendies les frontières d’un espace public oppositionnel, différent de l’espace animé dans les quartiers depuis une vingtaine d’années.
La notion de maître ou de maîtresse de maison, d’activation de la mise en espace public, est fondamentale, car le rassemblement d’hétérogénéités est au mieux indifférence mais le plus souvent conflit ouvert, voire violent, dès lors que la situation n’est pas instituée, mise en perspective, formée. Habermas l’explique très bien dans le cas de l’espace public bourgeois naissant en France au XVIIIe siècle. Dans l’espace public au sens classique du terme, l’espace non privé, visible de tous, le frayage commun entre personnes de l’aristocratie ou du clergé avec des personnes du Tiers État était interdit par le roi. Ce n’est que dans des espaces privés, chez quelqu’un invitant nominativement ses amis, que cet interdit royal de fréquentation pouvait être levé. L’espace public bourgeois prérévolutionnaire, la fusion des trois ordres en un seul corps constituant, ne pouvait être anticipé, rendu visible, concret, qu’en privé, dans un salon. Ce salon était en général tenu par une femme, qui en avait d’autant plus la capacité qu’elle n’était pas pensée par ces Messieurs comme pouvant être citoyenne. Cette capacité féminine est fondée sur des compétences tout à fait hétérogènes à ce qui va faire l’objet de l’espace public – la discussion d’œuvres littéraires et politiques – comme l’achat des victuailles et de boissons, l’art de mettre la table, de disposer les fauteuils, bref de tout faire ce qui peut faire advenir quelque chose chez les autres.
Autre élément de l’espace public habermassien bourgeois et prévolutionnaire français : ces personnes des trois ordres qui enfreignent l’interdit royal le font pour venir discuter d’œuvres non encore publiées, à l’état de brouillons, et qui veulent toutes remettre aussi en cause l’ordre existant. Il est proposé d’y apporter à chacun sa petite pierre par des corrections marginales, de participer au grand œuvre intellectuel des Lumières. Les petits fours se chargent de parfums conspirateurs, si comme l’ont dit les Italiens à Bologne en 1977, « Conspirer c’est respirer ensemble ». On conspire, on respire ensemble l’air du commun, à peu de frais, et on valide ceux qui configurent ce commun par leurs écrits. Il s’agit de la constitution d’une subjectivité rebelle, de la production d’un « espace public oppositionnel », qui va être catapulté dans la révolution, dans la transformation des États généraux en Assemblée constituante, et transformer ses membres en aspirants à gouverner. C’est à ce moment du passage à la fonction gouvernementale que s’accroche Habermas : l’espace public aux contours indéfinis, même s’il était limité pratiquement à quelques salons, devient brutalement l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, une arène à laquelle ne peuvent participer que des hommes sélectionnés par l’élection et ayant témoigné pour cela d’une fortune et d’une culture certaines. L’espace public bascule dans l’espace de l’homogénéité bourgeoise, quelle que soit la diversité des partis politiques appelés à discuter ensemble.
On trouvera sans doute un peu osée la comparaison des chefs de projets de la politique de la ville avec les grandes bourgeoises qui tenaient les salons prérévolutionnaires. C’est pourtant ce rôle de maîtres et de maîtresses de maison d’un débat politique local créé à côté des enceintes politiques municipales ordinaires qui leur a été dévolu. Il s’agit d’animer, comme ils ou elles le voudront, avec leurs compétences toujours singulières, un espace d’où puisse ressortir un programme commun à un quartier déterminé. Il ne s’agit pas de faire du chef de projet lui-même, ou de quelques habitants reconnus par les autres, les « représentants » du quartier auprès des instances municipales ou étatiques. Non, il ne s’agit pas de cela car les seuls représentants légitimes sont les représentants municipaux élus ; ces représentants professionnels ou issus de la participation n’ont pas vocation à les concurrencer, n’ont pas de légitimité politique. L’espace public local disparaît aussitôt qu’entrevu dans une obligation de se limiter à une discussion technique, à des choix consensuels et surtout à la réduction à zéro de la tension entre les différents groupes du quartier. Fin de ce qui aurait pu apparaître comme un espace public oppositionnel ou constituant. Entrée dans la sagesse habermassienne et refoulement dans l’ombre des désirs différents, de la volonté d’opposition.
Toujours dans notre désir de souligner le rôle essentiel des animateurs de l’espace public, des maîtres et maîtresses de maison, des chefs de projet, nous avons eu recours à la métaphore théâtrale. Par ses choix programmatiques, la direction d’un théâtre attire un public composé de plein de gens différents rassemblés dans la communion avec les mêmes œuvres, et affectés ensemble par les mêmes éléments le temps du spectacle, et dans les conversations qui le précèdent ou qui s’ensuivent. On pense à la ferveur du TNP de Jean Vilar ou du Festival d’Avignon, nourrie par le recours aux comités d’entreprise et la formation d’un public qui échappe à la qualification bourgeoise. Et on rêve à nouveau de l’espace public comme un agent actif de fusion entre hétérogènes, comme un constituant du « commun » cher à Toni Negri. Mais quelle œuvre autre qu’une liste de travaux propose-t-on dans un quartier ? Y a-t-il confrontation de la subjectivité des uns et des autres avec la subjectivité productrice d’une œuvre, avec une singularité, qui renverrait chacun à la sienne dans le commun ? Peut-on dire comme le disait Tarde qu’on constitue un public dès lors qu’on lit le même journal, qu’on articule sa propre opinion à partir des mêmes données médiatiques ? Le commun semble réduit au minimum, il n’a plus l’émotion des rassemblements.
Précisément dans la grande ville contemporaine, le commun est réduit à tous ces éléments matériels qui sollicitent l’attention et à tous ces services utilisables, sans qu’aucune synthèse puisse en être faite entre usagers. Vivons-nous à « l’ère de la dispersion de l’espace public », comme le dit Isaac Joseph, dans un monde où nous sommes attentifs les uns aux autres, mais de façon distante et dans le souci premier de préserver notre territoire individuel ? Ce qu’on nous présente alors comme espace public – les rues, les places, tous les lieux qui sont la propriété d’autorités publiques – fonctionne comme un espace d’indifférence, de circulation, de passage, dont les autorités se croient en charge de faire disparaître les aspérités, les obstacles à la circulation des flux. Depuis Georg Simmel, on reconnaît le degré d’avancement dans la civilisation urbaine par la capacité à rester de marbre à la vision d’un étranger, à continuer à vaquer à ses occupations, quelle que soit l’hétérogénéité d’une situation. La maîtrise n’est plus globale, comme dans le salon. Elle est individuée portée par chacun. L’espace public est devenu individuel et portatif, compétence culturelle acquise à vivre civilement, à pratiquer l’indifférence polie. Cette compétence est censée universellement partagée, elle est exigée, et sa détention différenciée classe les gens en « in and out ». L’exigence s’applique à ceux qui en disposent plus ou moins, comme le sans domicile-fixe ou le sans-papier, et régule leurs interactions avec les autres. C’est à la fluidité comme valeur commune que chacun mesure l’ambiance globale. Dans cet espace lisse, la subjectivité rebelle met ses barricades, ses entraves, rassemble par points, concentre l’espace dispersé en une multitude de microcentralités.
L’exemple du rassemblement de ces subjectivités rebelles, c’est pour Negt Mai 1968, dans lequel ont convergé étudiants, ouvriers et révoltés de tous horizons contre un pouvoir vacillant. Mais avant l’espace oppositionnel, d’autres espaces avaient semé leurs ferments. Groupes gauchistes aimés-haïs, attendant autre chose et surtout cette émergence nanterroise de la plaisanterie comme mode de production des situations. Mai 1968 c’est le déferlement de la poésie, de l’humour, dans lesquels l’opposition est un arrière-fond, une aimantation des énoncés mais pas une préposition. Du coup cela fuse dans tous les sens ; on ne sait pas qui a dit ça ; on lit ce qu’on pense sur les murs ; on court après l’événement. L’espace public d’assemblée est toujours là mais il est interrompu ou informé par ce qui se passe ailleurs.
Globalement, il est évident que c’est une opposition ; localement, c’est d’autres volutes. Et toujours depuis quelques centres, la volonté de réanimer la flamme, d’être maître de maison, de prolonger la veillée. Mais le pouvoir veille ; à coup d’interdictions et de retrait des denrées nécessaires à l’effervescence révolutionnaire – essence et cigarettes – l’espace public s’aplatit, la discussion se fait moins fervente. Y a-t-il eu en mai 1968 un espace public révolutionnaire, même temporaire ? Peut-être. Il n’était même pas constituant. Il ne savait pas quelles valeurs il imposerait. Ses hommes providentiels, François Mitterrand et Pierre Mendès France étaient des hommes sinon du passé, du moins largement coupés des microgroupes qui discutaient partout dans les facultés, dans les usines ; l’espace public naissant ne pouvait se catapulter en eux ; il devenait peut être oppositionnel, mais au sens le plus parlementaire du terme. Sous l’effet de cette offre de rassemblement et de représentation, l’espace public esquissé se décomposait. Les drapeaux se remballaient, l’élan révolutionnaire se repliait. Pas d’issue dans la sphère de la représentation, certains ont cru aux vertus de la violence, elle n’a rien de publique dans sa préparation, seulement dans ses effets, non contrôlés par ceux qui la mettent en œuvre.
Aujourd’hui l’espace public reparaît, global, comme la ville, comme l’information. Une alliance improbable d’associations et de syndicats a fait peur à Seattle par sa capacité de dérision, de non-participation, d’opposition. Dans la rue il y a des gens qui n’ont rien à perdre, qui sont ensemble, qui se coordonnent, et qui supportent de ne pas être tous pareils, qui forment une coordination. On ne fait pas tous la même chose mais on dit à tous ce qu’on va faire. On est libres et reliés, ce que les autres prétendent impossible. Face aux chefs d’État des pays les plus puissants du monde le scénario se répète, interprété différemment à chaque fois qu’il est mis en œuvre. L’espace public oppositionnel est à la fois fragile et divisé, fort et uni, uni peut-être par la concentration à laquelle il veut s’opposer. Dérisoire sur le terrain, mais présente, la patte du monde se pose sur des sols qui ne l’avaient pas connue depuis longtemps. Un monde d’opposants et pas seulement de puissants. Une potentialité de rêves qui ne trouvent pas localement à s’exprimer. Sur le terrain on chausse les bottes de l’espace public bourgeois, de la participation, de la concertation, de l’expression et on se hausse du col : on est un leader local, voire national, on représente ses mandants, on résume un petit espace public adhoc qu’on bichonne. L’ouverture à d’autres mondes est difficile, sans supports non canalisés, non dédiés. La machine à humoriser les situations tourne individuellement ; à plusieurs on est triste et contrit, parfois on rit, ça n’embraie pas, on attend, on écrit, on individue, on divise l’espace public : ma rue, ma maison, mon garage, ma voiture, les agencements ne se font pas, le collectif n’émerge pas. L’espace public attend. Il est plein de gens mais on ne les voit pas. quelque chose pour en voir d’autres, s’accrocher à l’opposition pour découvrir l’espace public, ce lien aux autres qui est toujours pendant, possible, réprimé, exalté suivant les moments.
L’espace public n’attend pas, il est toujours présent ; il est labile, organisable de plein de différentes façons, prêt à de nombreuses représentations. Toujours il s’agit d’un spectacle, d’une vision, d’un projet, d’un don. Comment faire avec les autres comme ils sont, comme ils se proposent ? L’espace public se rassemble par moments, dans l’expression, dans l’opposition, dans la joie, dans la souffrance, dans des affects. Ce rassemblement peut être bourgeois, viser le rassemblement des corps et des esprits, la redistribution des ressources vers l’égalité ou l’équité, en tout cas vers le repos ; il peut être aussi oppositionnel, concentrer certains sur une même ligne de force, produire un aiguillon, tarabuster un pouvoir ignorant ou opposé à ce qui le préoccupe. La multiplication des forces mineures, des aiguillons, peut-elle converger dans ce que Negt appelle un « espace public prolétarien », l’accumulation transversale des oppositions dans une faculté de renversement révolutionnaire ?
L’histoire donne des exemples insatisfaisants : la subjectivité révolutionnaire transversale à l’aristocratie, au clergé et au tiers état a certes abouti à ses fins, mais n’a pas été capable de garder la main, quand ses idées ont dû s’appliquer, trancher dans le vif de l’inertie et des contradictions. Même remarque pour la coupure léniniste qui a su un moment synthétiser la situation, mais pas la développer le long de linéaments trop différents. Prendre le pouvoir, cela ne consiste pas seulement à le renverser : la mobilisation continue d’un espace public de gestion, après la bascule de l’espace public d’opposition dans son anéantissement, demande des compétences qui n’ont encore jamais été trouvées. L’espace public de gouvernement ne doit pas retrouver alors les traits de l’espace public bourgeois qui garantirait seul le caractère démocratique de l’exercice gouvernemental, comme le disent les philosophes revenus de tout. Et pourtant c’est jusqu’ici la seule référence disponible. Lénine lui-même aurait dit : Ce qui nous manque, à nous autres soviétiques, c’est une véritable culture bourgeoise ! L’espace public oppositionnel ne peut se suffire de la cueillette de la culture dominante existante pour tracer ses nouveaux espaces de vie. Il ne peut être seulement oppositionnel mais doit multiplier les agencements créatifs qui feront craquer le corset de l’ordre existant.