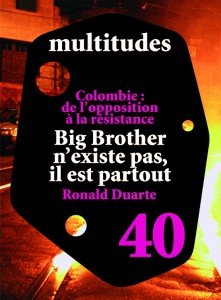La surveillance globale, un nouveau mode de gouvernementalité
Les techniques numériques ont donné depuis quelques années une forme inédite aux dispositifs de surveillance, dotant ceux-ci d’une efficacité, d’une multiplicité de champs d’application, d’une omniprésence, et d’une puissance encore jamais atteintes – au point de modifier significativement notre rapport au monde et au réel.
La pensée de Michel Foucault est indissociable des questions relatives à la surveillance, à la discipline, au contrôle, aux procédures de subjectivation et de manière générale à la façon dont les pouvoirs travaillent les corps. De la description des sociétés disciplinaires à celle des sociétés de contrôle en passant par la biopolitique, les approches par Foucault ou issues de son travail (notamment chez Deleuze avec son « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » in Pourparlers, Minuit, Paris, 1990) semblent avoir bordé jusqu’alors les problématiques qui touchent à ces phénomènes.
Pourtant la surveillance contemporaine semble excéder ou déborder, en les incluant, les catégories élaborées par Foucault et Deleuze. À l’origine de ce dossier, le livre d’Éric Sadin, Surveillance globale, Enquête sur les nouvelles formes de contrôle (Climats, Paris, 2009), nous donne l’occasion de prendre toute la mesure de ces phénomènes, leur ampleur autant que leur singularité.
De nature composite, la surveillance contemporaine s’élabore à partir de l’interconnexion des technologies numériques, de la géolocalisation, de la vidéosurveillance, des bases de données, de la biométrie, de l’interception des communications et de l’horizontalisation planétaire de l’ensemble de ces aspects.
Elle se distingue des modes de surveillance ou de contrôle des périodes précédentes par le fait qu’elle présente les capacités d’adhérer en permanence à son objet ; que celui-ci n’est pas poursuivi, mais dessine lui-même la traçabilité de ses actes – le sujet surveillé émet les signaux numériques permettant sa surveillance, faisant de chaque personne un terminal humain ; qu’elle tend vers l’anticipation des actes délictueux – la précognition imaginée par Philip K. Dick dans Minority Report en voie de réalisation – à travers un ensemble de logiciels d’analyse de bases de données interconnectées et de programmes de reconnaissance de comportements plus ou moins déviants ; qu’elle ne se propose pas comme cible a priori les « marginaux » et les « anormaux », mais bien plutôt le normal, l’ordinaire, le quelconque ; qu’elle vise à être l’accompagnateur le plus infatigable du moindre de nos gestes ; que les positions de surveillant et de surveillé sont permutables.
Ce qui définit la surveillance contemporaine globale, c’est de ne pouvoir être séparée des procédures quotidiennes par lesquelles nous travaillons, consommons, communiquons, nous déplaçons : « Plus on voyage ou on achète (…), plus s’amassent les volumes de données évaluables. La plus grande liberté est la condition paradoxale et contemporaine de la plus grande surveillance »[1]. La surveillance contemporaine établit une stricte équivalence entre vivre et être surveillé. Vivre, c’est désormais être surveillé globalement sans rupture par les rets de plus en plus affinés et allant toujours s’étrécissant d’un maillage électronique invisible et omniprésent.
Ainsi, l’invisibilité, la permanence (ou l’absence de rupture), le banal (ou le quotidien, l’ordinaire, le normal) comme essence du « surveillable », la brisure de symétrie de la causalité entre faute et punition caractérisent la surveillance contemporaine.
La question de la visibilité dans le registre de la surveillance est évidemment centrale. Ce qui apparaît à la fréquentation des textes de Foucault, c’est qu’y existe, conformément à la tradition occidentale, une analyse basée sur la valorisation d’un sens : le regard. Celui-ci est l’instrument de la surveillance. Surveiller, c’est observer : porter les yeux sur quelque chose avec vigilance. Surveiller, juger, punir, avant tout, c’est regarder. Le Panoptique de Bentham ne constitue pas seulement un outil repéré et réélaboré par Foucault pour penser une modalité centrale du disciplinaire. Il apparaît également comme la machine à regard apte à révéler la matrice scopique des phénomènes analysés par Foucault.
Il est d’ailleurs à noter que cette question du regard organise jusqu’à la position de l’intellectuel. La théorie est culturellement envisagée comme une occurrence de la contemplation, c’est un acte d’optique mentale, une modalité de regard (θεορια : observation, contemplation). Le philosophe que Platon fait revenir dans la Caverne révèle aux hommes qu’ils ne regardent que les ombres des Idées. La Caverne platonicienne est toute entière un dispositif d’optique ontologique par lequel s’éclaire la réalité, et la nature de reflet du monde sensible. Dans la tradition occidentale, comprendre, c’est éclairer, poser la lumière sur les ténèbres de l’ignorance ou du non-révélé. L’explicitation du monde est une mise en lumière de son ordre. La raison triomphante et « éclairée » du XVIIIe siècle se donne partout en Europe le nom de « Lumières » (Aufklärung en Allemagne, Enlightenment en Angleterre, Ilustración en Espagne ou Illuminismo en Italie). Le « spéculatif » est une variante du scopique (speculativus : « contemplatif », speculum : « miroir »). N’échappant pas à ce cadre général, l’intellectuel posant sur la surveillance un regard critique peut donc s’appréhender d’un certain « point de vue » comme un site de surveillance de la surveillance : un regard regardant des regards qui regardent des regardés.
Or, la surveillance contemporaine se détache nettement du scopique, même si la vidéosurveillance en compose une part importante. Comme dans les sciences où les outils d’analyse ont depuis longtemps cessé d’être des extensions sensorielles – notamment du regard naturel avec les variantes du microscope ou du télescope selon lesquelles il suffirait de « grossir » le regard pour voir le réel, la loupe comme modèle du connaître –, la surveillance globale contemporaine a cessé d’être bâtie centralement autour du modèle du regard et de la visibilité : elle ne relève plus du fait de regarder ou de voir, ni même de celui d’être vu. L’invisibilité est le trait qui la caractérise massivement : le « surveillant » (qui n’existe plus en tant qu’entité individualisée) et le surveillé (qui n’existe plus en tant que tel, en tant qu’« anormal » isolé, surveillé ou surveillable) sont invisibles, tout autant que le dispositif de surveillance lui-même (composé de l’entrecroisement de multiples techniques). De plus, l’immatérialité renforce l’invisibilité : sait-on même à quoi ressemble une base de données ? Le phénomène de la surveillance globalisée – et globalisante – s’engrène à partir d’un point de bascule de l’essence du surveillable, qui passe du regardable vers le calculable, donc du visible vers l’invisible. Surveiller n’est plus voir, mais calculer. Cette libération des limites imposées par le « voir » – voir, c’est cadrer, donc exclure – est précisément ce qui ouvre la surveillance à la dimension globale. N’est plus surveillable seulement ce qui est visible, bien que ce qui est visible reste une partie du surveillable : le visible ne constitue plus le paradigme du surveillable, mais l’un de ses cas particuliers. De la même façon, dans ce cadre, le visible lui-même se désincarne, en n’étant plus envisagé comme une modalité surinvestie de la perception – ce qu’il était dans le modèle précédant des dispositifs de contrôle – mais comme une occurrence parmi d’autres du computationnel. La surveillance n’est plus un regard qui juge, mais une capacité de calcul fondée sur les probabilités et l’analyse statistique des données.
Pour ces raisons, on peut être conduit à suspecter le terme même de « surveillance », et à envisager, pour mieux cerner le phénomène, un vocable de substitution : le néologisme de sousveillance.
« Veiller » signifie « garder les yeux ouverts ». « Surveiller », c’est « veiller sur », ouvrir des yeux scrutateurs de façon particulièrement intense. Le sur-veillant est toujours en position épiscopale (littéralement : celui qui voit les choses d’en haut) par rapport au sur-veillé. Ainsi, là où « sur-veillance » désigne une modalité de contrôle basée sur un scopique redoublé – ouvrir les yeux depuis un « dessus » d’où l’on regarde –, « sous-veillance » pourrait en nommer une pratique reposant sur un scopique atténué. Cette sousveillance qui échappe en grande partie au scopique pour rentrer dans l’ordre invisible du computationnel, y compris lorsqu’il s’agit de vidéosurveillance, n’a pas besoin d’yeux, ouverts ou fermés. Cette modalité de la surveillance est littéralement aveugle. Dans son aveuglement hypervigilant, par sa cécité qui autorise une hyperconvivialité invasive et indiscrète, elle sous-veille, de ne plus avoir besoin d’yeux. Du coup, la primauté du domaine optique dans la surveillance s’estompe pour donner lieu à une modalité de contrôle qui n’est plus essentiellement basée sur le regard, la vue et la vision, mais sur le calcul et la prédictibilité. L’œil – celui, divin, qui scrute et voit tout, c’est-à-dire connaît tout ; ou celui, accusateur, qui métaphorise la culpabilité de Caïn – a cessé de représenter le modèle du surveillant.
La sousveillance est un dépassement de la surveillance en ce qu’elle est légère, discrète, immatérielle et omniprésente. Le « sous » de sousveillance en désigne le côté plus insidieux, l’action de quelque chose qui travaille « par en dessous ». Les bases de données composent le cœur de ce système, et il faut entendre le mot dans toute sa littéralité : une « base », par définition, est toujours située « sous ». C’est ainsi que cette veille sans regard – donc virtuellement sans point aveugle – peut mieux capter ce que la surveillance classique ne pouvait que manquer de saisir. La sousveillance n’est pas « sur » – ou agissant depuis un « sur » –, elle est partout. Ça ne veille plus « sur », c’est-à-dire depuis la position surplombante et surmoïque d’un pouvoir situé « au dessus » des sujets, mais sur le mode d’un tapis sur lequel avancent les surveillés, ou plutôt comme une tresse digitale multidimensionnelle « en » laquelle ils évoluent, disséminant eux-mêmes, avec une bonne volonté dont aucun pouvoir ancien n’aurait oser rêver, les traces numériques autorisant leur suivi sans rupture par des dispositifs appropriés.
Si surveiller n’est plus voir – c’est-à-dire au fond : constater ce qui a eu lieu –, on peut anticiper l’acte délictueux. Il y a alors non seulement rupture de symétrie entre l’acte délictueux et la « correction » infligée à son auteur, mais également brisure de causalité temporelle : le soupçon (et l’éventuelle intervention préventive) préexiste à l’acte. L’invisibilité règne ici encore puisqu’aucun acte délictueux n’a encore été commis mais des signes de comportement à faible probabilité faisant signal sur le bruit de fond des mouvements ordinaires (ordinaires : les plus statistiquement répétés) donnent l’alerte. Le significatif peut apparaître aux systèmes de sousveillance avant même qu’ils surgissent dans la conscience claire de celui qui va opérer l’acte. Google prétend pouvoir savoir grâce à l’analyse de ses navigations sur l’Internet qu’une personne s’apprête à avoir l’idée de changer de travail plusieurs mois avant que cette personne ne le sache elle-même. Ainsi, l’idée même d’intentionnalité se voit suspendue à partir du moment où la lecture des intentions humaines ne résulte absolument plus d’une interprétation en termes de subjectivité ou de psychologie, mais d’un rapport calculable à la valeur statistique. On assiste alors à un détachement de toute subjectivité dans le gouvernement du « troupeau humain », pour reprendre une image pastorale chère à la philosophie politique classique : ici, toute subjectivité est non seulement gommée mais, plus profondément, évacuée pour être remplacée par une figure de variabilité statistique en évolution constante, constamment mesurable.
Avant d’être une réalité généralisée, qui vraisemblablement ne manquera pas d’advenir, ces diverses fractures témoignent de l’émergence locale de nouveaux schémas de pensée échappant partiellement ou totalement à des principes ayant semblé pendant des siècles aussi essentiels que la causalité (une conséquence est l’effet d’une cause), la succession temporelle (l’avant précède l’après), la responsabilité juridique des actes (un acte a besoin d’avoir été commis pour exister comme tel) ou encore le principe de non-contradiction. Élevés avec le temps, l’habitude et les usages à l’état de quasi-sacralités, ces principes fondaient la vision classique de l’homme. Leur ébranlement par les dispositifs de sousveillance fait que le sujet responsable de ses actes, tel qu’il était envisagé par le droit, se trouve ici réduit à l’état de modèle attaqué, en voie d’obsolescence rapide. La sousveillance ne s’installe pas, comme on le prétend souvent, dans des « vides juridiques », elle vide le juridisme d’une partie de ses appuis classiques. Le juridisme autant que la pensée du sujet s’en trouvent bouleversés. C’est sans doute dans cette zone que les implications politiques de l’existence des techniques de sousveillance sont les plus immaîtrisables. Ce gouvernement de la moyenne statistique fait qu’on peut parler ici sans aucune exagération d’une révolution par laquelle est littéralement dilacérée la conception – la « vision » – classique du sujet individuel basée sur le droit. Ceci pose la question de la capacité du seul point de vue juridique pour fixer des limites au développement et à l’exploitation des dispositifs de sousveillance, car ceux-ci existent précisément en fissurant les bases séculaires du sujet responsable, tel qu’il a été globalement cadré par notre juridisme depuis le droit romain.
Cette présence invisible signe aussi le triomphe du banal dans la signification : ce n’est plus l’exceptionnel ou le déviant – les « anormaux », comme disait Foucault – qui devient l’objet de la sousveillance, mais au contraire le tout-venant, c’est-à-dire le statistiquement normal. L’anormal, ses gestes, ses dispositions, ses actes cessent de constituer la référence négative contre laquelle s’adosse la normalité. La sousveillance globale travaille sur de grandes masses d’informations. Ce n’est plus l’attitude unique et isolée en tant qu’elle se détache de la norme qui se voit scrutée, mais la totalité des actes ordinaires dont l’amas et l’interaction fabriquent la norme qui se trouve possiblement enregistrée et analysée dans une perspective actuarielle.
Toute posture est ainsi susceptible d’entrer dans un diagramme explicatif. Il n’y a plus aucun geste gratuit ou perdu. L’adhérence continuelle des systèmes de sousveillance fait de la déconnexion ou de la séparation – le repli sur ce qu’on appelait il n’y a pas si longtemps la « sphère intime » – un acte désormais presque irréalisable.
La sousveillance globale ne concerne alors plus seulement la vérification de la faute ou l’inspection de ceux qui, ayant commis un délit, doivent se trouver sous le regard d’un surveillant. C’est ainsi que l’aire de compétence du terme « surveillance » s’est élargie du seul registre du policier ou du judiciaire pour inclure le renseignement (Intelligence) et le marketing. Il s’agit alors pour les dispositifs de sousveillance, devenus organes d’une gouvernementalité à dimension intégrale, de se tenir en permanence à distance des personnes, sans rupture de contact, afin d’amasser des données pouvant être utilisées dans le cadre indifférencié du répressif ou du commercial : les deux étant désormais basés sur la capture et l’analyse des comportements, sur l’anticipation des actes, sur la réponse instantanée et sur le profilage de ce que l’on pourrait appeler les pratiques de soi.
L’ambition de cette Majeure est moins de souligner les différences maintes fois commentées entre les sociétés disciplinaires décrites par Foucault et les sociétés de contrôle (terme de Burroughs, conceptualisé par Deleuze) ou leurs variantes dans lesquelles nous évoluons aujourd’hui que de questionner différents aspects techniques, juridiques, philosophiques de cette nouvelle modalité multidimensionnelle de la surveillance à travers laquelle s’élabore un nouveau paradigme de la gouvernementalité.
Dans un entretien en deux parties, Éric Sadin nous éclaire sur ces dispositifs dont l’entrecroisement de plus en plus serré forme l’architecture de la surveillance globale (1ère partie) ainsi que sur les implications en termes anthropologiques et politiques de l’existence de tels outils (2e partie).
Mathieu Potte-Bonneville s’interroge sur la façon dont les concepts de Foucault peuvent permettre d’aborder ces phénomènes à travers l’analyse d’une procédure particulière : les « tests ADN » votés en 2007 par l’Assemblée nationale.
Antoinette Rouvroy et Thomas Berns livrent leurs réflexions sur les transformations du « sujet statistique contemporain » et les conséquences de la « gouvernementalité algorithmique » sur le rapport au réel.
Frédéric Neyrat met en évidence le rapport au temps singulier dans ces sociétés du contrôle qu’il nomme « sociétés de clairvoyance ». Là où les sociétés disciplinaires entretenaient un lien privilégié avec le passé et les sociétés de contrôle avec le présent, l’objet des sociétés de clairvoyance est le futur, qu’il s’agit d’anticiper et de faire advenir selon des critères configurés dans le cadre d’une neutralisation préventive du temps.
Ariel Kyrou montre lui aussi comment une mise au pas de « l’à-venir » est opérée par les dispositifs de sousveillance qu’il décrit comme des systèmes automatisés de production individualisée de fictions. Opposant fiction contre fiction, il développe l’idée que face aux nouvelles fictions de sécurité et de consommation à vocation normative qui nous habitent sur un mode hypnotique, il convient de créer des contre-fictions troublant créativement le jeu de la fixation de la normativité.
Ainsi, la nouveauté des protocoles qui forment ce dispositif global questionne le terme foucaldien de surveillance aussi bien que celui, deleuzien, de contrôle. Les textes de cette Majeure montrent que l’un comme l’autre sont désormais inadéquats, ou plutôt insuffisants, pour cerner des phénomènes qui relèvent d’un autre registre. Continuer à employer aujourd’hui ces notions dans leur signification usuelle ne saurait reposer que sur une commodité de langage, sauf à tenter d’élargir et préciser leur sens – éclaircissement auquel cette Majeure tente d’apporter sa contribution.
De la même façon, la sousveillance globale contemporaine interroge la validité ou la plasticité de notions comme celle de résistance, laquelle devant trouver – si cela est encore possible, ce qui constitue une question fondamentale aujourd’hui – de nouveaux sens et surtout de nouvelles pratiques et modalités d’action.
Ce qui apparaît de façon éclairante au terme de cette Majeure est l’aspect profondément éclaté de ce phénomène. Il n’existe pas un projet unifié de surveillance dans la sousveillance globale – c’est même précisément en cela qu’elle peut être dite « globale » –, mais un foisonnement de stratégies de développement de techniques très diversifiées dont la rencontre ou le croisement génèrent une efficacité pluristratifiée qui se substitue à l’idée plus aisément repérable de pouvoir. Ce constat déjoue toute interprétation en termes simplificateurs de complot, et appelle en retour une hausse du niveau de complexité, tant pour le penser que pour s’y soustraire ou tenter de s’y opposer. Car on ne se situe pas de la même façon selon que l’on est face à un appareil de répression visible et incarné, ou engagé dans les mécanismes d’une hydre numérique immatérielle sans visage, implantée dans notre propre désir pour en faire le moteur de son immense efficacité.