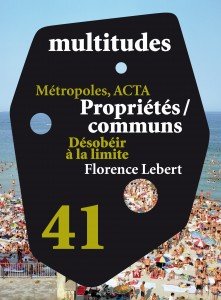Surtout développé par Jürgen Habermas dans ses écrits politiques des années 1980 et 1990, le thème de la désobéissance civile a aussi fait l’objet d’allusions répétées dans ses œuvres importantes, de Droit et Morale (1986), à De l’éthique de la discussion (1991), Droit et démocratie (1992) ou L’intégration républicaine (1996), et persiste dans ses publications les plus récentes, du débat sur le 11 Septembre avec Jacques Derrida aux considérations sur la notion de tolérance.
On pourrait formuler l’hypothèse que la désobéissance civile constitue la forme privilégiée du conflit politique chez Habermas. Il a été fréquemment, et à bon droit, relevé la minceur, voire l’absence du motif de l’antagonisme dans une théorie entièrement préoccupée d’entente. Pourtant, s’il est à chercher, c’est bien là, dans la figure de la désobéissance civile, que le conflit se trouve. C’est elle qui assure, de manière ténue, mais ferme, la continuité avec cette conviction de la Théorie critique selon laquelle la réalisation hégélienne de la raison doit être comprise comme « un processus d’apprentissage conflictuel dans lequel une connaissance universalisable se fait jour au cours de la résolution de problèmes qui apportent des améliorations, ceci contre la résistance des groupes dominants»[1]. Selon Axel Honneth, qui lui, on le sait, place le conflit au cœur de sa théorie morale et politique, ses prédécesseurs à Francfort ont tous, d’une manière ou d’une autre, repris à leur compte l’idée de Hegel selon laquelle, face à des pathologies sociales résultant d’une incapacité des sociétés à exprimer adéquatement le potentiel rationnel déjà inhérent à leurs institutions et à leurs pratiques, le déploiement de la raison résulte d’une praxis commune qui engendre des solutions indissolublement liées à des conflits qui permettent l’apprentissage.
Loin des voies empruntées par d’autres représentants de la Théorie critique, la figure du conflit politique adoptée par Habermas est sinon opposée, du moins soigneusement distinguée de la praxis révolutionnaire, qui peut pourtant elle aussi être envisagée comme une politique de transformation des formes de vie sous l’égide de points de vue moraux. Le premier argument avancé n’est pas celui du recours à la violence ; ce que lui objecte d’abord Habermas, c’est que l’action révolutionnaire n’est que le fait d’une avant-garde qui se substitue à la praxis paralysée du macrosujet social, alors que la désobéissance civile compte sur « l’intersubjectivité d’un rang supérieur fait d’espaces publics dans lesquels les communications se condensent en des processus généraux d’autocompréhension sociale »[2].
Habermas évite par ailleurs le modèle de la « lutte pour la reconnaissance ». S’il a été amené, à la suite d’Axel Honneth, à utiliser l’expression, celle-ci se voit affubler d’une définition radicalement différente de celle d’un conflit motivé par la souffrance et des attentes de reconnaissance déçues, d’un processus pratique déclenché par des expériences individuelles de mépris. Elle est bien plutôt une « querelle quant à l’interprétation des besoins (qui) ne peut pas être déléguée aux juges et aux fonctionnaires »[3] : ce que recouvre son acception du terme, c’est ce que Nancy Fraser nomme struggle over needs[4], qui passe par la dénaturalisation des interprétations dominantes des besoins, par leur politisation et par l’imposition du thème dans l’agenda des institutions politiques. Cette « lutte » étant finalement une dispute autour de l’interprétation d’exigences et des lois censées en rendre compte, elle ne peut, dans le cadre habermassien, prendre que deux formes : soit un échange d’arguments tendant vers l’accord, une confrontation de (bonnes) raisons, orientée vers la réconciliation, en échappant donc au motif du conflit ; soit un rapport de force prenant alors un autre nom, celui de désobéissance civile.
De quels traits est alors paré le conflit politique tel qu’il apparaît chez Habermas ? Fort classiques, ils sont pour la plupart empruntés à John Rawls. Dotée d’un caractère public et symbolique, à des fins de dramatisation et de mise en scène, la désobéissance civile est définie comme une « résistance transgressive aux règles en vigueur [qui] se justifie d’une manière recevable eu égard à l’esprit et à la lettre de la Constitution elle-même, et [qui] recoure à des moyens qui donne à leur lutte le caractère d’un appel non violent à la majorité afin qu’elle reconsidère sa décision », une fois tous les autres recours épuisés[5].
C’est l’architectonique théorique sur laquelle elle se trouve déposée qui donne à la désobéissance civile sa spécificité et sa centralité. Elle se trouve en effet au croisement des thèmes de la légitimité, de la société civile, de la culture politique et de l’être-ensemble, qui constituent les points cardinaux de la politique délibérative de Jürgen Habermas.
La légitimité des lois :
Il est loin, très loin de Hannah Arendt qui s’efforce de replacer la désobéissance civile dans une logique purement politique, indemne de références à des impératifs moraux, portée par des « minorités organisées unies par des décisions communes […] et par la volonté de s’opposer à la communauté gouvernementale »[6], qui rendent les appels à un droit supérieur « inadéquats », parce que la force de leur argument réside uniquement dans le nombre de ceux qui le défendent. Habermas conçoit celle-ci comme un geste politique qui se justifie d’abord par une objection d’ordre moral, fondée en justice, appendice logique d’une théorie fréquemment accusée de rabattre la politique sur la morale.
Habermas récuse les différentes théories selon lesquelles on ne rencontre pas d’ordres politiques légitimes, mais seulement des ordres politiques considérés comme tels, à commencer par celle de Weber, qui envisage la légitimité comme la soumission à des statuts formellement corrects et établis selon la procédure d’usage. Pour Habermas, la croyance en la légalité ne peut engendrer la légitimité que si la légitimité de l’ordre juridique, laquelle prétend à la validité, est déjà présupposée. Même dans le cas d’une « traditionalisation » de la légitimité, où l’acceptation de l’ordre juridique relève de la soumission à l’habituel, les règles ont cessé d’être élucidées dans leur raison interne par ceux qui les suivent, mais « il y a la confiance dans les fondements rationnels, globalement présupposés, de l’ordre juridique »[7]. Ce soupçon que l’obéissance à un ordre légitime repose sur de bonnes raisons, la volonté de ne pas négliger le fait « que des exigences normatives de validité [sont] reconnues parce que, notamment, on considère qu’elles peuvent faire l’objet d’une discussion, parce qu’on les tient pour justes, donc, précisément, pour fondées »[8], sur lesquels s’appuie une construction que l’on retrouve de La technique et la science comme idéologie à Droit et démocratie, aboutit à une justification de la désobéissance civile qui diverge radicalement de celle qui est proposée par Thoreau.
Ici, le raisonnement repose est la faillibilité de la raison, pas sur le fait que la désobéissance est le revers inéluctable d’un système politique assis sur la soumission volontaire, comme chez Thoreau[9]. Loin de constituer un accroc porté à l’ordre légitime, l’acte de désobéissance civile en est son achèvement, ou en tout cas un instrument de son déploiement.
À l’époque de Droit et morale, pour Habermas les formes de justification institutionnalisées par la procédure juridique sont, du point de vue de la logique argumentative, ouvertes aux discussions morales, par exemple sous la forme de renvois aux principes moraux du droit naturel. La double base de validité du droit moderne, à la fois principe d’édiction et principe de fondation, amène alors Habermas à interpréter la désobéissance civile comme l’une des manifestations d’une tendance moderne à la déformalisation du droit, tendance qui, « au nom d’un droit moralisé, en appelle au droit « véritable » (richtig) »[10], et en vient à miner l’une des deux bases de validité du droit (ce qu’il constate simplement, sans le déplorer).
Plus tard, sans renier l’idée que le mode de validité du droit repose sur l’attente morale que l’on parvienne à la reconnaissance d’une prétention à la validité qui ne peut être honorée que par l’argumentation, il va filtrer le mode d’entrée des arguments moraux dans la discussion sur les lois : la désobéissance civile ne relève plus d’une convocation dans l’espace public d’arguments moraux, mais elle est composante d’une dispute sur les principes inscrits dans la Constitution (qui elle-même reste conçue comme sous-tendue par des considérations morales), et leur juste interprétation. C’est sur « l’esprit et la lettre » de la Constitution, redéfinie comme « projet inachevé »[11], que porte désormais la contestation. En d’autres termes, Habermas arrime désormais la désobéissance civile à la validité formelle du droit, en plaçant à distance l’arme morale, qui n’est plus accessible que médiatement, tandis que l’illégitimité d’une loi se conçoit « compte tenu de la Constitution »[12].
Désobéissance et société civiles
La désobéissance civile fait l’objet d’une double restriction dans la théorie politique de Habermas : elle est pensée comme le geste politique d’une société civile normativement conçue comme une collection d’individus privés, et descriptivement envisagée comme contrainte par les impératifs d’une complexité envahissante.
Le traitement du concept de société civile par Habermas exprime de manière particulièrement nette une méfiance vis-à-vis des associations, groupements et organisations en tant qu’acteurs de cette société civile, au motif qu’elles rendent difficile l’élimination du pouvoir social au sein de l’espace public. Dès lors, il devient évident que la désobéissance civile est acceptable par Habermas parce qu’elle est d’abord un acte individuel (même s’il n’est pas personnel, à la différence de l’objection de conscience, dans la mesure où il porte un appel à la majorité[13]), qui s’intègre sans mal dans le tableau d’une société civile qu’il persiste à décrire comme « le substrat organisationnel de ce public général, pour ainsi dire issu de la sphère privée, constitué de citoyens qui cherchent à donner des interprétations publiques à leurs expériences »[14]. Elle trouve de fait son origine dans une culture politique radicalement individualiste, comme le met en évidence Hannah Arendt, en se référant aux associations volontaires américaines, « organisations fondées dans un but à court terme, et qui disparaissent quand ce but est atteint »[15] ; l’action concertée des individus y procèdent de leur commun accord, pas d’une communauté d’intérêts ni de leur intégration à une collectivité. Sans surprise, c’est d’ailleurs la même expression « d’associations volontaires » que l’on découvre dans le vocabulaire de Habermas pour rendre compte de l’infrastructure propre à la société civile d’un espace public dominé par les mass-média.
Par ailleurs, réalité de la politique délibérative et de la souveraineté populaire, Habermas considère depuis Droit et démocratie que « la masse de la population ne peut plus, aujourd’hui, jouir des droits à la participation politique qu’en s’intégrant à – et en exerçant une influence sur – une communication publique qui constitue un cycle informel »[16]. Il pose dans l’espace public une minorité qui possède le pouvoir et produit de la publicité (ce sont des acteurs « professionnalisés »), et une majorité simplement réceptrice. Cette différenciation redouble une passivité nouvelle qui caractérise l’espace public, alors que la sphère politique instituée est seule « capable d’agir ». On retrouve ici la conviction propre au libéralisme classique selon laquelle la participation à la décision menace l’autonomie de l’opinion publique, qui deviendrait le cas échéant partie de la sphère étatique, tandis que la société civile disparaîtrait comme sphère séparée. La nécessaire séparation de l’État et de la société comme principe de l’État de droit est pensée comme un rempart à une prise directe du pouvoir social sur le pouvoir administratif. Mais cet arrangement est aussi une contrainte liée à la complexité des sociétés contemporaines, responsable d’un dépassement de la capacité cognitive de la politique délibérative. Il faut bien alors décharger le public de certaines décisions ; et « ces décisions ajournées sont réservées à des institutions ayant pour charge d’adopter des résolutions »[17].
Sur cet arrière-plan, Habermas en arrive à l’idée que les acteurs de la société civile ont, en dépit de la complexité plus réduite de leur organisation, dans des situations de crise, la capacité d’inverser la direction des cycles de communication établis de façon conventionnelle à la fois dans l’espace public et dans le système politique.
Non seulement la périphérie qu’est la société civile possède vis-à-vis des centres de la politique, en tant qu’émanation de la sphère privée, l’avantage d’une plus grande sensibilité pour la perception de problèmes nouveaux, mais on peut observer que dans les espaces publics politiques (qui sont investis par le pouvoir social) « les rapports de force changent dès que la perception de problèmes sociaux significatifs suscitent à la périphérie une conscience de crise »[18].
C’est ici que ressurgit la désobéissance civile, moyen et expression de la constitution d’une telle conscience : « La désobéissance civile se rapporte ainsi à sa propre origine dans une société civile qui, en cas de crise, actualise dans le médium de l’opinion publique les contenus normatifs de l’État de droit démocratique et les oppose à l’inertie systémique de la politique constitutionnelle »[19]. Précisément parce que les attentes normatives liées à la politique délibérative se concentrent désormais sur la faculté de la périphérie des structures de formation de l’opinion à percevoir les problèmes, à les interpréter et à les mettre en scène d’une façon qui suscite l’attention, la désobéissance civile n’est pas un événement marginal et toléré de mauvais gré pour sortir des moments de blocage du processus d’apprentissage d’une société ; il est envisagé par Habermas comme une pratique indispensable et une « correction permanente », même si l’environnement désolé que nous venons de décrire limite la portée politique de l’exercice.
La désobéissance civile tend ainsi à devenir chez Habermas l’un des rares lieux de pouvoir communicationnel dans un espace public informel de plus en plus marginalisé par le système politique et les acteurs qui détiennent le pouvoir social au sein de la société civile.
La vertu démocratique et la culture politique
La désobéissance civile est fréquemment décrite par Habermas comme une « composante normale parce que nécessaire de [la] culture politique d’un État de droit »[20].
Pour lui, la formation d’une volonté rationnelle présuppose que les participants à la délibération politique acceptent de se soumettre à la loi du meilleur argument, ce qui signifie qu’il est contraint d’introduire un principe moral qui n’est pas fondé dans le cadre de sa reconstruction de la raison pratique. Néanmoins, il s’est toujours opposé aux théories politiques, celle de Rousseau, celle de Hannah Arendt, qui font dépendre le processus démocratique des vertus des individus, poussant ainsi « au plus haut la demande éthique qui pèse sur le citoyen »[21]. Selon lui, la participation à la discussion induit per se de l’orientation vers l’entente. La procéduralisation de l’espace public – le fait que la ’raison communicationnelle’, n’ait d’autre contenu que sa propre méthode – est explicitement érigée en solution à la possibilité que les citoyens se détournent de la recherche du bien public. Or la procédure semble rapidement ne plus suffire ; progressivement, et tout particulièrement depuis L’intégration républicaine, Habermas a trouvé à la question de la motivation une autre réponse : « on peut attendre des citoyens qu’ils s’orientent vers le bien public, mais on ne peut en faire une obligation juridique. La culture politique doit inciter à ne pas persister dans l’attitude, exclusivement orientée vers le succès personnel, des acteurs égoïstes du marché »[22]. Dispositif motivationnel, la culture politique s’entend également comme le résultat d’un apprentissage ; elle est en effet fréquemment dépeinte en termes d’expression d’une maturité politique. « Je ne peux […] me représenter la tentative d’installer une société démocratique, écrit-il dans Après Marx, autrement que sous la forme d’un processus autocontrôlé d’apprentissage »[23]. Ce motif des stades d’apprentissage décrit des sociétés engagées dans une discussion qui se poursuit indéfiniment, où la seule loi du meilleur argument entraîne les participants dans une progression sans limites, au moyen d’une succession d’expérimentations qui se font d’abord dans la discussion et le croisement de propositions faillibles. Parmi celles-ci, figurent de manière proéminente les gestes de désobéissance civile.
La culture politique est alors, autant ce qui explique la désobéissance civile (elle est ce qui maintient en éveil la méfiance vis-à-vis de l’injustice se présentant sous des traits légaux), ce qui la limite (au sens par exemple où elle n’est une pratique convoquée qu’après que tous les autres recours aient été épuisés), et ce qui conditionne son succès. C’est en effet dans la mesure où elle est partagée par la minorité qui tente d’obtenir la révision d’une décision et la majorité du moment dont on en appelle au sens de la justice, que la méthode de la désobéissance civile se trouve transformée en argument ayant une prétention rationnelle à la validité normative. En outre, elle dispose les paramètres « qui délimitent l’éventail chaque fois établi de la querelle publique engagée pour parvenir à la meilleure interprétation de la Constitution »[24].
L’identité et le tenir ensemble :
L’identité collective doit être comprise chez Habermas dans une perspective intersubjective et non fusionnelle. Loin d’être une simple réalité transmise, elle est pour chaque communauté politique un projet propre. Si elles ne peuvent évidemment choisir leurs traditions, elles peuvent décider lesquelles, parmi ces traditions, elles souhaitent poursuivre ou ne pas poursuivre. Ne s’entendant pas comme un héritage, l’identité collective ainsi dessinée ne saurait constituer le milieu d’une « confiance prépolitique ». La discussion dans l’espace public constitue la seule source possible d’une solidarité entre personnes étrangères les unes aux autres ; qui plus est, la régulation coopérative de leur vie en commun dans les démocraties contemporaines est telle, ou devrait être telle, que celles-ci s’accordent réciproquement « le droit de rester étrangères les unes aux autres»[25].
L’identité collective tend dans ces conditions à se superposer exactement au concept de culture politique : « L’identité de la communauté politique […] dépend en premier lieu des principes juridiques ancrés dans la culture politique et non d’une forme de vie ethnico-culturelle particulière dans son ensemble »[26].
Dès lors, si la culture politique est avérée et actualisée tout à la fois par la désobéissance civile, qui en constitue même sa manifestation la plus puissante, il en découle que la désobéissance civile contribue à tenir ensemble la communauté.
La voie empruntée par Habermas diverge ici singulièrement de celle de Hannah Arendt, ou plus exactement de la tradition américaine qu’elle commente. La désobéissance y est rupture (légitime) d’un contrat toujours révisable, reposant sur une « conception horizontale » du « contrat social » caractérisée par le fait que les individus tissent et entretiennent des relations basées sur un consentement avec un fort lien de réciprocité. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve sans ambiguïtés chez Thoreau, qui écrit : « Je désire simplement refuser obéissance à l’État, me retirer et m’en désolidariser d’une manière effective »[27]. Chez Habermas, loin de rompre un contrat social, le geste de désobéissance civile le réaffirme. Il est non seulement participation à l’ordre politique, mais aussi, parce que c’est à celui-ci que se ramène l’appartenance, il est production de commun. Plus qu’une mise à l’épreuve de l’être-ensemble, plus même qu’une illustration de celui-ci, il devient ce qui tient ensemble.
La force prêtée à la désobéissance civile comme médium de l’intégration politique et donc de l’intégration tout court est telle que Habermas l’inscrit dans une politique de la tolérance vis-à-vis de dissidents dont l’attitude par rapport à l’État démocratique peut être équivoque : si le droit à la désobéissance civile leur ait reconnu, écrit-il « ces derniers, qui pourraient en fin de compte se révéler être des ennemis de la Constitution, ont tout de même une chance de se présenter, en dépit des apparences, comme les vrais patriotes de la Constitution qu’ils prétendent être »[28]. Habermas va donc jusqu’à parier qu’en qualifiant de « politiques » des refus d’obéissance qui n’en sont peut-être pas, en en faisant des tentatives de discussion d’un ordre constitutionnel reconnu par là même, bref en enchâssant une pratique dans une interprétation qui lui est peut-être étrangère, il est possible de la recomposer, et la contraindre à assumer les fonctions, par exemple en termes de tenir-ensemble, qui lui incombent normalement.
La désobéissance civile se révèle ainsi chez Habermas toute à la fois condition, signe et réalisation de la démocratie, de la culture politique, et de l’être-ensemble. Et il faut relever que c’est une figure du conflit qui se trouve dotée d’une telle cardinalité. Cette figure du conflit, c’est celle d’un affrontement qui non seulement a vocation à la réconciliation, mais qui est vecteur de la socialisation : dans une veine simmelienne, l’intégration sociale résulte du conflit, à la manière dont Honneth définit le phénomène de l’antagonisme social comme « l’autre facette de [l’]orientation vers l’entente »[29].
C’est aussi un conflit – ce qui n’est pas le cas du modèle des luttes pour la reconnaissance par exemple, qui suppose l’existence des blessures morales et l’infliction d’un tort –, dont la motivation, sise dans le sens de la justice et la culture politique, permet de penser des luttes dans lesquelles l’on s’engage pour d’autres que pour soi.
C’est encore un rapport de force dont on ignore si la nature est argumentative, inhérente au désordre engendré, ou à la posture morale de celui qui accepte les conséquences juridiques de ses actes. Peut-être cette imprécision est-elle une conséquence de l’évidence prêtée au thème dans la théorie politique de Habermas.