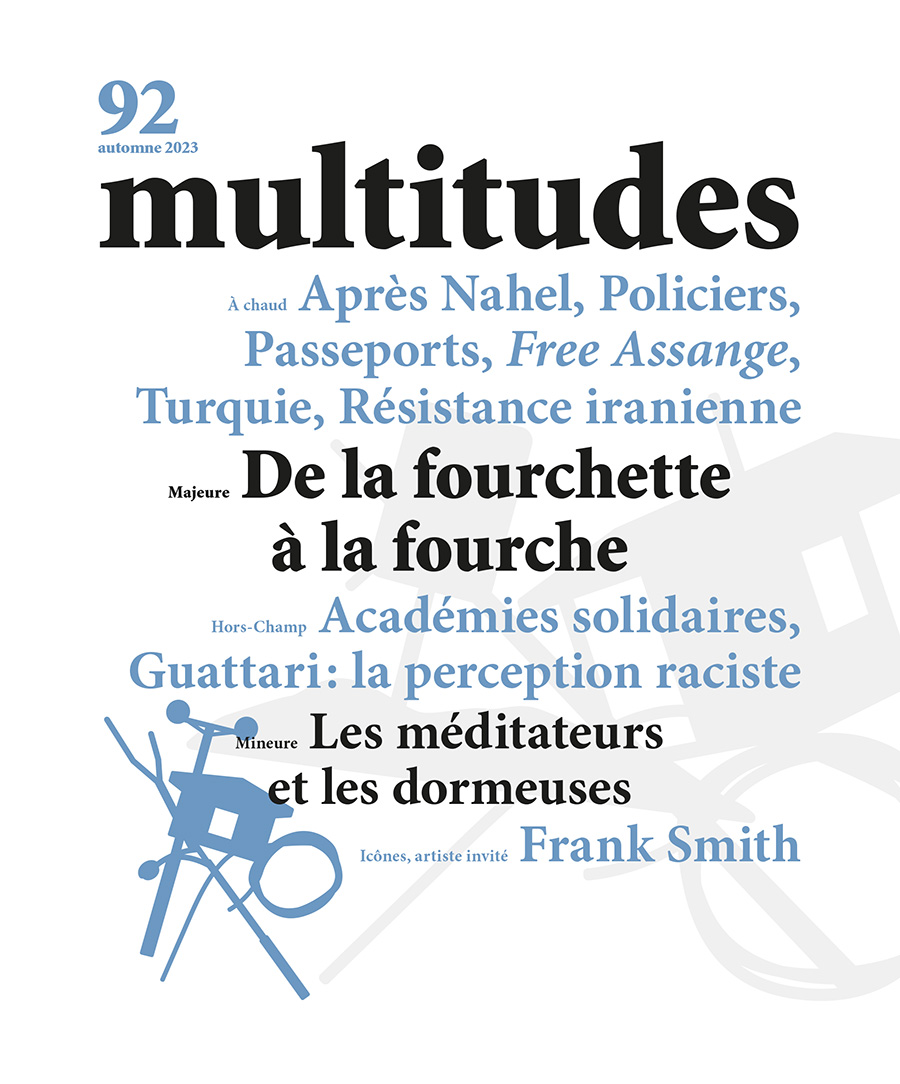Le Mouvement des Sans Terre (MST) brésilien, le plus important mouvement paysan, à l’origine de la création du réseau mondial Via Campesina est aussi le plus anciennement actif, puisqu’il fêtera ses quarante ans en 2024. Il aborde les débuts du gouvernement de Lula avec un mélange de soulagement, d’inquiétude et un sentiment d’impasse. Soulagement dû à la fin du gouvernement Bolsonaro, l’un des plus réactionnaires que le Brésil ait jamais connu ; alerte due à la montée en puissance de l’agro-industrie et à la pression que l’extrême droite continue d’exercer pour criminaliser la lutte pour la terre ; impasse qui oblige, après 39 ans, à redéfinir les tactiques d’occupation des terres pour une réforme agraire et une production agroécologique, dans un scénario où l’agriculture hyper-intensive alliée au capital financier constitue la force hégémonique du pays. Le panorama est peu clair : des désaccords surgissent au sein du MST, la conjoncture économique brésilienne est indéfinie, le contexte alimentaire international de plus en plus flou. En Europe, la guerre en Ukraine provoque une forte vague inflationnaiste dans le secteur alimentaire. Enfin, la demande de produits agricoles dans les pays émergents se poursuit.
La force de l’agro-industrie brésilienne
Dans ce scénario d’augmentation de la demande alimentaire mondiale, les avantages comparatifs du Brésil sont indéniables. Avec deux récoltes par an grâce à son climat tropical et de vastes surfaces cultivables facilement extensibles, de qualité raisonnable et bénéficiant de précipitations régulières et abondantes, le Brésil est une puissance agricole dont le potentiel est encore largement sous-exploité. Selon la NASA et l’entreprise publique brésilienne de recherche agricole (Emprapa), le pays n’exploite que 10 % de ses terres arables1. Et ce dixième représente déjà la somme des récoltes de la France et de l’Espagne. Du point de vue de la géopolitique alimentaire, le Brésil doit toujours être considéré comme un partenaire capable d’approvisionner les marchés et, ainsi, de réguler et d’intervenir sur les prix de certains types de denrées qui, en période de crise et de guerre, peuvent voir leur prix devenir plus élevés que ceux de produits de qualité supérieure. C’est dire la force de l’agrobusiness brésilien qui s’oppose aux mouvements qui luttent pour la réforme agraire au Brésil.
Dans le modèle actuel de l’agro-industrie brésilienne, le soja est le principal produit d’exportation du Brésil. La majeure partie de la production est destinée à l’huile de friture ou à l’alimentation animale2. L’aberration est que le principal produit d’exportation est davantage destiné à nourrir le bétail dans d’autres pays que les habitants du Brésil.
Malgré tout, le Brésil continue d’augmenter sa production pour le marché
extérieur, mais le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition augmente sans cesse. Selon l’enquête sur l’insécurité alimentaire réalisée lors de la pandémie du
Covid-19, 33,1 millions de Brésiliens ne disposaient pas des moyens matériels pour s’assurer au moins un repas par jour, et dépendaient de la charité. De plus, les surfaces cultivées sont de moins en moins consacrées à des produits vivriers tels que le manioc, les patates douces, le riz et les haricots et sont remplacées par des plantation de soja, de canne à sucre et de maïs pour la production de biodiesel3.
Ce processus a conduit à une grave pénurie de produits pour le marché intérieur sous le gouvernement Bolsonaro. L’ultralibéralisme a conduit les grands négociants à augmenter les prix alors que les revenus étaient grignotés par l’inflation. Dans l’État du Mato Grosso, champion de l’exportation de soja, on voyait des files d’attente pour acheter des os de bovins, la seule protéine bon marché à laquelle de nombreux Brésiliens pouvaient accéder. Que dirait aujourd’hui Josué de Castro, auteur de Géographie de la faim, s’il constatait que le panorama de l’exclusion dans le pays de l’abondance était encore plus paradoxal avec l’intensification de l’usage des technologies, de la financiarisation et de la mondialisation ?
Lula III, l’équilibriste
C’est dans ce contexte que Lula, pour son troisième mandat, est engagé dans une course contre la montre pour remettre sur le métier des politiques publiques visant à réduire les inégalités socio-économiques structurelles au Brésil, y compris dans l’agriculture. L’actuel président est dans l’obligation de mettre en place, au plus vite, des politiques assurant, a minima, la relance et la régularité d’une production agricole tournée vers un marché intérieur de 220 millions d’habitants et d’affronter des problèmes structurels d’approvisionnement et d’oligopoles.
Les politiques agricoles au Brésil4 ont été fluctuantes dans le temps. Au retour de la démocratie dans les années 1980, elles ont consisté à verser des subventions à l’agriculture exportatrice, avec un financement résiduel pour l’approvisionnement du marché intérieur, dans le but d’absorber les mauvaises récoltes, d’éviter les pénuries et les troubles sociaux. Au début des années 2000, avec la vigueur de la croissance induite par l’augmentation du salaire minimum, cette politique « résiduelle » s’est avérée si profitable qu’elle a mené les agro-exportateurs à inverser leurs priorité de ventes en direction du marché intérieur. En 2012, les projections du gouvernement brésilien misent sur le renforcement du marché intérieur, via l’augmentation des revenus et du pouvoir d’achat5. Mais à partir du démantèlement complet des politiques agricoles en direction du marché intérieur en raison d’un ajustement fiscal draconien initié par le gouvernement Temer (2016-2018) et prolongé par Bolsonaro (2018-2022), tous les efforts ont été orientés pour satisfaire les grands producteurs tournés vers le commerce extérieur. Une inflexion qui réitère le compromis appelé « Modernisation conservatrice » par l’économiste Guilherme Delgado pour définir la croissance de la grande entreprise agricole alliée au capital financier pendant la dictature militaire. À partir de là, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques grands groupes s’est intensifiée et les exportateurs de produits agroalimentaires ont regagné du terrain sur le plan politique et économique.
À ce rythme d’accumulation de pouvoir – et d’arrogance – l’agrobusiness brésilien a démontré sa force et son opposition à Lula au sein du Congrès national. La « bancada ruralista 6 » a constitué une force hégémonique constante, capable d’agglutiner d’autres secteurs et de former des majorités lorsque cela s’avérait nécessaire. C’est au sein du pouvoir législatif que l’agrobusiness continue de dicter ses règles et d’imposer des défaites à la coalition large, mais diffuse et confuse de Lula. Le front ruraliste, allié à certains congressistes bolonaristes et ultralibéraux, a imposé une Commission d’enquête parlementaire (CPI) sur le MST, dans le but de criminaliser la lutte pour la réforme agraire.
Outre la tribune parlementaire, le financement des écrans sont un autre moyen pour l’agro-business d’accroître son prestige. Une campagne de marketing, menée principalement par la première chaîne de la télévision publique, martèle le slogan « Agro is tech, agro is pop, agro is everything 7 ». Dans ce climat, le MST est souvent mentionné dans les récits conservateurs comme étant destructeur de biens et auteur de violences. Il s’agit d’un cas classique d’hypocrisie conservatrice : accusez vos ennemis de tout ce que vous faites. Et s’ils vous accusent, niez-le.
L’offensive réactionnaire vise à construire l’image du mouvement de lutte pour la réforme agraire comme un fauteur de troubles, un vandale et un opposant à la propriété privée. Cette stratégie convainc malheureusement une partie importante de la classe moyenne qui est informée par des fake news prêtes à porter fabriquées pour enflammer l’esprit conservateur. Depuis 2015, le MST est utilisé comme bouc émissaire par l’extrême droite à la recherche d’ennemis internes capables de mettre en transe un troupeau de fanatiques, dans une boucle frénétique de fausses informations via les médias sociaux, en particulier WhatsApp et Telegram.
Occupation des terres
ou commercialisation solidaire ?
Pour réagir tout à la fois à l’image de l’agrobusiness comme « sauveur des récoltes » et à la criminalisation de la réforme agraire, le MST a opté depuis 2016 pour un repli stratégique non déclaré. L’occupation des terres, sa principale stratégie d’action directe a subi un ensemble d’attaques sous diverses formes. L’augmentation des violences et des crimes contre les occupants dans les campagnes, sans que le Médiateur national agraire n’intervienne, en a été une. Dans le domaine administratif, on a largement constaté la diminution des inspections foncières, le retard d’interventions dans les cas d’esclavage, la bureaucratisation de la sélection des familles à installer, enfin, la diminution du budget de l’Incra (Institut national de la colonisation et de la réforme agraire) pour l’expropriation des terres8.
La réalité de la campagne brésilienne et des « colonies9 » de la réforme agraire a conduit le Mouvement à intensifier son travail de mise en place de systèmes de production écologiques, avec une gestion collective et/ou des coopératives, en articulant la production et la consommation par des réseaux de solidarité basés sur deux principes : des prix équitables et la production d’aliments de qualité accessibles aux travailleurs ruraux et urbains.
La stratégie consistant à organiser annuellement un Marché national de la réforme agraire 10 à São Paulo, ainsi que l’adoption d’une perspective agroécologique ont rapproché le mouvement de certains secteurs de la classe moyenne urbaine à la recherche d’une alimentation saine et de produits moins nocifs pour l’environnement. Tranquillement, le MST a survécu à une dure période de criminalisation, de Temer à Bolsonaro, au cours de laquelle les politiques publiques favorisant la réforme agraire, la sécurité alimentaire et les crédits à l’agriculture familiale ont été brusquement réduites.
La plus longue période de réforme agraire proprement dite au Brésil s’est déroulée de 1994 à 2010, que ce soit par l’étendue des terres distribuées ou par le nombre de familles visées. Plus de 959 000 familles vivent actuellement dans quelques 9 500 colonies créées ou reconnues, sur une superficie totale de 87,5 millions d’hectares, selon les données officielles de l’Incra datant de 2022. Cependant, depuis le mandat de Dilma Roussef, cette politique gagnant-gagnant – ceux qui vendent des terres au gouvernement gagnent des indemnités, le mouvement gagne de nouvelles zones – est entrée en crise pour deux raisons. La première est le rétrécissement des budgets publics : depuis 2013, le gouvernement fédéral a totalement cessé d’exproprier ou d’acheter des terres pour la réforme agraire. La seconde en est la surchauffe du marché foncier car l’agrobusiness, en particulier les planteurs de soja et les éleveurs de bétail, continuent de vendre à la hausse, et donc d’étendre leurs activités en avançant dans les réserves forestières, avec une dévastation dramatique des biomes du cerrado11 et de l’Amazonie ces dernières années.
Avec le mot d’ordre « régulariser tout le monde » les gouvernements Temer et Bolsonaro ont promis des titres de propriété foncière aux colons. Bolsonaro s’est même vanté d’avoir délivré 360 000 titres fonciers. En réalité, 90 % de ces titres n’étaient rien d’autre que les habituels Contrats de concession d’usage – une déclaration du gouvernement fédéral reconnaissant simplement la qualité de colon de la famille12.
Du paysan à l’homme d’affaires,
du catholique au néo-pentecôtiste
Mais se posent aussi des questions inhérentes au plus grand mouvement opérant dans le pays, à propos notamment de sa base sociale. Les militants du MST sont confrontés à deux grands défis : le premier tient à son origine et à sa tradition catholiques ; le second à la vision néo-libérale du milieu agricole. Le MST est tributaire depuis la seconde moitié du XXe siècle d’une culture particulière. Nombre de ses dirigeants et cadres ont été formés par des prêtres et religieuses de la dénommée Doctrine sociale de l’Église – un courant progressiste influencé par la Théologie de la libération, mais aussi par des personnes comme Dom Pedro Casaldáliga et Dom Helder Câmara parmi quantité d’anonymes qui, malgré leurs différences, croyaient en l’importance de l’Église dans l’amélioration de la vie des plus pauvres. Avec le pape Jean-Paul II et la montée du Renouveau charismatique à tendance conservatrice, l’Église catholique brésilienne a commencé à prendre ses distances avec la dynamique du travail pastoral et les Communautés ecclésiales de base.
L’autre mutation est liée à la subjectivité entrepreneuriale du néolibéralisme13. La notion d’« entrepreneur de soi » ne s’est pas construite uniquement dans les villes. Dans les campagnes brésiliennes, le rêve d’être « propriétaire de sa propre entreprise » est très présent dans l’imaginaire des travailleurs ruraux. Le paradigme de l’entrepreneur est apparu dans l’agriculture et l’élevage, avec l’image de l’agro-industrie américaine comme référence. La conséquence en est que la lutte pour la terre – dans la pratique du MST, une action nécessairement collective dans le but de créer une communauté – subit aujourd’hui une forte inflexion, en particulier dans les colonies de la réforme agraire.
Cependant, face aux difficultés internationales et à la puissance de l’agrobusiness brésilien, certaines avancées des mouvements sociaux brésiliens méritent d’être soulignées : la reconnaissance des diversités, la lutte contre le racisme et la violence machiste. Les leaders militants LGBTQIA+ ont joué un rôle de premier plan non seulement dans les groupes sectoriels, mais aussi dans les organes régionaux du MST. La lutte des femmes pour la parité a permis d’obtenir de réelles avancées, telles que l’attribution de titres de propriété au nom des femmes et la parité dans les conseils de décision.
Mais les difficultés ne sont pas minces. La pénétration des églises évangéliques néo-pentecôtistes dans les périphéries des villes moyennes, les petits centres urbains et les villages de l’intérieur représente un grand défi pour le MST qui, comme nous l’avons vu, est issu d’une tradition essentiellement catholique. Les nouvelles confessions s’appuient sur une compréhension de la foi liée à la réussite financière de l’individu. On assiste à l’émergence d’une religiosité parfaitement adaptée au sujet entrepreneurial néolibéral susmentionné, définie par les études sur les religions comme Théorie de la prospérité.
Il est indéniable que les églises néopentecôtistes ont pris une place centrale dans l’influence et l’aide aux populations les plus fragiles et marginalisées du Brésil. Elles étendent leur base sous la bannière du « sujet entrepreneur ». Leur succès repose sur une pratique religieuse qui met en valeur la prospérité individuelle, au sens matériel et moral.
Et maintenant ?
Le MST se trouve à la croisée des chemins : parier sur la radicalisation de la lutte pour la terre, ou donner la priorité à la lutte pour une production agricole durable. Choisir la première option signifierait affronter directement l’agrobusiness au moment de sa pleine expansion. La crise budgétaire du gouvernement fédéral constitue un obstacle à cette option. Sans ressources financières pour acheter des terres, qui sont de plus en plus chères, Lula ne peut plus offrir la solution gagnant-gagnant des années 1990.
Malgré la volonté initiale des dirigeants du MST de reprendre les occupations des terres à l’arrivée de Lula III, peut-on recommander, au vu des tensions dans les communautés paysannes et de la polarisation politique de la société, cette approche radicale ? La confrontation n’offre-t-elle pas un piège que les conservateurs et les néolibéraux attendent pour créer un ennemi intérieur ?
D’un autre côté, le mouvement a tiré bénéfice de la création de son propre réseau de soutien, de commercialisation et d’appui aux produits des colonies agricoles dans les petites villes et les grands centres urbains. Dans les villes, la stratégie a été couronnée de succès, en particulier, à travers les groupements d’achat collectif de la classe moyenne urbaine à la recherche de produits agroécologiques de qualité, avec un contrôle de l’origine et des critères de production éthiques et durables.
En ce qui concerne la réforme agraire, un modèle qui a fonctionné une fois peut ne plus fonctionner une autre fois. Dans une analyse historique des différents plans de réforme agraire au Brésil14, nous avons montré que pour chaque époque, une conception de la réforme agraire se forge au gré des besoins, des défis et des changements de formes. L’interrogation est la suivante : comment avancer dans le débat sur la question agraire brésilienne, en particulier sur la défense des terres et des territoires par la souveraineté populaire, ceci dans un environnement hostile marqué par l’exacerbation des conflits de classe par /dans l’État, par l’offensive néolibérale et par les médiations des technologies de l’information ? ll est alors important de poursuivre une forme de résistance par la commercialisation solidaire et les produits à valeur ajoutée. Mais ce réseau est-il suffisamment fort pour offrir un contrepouvoir à l’agro-industrie ? Des arrangements sociaux sont en cours qui associent les colons de la réforme agraire et les petits producteurs familiaux pour coopérer à la commercialisation directe des produits, y compris aux larges échelles régionale et nationale. À l’aide d’applications et d’outils numériques tels que les groupes WhatsApp, Instagram, Facebook et Telegram, les collectifs de commercialisation articulent l’achat et la vente et mettent les gens en contact.
L’un des obstacles à cette stratégie est que les réseaux de commercialisation alternatifs n’atteignent que les colons et les agriculteurs familiaux les plus organisés, ainsi que les consommateurs disposant d’un certain pouvoir d’achat ou se trouvant dans un circuit économique alternatif. Comme le souligne le MST, la lutte pour la terre inclut la lutte pour le territoire, pour la circulation, pour le choix du modèle agricole – agro-industrie ou agroécologie – qui tous impliquent d’autres temporalités, d’autres rythmes pour contrer l’accélérationnisme perturbateur de la financiarisation et de l’informatisation de l’agriculture. Il s’agit d’inventer une nouvelle relation dans laquelle la production alimentaire est pensée non seulement en réseaux de production – business ou agroécologique – ou réseaux de commercialisation – plateformisés ou solidaires – mais aussi en réseaux d’informations et d’affects.
Le géographe brésilien Milton Santos avait déjà interrogé la vitesse et l’accélération des logiques entrepreneuriales dans l’agriculture. Les évolutions contemporaines divisent les gens entre les « hommes du risque », entrepreneurs d’eux-mêmes, et les hommes lents qui ne prétendent pas suivre un rythme frénétique. Adopter un rythme lent comme forme de résistance à un nouveau milieu que le géographe a identifié comme étant technico-scientifique-informationnel15, c’est contester, pirater et contrer, on ne peut plus l’ignorer. À la croisée des chemins, plusieurs bifurcations s’offrent à nous, dont il faudra choisir la direction et le rythme.
Traduit du portugais (Brésil) par Priscilla De Roo
1www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/30972114/nasa-confirma-dados-da-embrapa-sobre-area-plantada-no-brasil
2Le MIT (UCUSA) affirme que 70 % à 75 % du soja produit dans le monde est destiné à l’alimentation des bovins, des porcs, des poissons d’élevage, alors que seulement 6 % est utilisé directement dans l’alimentation humaine. https://www.ucsusa.org/resources/soybeans
3Pour approfondir l’étude des chemins de l’agriculture brésilienne au XXIe siècle, voir Paulo Alentejano : https://publicacoes.agb.org.br/index.php/terralivre/article/download/426/403
4Lúcio Pereira Mello, Victor de Lima Gualda, « Políticas para o meio rural: um Estado e duas abordagens » (Politiques pour le milieu rural : un État et deux approches), in Território, Estado e políticas públicas espaciais, Marília Steinberger (Dir), Ler Editora, Brasília, 2013.
5www.canalrural.com.br/noticias/mercado-interno-mantera-lideranca-consumo-agronegocio-brasileiro-indica-ministerio-agricultura-39950
6La « bancada ruralista » ou « banc ruraliste », nom donné au Front parlementaire de l’agriculture et de l’élevage (FPA), constitue un groupe de pression au Congrès fédéral pour défendre les intérêts des grands propriétaires fonciers. En son sein existent différents « fronts » parlementaires qui défendent les intérêts de secteurs agricoles particuliers, comme celui du bioéthanol et de la fruiticulture. La bancada ruralista s’est souvent associée à la bancada évangélique ou à la celle des marchands d’armes. D’où la dénomination de cette association « bancada BBB » pour Bible, Bœuf, Balle.
7https://viacampesina.org/fr/bresil-la-dangereuse-relation-entre-agrobusiness-et-industrie-culturelle
8L’occupation des terres improductives est le mécanisme légal de lutte pour garantir la fonction sociale de la terre, prévue dans la Constitution de 1988.
9Colonie veut dire ici « installation » due à la réforme agraire.
10Le Marché réunit des paysannes et paysans venant des quatre coins du Brésil. Il propose environ 500 tonnes de produits provenant des colonies de la réforme agraire de toutes les régions. Il vend une grande variété de produits frais et agro-alimentaires, exempts de poison et basés sur de nouvelles relations avec le vivant.
11Savane du centre du Brésil.
12www.cartacapital.com.br/sociedade/quase-90-dos-titulos-de-terras-concedidos-por-bolsonaro-sao-apenas-provisorios
13Pierre Dardot, Christian Laval, La Nouvelle Raison du Monde : essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2010.
14Mello L. P., Sulzbacher A. W., « Os planos nacionais de reforma agrária no Brasil: a letargia de um desenvolvimento alternativo para o campo ». In XIV Encuentro de geógrafos de América Latina, Reencuentro de Saberes territoriales latino-americanos, Lima, Perú, 2013.
15Milton Santos, « Mode de production technico-scientifique et différentiation spatiale », Strates, hors-série, 2002.