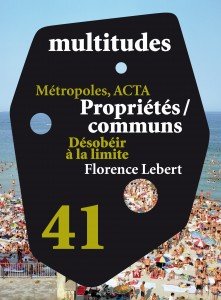Un nouveau continent des biens communs
Depuis 60 ans, l’irruption de l’informatique, des technologies informationnelles (par exemple en biologie), puis des réseaux universels comme Internet ont donné une nouvelle jeunesse aux biens communs. Cette affirmation pourra surprendre. Ne sommes-nous pas à l’ère de la marchandisation de l’information et des connaissances ? N’assistons-nous pas ces trente dernières années à une extension et un durcissement permanent des monopoles de propriété (brevets, copyright et droits d’auteur, droits propriétaires sur les bases de données) ? Ne voit-on pas le capitalisme informationnel des logiciels propriétaires, des médias et de l’édition centralisée et de l’industrie pharmaceutique générer des marges de profit inouïes ?
Pourtant, avant ces réactions propriétaires, l’informatisation se traduisit avant tout par une accessibilité et une réutilisabilité accrues des données, savoirs ou méthodes de calcul qui y sont représentées « en information ». Les années 1950 à 1970 ont pu être décrites comme époque de l’émergence silencieuse des biens communs[1], avec une forte culture de partage et d’accessibilité. L’information séparable de son support est par nature reproductible à l’infini. Il est presque impossible de l’enfermer dans un enclos de propriété, notamment si cette information doit rester « utilisable » dans un produit. C’est toute la contradiction dans laquelle s’est enfermée l’industrie phonographique lorsqu’elle a voulu empêcher la copie des enregistrements tout en conservant la possibilité pour ses consommateurs de les écouter[2].
L’apparent paradoxe du développement de puissantes industries s’appuyant sur des monopoles de reproduction de l’information (logiciels, médias, industrie pharmaceutique et des semences) au moment même où ces monopoles sont affaiblis par la diffusion des technologies s’explique aisément. Les monopoles informationnels sont certes fragiles, mais les profits qu’ils permettent sont sans commune mesure avec ceux des industries traditionnelles. Le découplage complet entre prix de vente et coût de production est une perspective irrésistible pour les investisseurs. Dès les années 1970, l’Industry Advisory Committee on Trade Negotiations piloté à l’époque par IBM, Monsanto et Pfizer, conçut le projet d’une mondialisation de monopoles étendus et durcis de brevets et de copyright. C’est la signature des accords ADPIC[3] en 1994 qui concrétisera ce projet.
Une première coalition des biens communs[4]
La résistance d’acteurs de la société civile à ce durcissement de l’appropriation fut particulièrement vive, et conduisit à une première reconnaissance de ce qu’il y a de commun… entre différents types de biens communs. Son périmètre (entre 1994 et 2005) rassembla les mouvements des logiciels libres, des créations partagées, de l’accès aux connaissances, et ceux de l’accès aux médicaments et des droits des fermiers contre les semenciers et les OGM.
La reconnaissance mutuelle de ces différents mouvements s’effectua dans l’affrontement à des adversaires semblables et qui s’étaient eux-mêmes reconnus comme alliés. Une caractéristique essentielle des acteurs des biens communs informationnels est qu’ils sont engagés dans la construction des biens communs au moins autant que dans leur défense contre l’appropriation. C’est dans la seconde moitié des années 1990 que l’ampleur de cette construction volontaire des biens communs apparut au grand jour, avec la prise de conscience de la portée des logiciels libres. Bien que leur projet ait été formulé quinze ans plus tôt, les logiciels libres avaient longtemps été considérés, hors de leur cercle, comme un modèle marginal. On prit progressivement conscience de ce qu’ils constituaient la base même de l’infrastructure d’Internet et du Web et que leur modèle d’innovation et de coopération avait une portée générale dans toute la sphère de la production d’artefacts informationnels (c’est-à-dire d’expressions, d’œuvres, de données ou d’outils qu’on peut représenter « en information »). Quelques années plus tard, la portée du modèle de production collaborative par les pairs sur la base des biens communs[5] a été démontrée dans des domaines très divers : encyclopédies libres avec Wikipedia et d’autres projets, publications scientifiques et données en accès libre, expressions et créations partagées sous licences Creative Commons ou Art Libre, réseaux de semences paysannes, nouveaux mécanismes d’innovation pour les médicaments.
Très progressivement les affirmations positives d’un projet partagé se développèrent ; il fallut pour cela reconnaître à la fois ce qu’il y a de commun entre un logiciel et une semence (l’information) et ce qui y est profondément différent : information pure qui ne fait référence qu’à une machine abstraite pour les logiciels, information génétique qui ne s’exprime que dans un environnement physique particulier pour la semence, par exemple. Le mûrissement des actions de cette première coalition des biens communs prit du temps, mais il est aujourd’hui un fait établi. Qui plus est, de nouvelles visions affirmatives, de nouveaux récits ont été produits, désignés comme nouveaux domaines publics ou communs informationnels, défendus contre la tragédie des enclosures[6] et promus par la mise au premier plan de droits intellectuels positifs de préférence à celle des droits restrictifs (droits à interdire). James Boyle a été le premier à fédérer ces visions dans son article « A politics of intellectual property: Environmentalism for the Net?[7] » dans lequel il prédit que la reconnaissance des communs de la connaissance peut porter une recomposition politique aussi importante que celle à laquelle aboutit l’environnementalisme à partir de 1970.
La question des limites de cette redécouverte et de cette réinvention des communs reste cependant ouverte. Peut-elle apporter une nouvelle jeunesse aux biens communs physiques (air, eau, environnement, climat) et aux biens publics sociaux (éducation, santé publique, réduction des inégalités, espaces publics urbains) ? Comment peut-elle rencontrer les efforts de ceux qui tentent de les défendre et de les réinventer dans un contexte hostile ?
De l’environnement au social
Pour les biens communs de l’environnement tout comme pour les biens publics sociaux, les trente dernières années du XXe siècle furent une époque de contraste. Ils y furent reconnus comme jamais, mais avec des limites fortes aux effets de cette reconnaissance dues à la domination de l’économisme (la réduction à l’économique) et du fondamentalisme marchand dans cette période. Au terme d’efforts amorcés en 1972 à Stockholm, la biodiversité, le climat, plus généralement « la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre », mais aussi le droit au développement et la réduction de la pauvreté furent reconnus comme biens communs ou objectifs partagés mondiaux lors des sommets de New York et de Rio en 1992[8].
Cette reconnaissance des biens communs physiques et des biens publics sociaux ne tomba pas du ciel. Dès les années 1980, une réponse intellectuelle au modèle de la tragédie des communs s’était construite. Garrett Hardin, dans son article de 1968[9], affirmait que les biens communs sont fragiles face à la pression d’usages accrus pour des raisons démographiques ou économiques. Face à ce danger de destruction ou de surexploitation, il fallait selon Hardin, soit les transformer en propriété privée pour assurer qu’ils soient défendus et entretenus par leurs propriétaires, soit recourir à la gestion publique, qu’il jugeait par nature inefficace et corrompue. Les travaux d’Elinor Ostrom[10] montrèrent qu’Hardin avait négligé une troisième forme de gestion différente de la gestion propriétaire et de la gestion publique : la gestion des biens communs par les communautés d’usagers. Elle montra[11] que celle-ci variait dans ses formes pour divers biens communs (terres de pâturage, forêts, eau, ressources de pêche) et qu’elle est généralement efficace en l’absence de destruction externe.
Cette reconnaissance des biens communs fut cependant détricotée en même temps qu’elle prenait place, en raison d’un contexte idéologique et institutionnel défavorable. Seule la Convention sur la diversité biologique intègre une cour arbitrale qui la rend juridiquement contraignante. La plupart des autres textes mentionnés plus haut sont de nature déclarative ou en tout cas n’ont pas un impact aussi fort que les accords liés à l’Organisation mondiale du commerce. Dans de nombreux domaines, divers groupes d’intérêt se mobilisèrent pour refuser l’emploi des notions fortes de bien commun et de patrimoine commun de l’humanité, et y substituer celle de bien public mondial qui fait l’impasse sur la question des régimes de propriété et la nature des acteurs garants. Ces tensions furent particulièrement sensibles dans le domaine de l’eau, où le Conseil mondial de l’eau s’oppose à la reconnaissance de l’eau comme bien commun, défendue par exemple par Riccardo Petrella, et décrit l’accès à l’eau comme un besoin vital et non comme un droit humain[12]. De façon moins réductible à l’influence des groupes d’intérêt économiques, des tensions sont apparues entre l’attribution de statut de biens communs planétaires à des ressources comme les forêts (considérées comme puits de carbone) et les besoins de développement de pays défavorisés.
Outre l’épuisement des fondamentalismes marchand et propriétaire du fait de l’évidente nocivité des politiques appliquées en leur nom, la diffusion du concept de développement humain joua un rôle important pour renforcer la reconnaissance encore fragile des biens communs. Les indicateurs de développement humain, conçus dans les années 1990 sont non réductibles à une mesure économique unique[13]. La vision intégrée du développement humain qui les sous-tend permettra plus tard de reconnaître les liens entre biens communs (outils et ressources éducatives libres d’accès et d’usage, médicaments génériques, accès aux informations produites par les organismes publics, environnement sain, espace urbain) et biens publics sociaux essentiels (éducation, santé, justice sociale, bonne gouvernance, habitat). La mise au premier plan du développement humain va également, permettre de dépasser les oppositions pensées uniquement en termes d’affrontements de pays. Des associations de défense des biens communs dans le Nord et des associations soucieuses de développement au Sud pourront se réunir sous sa bannière.
Un début d’alliance s’est ainsi tissé entre défenseurs de l’accès aux connaissances et tenants de la justice sociale mondiale ou du développement. Dans les années récentes, une coalition d’ONG du Nord comme du Sud, de pays émergents (Brésil, Inde, Argentine, Chili, etc.) et de pays en développement a mis en rapport d’une façon nouvelle biens communs informationnels et développement.
Il en a résulté l’adoption d’un agenda pour le développement à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le lancement de travaux sur de nouvelles formes d’incitations à l’innovation et de partage mondial de l’effort de recherche à l’Organisation Mondiale de la Santé. Ces développements sont loin d’avoir rééquilibré les actions de ces organismes qui restent « sous influence » de puissants intérêts privés. Mais ils constituent cependant un tournant, qui suscite des inquiétudes visibles chez les tenants de la mondialisation propriétaire. Plus récemment, lors des sommets sur le climat, de nouvelles coalitions sont apparues entre tenants de politiques fortes pour limiter la contribution humaine au changement climatique et défenseurs de la justice sociale planétaire.
Le temps est donc mûr pour qu’une nouvelle école de pensée politique se cristallise autour d’une approche conjointe des communs et des biens publics sociaux. Le reste de ce texte explore deux grandes questions auxquelles cette école de pensée va devoir se confronter.
La gouvernance moderne des communs
et des biens publics sociaux
Les communs informationnels ont comme les communs physiques une très grande diversité. Diversité des statuts qu’ils se donnent, qui prennent aujourd’hui la forme de licences ou de termes d’usage mais que l’on peut lire comme de véritables « constitutions des biens communs »[14]. Mais aussi diversité de la gouvernance des projets qui alimentent les biens communs, diversité des organisations qui en sont garantes, diversité des relations entre biens communs et activités économiques qui les utilisent et parfois y contribuent. Les biens communs informationnels sont un véritable laboratoire de nouveaux mécanismes de gouvernance, dont on peut citer deux exemples importants :
– Le processus de révision de la licence libre GNU GPL, qui réunit des acteurs de nature et de puissance très différente (de grandes entreprises comme IBM ou Intel à des projets de développement communautaires, des usagers administratifs aux contributeurs individuels)[15]. Tous sont intéressés à l’existence et à l’efficacité de la licence comme constitution d’un bien commun mais leurs intérêts sont très divers et exercent des pressions parfois contradictoires sur le contenu de la licence.
– La gouvernance interne à Wikipedia qui, contrairement à l’idée caricaturale d’une gestion anarchique, a mis en place toute une série de règles et de mécanismes pour protéger les caractéristiques essentielles de l’encyclopédie libre.
Dans le même temps, la gouvernance des biens communs physiques et des biens publics sociaux doit s’adapter à de nouvelles conditions. Bien que très riches, les mécanismes de gestion communautaires traditionnels souffrent de limites qui imposent de les réagencer. Ils reposent en effet sur l’adhésion stable des individus à la communauté et une délimitation relativement précise de ses limites. Ces conditions ne sont aujourd’hui plus réunies, du fait de processus d’élargissement des échanges mais aussi du fait de la volonté propre d’émancipation des individus. Les appartenances sont en permanence renégociées : les individus sont toujours parties prenantes à des communautés, capables d’y investir leurs énergies, mais ne leur « appartiennent » pas, où si c’est le cas, c’est souvent un signe de confinement subi avant d’être revendiqué.
Les communs informationnels sont depuis longtemps confrontés à ces situations typiques de l’âge numérique. Lorsqu’il s’agit de décisions portant sur des biens authentiquement non-rivaux comme les logiciels libres, des formes fluides de gestion communautaire sont possibles. Les participants au développement d’un logiciel libre, s’ils sont insatisfaits de son orientation ou de son organisation, peuvent « dupliquer » le bien commun et continuer son développement dans un autre cadre ou avec d’autres buts. Cela explique qu’une diversité très grande de modes de gouvernance puisse y exister, depuis des organisations hiérarchiques avec cooptation (y compris conduites par des entreprises) jusqu’à des organisations beaucoup plus horizontales. Cette gouvernance diverse et fluide ne peut pas être transférée aux biens communs physiques ou sociaux. Un usage d’un espace urbain peut être en tension avec un autre et cet espace ne peut être dupliqué pour les rendre compatibles. Le partage du bien commun y suppose une négociation, l’orientation de son devenir des choix politiques partagés dont les conséquences s’exerceront pour tous. D’autres processus de gouvernance des communs informationnels sont plus adéquats pour inspirer et tirer inspiration de la gouvernance des communs physiques et biens publics sociaux. Il s’agit de ceux qui portent sur les ressources qui restent rares malgré l’abondance informationnelle ou qui doivent par nature être partagées, comme celles mentionnées plus haut : licences, codes de conduite ou termes d’usage, contenu d’un article particulier. Des dispositifs sont expérimentés à l’heure actuelle dans des champs très divers (innovation en biologie, accès aux connaissances et à la culture, chartes territoriales, aménagement urbain, éducation, santé publique). Ils mettent en place de processus participatifs à des étapes clés : diagnostic, élaboration de programmes, suivi de mise en œuvre. À l’heure actuelle, la participation effective à ces processus est limitée par le doute sur leur influence effective et par le caractère chronophage (consommateur de temps) des formes traditionnelles de participation (réunions, ateliers). Les technologies informationnelles permettront-elles de construire une alternance entre les temps flexibles de l’interaction asynchrone possible avec l’informatique et Internet et les temps intenses de l’interaction face à face ?
Les relations entre communs
et économie et la réinvention du social
L’organisation des relations entre communs et économie est un défi politique majeur de notre époque. Même parmi ceux qui reconnaissent la valeur des biens communs, des modèles assez divers s’affrontent lorsqu’il s’agit de les mettre en relation avec l’économie monétaire.
Quatre grands modèles existent, et il est clair que l’équilibre entre ces modèles est à débattre et expérimenter pour chaque type de bien commun ou de bien public social :
– l’investissement privé et les incitations fiscales qui visent à le stimuler ou l’orienter ;
– la mutualisation des conditions d’existence d’un bien commun entre ses usagers ;
– l’impôt et les politiques publiques visant à assurer directement l’existence d’un bien commun ou d’un bien public social ;
– la distribution (explicite ou de facto[16]) de revenus d’existence à l’ensemble des contributeurs potentiels aux biens communs.
Or même dans le champ des seuls biens communs informationnels, des différences existent qui justifient un traitement différencié de différents secteurs. Pour les logiciels libres, il semble qu’un équilibre reposant sur une combinaison du premier (investissement privé avec incitations) et du dernier modèle (contribution distribuée des individus) soit viable, avec une contribution souvent sous-estimée des politiques publiques, notamment de recherche. Pour les connaissances scientifiques, le rôle très excessif accordé à l’investissement privé (souvent aux frais des contribuables) n’est pas pour rien dans les mécanismes d’enclosures et d’orientation appauvrissante qui se sont développés. En matière de créations culturelles, il semble qu’une combinaison de l’ensemble des modèles soit à privilégier, à condition qu’un rôle très fort soit donné à la mutualisation sociétale porteuse de diversité culturelle, que le rôle de l’investissement privé soit encadré de façon à l’empêcher de prétendre restreindre l’accès à la culture comme bien commun pour les besoins de modèles commerciaux monopolistiques, et que la gouvernance des financements publics de la culture (re)devienne un objet de débat politique et de décision démocratique.
On retrouve une diversité des relations à l’économique dans le domaine des biens communs physiques et des biens publics sociaux. Cependant, il semble nécessaire d’y confiner le rôle de l’investissement privé :
– à la fourniture de certains moyens (par exemple bâtiments, infrastructures de transport, innovation pharmaceutique ou plus généralement technologique mais avec des garanties face aux excès de contrôle propriétaire sur son orientation) et de certains services contribuant aux biens publics sociaux,
– à l’économie d’utilisation des externalités positives des biens communs (services à valeur ajoutée exploitant l’existence des biens communs).
En d’autres termes, l’orientation de la protection, de l’entretien et de la production des biens communs et des biens publics sociaux semble devoir réserver une place particulière à une combinaison entre des acteurs sociétaux (mutualisant leurs ressources) et une action publique régénérée par de nouvelles gouvernances démocratiques. La construction effective de cette gouvernance des biens publics sociaux est rendue plus complexe du fait que l’on ne peut pas raisonner seulement en termes de statut des acteurs : un commerce en bordure d’un espace public pourra contribuer à sa qualité alors qu’un mobilier urbain mis en place par une collectivité à travers un appel d’offres adossé à l’attribution d’espaces publicitaires pourra de fait privatiser une dimension de l’espace public. La gouvernance doit donc être attentive à des effets qualitatifs fins, sans pour autant tomber dans une micro-gestion administrative.
Bref, le chantier de la réinvention des biens publics sociaux et des biens communs physiques est devant nous. Il promet d’être complexe, mais c’est celui d’une nouvelle ère démocratique.