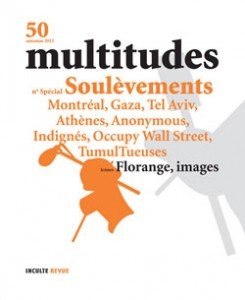De l’avis de plusieurs, l’adoption par le gouvernement Charest de la loi spéciale 78 dépasse les bornes. Les contraintes formelles visant à limiter la liberté d’association et l’exercice de la liberté d’expression ont été contestées devant les tribunaux par des associations étudiantes soutenues par une coalition de 140 organisations issues de la société civile. La mesure d’urgence a provoqué un tollé médiatique à l’échelle internationale, plusieurs y allant de parallèles avec la Russie de Poutine, tandis qu’Amnesty International ne mâchait pas ses mots pour dénoncer la situation. Mais surtout, l’imposition de la loi spéciale a eu pour effet de renforcer la détermination des étudiants grévistes dans leur lutte contre la hausse des frais de scolarité, en plus d’inciter d’autres secteurs de la société québécoise à embrasser leur cause. Plutôt que de mettre un frein à leur mouvement donc, la loi spéciale 78 l’a intensifié, l’amenant au point d’ébullition d’un mouvement général de contestation. La colère populaire a débordé de toute part la tentative éhontée de court-circuiter la négociation sociale d’un enjeu politique majeur par un décret autocratique venu d’en-haut.
Vers une logique de la préemption
Mais au-delà de l’excès manifeste des moyens employés pour faire taire les manifestants, c’est sans doute la surprise apparente du gouvernement Charest face à l’ampleur de la réaction qu’il a déclenchée qui donne le plus à réfléchir. La loi a été présentée avec une remarquable nonchalance, comme si ses dispositions ne s’instituaient pas en rupture avec la procédure normale de fonctionnement, ne représentant qu’un simple changement de degré plutôt que de nature. Cette attitude mérite qu’on s’y attarde de plus près. Elle trahit une proposition implicite, à savoir que la loi 78 devrait être envisagée en continuité avec la situation normale. L’hypothèse tacite qui sous-tend l’insouciance gouvernementale, c’est que la loi spéciale 78 ne fait qu’officialiser une situation déjà en vigueur de facto. En d’autres termes, le court-circuitage des négociations sociales – l’effacement du politique entendu de manière plus générale que comme le rituel d’abdication du pouvoir de décision à une élite managériale de décideurs substituts à travers l’exercice périodique d’un vote pour la moins pire ou la plus supportable des options – est une réalité de la vie dont la masse devrait déjà avoir l’habitude.
La première indication que c’est effectivement le cas est que, pour l’instant du moins, le service de police de la ville de Montréal (SPVM) n’a pas jugé nécessaire d’invoquer la loi 78. Il a en effet continué à procéder comme si de rien n’était. Au Québec comme ailleurs au Canada, dans la foulée du Sommet des Amériques à Québec en 2001 et des manifestations contre le G20 à Toronto en 2010, on observe un changement profond dans la manière dont les forces policières exercent leurs fonctions. Le changement réside dans le passage d’une logique de l’application [enforcement] à une logique de la préemption. Préemption ne signifie pas prévention. La différence consiste en ce que la préemption produit activement ce qu’elle combat, se donnant ainsi l’avantage du choix des champs de bataille et la possibilité de répondre avec ses tactiques de prédilection. Le rôle prétendu de la police est de combattre l’illégalité. À plusieurs reprises depuis le début des contestations par exemple, le SPVM déclare illégale la totalité d’une manifestation pour ensuite s’attaquer à tous les individus présents avec une force démesurée mettant leur vie en danger, en réaction à une petite minorité qui provoque les forces de l’ordre avec des actes de vandalisme mineur ou des jets de projectiles à leur endroit. De quoi s’agit-il dans ces cas-là, sinon de la production systématique d’illégalité comme stratégie d’État? Cela revient à criminaliser l’exercice du droit d’association et de libre expression par la grande majorité de ceux qui participent de manière non-violente aux manifestations, coupant effectivement court à leurs velléités démocratiques. En d’autres mots, les manifestants pacifiques sont déclarés coupables par association.
Le seul changement que la loi 78 a apporté à cette stratégie est que, après son adoption, la police a commencé à déclarer les manifestations illégales avant même que toute infraction ait été commise – dans certains cas, avant même que la manifestation ait commencée. Les porte-paroles des forces policières ont bien pris soin de souligner que cela se fait sans invoquer la loi 78. Enhardi par la loi 78, mais non pas en fonction de celle-ci, le SPVM a poussé la logique de la préemption un cran plus loin dans sa direction naturelle. Du court-circuit de la contestation par la culpabilisation par association, la police désormais criminalise les manifestations a priori, de manière à les préempter avant même qu’elles n’aient lieu. Tout rassemblement de plus de 50 personnes qui n’est pas autorisé à l’avance par les forces de l’ordre et qui ne se déroule pas intégralement selon leurs termes est désormais considéré d’emblée illégal. Mais bien sûr, les manifestations qui se tiendraient selon les termes imposés au préalable par les autorités ne sont d’aucune façon contestataires. Elles ne constituent plus guère que des actes d’obéissance orchestrés.
Voilà l’opération de préemption telle qu’elle s’effectue dans sa boucle la plus resserrée. Elle n’attend plus les habituels signes avant-coureurs, tels des pierres lancées contre les lignes puissamment armées de la police, avant de criminaliser dans son entièreté un événement afin de se prémunir contre d’éventuels débordements. À présent, l’anticipation passe à l’avant-scène pour s’exercer a priori. L’effet ainsi désiré est de traduire manu militari la criminalité en obéissance directe. L’acte collectif de volonté politique consistant à se rassembler sur la place publique pour exprimer son désaccord et ainsi faire pression en vue d’une résolution alternative à une situation conflictuelle est ainsi pris dans un mouvement en tenaille qui le voue à la non-existence. Si cette connexion directe entre culpabilité a priori et obéissance directe vous semble orwellienne… il n’en est rien. Si cet effacement de la place du politique vous semble totalitaire… il n’en est rien non plus. Nous avons affaire à quelque chose de nouveau, pour lequel de nouveaux concepts – et de nouvelles réponses – doivent être inventés.
L’université, industrie de services
Pour commencer à comprendre de quel genre de formation plus large la préemption fait partie, il est utile de porter attention à une autre pointe de son déploiement. Un mouvement en tenaille semblable à celui utilisé dans les rues a été appliqué aux professeurs en classe dès les premières étapes de la grève étudiante. Des professeurs de plusieurs universités et collèges ont été avertis par leurs administrations qu’ils se retrouveraient en rupture de contrat et pourraient faire face à des mesures disciplinaires voire à des licenciements si ils ou elles exprimaient leur soutien à la grève étudiante, ou même s’ils laissaient savoir aux élèves qu’ils n’allaient pas être pénalisés en y participant (par exemple, en leur donnant des évaluations incomplètes ou en établissant des plans de rattrapage pour les heures de classe manquées). Non seulement ces décrets définissent l’exercice du droit d’association des étudiants comme étant illégitime a priori, il instaure le corps professoral dans le rôle de responsable de l’application des décrets administratifs.
Cela s’est fait en reléguant d’abord les professeurs au rang de simples employés sans autre statut et dépourvus de tout rôle social ou politique, puis en incorporant à cette définition de tâche un devoir implicite de faire respecter les règles institutionnelles au nom de l’administration. Un autre court-circuit entre la criminalisation a priori de l’action collective et l’obéissance directe a ainsi été mis en place, bafouant au passage le principe de liberté académique sur lequel l’université, comprise comme lieu d’une éducation libérale, est théoriquement fondée. De rares et précieuses voix ont certes fait valoir leur opposition ; pour ce qui est des nombreux professeurs qui se sont si aisément laissés enrôler dans cette logique de préemption, qu’ils gardent durablement à l’esprit et avec la honte qu’il convient le souvenir de ces événements, afin qu’une telle capitulation ne se répète pas de nouveau.
Le fait est que les administrations universitaires et les gouvernements provinciaux et nationaux vis-à-vis desquels ils sont imputables au Canada ne considèrent plus l’université comme étant le siège de l’éducation libérale. Ils la conçoivent comme une industrie de services. La mobilisation collective des étudiants ne peut qu’apparaître illégitime en regard d’un autre droit désormais placé à l’avant-plan : le « droit » individuel de l’étudiant(e) à recevoir le service pour lequel il ou elle a payé. Un certain nombre d’étudiants ont individuellement demandé et obtenu des injonctions judiciaires sur cette base, niant ainsi le droit collectif des associations étudiantes en grève de dresser des lignes de piquetage devant les salles de classe. Cette redéfinition de l’étudiant comme client et de l’éducation comme une industrie de services à la carte soulève la question fondamentale du rôle que l’éducation joue ou devrait jouer dans la société, et si l’éducation elle-même devrait être considérée comme un droit. La question de l’éducation est présentée comme une affaire classée, avant même d’avoir pu être posée. En un mot, l’éducation est préemptée en tant qu’enjeu social et politique.
Le formatage capitaliste de l’éducation
La logique dont sont issues ces stratégies de préemption apparaît désormais dans toute sa clarté. C’est la logique du capitalisme néolibéral. Selon cette logique, l’université, comme tous les secteurs de la vie, doit être subordonnée aux impératifs du marché. Ceux qui se retrouvent au sein d’établissements d’enseignement sont essentiellement considérés à titres d’acteurs économiques (employés, clients), tout comme l’institution dans son ensemble ne peut justifier son existence que par l’adaptation de sa structure et de ses modes de fonctionnement, au niveau de l’enseignement comme à celui de la recherche, en fonction des besoins présumés du marché. Toute logique de fonctionnement social qui n’est pas directement formulée dans les termes du modèle économique néolibéral est traitée comme une valeur nulle et non avenue.
La question de l’augmentation des frais de scolarité n’a jamais été une simple question de finances individuelles des étudiants. Les associations étudiantes ont, dès le début, lié avec lucidité la hausse des frais de scolarité à des enjeux de plus grande envergure. Soutenus par des études menées par l’IRIS, ils ont mis en évidence nombres de problèmes tels que la diminution progressive du pourcentage du financement octroyé aux universités allant à l’enseignement en rapport à la croissance continue des structures administratives ainsi que du salaires des cadres supérieurs (une tendance qui se reflète également dans le secteur privé). Ils ont également souligné l’imbrication toujours plus étroite entre recherche et production de résultats « livrables » et utiles à l’industrie, ce qui revient à faire de l’université une forme de prestataire social pour entreprises en leur permettant aux d’externaliser des fonctions de recherche autrefois effectuées et payées à l’interne. Ils ont, à juste titre, dénoncé le cynisme avec lequel on prétend que toute augmentation des ressources due à la hausse des frais de scolarité servirait à améliorer la qualité de l’enseignement, étant donné que, par exemple, jamais dans l’histoire du Québec une hausse des frais ne s’est traduite dans une amélioration du ratio prof/étudiants.
Les associations étudiantes ont ainsi raisonnablement entretenu le soupçon que l’augmentation des frais exigée par le gouvernement ne ferait que confirmer la subsomption de l’université dans la logique du néolibéralisme, subventionnant à fort prix une classe managériale promettant plus « d’efficience » et un système de sous-traitance de la recherche au bénéfice de l’industrie, le contrôle du financement glissant toujours plus sûrement entre les mains de l’empire du marché. La question des frais de scolarité s’est donc constituée dès le départ comme un enjeu critique au sein d’un débat plus large sur le rôle de l’éducation dans la société d’aujourd’hui, dans un contexte où nous sommes mis devant le fait accompli que, dans la foulée de son intégration à « l’économie du savoir », la vocation libérale traditionnelle de l’université en tant que haut-lieu de la recherche libre et incubateur pour la pensée critique serait désormais désuète.
Les politiques préemptives, qu’elles soient mises en œuvre dans les rues ou dans les amphithéâtres de l’académie, sont le mode d’expression politique de la colonisation par le néolibéralisme de tous les secteurs de la vie selon le modèle économique. Dans le cadre de ce modèle, la figure du « citoyen » comme acteur social fondamental est remplacé par celui de l’individu redéfini comme « capital humain » : ce que certains commentateurs ont appelé « l’individu-entreprise » (qui est aussi, et cela n’est bien sûr pas une simple coïncidence, le sujet de la dette perpétuelle). La préemption est le mode d’expression politique de la dépolitisation a priori de la vie sous le couvert de l’économisme. La formation dont la préemption est l’expression n’est ni orwellienne, ni totalitaire dans sa structure de base, même si elle produit des effets de cette nature quand elle s’abat dans les rues et s’infiltre dans les amphithéâtres de nos institutions. En elle-même, elle est, tout simplement, capitaliste. C’est le formatage économique de la vie sous le régime actuel du capitalisme.
Ce que les professeurs ont à apprendre des étudiants : Vive l’inefficience ! La préemption est la forme d’expression de la logique d’usurpation économiste du capitalisme néolibéral de la sphère anciennement connue sous le nom de politique, entendu au sens le plus large comme mobilisation collective pour la contestation sociale et la négociation. Elle constitue l’aile (dé-)politique de la logique opératoire d’économisation du néolibéralisme. Souligner cette convergence entre le capitalisme néolibéral et les effets d’autoritarisme accompagnant l’opération de préemption n’est ni une réponse ni un point final. C’est une plaie béante, une question ouverte – nécessitant une révision profonde de nos concepts de gouvernement, de sphère publique, de la place de l’éducation ainsi que de nos stratégies en relation avec eux. Ce n’est que le début. Du point de vue de la logique régnante de l’économisme, l’engagement des associations étudiantes en faveur de l’expérimentation de formes de démocratie directe comme base collective de re-politisation des questions qui les concernent – dénigrée avec un mépris sidérant par la presse – ne peut être considérée comme un exercice puéril et « inefficient ».
Si les professeurs veulent revendiquer ou réinventer pour leur propre compte un rôle autre que celui d’employés dans une sous-industrie corporative, ils feraient mieux de s’inspirer de « l’inefficience » de leurs étudiants. Pour que l’université ait une chance de retrouver son rôle social, ou mieux, d’en inventer un nouveau pour le futur, une chose sera requise de ses professeurs : qu’ils se remettent à agir collectivement dans la grande arène en tant qu’acteurs sociaux et politiques, au-delà des limites de leur institution d’attache et en opposition à la réduction de leur position à celles de policiers policés du modèle entrepreneurial.
Pour ce faire, leurs associations devront apprendre à se départir de leur propre corporatisme – qu’on pense par exemple au comportement intéressé des syndicats de professeurs durant la grève 2005 à l’Université de Montréal, où ils ont donné priorité à la hausse de salaire des professeurs au détriment des enjeux liés à la qualité des conditions de travail ayant une incidence directe sur la qualité – et la nature – de l’éducation dispensée. Ce serait déjà un premier signe encourageant si la participation de la fédération des enseignants du Québec ainsi que le syndicat des professeurs de l’université de Montréal à l’action en justice contre la loi 78, sans compter l’appui de plus en plus manifeste de nombreux professeurs à la grève étudiante, pouvaient être lus comme les premiers pas vers une sortie du corporatisme traditionnel – et vers la rue, côte-à-côte avec les étudiants qui ont eu le courage de catapulter les problèmes de l’université et la question du sort du politique dans le néolibéralisme à l’avant-scène du débat public, au moment où la détermination de leurs aînés s’est montrée si clairement défaillante.
Si les actions du gouvernement Charest justifient amplement qu’on lui montre la porte aux prochaines élections, la loi 78 ne mérite elle non plus guère mieux que d’être reléguée par les tribunaux aux oubliettes de l’histoire légale. Mais si la réponse populaire s’en tient aux urnes ou aux actions en justice, une opportunité historique aura été perdue. L’opportunité d’une re-politisation –au sens le fort et le plus démocratique