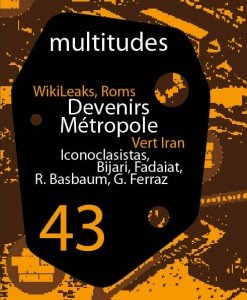« Idiot ! Je ne suis pas ton ennemi ;
je suis ton déni. »
C’était un thème récurrent dans les dessins des journaux iraniens, depuis la victoire du réformiste Khâtami à la présidentielle de 1997, que de dessiner la scène d’un jeu d’échecs où un joueur calme, parfois même un peu avachi et souvent d’un air las, réfléchissait désespérément à son jeu devant l’échiquier. Son adversaire, en revanche, un grand costaud plutôt, était soit en train de lui donner un coup dans la figure, soit de braquer son arme sur notre joueur respectueux. Telle a été la situation politique en Iran pendant les huit ans de la présidence de Khâtami. Elle l’est restée, aussi après l’arrivée d’Ahmadinejad. L’almanach est suffisamment riche en péripéties : une crise tous les neuf jours, de l’aveu de Khâtami lui-même. Et en ce qui concerne son successeur, le complot, la répression, la prison, la torture et le meurtre sont considérés comme tâches gouvernementales, non pas comme crises. La chose commence à l’époque de Khâtami – mieux vaudrait dire qu’elle continue, car après l’établissement de l’État religieux elle n’a jamais été interrompue, quoiqu’en absence totale d’informations et de médias – par le rapt de deux modestes écrivains, puis leur assassinat ; et par celui de deux autres, un vieux couple d’anciens activistes nationalistes, poignardés dans leur appartement. Le grand exploit du gouvernement réformiste, le seul en la matière, consistera à identifier et à dénoncer une « bande » dans le Ministère des informations comme responsable de ces crimes, Ministère qui était par ailleurs seul en apparence une partie du gouvernement maintenant réformiste. Le système judiciaire, sous la pression de l’opinion publique, ne peut que réagir. Mais avant tout procès ou tribunal, le chef de bande sera réduit au silence en le suicidant en prison. Et puis, il y a l’attaque du dortoir universitaire pendant la nuit du 25 juin 1999, attaque on ne peut plus brutale avec des morts dont seulement un est officiellement reconnu, et plusieurs blessés. Les cinq jours qui suivent verront l’oppression atroce des étudiants protestant contre cette attaque par les forces de l’ordre et surtout par les miliciens en tenue civile, les bassijis. Ce qui veut dire qu’ils seront écrasés, cette fois-ci en plein jour, par ceux-là même qui ont commis l’attaque nocturne. Pour calmer la situation, il y a un tribunal. Son jugement : il condamne un soldat qui fait son service militaire à ce moment-là pour le vol d’un rasoir électrique du dortoir. Ensuite, vient le tour de la fermeture des journaux : une vingtaine le premier jour après le signe public du Guide, Khâmenei ; puis, l’arrestation des journalistes et des activistes ; viendra ensuite le tour des ministres d’être battus dans la rue ; et même, celui de l’attentat contre un réformiste, Sa’id Hajjâryân, à l’époque membre du Conseil municipal de Téhéran, attentat qui le laissera paralysé à vie. Dans ce dernier cas, à nouveau un tribunal. Son jugement sera encore plus « hilarant » que le précédent. En revanche, Hajjâryân le paralysé sera arrêté et torturé tout de suite après l’élection de 2009 : on l’accuse d’avoir organisé les émeutes. Pour qu’il avoue ses complots à la télévision nationale, il a fallu que son jeune fils soit torturé devant le père. De cela, on n’aura pas de peine à déduire le sort des autres prisonniers moins connus, et pis encore, des simples étudiants, ouvriers ou gens de la rue, encore que, pendant toutes ces années, le système judiciaire n’ait jamais reconnu l’existence de prisonniers politiques en Iran. Le réformiste, bien entendu, n’a pas cessé de réagir en chantant des hymnes à la liberté, à la loi et à la démocratie… Au dialogue et à la société civile surtout.
Encaisser des coups à chaque fois plus durs, reculer de plus en plus, mais s’efforcer de réfléchir coûte que coûte à la position des pièces ; tout au plus, se plaindre de temps à autre de l’injustice de l’adversaire, et l’inviter à revenir à l’échiquier et à respecter les règles du jeu : voilà le bilan politique du discours réformiste durant sa vie, sa longue agonie comprise. Il est peut-être intéressant de voir qu’aujourd’hui, un thème répandu des dessins sur les sites (il n’y a plus de journaux indépendant, ni même semi-indépendants) est celui d’un journaliste, peut-être l’un de nos dessinateurs de la scène du jeu, pendu ou poignardé par sa propre plume. Telle est la situation politique de l’Iran d’aujourd’hui.
L’extrême non-violence
Quand plus de vingt millions d’Iraniens, c’est-à-dire 70% de votes, qui avaient élu Khâtami (le 23 mai 1997), et, deux ans plus tard, avaient envoyé ses camarades réformistes d’une majorité encore plus significative à l’Assemblée, demandaient aux réformistes de prendre l’initiative, ceux-ci présentaient toujours la même excuse : les conservateurs avaient accaparé tous les moyens, du reste non-démocratiques, d’exercice du pouvoir, de telle sorte qu’eux, bien qu’élus légitimes du peuple, n’en possédaient aucun. Et, tant que leur mandat n’était pas reconnu par l’adversaire comme un pouvoir effectif, ils se trouvaient impuissants pour entreprendre des réformes, impuissants, entendons-le, pour battre cet adversaire, lui-même, en brèche. En vérité, si tout allait bien, cet adversaire devait reculer devant une force qui, sans sa bonne volonté, n’en constituait aucune. C’est que dans le discours réformiste, le peuple, une fois qu’il a choisi ses représentants dans les urnes, rentre chez lui et laisse à ceux-ci la négociation sur ses droits avec les instances non-démocratiques. La lutte politique démocratique n’est alors rien d’autre que cette négociation. Le peuple politique est celui qui sait s’exprimer sagement par les votes. Il ne descend jamais directement dans l’arène du combat politique. Une telle intervention équivaut au radicalisme, à l’émeute, au chaos… Bref, à la violence ; surtout là où il s’agit d’un antagoniste autoritaire prompt à recourir aux moyens violents. Voyez-en la preuve, disaient dans leur barbe nos réformistes (qui étaient, pour la plupart, des ex-révolutionnaires repentis), dans les désastres issus de la Révolution en 1979. Ainsi, en envoyant ses pouvoirs chez eux, le réformiste avait tout bonnement la foi en le bon sens d’un monstre tout-puissant. Il est singulièrement frappant de voir qu’après le coup d’État de l’année dernière et le déferlement de la foule dans les rues, et qu’après avoir passé plusieurs mois en cellule d’isolement et subi la torture, A. Ramazânzadeh, l’un des réformistes les plus radicaux, refuse devant le tribunal-spectacle l’accusation d’avoir organisé des manifestations en déclarant qu’il « n’a jamais cru à la présence des gens dans la rue ». Alors que, mieux que personne, il sait que si l’avènement du Mouvement Vert n’avait pas entravé le plan du coup d’État, l’étape suivante aurait été sa propre exécution et celle de dizaines d’autres réformistes.
De leur côté, les Iraniens, il est vrai, abominaient la violence, tant ils en ont été les victimes : celle d’un envahisseur étranger et de la guerre ; ou celle d’un groupe terroriste d’opposition, les Mojahedins, dont la politique durant les années de la guerre, en même temps que la collaboration avec Saddam Hussein, consistait essentiellement à perpétrer des attentats et à tuer les civils, et à propos desquels, aujourd’hui encore, nul ne peut s’assurer qu’ils ne reprendront pas cette politique dès que l’occasion se présentera ; ou surtout d’un État qui, par exemple, au nom de la défense contre la menace de ces Mojahedins, a clandestinement massacré dans ses prisons des milliers de dissidents, majoritairement gauchistes, en 1988 et cela, en l’espace de quelques nuits. On comprendra donc que si le sens théorique de la devise réformiste, la tolérance, s’annonçait en tant qu’« être tolérant même à l’égard de son ennemi », son sens pratique ne suggérait rien d’autre que ceci : « ne pas provoquer l’ennemi intolérant ». Ainsi, le message de non-violence résonnait pendant l’ère réformiste, pour son émetteur autant que pour son public, comme la peur de la violence. C’est précisément cette peur qui amènera le réformiste jusqu’à devenir l’exécuteur de la conjuration de son ennemi contre lui-même. En 2004, le Conseil des gardiens de la constitution révoque le droit de candidature de la quasi-totalité des députés réformistes pour la nouvelle élection législative. L’Assemblée, rappelons-le, bien qu’impuissante devant l’intervention directe du Guide ou ses machinations indirectes par le Conseil des gardiens, était la dernière barricade entre les mains des réformistes pour seconder le gouvernement de Khâtami. Ceux-ci décident du coup de tous démissionner et de faire grève dans les locaux de l’Assemblée. Cela constitue du reste l’acte le plus radical de l’Assemblée réformiste pendant ses quatre ans d’existence. Leur première demande est d’ajourner l’élection par le gouvernement. Seulement, peu de jours après, Khâtami, sous la menace du Guide, annonce que l’élection aura lieu à la date prévue et, avec Karroubi (alors le président de l’Assemblée), demande aux députés de mettre fin à leur grève. Ce sera le coup final que l’État et son Guide porteront à notre réformisme à bout de souffle. Ils le donnent, bien entendu, par la propre main du réformiste.
Coup d’État
comme coup de l’État
Deux jours après sa réélection en juin 2009, Ahmadinejad, ravi de sa victoire, fait un discours devant ses partisans. Il traite de « poussière » les protestataires contre le scrutin. Le lendemain, le 25 khordâd (15 juin), malgré toutes les menaces, environ trois millions de personnes marchent entre les deux grandes places de Téhéran, à savoir la place Enghelâb [Révolution] et la place Âzâdi [Liberté]. Un défilé absolument pacifique, sans même de slogan. Moussavi et Karroubi sont parmi les manifestants, Khâtami y participe aussi. C’est un évènement au sens fort du terme qui annonce le devenir effectif d’un nouveau discours signé désormais « Moussavi ». Ici, la politique n’est plus réductible au négociationnisme et la force des individus ne s’isole pas dans les urnes. Le « peuple » retrouve alors son lieu d’effectivité dans la rue. La non-violence est toujours un « principe », elle ne signifie pas pour autant la peur de la violence. Dès sa première déclaration (le soir de l’élection), Moussavi invite à une protestation non-violente et pacifique, de même qu’il fera du courage le leitmotiv de toutes les autres jusqu’à aujourd’hui (18 déclarations).
Le même 25 khordâd, les Bassijis commencent à ouvrir le feu sur les manifestants. Avant minuit, il y aura déjà plusieurs morts. Quand la radiotélévision nationale se trouve contrainte d’annoncer huit morts, ça veut dire qu’il y en a eu beaucoup plus. Les jours qui suivent, à mesure que la résistance s’étend dans tout le pays et se révèle bien plus profonde qu’une ou deux émeutes passagères, comme l’aurait deviné l’État, celui-ci, terrifié, n’est plus soucieux de son image populiste. Désormais les forces de l’ordre, les gardiens de la Révolution militaires ou en tenue civile tirent en plein jour sur n’importe qui : ce qui importe en effet, c’est la terreur. En réalité, plutôt qu’une insulte, le mot d’Ahmadinejad révélait une politique : ceux qui n’acceptent pas le nouvel ordre seront désormais traités comme de la poussière. La cruauté inimaginable que l’on a vue depuis ne fait que traduire ce mot d’ordre.
Les arrestations ont commencé le soir même de la journée d’élection (le 12 juin), alors même que le vote est encore en cours. Jusqu’à la semaine suivante, le nombre des arrêtés s’élève à 2000, rares sont les membres des deux partis réformistes officiels qui ne soient pas encore en prison. Plus tard, on apprendra que l’ordre judiciaire d’arrestation de plusieurs d’entre eux était signé quatre jours avant l’élection ! Très vite, l’ampleur des arrestations embrasse les activistes politiques, sociaux, féministes, et les journalistes, même ceux qui ne travaillent pas dans le domaine politique. Les arrestations au domicile ont systématiquement lieu entre deux heures et six heures du matin. Où les emmène-t-on ? Personne ne le saura qu’après des jours et parfois des mois de recherche. Parmi les inconnus arrêtés dans les manifestations, il y en a dont la famille n’a pas encore trouvé trace. Dans les prisons, qui peuvent aussi bien être de nombreux bâtiments anonymes des services secrets dans chaque ville que des locaux ministériels, si la torture des personnalités connues vise plutôt à les obliger à assister aux « séances d’aveu public » et, par conséquent, est d’une visée plutôt psychologique, la torture des autres, moins connues, cherche à établir la terreur et en ce qui concerne les détenus inconnus, son seul objectif véritable consiste dans la destruction définitive de l’individu, ce qui provient purement et simplement de la décharge d’une haine perverse et, pour reprendre la terminologie d’Étienne Balibar, d’une cruauté ultra-subjective[1]. Et cela va jusqu’au viol massif des détenus, à leur meurtre sous la torture et à leur enterrement, nuitamment, dans des tombes anonymes. En juillet, on apprend l’existence, par de très rares rescapés, d’un camp de concentration, Kahrizak, où les manifestants arrêtés sont privés même des conditions de la vie animale. Les gens l’appellent l’Abou Ghraib de l’Iran. Quand commence à circuler la nouvelle du meurtre de plusieurs détenus dans ce camp, Khâmenei est enfin obligé d’ordonner son évacuation immédiate (le 27 juillet). À ceci près que, comme d’habitude, l’ordre du Guide doit se comprendre de deux manières, l’une exotérique et l’autre ésotérique ! Chez le peuple, il est censé redresser son image de Saint juste. Chez ses hommes, l’ordre somme d’effacer toute trace de crimes le plus vite possible. Ainsi, le jeune médecin du camp, qui y faisait son service militaire, est mort le 10 novembre d’une mort subite.
C’est devenu un principe dans l’exercice de la violence de l’État de procéder par l’entremise de plusieurs organes en apparence disparates et, pour leurs victimes surtout, difficilement identifiables[2] : Bassij, plus d’un service secret, les Gardiens de la Révolution, le Ministère de l’information, les forces de l’ordre, la police judiciaire, ce sont tous les bras de force d’un Léviathan étatique, très élaboré, dont la tête est le Guide Khâmenei. C’est sur son ordre que, depuis la victoire des réformistes, ces bras ont proliféré et que l’Organisation des Gardiens de la Révolution, sa propre armée, s’est transformée en un épouvantable monstre économico-militaire. Et c’est cette même Organisation qui a planifié et dirigé le coup d’État de l’année dernière sous le couvert d’une élection présidentielle. Bassij, la partie civile des Gardiens de la Révolution, constitue le bras le plus important de cet État et son effectif dépasse 3000 bataillons. Dans tous les quartiers, les universités, les écoles ou les usines il existe un centre de Bassij, organisation de base populaire dont le zèle des membres, les bassijis, et leur mobilisation polyvalente en ont fait la grande ressource et le point d’appui de l’État. Le mélange d’une idéologie messianique extrémiste, le culte du Guide et l’obéissance aveugle à ses volontés (même si cela s’oppose à l’éthique et la foi religieuses) d’une part, leur statut social et leur rôle de levier étatique de l’autre ont fait des bassijis un phénomène singulier. S’il fallait rechercher un certain parallèle historique, ce serait quelque chose entre les Assassins ismaéliens et les gardes mobiles sous la deuxième république française. Par ailleurs, un État qui vit essentiellement de son image populiste préfère évidemment que ses forces officielles interviennent moins là où il s’agit de la terreur et de la violence publique et exerce celles-ci par le moyen de ses agents non identifiables comme si c’était sa base populaire qui se dressait spontanément contre toute menace et toute opposition. Or, si frapper par une force en apparence civile et par une machine paramilitaire invisible constitue la pièce maîtresse de sa pratique autoritaire, il n’en reste pas moins que pour l’État iranien, le paradigme définissant son rapport à la société est fondamentalement militaire. Autrement dit, Bassij doit être simplement considéré comme une solution tactique au service de la stratégie de la guerre, le nom véritable de la politique de l’État à l’intérieur. Les mots de guerre, de stratégie, de tactique, d’offensive, de défensive, de feuille de route etc. abondent dans le discours politique de l’État, de ses scribes propagandistes et de ses prêcheurs de la prière du vendredi jusqu’aux députés, ministres, dirigeants de tout niveau, mais surtout chez Khâmenei lui-même. Ainsi, hier, le mot-clef du discours de celui-ci, répété, débattu et commenté partout, était l’« attaque nocturne culturelle » ; aujourd’hui, c’est la « guerre douce ». C’est que l’ennemi nous menace, dit la doctrine de l’État, de l’extérieur par la guerre militaire et de l’intérieur par la guerre douce. Or, puisque l’ennemi extérieur est supérieur par sa force militaire, la défensive dont les Gardiens de la Révolution se chargeront consiste à mener une guerre asymétrique. En ce qui concerne la guerre intérieure, s’agissant cette fois-ci d’une force étatique organisée, mais relativement peu nombreuse, face à la force, non organisée, des masses très nombreuses, l’État mène ici une offensive asymétrique. Peu importe si lui-même la baptise franchement dans ses propagandes de « défensive contre la guerre douce ». Peu importe si tout cela pourrait seul relever d’un cas paranoïde (mais la paranoïa n’est-elle pas la caractéristique de tout État totalitaire ?). Ce qui importe, c’est que sous cet angle, on pourra identifier maintenant les persécutions, les attaques au domicile, le vandalisme, la torture, l’attentat, la prise d’otage, le meurtre, bref, l’ensemble des crimes vis-à-vis des dissidents, y compris des membres de leurs familles, ou des citoyens tout court, comme les tactiques d’une guerre (asymétrique, ne l’oublions pas) où toute violence est légitime ; en fait, assez proche de ce qu’on a connu ailleurs sous le nom de guerre sale.
Non-violence dans les limites de la guerre
Devant cette machine nettement belligérante, les partisans du Mouvement Vert ont insisté unanimement sur la non-violence comme principe de leur lutte. L’État, à son tour, n’en a pas moins augmenté sa violence à son point extrême, jusqu’à l’exercer contre les personnes âgées, les femmes et les enfants dans la rue. Et le procureur public d’annoncer que tout manifestant sera considéré d’après la loi islamique comme ennemi et son châtiment sera la mort. Le jour de la cérémonie d’Achoura (le 26 décembre 2009) marque à cet égard un nouveau stade. Pour la première fois, les manifestants pacifistes se trouvant devant la violence déchaînée des forces de l’ordre réagissent. Au lieu de fuir, ils résistent et arrivent à désarmer plusieurs soldats ou bassijis et à saisir quelques blindés (après qu’un d’eux ait écrasé le corps d’une victime) et à les renverser. Ce sera la dernière grande manifestation après plus de six mois de présence dans la rue. Depuis, plus de rassemblement quotidien des manifestants. D’un côté, certes il y a eu de grands attroupements de toutes les forces de l’État ; mais, de l’autre, il faut tenir compte de la désertion de la rue par les Verts. Tout se passe comme si c’était les Verts eux-mêmes qui avaient eu peur, les premiers, de leur propre capacité, jusque-là négligée, à réagir.
Le discours vert reste à vrai dire assez ambigu sur la question de la violence, question qui constitue pourtant le point névralgique du Mouvement. L’aporie porte sur le fait que d’une part, on opte pour la résistance et invite à la persévérance, ce qui veut dire que, contrairement au discours réformiste, on s’engage dans l’affrontement des forces. D’autre part, on néglige volontiers les conditions réelles de cet affrontement au profit d’un amalgame d’éléments hétérogènes, allant de maximes spirituelles souvent trop abstraites aux tactiques de combat propres à quelque situation concrète. Se réclamer d’une lecture pacifiste de la religion ou de la tradition mystique, comme le font souvent les partisans d’une religion modernisée, c’est oublier que tout affrontement, et la lutte politique en particulier, va à l’encontre d’une doctrine qui privilégie la paix divine et absolue car si la boue et le sang caractérisent les formes extrêmes de la violence, celle-ci, sous une forme ou sous une autre, n’en est pas moins en jeu dès qu’il s’agit d’imposer une action quelconque à quelqu’un contre son gré. En d’autres termes, on oublie ainsi la distinction, primordiale dans le domaine politique, qu’établie Weber entre l’éthique absolue et l’éthique de responsabilité. Encore que, paradoxalement, cette tendance au spiritualisme pacifique tellement en vogue dénature l’islam, surtout dans sa lecture chiite, qui, qu’on le veuille ou non, ne manque pas d’intervenir dans les affaires d’ici-bas et comporte un aspect politique. À ce propos, il est significatif que la première fois où les masses ont décidé de réagir ait été le jour d’Achoura, anniversaire du martyre du troisième Imam chiite révolté contre l’injustice d’un État.
De son côté, Moussavi, s’il donne tant de poids à la non-violence c’est parce qu’il la considère comme le « noyau rationnel » de la lutte (dix-huitième déclaration), auquel cas il s’agira moins d’une maxime ou d’une sentence morale que d’une tactique de lutte. Autant dire que ce qui compte désormais c’est l’avantage et l’inconvénient de la non-violence par rapport aux conditions réelles où se déroule la lutte des Verts. Dès lors, le modèle de Gandhi que l’on psalmodie invariablement aux Iraniens commence à perdre son autorité universelle. Les tenants Verts de ce modèle qui lui assignent une supériorité historique et veulent y reconnaître l’indice de civilité, non seulement souffrent d’un malentendu sur ce que par exemple entendait Gandhi par Satyâgraha (la résistance active contre la résistance passive) et l’exercice de force qui s’y implique, mais aussi et surtout ils perdent de vue le fait que devant un État qui n’est pas État de Droit et qui, loin de là, ne se contente de moins que d’en finir avec toute « mal-obéissance » par des réactions cruelles, l’effort pour tourner ses lois contre lui en ayant recours à la désobéissance civile est simplement absurde. Il faut voir l’embarras qu’ont eu, par exemple, Gandhi et ses camarades pour réagir contre la Loi Rowlatt alors que le projet de cette loi restrictive de la liberté n’était pas encore sanctionné en tant qu’une loi. Au fond, la politique de non-violence de Gandhi est appropriée à une lutte où l’exercice de force de l’adversaire, même dans les cas extrêmes, doit passer par les « formalités légales »[3]. Alors que, dans le cas qui nous préoccupe, désobéir afin de se faire emprisonner et défier de la sorte le système juridique, tactique privilégiée dans le combat de Gandhi, ce ne sera que se rendre naïvement entre les mains d’un État sans lui faire la plupart du temps de grande difficulté, État dont la violence symbolique, au moyen d’un système sophistiqué de propagande, de démagogie et de mensonge qui s’étaye par les méthodes médiatiques modernes, est aussi illimitée et extrême que sa violence matérielle. Soyons clair. Il ne s’agit pas de préférer les crimes d’un empire de colonisateurs éclairés à ceux d’un « totalitarisme autochtone », en l’occurrence d’une idéologie religieuse. Il s’agit simplement de voir que la lutte pour l’émancipation contre un État se servant de la politique en tant que « continuation de la guerre par d’autres moyens » est forcément différente de la lutte d’émancipation à mener contre un autre État pour qui la politique consiste dans l’usage inconditionné des moyens de guerre, eux-mêmes, à l’intérieur de son territoire.
Depuis le jour d’Achoura, les manifestants ont beau déserter la rue, les forces de l’ordre et les bassijis continuent d’y être présents se servant de toute occasion pour exercer la violence. À tour de rôle, les uns arrêtent un jour violemment les femmes parce que « mal voilées », les autres matraquent le lendemain les jeunes garçons pour leurs tenues « incorrectes » ou encore ils attaquent les domiciles des chefs de l’opposition et des ayatollahs critiques de Khâmenei. Or, la moindre raison d’État exigerait d’éviter la provocation des masses qui ont encore très présent en mémoire les évènements d’il y a moins d’un an. À y regarder de plus près, on s’aperçoit que ce qui est en cause c’est l’hypothèse selon laquelle l’État, une fois qu’il aura donné son coup de force, rétablira tôt ou tard l’état normal. Or, il semble que le courage du peuple pour descendre dans la rue et sa résistance devant la violence est justement ce qui ne permettra pas à l’État de sortir désormais de la situation d’exception que lui-même avait compté établir de manière provisoire. Autrement dit, ayant perdu son autorité une fois pour toutes, l’État ne peut qu’essayer de la compenser par un recours constant à la violence. Mais en vain, puisqu’il est déjà dans un cercle vicieux où plus il fait appel à la violence, plus il perd de son autorité et vice versa. Cela veut-il dire qu’il faut attendre le jour où, de par son érosion progressive, cette machine finira par s’effondrer ? Rien ne garantit que ce cercle ne se reproduise à l’infini. Ce qui est, par ailleurs, inadmissible, c’est qu’une telle attente consent passivement à la prolongation de la violence extrême qui est de plus en plus la condition de survie de cet État. En revanche, ce que le constat précédent veut dire, me semble-t-il, c’est que reconnaître la guerre qui fait rage sous la paix est notre première responsabilité. Car, après tout, ne pas laisser à l’ennemi nous entrainer dans son abîme de violence est une chose ; c’en est une autre de confondre la guerre avec la paix. Orwell l’a bien vu : inculquer que « la guerre c’est la paix », voilà l’alpha et l’oméga de toute idéologie de domination.