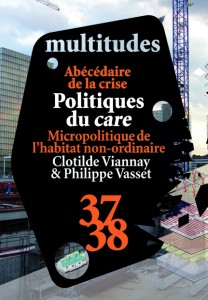De quoi parlons-nous à travers les références actuellement omniprésentes à « la crise » ? Et surtout : de quoi ne parlons-nous pas quand nous parlons de « la crise » ? Multitudes a ouvert ses pages à des auteurs très divers pour esquisser quelques réponses, qui figurent ici sous la forme d’un abécédaire : une suite d’entrées plus ou moins brèves qui visent à prendre « la crise » à rebours. Bien entendu, il ne s’agit pas de composer une encyclopédie, qui fasse le tour de la question, mais de proposer quelques percées, qui dégonflent quelques bulles, et qui creusent quelques trous dans les clichés les plus communs. Ces perspectives à peine esquissées visent autant la ludicité que la lucidité : la misère sociale n’a rien de drôle, mais le misérabilisme qui couvre les yeux de larmes aide rarement à y voir clair. Notre conviction commune est que le triste effondrement en (long) cours réclame un nouveau « gai savoir », pour lequel le jeu et la dérision seront des outils privilégiés d’élucidation.
Cet abécédaire, qui constitue le n° 38 de la revue, viendra strier le n°37, mais il s’insère à l’intérieur des dossiers, pour explorer les interstices que « la crise » permet d’investir. Ce striage dissémine sur une multiplicité de question « en crise » l’attention, la sollicitude et le soin que la majeure care étudie de façon plus approfondie ; il offre un habitat très peu ordinaire à des analyses qui ne se veulent nulle part chez elles, partout déplacées et déplaçantes. Une série d’artistes (en majorité brésiliens) ont proposé des contributions visuelles qui viennent à leur tour traverser l’abécédaire, offrant autant de points de vue sur ce qui se voit (ou ne se voit pas) de la « crise », pour nous inviter à la regarder autrement.
À travers un frottement dialectique d’associations libres, Multitudes se voit investie par une polyphonie qui sied bien à son titre et qui rejette toute territorialisation disciplinaire – mais qui trame des réseaux souterrains, spontanés, imprévus, ceux du geste provocateur, de l’arte povera, de la reconfiguration conceptuelle, du spiritisme, du nec plus ultra, de la vulnérabilité, de la résistance du concret… La « vraie » crise n’est ni financière, ni économique, ni écologique : elle hante le devenir de nos sociétés sur tous les points de failles où de nouvelles forces cherchent à affleurer, sous le poids et les habitudes d’un capitalisme obsolète. Tout autant qu’un effondrement, c’est un surgissement que nous pressentons autour de nous. Ce que cache le plus souvent le discours (misérabiliste) sur « la crise », c’est justement cette émergence de forces nouvelles et de problèmes inédits – à laquelle nos entrées plurielles et hétérogènes tentent de donner des voix (multiples).
Les contributeurs à cet abécédaire ont accepté de jouer le jeu de l’anonymat : ce n’est pas tant telle ou telle personne qu’un peu de notre époque qui se met au jour à travers les poussées dont témoignent la cinquantaine d’entrées réunies ici. On trouvera la liste alphabétique des contributeurs à la fin du dossier, une liste marquée par la diversité des origines, des positionnements, des statuts, des âges, des partis pris, des styles – certains, lecteurs de la revue, d’autres animateurs, d’autres encore qui ne l’ont jamais peut-être ouverte de leur vie – sans qu’il importe vraiment de savoir qui a écrit quoi.
Cet abécédaire ouvre une rubrique Mots qui réapparaîtra régulièrement dans Multitudes, consacrée à des études brèves de ce que les mots en vogue cachent, ainsi que de ce qu’ils révèlent contre leurs usages courants. Que ceux que cet abécédaire pourrait charmer se mettent donc au travail à leur tour : sa vocation n’est pas de faire le point (final) sur « la crise » infinie d’un capitalisme en mutation, mais d’ouvrir un espace de réflexion où leurs contributions seront les bienvenues, pour aider de nouvelles formes de vie à prendre consistance.
Arrogance Savante
Nous vivons de façon concomitante dans une culture de l’arrogance et dans une culture de l’expert. L’expert occidental n’est pas seulement celui qui sait, c’est aussi celui qui méprise celui qui ne sait pas, ou, plus exactement, celui qui ne sait pas comme lui. L’expert n’est pas celui qui se sent mieux parce qu’il sait, mais parce qu’il sait plus (ou mieux) que les autres. C’est aussi celui qui retire un profit matériel, social et institutionnel de son expertise. Le savant du temps jadis était désintéressé jusqu’à la niaiserie et le savant fou de la littérature populaire était précisément celui qui ne vivait que pour prendre le pouvoir. Celui de notre époque se contente d’approvisionner son compte en banque et d’étaler sa notoriété dans une presse en déconfiture. En d’autres termes, l’expert de notre époque a une ambition de parvenu et une conscience professionnelle de pickpocket de foire. La grande crainte de l’expert « international » (of course, in franglais dans le texte) est de se retrouver tout nu, et sa crainte est loin d’être imaginaire comme les récents événements l’ont montré. On a ainsi pu récemment écrire que « les seuls livres qui annoncent clairement la crise n’ont pas été écrits par des économistes professionnels », (Robert Skidelski, Books, avril 2008, p.24). La véracité du propos importe peu ; il suffit de constater qu’aujourd’hui, une telle phrase peut paraître dans une publication sérieuse.
Une autre caractéristique fondamentale de l’expert de notre époque est l’absence totale de sens du ridicule. On imagine la pièce que Molière en aurait tiré. Jean-Marie Messier devrait d’ailleurs recevoir ici une mention spéciale du jury, avec la publication de son livre pour expliquer comment sortir de la crise. Notre Molière du 21e siècle lui ferait sans doute rencontrer Paul-Loup Sulitzer (un précurseur…) – comme dit le proverbe : Asinus asinum fricat. (qu’on pourrait traduire très librement et très éthologiquement pour les jeunes générations qui n’ont pas eu la joie d’être instruit dans la belle langue de Virgile, le poète latin : les gogos aiment s’épouiller entre eux). Une autre caractéristique de l’expert, que révèle lumineusement la crise actuelle, est son incapacité à se remettre en cause. Nassim Taleb rappelle judicieusement que non seulement les experts se trompent, mais que les plus connus ont la fâcheuse tendance à (se) tromper plus que les autres[1] ! Faut-il s’en étonner ? Leibniz écrivait déjà que les hommes agissent contre leurs connaissances en se les cachant à eux-mêmes. Mais la situation est sans doute plus grave et pas seulement épistémique. Walter Benjamin était en effet sans doute plus pertinent quand il écrivait en 1933 que « le cours de l’expérience a chuté »[2]. Son constat est terrible : la complexité du monde croît avec l’appauvrissement de l’expérience qu’on peut réellement en faire et celui des moyens de la communiquer. Cette pauvreté qu’il évoque n’est d’ailleurs pas seulement celle des expériences privées mais également celle des « expériences de l’humanité tout entière ». L’expert joue sur l’expérience étriquée de celui auquel il s’adresse et il doit lui-même s’appuyer sur une expérience personnelle ou collective éminemment superficielle. Comment pourrait-il être juste ? Ceci dit, la situation est peut-être pire encore, sans vouloir paniquer le lecteur jusqu’à l’os. Le philosophe Günther Anders, qui fut le premier mari d’Hannah Arendt et qui refusa la chaire que lui proposa plus tard Ernst Bloch, considérait que le problème majeur de l’époque était l’incapacité dans laquelle nous étions d’anticiper ce que nous pouvions désormais faire. Il disait que nous souffrions d’un manque d’imagination épouvantable, et c’était pour lui le pire des maux[3]. Dans son roman étrange Kafka sur le rivage, le romancier japonais Murakami appelle ceux qui sont sans imagination des « hommes vides » à la suite du poète anglais T.S.Eliot qui travailla longtemps dans une banque et savait de quoi il parlait. Le terme est plutôt bien choisi. « Ils bouchent leur vide avec des brins de paille qu’ils ne sentent pas, et ne se rendent pas compte de ce qu’ils font. Et avec leurs mots creux, ils essaient d’imposer leur propre insensibilité aux autres » écrit l’écrivain japonais[4]. Finalement, c’est une assez bonne caractérisation de l’expert de crise : un homme doté d’une expérience infirme, qui manque d’imagination et qui prétend guider les autres avec une insolence ostentatoire. Un être un peu pitoyable donc, et qui devient franchement ridicule devant l’épreuve. On peut en effet s’amuser des défaillances de l’expert. Ce serait une erreur. Ce qui apparaît blâmable chez l’expert, c’est sa suffisance, pas ses insuffisances.
Auto-Réduction
Que se passe-t-il lors du vol d’une marchandise dans un supermarché ? Puisque j’échange cette marchandise contre rien, aucune plus-value n’est réalisée dans cette opération et je ne fais pas fonctionner le système capitaliste. Pire pour le capitaliste, en ne lui payant pas même la somme que lui a coûté la marchandise et sa logistique, je la déduis aussi des différentes plus-values constituant son bénéfice. C’est pourquoi, pour lutter contre’cette déperdition, le capitaliste majore ses prix d’une évaluation des vols réalisés dans son point de vente, il fait payer mon vol à ceux qui payent les marchandises. Indépendamment de toute morale, il y a donc des consommateurs qui protestent contre les vols et les auto-réductions, car ils savent qu’ils les payent en achetant.
Le vol n’est donc pas une pratique révolutionnaire, même si elle est souvent nécessaire, car les capitalistes gèrent ce détournement. Pour leur faire perdre vraiment de l’argent, il vaut mieux s’attaquer directement à leurs valeurs d’usage et certains cambriolent la maison des grands bourgeois. Mais, là encore, n’allons-nous pas dynamiser aussi leurs efforts pour réaliser des plus-values ? Ce qui est en fait véritablement révolutionnaire, ce n’est pas de voler les marchandises, mais bien d’empêcher les capitalistes de réaliser la plus-value.
Si la pratique des auto-réductions dans les supermarchés, répercutée directement dans le prix de vente, n’attaque pas pratiquement le capital, elle reste néanmoins révolutionnaire. Toute l’efficacité est symbolique, ce sur quoi je vais revenir. Les capitalistes ont condamné la plupart des êtres humains à vendre leur force de travail et le chômage resserre encore le contrôle : il semble donc logique de résister à la peur de la misère en transformant le chômage, de le rendre désirable et non plus effrayant. C’est pourquoi il faut demander entre autres que le RMI soit au niveau du SMIC. Mais cela jamais les réformistes ne nous l’accorderons, car la peur est une partie constituante du système de contrôle. Dans son dernier livre, Nourritures Anarchistes, (éd. Hermann), que je conseille à tous ceux qui apprécient le « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle » de Deleuze, René Scherer analyse comment cette nouvelle société de contrôle place l’individu dans sa pince du risque et de la sécurité. Elle n’oppose pas exactement la liberté à la sécurité, mais en déplace répartition et signification. Le risque concernant l’emploi et la réussite sociale, la sécurité pèse, elle, sur toutes les modalités de la vie en enjoignant à chacun formation et préparation selon les normes concurrentielles. La société de contrôle est avant tout d’autocontrôle pour intérioriser la discipline et se faire « l’entrepreneur de soi-même ». Autour de chaque individu, de chaque groupe, s’érige la barrière de sécurisation des incertitudes, celle de l’emploi, au centre, étant la principale. L’incertitude motive une suspicion, un contrôle général. Risque et sécurité, de contradictoire deviennent complémentaires, grâce au contrôle qui en assure l’articulation.
Proposition pour d’autres auto-réductions :
Surveiller et Punir est un livre fondamental pour les politiques révolutionnaires contemporaines parce qu’il met en lumière le rôle véritable des appareils judiciaire et carcéral : contrôler les illégalismes en constituant le corps des délinquants. Dans le domaine des mafias, le capitalisme nous montre donc aussi son visage. Burroughs est un profond penseur du capitalisme, l’héroïne étant pour lui le produit de consommation parfaite, avec le gras dealer et les junkies pauvres, maigres comme des morts de faim. Ce dealer, écrit-il dans l’introduction du Festin Nu, ne vend pas l’héroïne au consommateur, mais vend le consommateur à l’héroïne. La lutte contre les drogues fait en effet partie du contrôle, elle est une façon pour le capitalisme de se développer sur de nouveaux marchés tout en criminalisant une plus grande partie de la population. C’est pourquoi il y a peu d’espoir que même quelque chose d’aussi inoffensive que l’herbe soit légalisée avant la destruction du capitalisme, car le capital a des intérêts énormes à ce qu’elle soit illégale et plus il y a de plus-value, plus le capital règne.
Même en Hollande, la cause anti-capitaliste reste faible, car si le prix de l’herbe y est parfois deux fois moins cher qu’en France (un des pays où cette denrée est la plus cher), les pauvres sont toujours rejetés vers la vraie calamité de l’alcoolisme. Encore et toujours la société de contrôle nous prend dans sa pince : d’un côté elle interdit certaines substances, et de l’autre elle organise le maximum de plus-value avec son trafic. Il n’est donc pas faux de dire que les juges, policiers et soldats qui luttent contre le trafic des drogues en sont en fait ses instruments.
C’est pourquoi la pratique des auto-réductions ne doit pas se limiter au capitalisme légal pour viser aussi son domaine informel. L’avenir des révolutionnaires courageux se tournera vers des cibles illégales, ils voleront aux dealers capitalistes leurs tonnes de hasch et les distribueront gratuitement aux pauvres. Lors des prochaines révolutions, dealers et capitalistes tout court seront dans le même sac. Il faut prendre au sérieux Allen Ginsberg dans ses Journaux Indiens qui fait de la légalisation totale de la ganja une de ses premières lois pour sortir l’humanité du marasme. Comme dit Deleuze, mieux vaut être balayeur que juge, et la ganja est une aide aux balayeurs. La génération 68 a fait de l’herbe un de ses plus grands symboles, et cette génération est dans les cinquante dernières années celle qui s’est révoltée le plus efficacement contre le capital.
Baltic Dry Index
L’un des indices considérés par les économistes comme les plus fiables pour prédire les taux de croissance à venir est le Baltic Dry Index, fait pour réjouir les avocats de « l’économie réelle ». Cet indice suit l’évolution des prix du transport maritime en vrac de matières sèches (minerais, céréales, ciment, etc.). En mai 2008, il se montait à 11 793 points ; en décembre de la même année, il était tombé à 663 points. Le plus intéressant, pour les investisseurs en quête d’informations à valeur prédictive, est que sa chute a précédé d’environ trois mois le grand effondrement de la confiance bancaire et des cours boursiers du début de l’automne.
Pour ceux qui tentent de comprendre cette crise permanente de l’économie qui a pour nom « capitalisme », le plus intéressant tient à deux autres choses. D’une part, le Baltic Dry Index nous donne l’impression de toucher enfin du doigt la réalité la plus primaire de l’économie la plus réelle, puisqu’il concerne la matière brute, la matière en vrac, celle qu’on peut toucher, mesurer, peser, empiler sous forme de montagnes de blé, de riz, de charbon, d’acier, de bauxite ou de chaux. Voilà bien le stuff dont s’alimentent nos économies réelles, nos industries, nos maisons, nos estomacs – avant que ne le corrompent, détournent et travestissent le fluff des spéculateurs, des banquiers et autres sophistes de la finance et de l’immatériel. D’autre part, le Baltic Dry Index est l’indice même de la globalité : il mesure le coût du déplacement des montagnes matérielles qui sillonnent en tous sens les océans d’une planète sur laquelle les niveaux des prix tendent d’ores et déjà à s’équilibrer, avec la même fatalité que le niveau des eaux. Si l’essentiel de la production restait interne aux économies nationales, si chacun se contentait de cultiver son jardin, le Baltic Dry Index n’aurait aucune valeur prédictive ; c’est parce que l’essence même de la valeur marchande est d’ores et déjà globalisée que cet indice se trouve érigé en canari de la grande mine capitaliste.
L’effondrement qu’a connu le Baltic Dry Index l’été dernier nous aide à sentir l’une des nouveautés majeures de l’épisode le plus récent (particulièrement spectaculaire) de la crise permanente qui se nomme « capitalisme » : la synchronisation planétaire des chutes de pression qui ont affecté les différentes économies nationales ou régionales. La plupart des « crises » précédentes avaient frappé l’Argentine, le Brésil, la Russie ou l’Extrême-Orient, en laissant les autres parties du monde continuer à faire leur business sans trop de soucis, voire en permettant à certains de tirer profit des malheurs de leurs voisins lointains. Ce dernier épisode, au contraire, a mis tout le monde en phase, au sein d’une paralysie globale de la production presque parfaitement synchronisée. C’est précisément cette paralysie dont rend compte l’effondrement du Baltic Dry Index : d’une semaine à l’autre, sur (presque) toutes les routes maritimes de la planète, (presque) plus personne n’a réservé de cargos pour déplacer les montagnes de réalités dont (presque) plus personne n’a soudainement cru avoir besoin. Mais le choix du Baltic Dry Index comme indicateur privilégié des soubresauts de la croissance capitaliste nous permet de comprendre encore autre chose sur la nature du système qui pilote (sans pilote) nos développements sociétaux : ce qui compte dans ce système, c’est que ça bouge, que ça se déplace, que ça traverse les océans (non sans émettre au passage ses tonnes de gaz à effets de serre). C’est bien ceci que mesure le Baltic : la volonté et la capacité des agents économiques à faire bouger du stuff d’un coin de la planète à l’autre. N’importe quel stuff, pourvu que ça bouge, pourvu que ça circule.
Cet évangile est aussi vieux que le capitalisme marchand qui sillonne déjà les océans de la planète depuis le xvie siècle : Circulez, pour croître et multiplier (le PIB) ! Quant à la nature précise du stuff qui se trouve ainsi déplacé, y’a rien à voir. Le Baltic Dry Index – comme le PIB – mesure une capacité parfaitement vide à déplacer des montagnes de réalités (purement formelles), sans que « la réalité » (substantielle) de ce qui est déplacé ou de l’usage qui va en être fait n’intervienne aucunement dans la mesure indiquée. Que le cargo déplace 100 000 tonnes de riz pour nourrir une population affamée ou 100 000 tonnes de charbon absorbés par une usine électrique inefficace et hautement polluante ne compte pour rien dans les réalités comptables du capitalisme.
Méfions-nous donc du type de réalité à laquelle se réfèrent les avocats de « l’économie réelle » : comme le Baltic Dry Index, elle renvoie souvent à la forme vide d’un stuff qui ne vaut guère mieux que le fluff dénoncé chez les sophistes de la finance et de l’immatériel – sauf que l’apparence de ce stuff (vide de tout contenu réel) donne à ces avocats l’occasion de multiples coups de bluff. Ce qui devrait compter dans nos calculs, ce n’est pas tant que ça bouge, mais que certaines (bonnes) choses arrivent au bon endroit, et que d’autres (moins bonnes) choses restent là d’où elles n’auraient jamais dû sortir. C’est de cela que dépendra notre « réalité » (plus ou moins vivable) de demain – bien davantage que des variations du Baltic Dry Index.
Basket
Pour comprendre les devenirs de l’humanité, le sérieux de la pensée nous propose le plus souvent et à juste titre une métaphysique du visage, du port de tête et de ses supervisions hautaines. C’est là se mettre à la hauteur des noblesses opportunes qui nous mènent à bon port et en revendiquer l’arrogance. Ne prétendons pas à cette éminence. Osons privilégier les pieds sinistres et baisser nos regards, nous abaisser vers le trivial, le vulgaire, l’ignoble de ce qui les couvre, les protège, les arme pour avancer. Pas à pas, au fur et à mesure des chutes, nous apprenons à jouir de notre puissance redressée, bien appuyée sur le sol. Inoubliable cette progression mesurée dans l’érection corporelle de soi. Le pied chaussé pour la marche est l’instrument moteur d’une méta-physique. Imposer à sa démarche des obligations motrices et des schèmes porteurs, c’est la diriger.
Quel est aujourd’hui l’élément clef de la méta-physique des pieds ? La basket. L’homo democraticus est homo basketicus ! La basket est le principe de base et chacun la porte. Le peuple a trouvé chaussure à son pied. La basketisation incarne la métaphysique porteuse de l’humanité contemporaine. Baissons donc la tête sans avoir honte et constatons la colonisation des pieds par la basket sportive. Elle est portée partout et à tout âge, en tout temps et pour tous les goûts, dans tous les genres et pour toutes les fonctions et usages. Des champs de labour au bureau high tech, de la rue menaçante aux boudoirs diorisés, la basket triomphe.
Née vers 1892, issue du sport (le basket-ball) mais utilisée surtout par les non sportifs, elle a conquis tous les milieux, toutes les générations et toutes les latitudes. Son avènement depuis les années 1970 par l’intermédiaire malin des rappeurs du Bronx et le coup de génie publicitaire d’une major de l’équipement sportif, fait l’unanimité. De toutes les couleurs et avec tous les matériaux (la toile, le cuir, le caoutchouc, le nubuck, le feutre, le vinyle, le tweed etc.), elle atteint désormais tous les cœurs de cible selon les techniques de vente les plus sophistiquées. De la grande surface aux séries limitées de collection, la basket gagne du terrain. De basket de détente pour circuler dans la pampa urbaine ou traverser les brousses banlieusardes, elle devient robuste aventurière pour affronter la zone. On négligera la basket commune du jogger pour retenir le nec plus ultra, la basket communicante de course, avec iPod intégré qui affiche vos performances en temps réel, diffuse en direct les conseils de votre coach, instille les encouragements de votre petite amie ou les acclamations d’une foule en pamoison. Sur tous les terrains, la basket se marchande et se vend comme les petits pains se multiplient. La basket a la vertu promotionnelle des gagnants victorieux du match social. Elle est l’élément de base de la grammaire universelle. Comment ne pas croire aux messages d’aisance, d’adresse et de santé qu’elle nous délivre ? Le plus apte toujours les porte. Celui qui les produit et les vend est la puissance tutélaire de l’hégémonie culturelle.
On ajoutera le nomadisme conquérant par l’inévitable sac à dos de la libre mobilité. Pour atteindre la parfaite conformité, le porteur formaté sera estampillé aux signes de la concurrence sociale par les inscriptions publicitaires du consommateur-roi. L’homme basketisé est un homme-sandwich : basket, survêt, market. Personne n’échappe à cette concrète catholisation (de khatolon, universel intégral) qui part d’en bas et atteint les sommets. Instrument de mesure et de contrôle des conformités, la démarche « basket, survêt, market », commencée par les pieds, est sortie du ghetto noir, elle monte de l’inférieur underground au supérieur de l’industrie dominante. La « Converse » en fait foi. La basket connecte toutes les vertus : elle conjugue dynamiquement l’aisance élastique de l’athlète, la désinvolture chaloupée du danseur hip hop, la douceur confortable de la familiarité, la finesse distinctive de l’argenté mais aussi la persévérance du jogger obstiné, l’adaptation sereine du conformiste, la décontraction cool du performant ou l’épaisseur machiste du beauf. La basket est un discriminant des potentiels véhiculés. Dis-moi quelles baskets tu achètes, je te dirai qui tu deviens.
La basket dans la variété de ses catégorisations ciblées symbolise le passage en douce des frontières sociales et politiques sans passeport ni aveu, sans craindre les dénonciations d’identité avec un art consommé de l’esquive, une capacité de s’infiltrer furtivement ni vu ni connu dans tous les espaces : to sneak connote ces significations. Elles qualifient le sneaker de la culture basket. Roi de l’interlope et de l’entourloupe, il se déclare sans foi ni loi, capable de rien et ignorant tout si ce n’est le droit de consommer en étant toujours dans le coup. Loin d’être un sans droit, il revendique le droit d’avoir tous les droits en étant chez lui partout. Du ghetto il ne craint pas de passer à la mafia. Le sneaker est préparé à toutes éventualités, il est prêt à tout. L’homo basketicus n’est pas menacé des vertiges de l’abandon ou des stigmates du bannissement. Au contraire, il publie ostensiblement sa banalité. Le basketisé n’est pas hors ban et dans la marge, il exhibe son inclusion dans un système dont il a intégré toutes les valeurs qui marchent et qui gagnent. Adapté à toutes les situations et prêt à tous les efforts pour être en forme, il sollicite d’être adopté.
Subrepticement en cumulant l’aérien du jump et le campagnard du randonneur, l’élasticité féline du fauve et la solidité endurante du coureur de fond, le sneaker nous informe qu’avec son look il est totalement in et tout à fait cool. Il peut jouer tous les rôles dans le show et se montrer dans le timing de toutes les allures, suivre tous les rythmes toniques et adopter toutes les démarches nécessaires au combat de l’intégration. Postures et impostures, simulations et stimulations, le sneaker connaît tous les registres du parcours gagnant. Candidat à toutes les embauches, le basketisé a le physique de l’emploi.
Dans le marché public des apparitions, la basket est la médiation de toutes les affirmations singulières de soi. C’est ce qu’on appelle, dans le langage des philosophes, un universel en acte. Elle permet à l’humanité de décliner toutes ses démarches performantes sous la métaphore sportive d’une compétition loyale et d’une concurrence non faussée. Parlant le même langage sportif et marchand, la basket permet de se comprendre avec les pieds. Elle fait l’accord métaphysique des corps. L’accessoire discret et confortable du repos décontracté et du loisir tranquille est devenue le principal signe de la valeur reconnue. Qui n’en porte pas se disqualifie. Handicapé moteur, il signe sa débandade. Signe d’appartenance, symbole de dynamisme, la basket est planétaire et elle fait désormais l’objet d’un culte[5]. Comme le dit Mathieu Kassovitz, « les sneakers sont au hip hop ce que le crucifix est aux chrétiens »[6]. L’homme véritablement homme, l’excellent est un sneaker.
Biopolitique
L’indétermination de l’actuelle crise du capitalisme est claire. Dans les différentes lectures politiques, avec toute la gamme de nuances idéologiques qui les caractérisent, il existe un certain consensus sur le fait qu’il n’y a pas de solution donnée pour cette crise. Même ceux qui s’attachent aux vieilles certitudes – avec une philosophie qui résiste aux coups de marteaux, de masses et de pioches – ne sont pas parvenus à proposer la crise comme un moment déterminant d’une révolution socialiste. Dans quel sens une vision biopolique de la crise pourrait constituer une nouveauté?
Il n’y a pas de détermination pour sortir de la crise en dehors de la materialité des luttes. Tout à coup, par derrière le flou des interventions gouvernementales visant à contrôler la crise, surgit avec une certaine netteté le défi d’une politique de la Multitude. Il a été lancé par le mot d’ordre « nous ne paierons pas la crise des patrons » : comment aller au-delà, vers une démocratisation des processus décisionnels ? Comment rendre irréversibles les coups portés à la “main invisible” par les milliers de milliards reversés par les États dans le crédit, les entreprises et la consommation ? C’est-à-dire, comment lier l’interventionnisme étatique à un nouveau et radical cycle démocratique ?
Dans un sens, dire « nous ne paierons pas leur crise » signifie attaquer la soudaine mobilisation d’une infinité de ressources dans le but de guérir le système financier alors qu’elles étaient, auparavant, insuffisantes et non disponibles pour l’avancée des politiques sociales. Dans un autre, cette vision doit se déployer dans une double perspective : vers une redéfinition du concept de coût social vis-à-vis de celui d’« investissement » et, en même temps, vers une démocratisation de la formulation et de la gestion de ces stratégies.
Au Brésil, champion mondial de l’inégalité, l’installation d’un système public de santé de portée universelle est un succès des luttes des années 80 pour la « re-démocratisation » (sortie du régime militaire autoritaire). Sous l’attaque des politiques néolibérales des années 90, l’assainissement de la précarité du financement de ce système fut combattu mais, au début des anées 2000, la liaison de ce financement à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) ressemblait à une victoire des mouvements et à un affermissement du système unique de santé.
Les effets de la crise troublent alors évidemment cette dynamique. La rétraction modérée du PIB brésilien à partir de la fin 2008 réduit immodérément les dépenses de santé publique et, par conséquent, les conquêtes importantes du gouvernement Lula en matière de distribution de revenu et de valorisation du salaire minimum. Nous avons ici les éléments d’un nouveau conflit qui vise les critères même du calcul de la richesse, du travail et donc des dynamiques institutionnelles. Le lien des dépenses de santé à la croissance du PIB a entraîné une amélioration, mais aussi une médiation interne à un pacte développementiste qui restreint le développement à un processus d’industrialisation nationale : la santé de la population est perçue, à droite comme à gauche, comme la conséquence d’une croissance industrielle. Or, par delà le trouble des discours technocratiques sur cette dynamique, la crise nous indique que le capitalisme contemporain, cognitif et global, fait de la qualité de vie de la population – sa santé ! – la dynamique même de la croissance
Il faut inverser complètement la perspective: ne plus attacher la santé à la croissance du PIB, mais le PIB à la « croissance » de la santé. La « croissance » de la santé ne tient pas dans les dimensions quantitatives et les critères de valorisation du travail industriel. Il s’agit alors d’un autre PIB, c’est-à-dire d’un processus de valorisation qui n’est plus séparable de ce que Foucault appelle processus de véridiction ou radicalisation démocratique de la biopolitique. L’universalité du système de santé n’est plus le résultat de la coopération contrainte par la discipline de l’usine, mais la base commune d’une coopération sociale qui a lieu indépendamment de la relation salariale. Si les dépenses publiques deviennent investissements dans la production de la population, l’horizon d’une politique de la Multitude se définit dans les conditions d’exercice du gouvernement de la population. La question de la crise et sa solution apparaît alors comme une question de démocratie : l’expansion des programmes sociaux est un terrain concret d’innovation démocratique au sein du gouvernement Lula, malgré sés contradictions « développementistes ».
Bistouille
« La bistouille, c’est tous les objets qui ne servent à rien, les fouillis, les trucs inutiles, le courrier publicitaire, les boites d’allumettes vides, les papiers de chewing-gum et les journaux de la veille. Quand il n’y a personne, la bistouille se reproduit. Tenez, si vous allez vous coucher en laissant de la bistouille traîner chez vous, le lendemain matin, vous en trouvez le double. ça n’arrête pas de croître (…) Personne ne peut gagner contre la bistouille, expliqua-t-il »[7]. L’écrivain américain de science-fiction évoque dans ce court passage trois intuitions lumineuses : la gestion des faux déchets est une caractéristique de notre culture de crise, ils ont une fâcheuse tendance à se multiplier de façon anarchique et l’on est nécessairement et ontologiquement vaincu face à eux.
La bistouille représente la version moderne du destin. Ces déchets ont de surcroît la caractéristique de ne pas être automatiquement repérés comme tels. Un tel avantage les rapproche dangereusement des proies animales faibles dont ils partagent le mimétisme redoutable avec l’environnement en trompant l’intelligence et la perception de leur prédateur le plus redoutable : l’homme. Le statut de la bistouille suscite par conséquent un doute légitime et un trouble métaphysique persistant : comment penser des choses qu’on pourrait jeter, mais qu’on garde, alors que l’époque est plutôt de jeter ceux qu’on devrait garder ? Le paysan d’antan gardait tout (c’était le « Principe de Récupération » qui anticipait d’une certaine manière le « Principe de Précaution ») car il avait peu de choses et beaucoup d’espace, alors que le citoyen moderne a peu d’espace et beaucoup de choses.
Blancs aux yeux bleus
Lors d’une récente visite de Gordon Brown au Brésil, le président Lula a déclaré : « Cette crise a été causée par des comportements irrationnels de blancs aux yeux bleus qui semblaient tout savoir et maintenant démontrent le contraire. (…). Ce n’est pas une question idéologique, mais la constation de faits. En observant les indices de l’économie et du chômage, on se rend compte qu’une fois de plus les premières victimes seront les pauvres du monde, c’est-à-dire ceux qui ne participaient même pas au développement promu par la globalisation. » Gordon Brown est resté bouche bée, les journalistes perplexes et la presse s’est déchaînée contre Lula en l’accusant de racisme… Cela n’a pas marché : 80% des 180 millions de Brésiliens savent que leur président n’est pas raciste.
Lula a décidé de ne pas faire une analyse économique de la crise. Après tout, les médias nationaux et internationaux en ont des paquets à offrir. Et tous savaient que le passage de Brown au Brésil, au sein d’une tournée en Europe, Amérique Latine et États-Unis, juste quelques jours avant la réunion du G20 à Londres, le 2 juin 2009, n’avait pour but que celui de présenter des recettes économiques réchauffées avec une bonne pincée de keynésianisme. Entre autres : interventions du gouvernement pour soutenir les marchés financiers, et politiques fiscales pour relancer la demande interne. Il fallait faire quelque chose pour que cette rencontre ne se transforme, une fois de plus, en vieux conflit d’intérêts entre le « Sud » et le « Nord » (et peu importe comment on veut désigner les vieilles et nouvelles hiérarchisations globales).
Presque cinq siècles après la déglutition de l’évêque Sardine (Bispo Sardinha) par les indiens Caetés, Lula, qui n’est pas British, a dévoré son invité bien élevé et a renversé le politically correct en politique de l’espièglerie. En dénonçant les responsables de la crise, il indiquait en réalité qui doit la payer, et il l’a fait avec le souvenir de ceux qui, pendant de longues années, ont dû se plier aux exigences du FMI et qui maintenant, avec l’autorité des comptes en ordre, disent non à la socialisation des pertes. En plus, Lula ne faisait pas uniquement mention aux yeux bleus de toute la planète, mais aux yeux bleus d’ici qui maintiennent des taux d’intérêt élevés, même dans un cadre d’inflation en baisse.
Lula, qui n’est pas rich, a subverti le discours économique du compagnon Brown en affirmation politique et, de cette manière, il a mis le monde la tête à l’envers. Non, les pauvres du monde ne doivent pas payer la crise des riches. Cette carnavalisation de l’ordre mondial se réalise grâce à l’expansion des relations du gouvernement brésilien avec les pays d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie, aux niveaux économique et politique – tout en passant par l’écologie – et au niveau symbolique en augmentant la présence de ces pays dans les organisations internationales.
En matière de politique interne, il s’agit d’un monstrueux casse-tête qui mélange des actions développementistes (PAC : Programme d’Accélération de la Croissance) avec des choix environnementaux (éthanol propre et bon marché), d’initiatives timides dans le champ de la communication avec la création d’un immense réseau de Points de Culture (qui agencent les micro-expériences les plus diverses du Brésil) de gestion économique traditionnelle avec une distribution inouïe du revenu, qui a fait en sorte que, tout au long de ce gouvernement, la honteuse inégalité brésilienne (pays riche avec une population pauvre) a finalement commencé à reculer.
Pour affronter ces paradoxes, le président Lula a eu recours à l’espièglerie : avec elle, il a dribblé les groupes hégémoniques de la droite la plus réactionnaire à la gauche la plus corporatiste. Son atout : une parole monoglotte (par contraste avec celle de son prédécesseur, Fernando Henrique Cardoso), mais polyphonique (expression des pauvres, par opposition à celle des médias monopolistes). Une voix qui défie la tristesse des « marketeurs » et une gestualité qui dérange la mélancolie des protocoles. Ouvrier avec peu d’études, Lula a investi dans l’université brésilienne comme aucun des « princes » issus de ses rangs ne l’a fait. Les politiques comme le ProUni (pour les universités privées), le ReUni et les quotas pour les noirs, les indiens et les étudiants provenant des écoles publiques, sont les premiers pas de la transformation d’une université élitiste en general intellect. De lui, Obama a dit : « He is my man ! » Depuis les expérimentations latino-américaines, après des siècles de colonisation et des décennies de dictature, jusqu’à l’audace nord-américaine après la catastrophe bushienne, vive le temps des bâtards ! Quelques jours après la rencontre avec Brown, on retrouve Lula, avec son sourire espiègle, assis à gauche de la reine d’Angleterre…
Bulle / Bulbe
Quiconque évoque aujourd’hui dans un éditorial bien informé une « bulle » économique (menaçant d’éclater ou ayant d’ores et déjà explosé), que cette bulle soit financière, immobilière ou autre, se doit généralement de rappeler doctement que la première des bulles connues concernait des bulbes de tulipe, au XVIIe siècle, en Hollande.
On parle de « bulle » lorsque le prix de biens échangés sur un marché, quel qu’il soit, augmente au point qu’il n’a plus de mesure commune avec la valeur dite « intrinsèque » ou fondamentale de ces biens. Il peut s’agir d’actions, comme lors de la crise des années vingt ou de l’affaire des actifs de la compagnie de la Mer du Sud, en 1720 ; il peut s’agir de biens immobiliers, de terrains, comme lors de la petite folie qui s’empara de la Floride, vers 1925 ; d’actifs immobiliers, comme c’est le cas avec la crise dite des subprimes depuis l’année passée ; il peut s’agir de matières premières ou même de marchandises très spécifiques, comme les comics américains, dans les années quatre-vingt, qui furent l’objet d’une intense spéculation.
La métaphore de la bulle, qui gonfle, mais qui se gonfle de vide, avant d’éclater fatalement un jour, s’applique rétroactivement à certaines crises emblématiques, qui deviennent progressivement des lieux communs, des images presque rassurantes, tirées d’un lointain passé, nous assurant de l’éternelle irrationalité des hommes, du fatum de la spéculation, relativisant notre propre sort non sans le teinter d’ironie. C’est ainsi que la première bulle, régulièrement convoquée par les spécialistes, et devenue plus ou moins proverbiale, et a quelque chose d’incongru qui la rend bizarrement rassurante et devrait éclairer notre malheur de la lumière mi-dérisoire mi-amusante de la déconvenue des amateurs hollandais de tulipes en 1637.
La célèbre « Tulipomania » désigne la flambée incroyable du prix des bulbes de tulipe qui affecta le marché néerlandais en 1636. Cette fleur, introduite un siècle plus tôt par un botaniste qui en avait commandé des exemplaires de toutes sortes à l’ambassadeur de l’Empereur auprès du Sultan de Turquie, devint la coqueluche de la population aisée dans les premières années du XVIIe siècle. Les tulipes extrêmement colorées, marbrées de tons vifs, probablement dus à un virus « mosaïque » lié à l’introduction de la plante sur les terres bataves, elles furent baptisées de noms pompeux et devinrent une marque sociale de luxe, un ornement distinctif des marchands les plus aisés. Les tulipes, qui poussent à partir des graines et des boutons, ne fleurissent guère qu’une semaine, en avril ou en mai, et se trouvent donc représenter un marché d’autant plus limité et précis. L’apparition des boutons secondaires après la semaine de floraison ouvre la saison d’échanges, de ventes possibles des bulbes, de juin à septembre. Le reste de l’année, les acheteurs potentiels devaient se contenter d’un contrat établi devant notaire, établissant par avance la concession d’un bulbe par le vendeur, lorsque la saison serait revenue, à l’acquéreur impatient.
D’après les faibles informations précises dont on dispose réellement, il semblerait que, lors d’une pause relative au sein de la Guerre de Sept ans, une extension de la demande de tulipes au territoire français ait commencé à provoquer une hausse conséquente du prix des bulbes. Un an plus tard, les spéculateurs fleurissent : rendez-vous est donné dans des tavernes, où le prix du bulbe de tulipe marbrée atteint vite des sommets. Évidemment, plus le bulbe est cher, plus des gens aisés sont prêts à payer plus cher encore, en prévoyant que les bulbes en question seront bientôt plus chers que chers… À l’acmé du phénomène, on rapporte qu’un seul bulbe de Semper Augustus (Olivier Bleys a d’ailleurs récemment tiré un roman de cet épisode, sous ce nom) coûtait vingt fois le revenu d’un artisan qualifié. Au même moment, les bulbes de tulipes communes prennent eux aussi une valeur démesurée, échangés virtuellement à Haarlem, alors que sévit une rude épidémie de peste bubonique dans le pays.
On colporte au sujet de cette supposée folie des tulipes quelques anecdotes, souvent issues du livre très populaire (et contesté) du journaliste Charles Mackay, publié en 1841, sur l’irrationalité des foules économiques. Il est par exemple question d’un marin revenu d’un long voyage, confondant par mégarde le bulbe d’une tulipe achetée par un marchand avec un vulgaire oignon, le mangeant, et se retrouvant accusé par le colérique propriétaire du précieux bulbe – le marin échouant finalement en prison pour son mâchonnement de tulipe.
Et… Dans les premiers jours de février 1637, vers le trois du mois très exactement, le cours des tulipes a commencé à s’effondrer, passant – sur un indice calculé par Earl Thompson – de presque deux cent à moins de dix, en mai. Les vendeurs ne séduisent plus d’acheteurs à un prix supérieur à celui proposé, les bulbes ne trouvent soudain plus du tout preneurs et les spéculateurs paniqués demandent l’aide du gouvernement hollandais, tentant de négocier le paiement de taxes compensatoires sur les contrats non honorés. Les tentatives de négociations resteront sans succès et l’effondrement du rêve économique de la tulipe marquera durablement les esprits : pour des raisons religieuses, de nombreux pamphlets, opposés à la spéculation, condamnent la folie qui s’est emparée des amateurs de fleurs hors de prix. Les économistes, qui, comme le remarque Schumpeter, considéraient jusqu’à l’âge classique les crises économiques comme des résidus d’erreurs de jugements, les conséquences indirectes de causes extérieures, liées aux guerres, aux famines, commencent à concevoir des modèles de crise économique, remplacés bientôt par des théories du cycle, dans lesquelles la bulle apparemment irrationnelle gonfle pour des raisons récurrentes, éclate, purge l’économie, et permet au cycle suivant de s’ouvrir, comme une fleur.
Depuis la bulle Internet des années 1995-2001, en passant par la bulle financière asiatique de 1997, par la bulle monétaire d’Argentine, la tulipe est devenue l’emblème de l’irrationalité apparente d’un emballement enveloppé dans une rationalité économique. Car les explications ne manquent pas. Les premières théories populaires parlent de psychologie rudimentaire, évoquant l’anticipation par les acheteurs payant la tulipe plus que son prix d’acheteurs prêts à payer encore plus qu’eux-mêmes, déclenchant ainsi un phénomène d’entraînement. Les spécialistes qui se sont repenchés depuis sur la question préfèrent pour leur part relativiser le phénomène. Anne Golgar explique ainsi dans ses études que la « Tulipomania » est restée circonscrite à un petit ensemble d’artisans et de marchands, ne touchant pas la noblesse, et ne provoquant vraisemblablement la ruine que d’une demi-douzaine de vendeurs, sans qu’on sache même si leurs ennuis de trésorerie sont strictement imputables à la bulle des tulipes, qui n’aurait été que le révélateur de malaises plus profonds dans la société hollandaise apparemment florissante de l’époque. Garber considère pour sa part qu’il n’y a rien d’irrationnel dans la bulle des bulbes bataves, comparant ce phénomène avec la mode soudaine des jacinthes au début du XIXe siècle, retrouvant la même dynamique de montée des prix, de lassitude des consommateurs et de baisse tendancielle par la suite, définissant le marché floral par sa volatilité. Earl Thompson, enfin, a proposé un modèle de compréhension de la crise des tulipes qui passe par la sensibilité du marché économique aux cadres légaux en vigueur. D’après lui, les espoirs, pour les spéculateurs, d’un décret examiné à partir de février 1637 par le Parlement, qui aurait transformé tous les contrats conclus après le 30 novembre 1636 en contrats optionnels, aurait entraîné la formation de la bulle. Auparavant, en effet, les contrats conclus tenaient lieu d’obligation pour les acquéreurs à acheter les bulbes ; le décret aurait permis aux acheteurs, si le prix des fleurs venait à baisser, de renoncer à leur achat et de payer en échange une petite pénalité de 3,5% du prix d’achats. Pour les investisseurs, la perspective d’un tel contrat optionnel avait pour conséquence une flambée automatique des prix. Il devenait forcément très avantageux de spéculer sur les bulbes de tulipe, puisque, pour un contrat initial de cent guilders, l’acheteur empochait, si les prix grimpaient de cinquante guilders, la différence de cinquante guilders et, si les prix stagnaient, pouvait se contenter de payer 3,5 guilders en renonçant à son achat. Cette facilité juridique entraîna une spéculation arrêtée nette par la volonté du Parlement d’abandonner ce décret, début février, en voyant les prix monter en flèche.
Camping-car
Le 29 septembre 1908, le ciné-journal décrit une « auto-cinéma-roulotte » à Goderville. La roulotte automobile devient le support de la diffusion du cinéma dans les campagnes. L’ancêtre du camping-car est donc lié aux foires et à la diffusion de la NTIC du début du xxe siècle, c’est le support logistique de la propagation d’une nouvelle culture de masse. La roulotte automobile fut d’abord utilisée par des forains, qui allaient être bientôt visés par la loi de 1912 et par la répression contre les Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. C’est le mode d’habitat qui les désignait comme étrangers et suspects, hors normes. Cependant si l’habitat non ordinaire a un aspect marginal, décentralisé, il a aussi une dimension réfléchie, il a fait l’objet de recherches et de décisions dans des paradigmes plus larges. Ce qui fait du camping-car un objet de théorie urbaine.
Le premier projet fut celui d’Hector Horeau (un architecte français du xixe), qui pensa des maisons roulantes pour les banlieues. Puis vinrent, les recherches des « désurbanistes » russes (par exemple Anatole Kopp) sur un habitat modulaire et démontable : elles avaient pour contexte d’élaboration le projet de déconstruire les villes héritées du passé et d’accompagner l’émergence d’un nouveau système urbain, fait d’agglomérations nouvelles, dans le processus d’industrialisation et de modernisation révolutionnaire de l’URSS. Dans les années 1940, l’État américain va mettre en forme des pratiques spontanées des hobos, des forains et des pionniers aristocratiques du tourisme pour mettre au point le camping-car et son cousin, le mobil-home. Tous deux font partie de l’effort logistique américain pour réallouer la main d’œuvre aux usines d’armements et mobiliser la force de travail. En Europe, leurs cousins (chalets et baraquements de l’après-guerre, légers, démontables et très solides) sont des éléments de la reconstruction provisoire, indispensables au processus de reconstruction définitive, qu’ils marqueront de leur empreinte et de leurs survivances. Il s’agit donc d’éléments dans un dispositif militaire et économique accompagnant la mutation vers le fordisme généralisé. Puis arrivera la firme Algeco construisant des modules pour loger les travailleurs immigrés algériens, jusqu’à des mosquées en plastique. Evolution qui est l’aboutissement d’un parcours mêlant logement pour immigrés, contrôle social et aménagement du territoire.
Les cités en conteneurs (Londres), dont les cités U (Amsterdam, Le Havre), sont conçues pour être déplacées suivant la requalification des anciennes friches et l’apparition de nouvelles, comme étape dans un renouvellement urbain permanent dans un régime post-fordiste. Elles utilisent la version multimodale du camping-car : le conteneur maritime. Le camping-car lui est officiellement assigné au tourisme de vacances. Ce qui masque d’autres utilisations : on en croise sur les chantiers du bâtiment, mais aussi dans des dispositifs industriels, dans des campings transformés en équipements collectifs pour salariés en déplacement (dont des enseignants et des informaticiens). Enfin, il revient à ses origines en redevenant camion aménagé en module habitable par des travellers de la musique techno ou des artisans nomades. Il y a les versions camouflées, sans fenêtres, qui permettent de séjourner en ville ailleurs que sur les aires prévues à cet effet, et qui concernent en général des salariés en déplacement furtifs.
D’où une question : d’un côté, ce type de logement participe de la « mobilisation infinie » (Sloterdijk), dès le début de la révolution industrielle. Et pourtant, d’un autre côté, surtout peut-être en temps de « crise », il est souvent suspect. Mauvaise conscience des élites ou perspective d’une autre mobilisation anarchique, via la prolifération ? L’usage touristique est toléré, voire soutenu par des équipements collectifs. Derrière le tourisme de vacance s’en profile un autre, créant des réseaux et des lignes de fuite de l’intermittent mobile, faisant resurgir le spectre de l’ouvrier nomade. Du point de vue des dominants, cette mobilisation est dangereuse quand elle débouche sur l’apparition d’une population hors contrôle. D’où cette apparente contradiction entre les traitements des différents usages du camping-car ou de sa mère (la caravane). Contradiction effacée par la définition internationale de la catégorie « touriste » qui recouvre maintenant tous les déplacements au-delà d’une certaine durée. Ce qui ferait du touriste général une des figures de la multitude. Mais ce qui peut aussi poser des problèmes logiques : certains voyageurs qui habitent leurs modules et sont toujours chez eux, où qu’ils soient, sont-ils des touristes ? Ultime question : comment le camping-car passera-t-il l’après-pétrole ? Certains sont déjà équipés de panneaux solaires pour le chauffage et l’éclairage, d’autres circulent au carburant fait maison. Le camping-car reste un champ d’expérimentations, de bricolages et donc de ruses permanentes, il n’a pas dit son dernier mot comme contestation en acte des normes d’habitat et de travail.
Capitalisme spiritiste
À la question Qu’est-ce précisément qui est en crise depuis les derniers mois et les dernières années ?, il ne serait pas forcément « idéaliste », ni « mystique », ni « réactionnaire », de répondre : l’esprit. À côté de ses usages « spiritualistes », le mot « esprit(s) » a en effet longtemps été utilisé par les « matérialistes » dans le cadre d’investigations d’ordre « scientifique ». La physiologie du xviiie siècle désignait du nom d’esprits animaux ou d’esprits vitaux ce que nous considérons aujourd’hui comme l’influx nerveux qui transmet les informations entre les différentes parties du système nerveux. Les (al)chimistes désignaient comme esprit la quintessence d’un fluide, telle qu’on pouvait l’en extraire par la distillation ou d’autres procédés de purification. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert résume de tels usages en signalant que « ce nom a été employé dans sa signification propre, par les Chimistes comme par les Philosophes & par les Médecins, pour exprimer un corps subtil, délié, invisible, impalpable, une vapeur, un souffle, un être presque immatériel ». Alors que les spiritualistes faisaient de l’Esprit quelque chose qui descend sur l’humanité depuis une source transcendante et divine, les matérialistes revendiquaient le même terme pour en faire quelque chose qui émane de l’organisation des êtres matériels et qui fait circuler de l’information au sein de cette organisation, pour tirer de leur grossièreté originelle quelque chose de subtil, de délié et de presque immatériel.
Après un siècle de tradition marxiste qui a fait du « matérialisme » la pierre de touche de tout sérieux philosophique, et qui a disqualifié toute forme de référence à « l’esprit » sous l’opprobre irrémédiable de l’« idéalisme », il convient peut-être de revendiquer un retour à ce terme, ainsi qu’à une certaine tradition de pensée qui en a entrepris la conceptualisation. À partir de la théorie spinoziste de la Mens, de la sociologie tardienne, de la conception de l’individuation proposée par Gilbert Simondon, de l’image de la pensée esquissée par Gilles Deleuze, du pragmatisme et du relationnisme anglo-saxons, on peut ainsi redéfinir l’esprit – avec Maurizio Lazzarato ou Bernard Stiegler – comme un régime de circulation de flux de désirs et de croyances[8] [8] Voir en particulier Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention. …
suite. Et l’on peut dire que de tels flux de désirs et de croyances constituent la « substance » même (« presque immatérielle ») dont s’alimente le pouvoir.
Il apparaît bien dès lors que ce qui est « en crise » à de multiples niveaux ce sont effectivement des régimes de circulation de flux de désirs et de croyances. Les bourses s’effondrent dès que se tarissent les flux d’espérances qui les animent. Tous les hauts et les bas des derniers mois ont obsessionnellement tourné autour du besoin impératif de restaurer la confiance sur laquelle repose tout le système bancaire, et à travers lui tout le régime de production capitaliste. L’indice de consumer confidence est devenu la pierre d’angle de tout l’édifice consumériste : il faut tout faire pour que les ménages désirent acheter quelque chose qu’on puisse leur vendre et pour qu’ils croient avoir de quoi en débourser le prix. Bien entendu, le rôle central joué par la fiduciarité n’est nullement propre à notre époque : il est aussi vieux que plus anciennes pratiques de prêt (voire que les plus « primitives » formes de foi religieuse). Le rôle des désirs et des croyances ne fait toutefois qu’augmenter au fur et à mesure que les économies « décollent » et « s’envolent » de plus en plus haut au-dessus des seuils de subsistance.
Derrière les crises récentes de la finance, il faut donc reconnaître une crise plus fondamentale de la fiance (crise de confiance, crise de défiance). Comment croire le trader qui nous promet que ça va remonter ? Comment croire l’évaluation des agences spécialisées ? Comment croire les chiffres proposés par un business plan à financer ? Comment croire que la banque ne fera pas faillite demain ? Ces questions financières ne sont, bien entendu, que le sommet de l’iceberg de la fiance, sur lequel repose l’ensemble de nos sociétés de contrôle.
Or, l’une des vérités que nous rappelle la « crise » actuelle, c’est qu’on ne peut pas ne pas croire. Il n’y a pas que les chrétiens fondamentalistes ou les musulmans fanatisés qui s’accrochent à leurs croyances. Nous mettons des milliers de milliards d’euros à soutenir fi(n)ancièrement les nôtres sans toutefois parvenir à y croire vraiment… Dès lors qu’on ne peut pas ne pas croire, la fiance est donc toujours en disponibilité d’être captée (up for grabs). Le capitalisme, comme le fondamentalisme chrétien, musulman ou hindou, comme l’engagement militant, n’est donc qu’une certaine modalité d’« envoûtement », de « sorcellerie » et de « captation d’âme »[9] . La façon la plus adéquate de caractériser le mode d’existence des objets économiques dans l’esprit du capitalisme (PIB, taux de chômage, ratings) est sans doute de les considérer comme ce que Bruno Latour a intitulé des faitiches pour désigner les entités mixtes qui tiennent à la fois du fait et du fétiche[10] . Quelque chose que les humains ont fabriqué, mais qui est doté d’une efficacité propre, qui nous dépasse et en arrive vite à nous fasciner.
La « crise » actuelle est donc moins bancaire, financière ou économique que spirituelle : ce avec quoi Alan Greenspan ou Bernard Madoff ont imprudemment joué, ce sont nos faitiches. Ce qui s’est vu ébranler (mais qui a nécessairement besoin de se reconstituer aussitôt), ce sont nos envoûtements. Plutôt que parler d’« économie de la connaissance » pour tenter de désigner ce qu’il y aurait de central dans les développements en cours, il vaudrait dès lors mieux parler de méconnaissance de l’économie de l’esprit. Si les luttes de pouvoir et les développements du capitalisme se jouent bien aujourd’hui autour de ces questions de flux de désirs et de croyances, d’envoûtement, de faitiches et de fiance, alors il convient peut-être d’infléchir les hypothèses du capitalisme « cognitif » pour les réinscrire au plus près d’un capitalisme spiritiste.
Casseroles (Argentine 2001)
Si le son du tambour a longtemps été celui de la guerre, qui devait allumer au cœur des soldats et des futures recrues la flamme du courage pour aller au-devant de l’ennemi et du danger – un bruit qui cachait si souvent la mort au bout du chemin – quel pourrait être le son de la crise ?
Le premier bruit qui revient à nos oreilles est celui de la ferraille, des casseroles brandies dans les rues, pour les cacerolazos, un des traits du grondement de la révolte lors de la crise économique et politique en Argentine en décembre 2001. C’est ainsi que se produisirent dans cette période les saqueos (mises à sac) les plus importants du pays, la fuite des capitaux vers l’étranger, la perte des économies pour la classe moyenne, sans compter la fermeture des usines. Si le pays a traversé alors une période de grande instabilité, l’un des événements des plus importants est qu’il y a eu de la part des citoyens une remise en question radicale de la classe politique, condensée par le slogan : « que se vayan todos ! » : Qu’ils s’en aillent tous ! La classe politique était alors totalement discréditée : aux yeux du plus grand nombre, il valait mieux laisser vide la place du pouvoir, plutôt que d’accepter de la voir occupée par les professionnels de la gouvernance. Aucune mesure prise, comme par exemple l’état de siège, ne parvint à réduire la profonde rupture entre société civile et sphère institutionnelle. Sept présidents se succédèrent à la tête du pays en l’espace de quelques mois, sans le moindre succès pour restaurer « le calme » et apaiser une révolte qui rejetait l’ensemble des politiciens.
À travers le refus général de la multitude de déléguer sa puissance à la classe politique se manifeste tout à la fois le choix du « non-identique », pour employer un terme d’Adorno, et le geste politique d’une insoumission collective. La Boétie l’avait remarqué avec justesse lorsqu’il signalait que le pouvoir puise sa force dans la soumission des uns au commandement des autres. Dans cette période de « crise », la politique se construit dans le geste des gens surgis dans la rue, qui, à corps et à cris, manifestent leur désespoir et leurs souhaits en cherchant à l’articuler à des expériences et des pratiques. Comme dans la révolte des piqueteros, les occupations d’usines, les manifestations, les escraches étendus à la question économique et sociale, l’autogestion, les assemblées de voisins, l’invention d’une monnaie locale à Buenos Aires, la reprise du troc, la gratuité des spectacles : toutes les possibilités de résistance et d’invention ont été mobilisées pour faire face à un effondrement économique et politique. Ces soulèvements sont ainsi la manière inventive et politique de renverser une situation de fait, un moyen de refuser le fait accompli. Depuis 2001, ceux qui ont participé au mouvement et aux révoltes sociales ont de fait contribué à re-dynamiser la politique, en inventant des formes d’action qui puisent dans la spontanéité, la nouveauté et l’invention. Dans une telle situation, les réponses les plus créatives, voire les plus excentriques ont été proposées dans une quête de dépassement de l’ordre établi et des restrictions imposées. Même s’il n’y a pas eu de changement visible de ce qui fonde l’être ensemble, tout n’a pas été perdu lorsque les classes moyennes ont abandonné l’esprit de révolte et son grondement de casseroles.
L’un des effets à long terme de cette expérience est d’avoir donné à entendre, à l’échelle internationale, combien le modèle néolibéral n’est pas une garantie pour le développement de la société. Cette expérience a ainsi eu des répercussions sur le modèle économique dominant, en dénonçant sa mise en scène fantasmagorique. Bien avant que les USA, puis l’Europe et le reste du monde, ne « découvrent » ses limites à partir de l’été 2008, c’est en Argentine – au son des casseroles – que ce modèle a d’abord mordu la poussière de la manière la plus brutale. Aujourd’hui, au cœur d’une nouvelle crise, on peut espérer que, devant la situation sociale actuelle, les casseroles sortent encore une fois dans la rue – et que le son de cette crise soit bien celui de l’invention, de la rupture des citoyens d’ici et d’ailleurs envers le management politique cynique. Car, hélas, une autre sonorité se déploie assez aisément face à des situations de crise capitaliste – celle des sirènes du populisme et de la haine de l’autre, qui sont loin d’offrir les mêmes perspectives de dépassement.
Condition-Catastrophe
Crise, être « plongé » dans la crise, « sortir » de la crise… Le minimum conceptuel consisterait aujourd’hui à mettre en crise le concept de crise, à décider de ne plus l’employer, ou avec mille précautions ; minimum conceptuel dont les conséquences politiques sont cependant considérables. Véritable signifiant bouche-trou, leurre à fonction distractive, ce terme dit en effet beaucoup moins et beaucoup plus qu’il ne faut, comme dans le cas de la dite « crise financière ».
Il dit trop peu parce qu’il atténue la gravité des événements qu’il est censé décrire : nous ne traversons pas une «crise du capitalisme », cette expression ne fait vraiment plus rire personne, elle peut surtout provoquer la colère de ceux qui se retrouvent sans domicile ou sans emploi. Nous traversons bien plutôt un effondrement annoncé, c’est-à-dire construit, de notre mode de subsistance. De nos manières de vivre et de continuer à vivre. Cet effondrement programmé dépasse largement la question de la sphère financière et engage l’économie tout entière dans ses rapports aux matières premières, aux territoires, aux habitations, aux énergies, à l’eau et à la nourriture, autrement dit à l’écologie globale. L’écologie physique et psychique du Globe, de l’Hydroglobe aux flux interconnectés, à la communication panique, épidermique, virale et virulente. Quand la totalité d’un monde et des manières d’être qui s’y rapportent est sollicitée par des événements susceptibles d’y inscrire une solution de continuité, ce n’est pas de crise qu’il faut parler, mais de « catastrophes ». De catastrophes en cours, non seulement à venir mais d’ores et déjà engagées, réalisées : nous sommes endommagés. Nous expérimentons chaque jour les limites de notre plasticité. Chaque jour nous nous réveillons avec l’espoir que notre seuil de résilience se tiendra encore bien sagement à l’horizon, éternellement inaccessible. Espoir immunologique des crises transitoires.
Pourtant le terme de crise dit aussi plus qu’il ne faut. Il semble dire que quelque chose serait vraiment sur le point de changer, engageant dès lors son sens étymologique (la krisis comme « jugement », « décision »). Or cela fait bientôt un demi-siècle que se met progressivement en place une nouvelle forme de « gouvernementalité », de « rationalité politique » précisément axée sur la question des risques et des crises. Depuis la fin du siècle dernier, cette nouvelle gouvernementalité a désormais intégré la gestion des catastrophes, des phénomènes extrêmes – climatiques, épidémiques, « terroristes », etc. – comme une donnée régulière. L’exceptionnel n’est pas seulement devenu la norme, comme on le répète aujourd’hui de façon somnambulique après Walter Benjamin, car les normes et les exceptions de naguère ont laissé la place à un Dispositif inédit, qui les reconfigure profondément. On peut – ce n’est qu’un nom, une tentative de description par le nom – nommer biopolitique des catastrophes la gouvernementalité qui, bien au-delà de la question « néo-libérale » des risques, fait de la catastrophe le point à partir duquel s’agence l’ordre politique, le nouveau nomos global. Pour exemple, la National Security and Homeland Security Presidential Directive promulguée en mai 2007 aux U.S.A., qui suspendrait le gouvernement constitutionnel en installant des pouvoirs dictatoriaux étendus sous Loi martiale dans le cas d’une « urgence catastrophique » – soit, dit la directive, n’importe quel « incident » pouvant « affecter la population, l’infrastructure, l’environnement, l’économie ou les fonctions gouvernementales des U.S.A. ».
Reste dès lors à relier biopolitique des catastrophes et solution de continuité, installation du nouveau nomos et abolition d’un mode de subsistance. Voici une hypothèse. De nombreux chefs de gouvernements, instances internationales et d’experts déclarés, ainsi d’ailleurs que de nombreux intellectuels dits « progressistes » (le prédicat expliquant sans nul doute beaucoup de choses), ont aujourd’hui clairement accepté l’idée de l’irréparable : changements climatiques, guerres de l’eau à venir, augmentation irrésistible des exils écologiques et économiques, etc. Un nouveau partage et une nouvelle distribution – un nomos donc – sont en cours. Ce sont des programmes d’adaptation aux bouleversements anticipés qui s’installent sous nos yeux. Et c’est dans ce cadre qu’il faut désormais penser la mise en place des lois et des structures dites « anti-terroristes » : leur fonction est d’agencer la surveillance, le contrôle, l’emprisonnement des populations sous condition catastrophique, qu’ils soient de lointains exilés ou des affamés de l’intérieur (ces deux catégories étant superposables et réversibles : dans un monde globalisé, comme sur un ruban de Moebius, tout élément intérieur est en même temps un élément extérieur). La visée du nomos global est de tenter de retrancher des groupes privilégiés du « reste » des populations, de créer des poches d’immunité, une Green Zone comme en Irak.
Pourtant, à la fin, il faudra bien quitter l’Irak, Obama va le faire, et l’on pense d’ores et déjà à quitter la Terre – mais, qu’on se le dise, ce sera nettement plus ardu. Car on sait bien que la biopolitique des catastrophes est condamnée à l’échec, que l’adaptation sera désastreuse, qu’aucune « classe » ne s’en sortira et que les velléités de désobéissance sont désormais monnaie courante, au point de rendre tendanciellement impossible tout contrôle efficace. Mais règne, hélas, l’antinomie du jugement immunologique : d’un côté nous savons que nous faisons complètement partie du monde, de l’Hydroglobe, du Flux Intégral et des comportements mimétiques qu’il génère, nous savons et nous expérimentons également que le transitoire ne concerne pas tant les dites « crises » que ce qui arrive entre les crise ; de ’autre, nous croyons pouvoir nous en excepter, et songeons secrètement : « il ne m’arrivera rien, je suis en sécurité, il ne m’arrivera rien, après le tumulte de la crise tout redeviendra solide ». Sait-on pourtant que le pire qui puisse nous arriver est qu’il ne nous arrive plus rien ? Que c’est cela, être si ce n’est mort, tout du moins inexistant ?
Les gens de Tarnac auront ainsi expérimenté à leurs corps défendant l’un des aspects de ce nouveau nomos ; ils ne seront pas les derniers. Tant que l’on continuera à simplement rabattre les lois anti-terroristes sur des lois répressives, liberticides, policières sans comprendre la nouvelle fonction immuno-territoriale de la police, on restera incapable de les changer. Ce qu’il faut combattre est la Condition Catastrophe : à la fois les origines des désastres économiques et écologiques, leurs inadéquates réponses gouvernementales, et le clivage immunologique qui rapporte inconsciemment les unes aux autres. De fait, c’est la même chose. Les Grenelle de l’Environnement, c’est Tchernobyl. Le capitalisme vert, c’est la famine. Les lois anti-terroristes, c’est la liberté sur les dents. Bien entendu, il est toujours risqué de mettre ainsi en rapport conceptuel des phénomènes qui apparaissent pourtant bien distincts. Quelle confusion, jugera-t-on ! Un tel jugement ne peut raisonnablement être émis que par un hypersomniaque qui aurait raté l’histoire des quatre derniers siècles. Nous sommes les sujets, les récepteurs de ces alliages étranges, de ce nouveau nomos, et nous le propagerons, nous le favoriserons tant que nous n’aurons pas inventé la forme politique de démobilisation capable de défaire la Condition-Catastrophe. Si nous ne l’inventons pas, ce n’est pas une « crise politique » qui se profilera, ni même une vertueuse révolution, qui n’est valable que pour les mondes globalement stables sur leurs bords : plutôt une violente abréaction. Un rejet, symbolique et physique ; un vomissement.
Consommation
Au cours du XXe siècle, la consommation aura connu une croissance marquée par deux âges : le premier fut caractérisé par l’essor du marketing et du design avec pour objectif de rendre séduisant, à l’instar de l’industrie automobile dans les années 20 dont General Motors, des marchandises produites en grande série. Le destinataire transformé en consommateur est au cœur de l’opération par laquelle des objets sont adaptés à des individus et réciproquement des individus à des objets. Au cours du second âge, dans les années 80, confronté à une saturation des marchés, des firmes ont dû procéder au déploiement massif d’artifices esthétiques pour doper la consommation, en investissant massivement le territoire des affects et de la sensibilité, au profit d’un développement des marques. À sa manière, l’entreprise postfordiste concentre sa production de richesses, non plus sur l’usine, reléguée aux confins asiatiques du monde, mais sur les tâches de conception des marchandises et sur la réception de ses publics.
Concernant la consommation, deux options se dessinent à l’horizon : dans un cas, la crise de la consommation, simple parenthèse, s’achèvera aussitôt régulées les convulsions économiques ; hypothèse loin d’être totalement exclue même si des éléments s’y opposent. En outre, un certain reflux de la consommation n’a guère à voir avec les appels à la « déconsommation » et à la « décroissance », lesquels marquent une différence de degré de consommation, absolument pas de nature, dont témoigne d’ailleurs l’abus de néologismes – alterconsommation, consommation équitable, consommation citoyenne, consommacteur, consommauteur. Cette sémantique témoigne de la difficulté à penser d’autres issues qu’une baisse de la consommation, écartant par là même l’idée que le modèle industriel qui la soutenait n’aura été qu’un âge de la civilisation industrielle.
Dans l’autre cas, la crise profite à un canevas où la consommation n’est plus centrale en vertu même de la disqualification des conditions qui avaient assurés sa croissance. En effet, d’une part, historiquement, la consommation aura obligé à traiter les objets d’usage comme des biens destructibles, et à consommer une chaise ou une table aussi vite qu’un vêtement, et un vêtement presque aussi vite que de la nourriture. Ce qui implique « la menace qu’éventuellement aucun objet du monde ne sera à l’abri de la consommation, de l’anéantissement par la consommation »[11] . Si la destruction concerne a priori n’importe quel objet, la consommation programme la destructibilité en tant que source de plus-value. D’autre part, à la différence des pratiques qui prennent corps dans la durée et en vertu d’une maturation de compétences, la consommation tend à isoler des individus (sinon à générer l’individualisme) dont le rôle se réduit à écouler une production pléthorique. Le consommateur n’entre pas dans les produits à partir de son activité, ce sont eux qui sont en lui, comme pliés à son cadre psychique et à ses dispositions pulsionnelles. Les conditions d’une rupture avec ce dispositif séculaire sont-elles désormais rassemblées ?
Avec le développement des technologies et des réseaux, la ligne de partage entre des consommateurs et des producteurs est remise en question. Des individus disposent de moyens d’appréciation, d’évaluation, de conception, de production et de reproduction, sans équivalent dans l’histoire. Et les formes inédites de production, qui émergent à l’intérieur même de la société et non plus exclusivement au sein du périmètre des firmes, déstabilisent les fondements – les droits de propriété industrielle – du capitalisme industriel. Mais la difficulté concerne moins la nature, indiscutablement radicale, de cette transformation que son pouvoir d’abrogation du régime classique de consommation. Il importe par conséquent de déterminer si l’outillage numérique généralisé est à même de se soustraire à une captation marchande traditionnelle.
Exemplairement, la rébellion en février 2009 des usagers du réseau Facebook, eu égard à une appropriation exclusive de données personnelles les concernant, est étroitement solidaire du déclassement des standards économiques. Une activité initialement libre, spontanée et sociale, est de facto en train de constituer une source de valorisation économique. Auparavant, situation loin d’être totalement épuisée, des entreprises développaient des produits en se chargeant de les concevoir à partir de la R&D, du marketing et des études de marché. Ces futures marchandises étaient testées lors de protocoles – des tests à échelle réduite sur des sujets – destinés à reproduire les conditions de jouissance des consommateurs.
73 Or, là où une organisation économique coûteuse, avec des résultats aléatoires, était nécessaire, il est possible de formaliser plus efficacement la commercialisation, grâce à l’indexation des préférences issues des réseaux sociaux. L’opération est réalisable in situ, à plus grande échelle (des millions de « consommateurs » en puissance), à un moindre coût (tous se livrant bénévolement au jeu des préférences) et surtout avec une fiabilité inédite qui tient à une collecte à la fois massive et différenciée de données englobant des différences sexuelles, sociales, esthétiques, religieuses, professionnelles, culturelles, affectives ou amicales.
74 Ce dispositif de valorisation marchande repose sur un effet retard : l’action économique n’a plus qu’à coller et envelopper littéralement une activité sociale offerte en temps réel de manière à ajuster les stratégies de consommation. Qui plus est, au-delà de la captation économique des goûts, les individus sont invités et s’invitent à des opérations de coproduction qui servent les intérêts de firmes qui disposent cette fois de réservoirs de conception et d’imagination dépassant les seules opinions des internautes.
75 Indépendamment des critiques déplorant les intrusions de l’économie et la marchandisation de l’existence privée, ce sont des populations entières, parfois réduites à la plus grande précarité, diplômées ou ingénieuses, qui deviennent avec les réseaux sociaux et les avatars de coproduction les pivots indispensables à l’agencement de la richesse économique. Cela appelle au moins deux remarques : d’une part, le leitmotiv défendant le principe d’un travail, en l’espèce du salariat, supplémentaire pour un gain supplémentaire, se révèle être d’une redoutable vétusté économique ; slogan ironique à l’adresse de ceux que la crise précipite plus rapidement dans les marges d’un modèle économique suranné. D’autre part, tout ceci oblige à repenser fondamentalement la conception et la répartition des richesses en tenant compte de ces populations actives, parfois exclues, qui produisent – parfois sans plus consommer – sans être comptabilisées parmi les actifs des entreprises ni dans la richesse des nations. Signes que les mues de la production ont pour corollaires celles de la consommation.
Crack-capitalism
76 Nous sommes la crise du capital et nous en sommes fiers. Assez de dire que les capitalistes sont responsables de la crise ! Cette seule pensée est non seulement absurde, mais dangereuse. Elle nous constitue en victimes.
77 Le capital désigne une relation de domination. La crise du Capital est une crise de la domination. Les dominants ne sont pas capables de dominer avec efficacité. Et nous descendons dans les rues pour le leur reprocher ! Qu’est-ce que nous exprimons par là, sinon qu’ils devraient nous dominer plus efficacement ?!
78 Il semble plus simple d’admettre que la relation de domination est en crise, parce que les dominants ne se soumettent pas suffisamment. L’inadéquation de notre subordination est la cause même de la crise. Tel est l’argument de Marx dans son analyse de la baisse tendancielle du taux de profit dans le Capital. Il y soutient que, même si le taux d’exploitation demeure constant, le taux de profit est affecté par une baisse tendancielle. Ce phénomène s’accompagne d’un déplacement dans la composition organique du capital, à travers l’importance accrue que revêt la machinisation dans le processus de production. En d’autres termes, la façon la plus efficace dont dispose le capital pour contrer la baisse du taux de profit consiste à accroître le taux d’exploitation, ce qui signifie non seulement l’intensification du travail à l’usine, mais encore la subordination de tous les aspects de la vie à la logique du capital. La reproduction du capital requiert une subordination toujours plus dense de nos vies au capital : un perpétuel tour d’écrou. La baisse tendancielle du taux de profit est une manifestation de l’inadéquation de notre subordination.
79 Dans cette situation, il n’y a vraiment que deux solutions. Nous pouvons nous excuser de notre défaut de subordination et demander davantage de travail : “s’il vous plaît, exploitez-nous davantage et nous travaillerons plus dur, nous soumettrons ainsi tous les aspects de nos vies au capital”. Telle est la logique du travail abstrait, la logique ineffective de la lutte du travail contre le capital. L’alternative réside dans l’abandon de la lutte pour le travail, et dans la déclaration ouverte et conséquente que la lutte contre le capital est inévitablement une lutte contre le travail, contre le travail abstrait qui produit le capital. En ce cas-là, nous ne présentons aucune excuse, mais trouvons au contraire une grande fierté en notre insubordination, en notre refus de plier à la logique qui est littéralement responsable de la destruction rapide de l’humanité. Nous sommes fiers d’incarner la crise du système qui nous achève.
80 La dernière option est, bien sûr, la plus ardue. Au sein du capitalisme, la survie matérielle dépend de notre subordination. Si nous ne faisons pas cela, comment survivrons-nous ? Sans fondement matériel, notre autonomie à l’égard du capital est plus que difficile. Cela semble relever de l’impossibilité logique, mais c’est au demeurant l’impossibilité dans laquelle nous vivons, l’impossibilité avec laquelle nous ne cessons de nous colleter. Tous les jours nous tentons la réconciliation de notre opposition au capital avec la nécessité de survivre. Certains d’entre nous le font d’une manière relativement confortable, en trouvant du travail (dans les universités par exemple), ce qui nous permet de libérer des espaces au sein desquels nous combattons le capital tout en percevant une rémunération. D’autres sont pris dans d’autres enjeux, et se sacrifient pour toute forme d’emploi (par choix ou par nécessité), allouant toute leur énergie aux activités qui vont à l’encontre et au-delà de la logique du capital, survivant tant bien que mal, en squattant ou en occupant du terrain, en le cultivant, ou en vendant des ouvrages anticapitalistes, en créant des structures alternatives de soutien matériel, que sais-je encore ? D’une façon ou d’une autre, mais de façon toujours contradictoire, nous tentons d’ouvrir des brèches dans la domination capitaliste, des espaces ou des moments au sein desquels nous disons au capital “non, ici tu n’as pas prise : ici nous agissons et vivons selon nos décisions propres, selon ce que nous seuls considérons nécessaire ou désirable”. Nous le faisons tous, tout le temps : telle est notre humanité, telle est notre intégrité (ou notre folie). Nous le faisons tous, à chaque instant, mais il n’en reste pas moins que nous nous trouvons à chaque instant au bord de l’échec, à la limite de l’effondrement. Telle est la nature de la lutte : nous courons délibérément contre le flux du capital. Nous ne sommes jamais loin du désespoir, mais tel est le lieu où l’espoir subsiste : voisin de pallier du désespoir. Le monde qui est le nôtre est dénué de réponses : un monde de pérégrination interrogative (asking-we-walk), un monde d’expérimentation.
81 La crise, dont nous sommes fiers, nous met face à ces deux options. Soit nous empruntons l’autoroute de la subordination à la logique du capital, dès lors conscients que cela nous mènera directement à l’autosuppression de notre humanité ; soit nous empruntons le chemin semé d’embuches de l’invention, çà-et-là, au travers des brèches que nous ouvrons dans la domination capitaliste, vers un monde différent.
Debitum / Dette (conjugale)
82 Ce qui mord la poussière depuis l’été 2008, ce serait une certaine économie « irrationnelle » et « insoutenable » reposant magiquement sur ce vide sans substance qu’est la dette. Les subprime mortgages et autres bad loans devraient leur « toxicité » au fait de ne reposer sur rien (que du vent). L’ensemble des ménages (américains, mais bientôt aussi les ménages européens qui leur emboîtent joyeusement le pas) vivraient à crédit, tirant sans vergogne des chèques sans provision, s’abîmant dans une dette qu’ils sont condamnés à espérer sans fond. Il y aurait la nation-phare du capitalisme mondialisé, les USA, qui auraient depuis plusieurs décennies financé sa croissance sur la montagne creuse d’un déficit budgétaire astronomique, autorisé uniquement par un statut d’exception néo-impérialiste. Pour couronner le tout, il y aurait les États eux-mêmes (en Europe et au Japon comme en Amérique du Nord) qui – après avoir imposé une cruelle discipline financière à tous les pays du Sud – vivraient « au-dessus de leurs moyens », accumulant des déficits budgétaires colossaux et irresponsables, qui escomptent honteusement les ressources des générations à venir.
83 L’effondrement actuel serait la conséquence du premier effritement de la mince couche d’apparences qui cache encore, de plus en plus mal, le vide central insubstantiel, immatériel sur lequel (ne) repose (pas) cette énorme économie de la dette. Voilà du moins ce qu’on entend répéter de toutes parts, et qui paraît somme toute fournir une analyse bien raisonnable de ce qui se (dé)fait autour de nous, voire sous nos propres pieds.
84 Face à de tels discours, qui prennent généralement la forme de « rappels à l’ordre », on peut s’appuyer sur les belles réflexions proposées par Nietzsche pour rendre compte de l’effet ordonnateur, disciplineur, civilisateur de la dette, qui opère moins comme un vide que comme un instrument de pression marquant au fer rouge celui qui en reçoit le stigmate et/ou qui en intériorise l’exigence. Il apparaît alors au moins deux choses, qu’a bien mises en lumière Maurizio Lazzarato dans un important petit ouvrage récent. D’une part, la dette se voit individuellement déculpabilisée puisque tout le monde s’y livre (ménages, États, opérateurs financiers) à tout propos (acheter une maison, une voiture, payer pour son éducation, pour sa chirurgie esthétique) ; d’autre part, l’ensemble de ces comportements se voit collectivement culpabilisé au nom de l’insoutenabilité de « déficits » qui, comme par hasard, concernent essentiellement des dépenses publiques d’éducation et d’assurances sociales (santé, retraite, chômage). Malgré les apparences « cette incitation à contracter des crédits et cette obligation de faire des sacrifices pour réduire le « trop » des dépenses sociales ne sont pas contradictoires puisqu’il s’agit d’installer les gouvernés dans un système de « dette infinie » : on n’en a jamais fini avec la dette dans le capitalisme financier, tout simplement parce qu’elle n’est pas remboursable. Cette « dette infinie » n’est pas d’abord un dispositif économique, mais une technique sécuritaire pour réduire l’incertitude du temps et des comportements des gouvernés »[12] [12] Maurizio Lazzarato, Le gouvernement des inégalités. Critique…
suite.
85 Le fait que les plus scandaleuses des dettes dont il a été récemment question ne concernent plus seulement les États et leurs « dépenses » sociales excessives, mais les banques privées et leurs « investissements » exagérément aventureux, ne change pas grand-chose à cette fonction « sécuritaire » de la dette. Les critiques du capitalisme financier reprennent à leur compte le rôle de rappel à l’ordre inhérent à la notion de dette sans toutefois parvenir véritablement à « retourner les tables » de la relation d’endettement : la plupart des banquiers qui signaient hier allègrement des mandats d’éviction continuent à en signer (davantage) aujourd’hui sans se retrouver eux-mêmes à la rue. Tant mieux pour eux : il n’y a jamais à se réjouir de l’éviction de son voisin. Reste que cette dissymétrie qui distingue certains débiteurs échappant à la loi commune de remboursement qu’ils imposent pourtant cruellement à autrui semble jeter un certain froid, qui est lui tout à fait bienvenu, sur la justice immanente des relations contractuelles financières et marchandes.
86 Aussi pertinente que soit cette analyse nietzschéenne de la dette conçue comme un instrument de contrôle et d’assujettissement, appliqué d’une façon éminemment dissymétrique, il serait toutefois possible d’évoquer un autre modèle de la dette, qui pourrait avoir des vertus également quoique différemment éclairantes sur la situation actuelle. Dans le droit canon qui s’est mis en place au moyen âge et qui a prévalu jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, mari et femme se devaient de remplir l’un par rapport à l’autre une dette conjugale (debitum conjugale). Des centaines de pages ont été écrites pour réglementer tous les cas et tous les détails imaginables d’une éventuelle défaillance à payer une telle dette.
87 L’indisponibilité de l’épouse ou l’impuissance du mari devaient être dûment constatées et éprouvées par des témoins, des experts ou des juges, tout en respectant les règles de la pudeur et de la charité chrétienne, ce qui n’allait pas toujours de soi. Les innombrables commentateurs des Quatre Livres de Sentences (1152) de Pierre Lombard se sont ingéniés à tracer une voie précaire entre la condamnation d’une libido sexuelle marquée en nous par le péché originel d’Adam et le droit à trouver dans le mariage de quoi éteindre le feu de la concupiscence[13] [13] On trouve le texte de Pierre Lombard qui concerne ces questions,…
suite. Il fallait éviter à la fois d’imposer la souillure sexuelle à ceux qui auraient eu le rare mérite de vouloir mener une sainte vie d’abstinence, et de condamner l’un des deux époux à devoir recourir à la fornication pour satisfaire des désirs modérés et légitimes. Il fallait donc légiférer afin de déterminer précisément sous quelles conditions (à quelles périodes, combien de fois, jusqu’à quel âge, dans quelles positions, dans quels buts, au nom de quels principes) un époux ou une épouse pouvait être obligé(e) de « rendre » (reddere) à son partenaire le devoir conjugal.
88 Le debitum conjugale qu’ont ainsi conceptualisé des siècles de débats scolastiques présente une structure qui pourrait servir de modèle alternatif à nos conceptions dominantes (marchandes) de la dette. Il a tout d’abord l’intérêt de concerner une dette commune (simultanée et fusionnelle), dans laquelle aucune des deux parties contractantes n’a commencé par donner ce que l’autre serait ensuite chargée de rendre. C’est la formation même du couple qui, de par l’institution du mariage, instaure une dette réciproque, antérieure à toute forme d’échange, conduisant les époux à devoir se rendre l’un à l’autre ce qu’aucun des deux n’a jamais donné. En dépit des jeux de mots grivois que n’ont pas manqué de multiplier les esprits moqueurs qui se sont rués sur ces débats théologiques pour en faire le pain béni de leurs comédies et de leurs fabliaux, la dette conjugale à la particularité de ne pouvoir faire l’objet d’aucun remboursement, puisqu’on y est appelé à « rendre » ce que l’on n’a jamais « déboursé ».
89 En effet, contrairement à notre imaginaire actuel de la dette, le type de « bien » dont fait l’objet cette dette n’est ni une somme d’argent ni un bien matériel (une maison, une voiture), donc rien qui puisse être proprement « rendu », au sens de : restitué à son premier propriétaire. À l’occasion du debitum conjugale, on est appelé à se rendre quelque chose que nul n’a donné et qui ne peut en aucune façon être restitué. La dette porte ici sur ce que les catégories économiques inscriraient au registre des services. Et c’est bien au titre du service d’une dette de services (à satisfaire à échéances régulières) que la scolastique conçoit le devoir conjugal.
90 En outre, dans l’esprit des théologiens chrétiens, cette dette ne fait l’objet d’une obligation que dans le contexte d’un devoir d’assistance : il s’agit d’aider l’autre à ne pas « tomber » (à ne pas chuter dans le péché de fornication). Du point de vue de la vie sexuelle, l’association matrimoniale constitue une cellule d’assistance mutuelle, qui canalise les flux de la concupiscence au sein d’un circuit fermé qui la rend légitime – sinon innocente, puisqu’on précise avec insistance que, même au sein du concubitus conjugal, c’est pécher que de chercher pour elle-même la delectatio, laquelle est presque inévitablement immoderata, là où il ne faut aspirer qu’à réaliser les bona matrimonii[14] [14] On trouve une bonne illustration des problèmes posés par…
suite. C’est donc bien à un « service public », réduit au cadre duel de la microsociété matrimoniale, qu’oblige le debitum conjugale : chacun n’est appelé à payer la dette sexuelle qu’afin de se faire le pompier des incendies qui risquent d’enflammer son partenaire (et qui risquent par là même, à travers les errances auxquelles pourra être réduit celui-ci, de mettre le feu à des foyers voisins).
91 On fera remarquer avec raison qu’un tel debitum conjugale représente un modèle de dette qui n’est ni particulièrement adapté à nos mœurs du début du XXIe siècle, ni véritablement séduisant. Les auteurs de comédies et de fabliaux ont eu raison de s’en moquer jadis, et il serait aussi inquiétant que ridicule de vouloir le réhabiliter aujourd’hui Le rapport sexuel ne se réduit (heureusement) pas pour nous à un service public de lutte contre l’incendie, la delectatio n’est plus un péché et notre économisme semble prendre plus au sérieux l’impératif Croissez et multipliez ! que les théologiens du moyen-âge.
92 Mais ce pourrait justement être dans la mesure même où le concubitus est explicitement devenu pour notre époque l’occasion d’une production de plaisir partagé que le debitum conjugale peut apporter une lumière éclairante sur nos conceptions actuelles de la dette. Ce que le discours moralisateur blâme dans les excès incontrôlés de l’endettement (américain), c’est précisément un hédonisme irresponsable : les uns (consommateurs sans le sou) veulent avoir leur voiture, leur maison et leur écran plat, alors qu’ils n’ont pas de quoi se les payer ; les autres (banquiers sans scrupules) leur font des prêts subprime parce qu’ils ne songent qu’à se remplir les poches pour jouir d’une richesse certes légale mais moralement illégitime et économiquement insoutenable. L’endettement excessif sous lequel le système s’effondre aujourd’hui résulte bien d’une occasion (malheureuse) de production de plaisir partagé. Tous ces inconscients ont voulu jouir trop, et trop vite !
93 Le détour par le debitum conjugale nous aide toutefois à gratter un peu sous les apparences très raisonnables de telles condamnations. En quoi cet hédonisme est-il véritablement irresponsable ? Est-ce dans son désir de jouir, autant et aussi vite que possible ? Ou est-ce plutôt dans les objets de désir et de jouissance sur lesquels il s’est porté ? Est-ce la dette par elle-même qui est néfaste, et dont nous aurions aujourd’hui à payer le prix ? Ou n’est-ce pas plutôt à la fois certains des usages qui ont été faits de l’argent ainsi dépensé et certaines des voies de financement qui ont été mobilisées à cet effet qu’il faudrait incriminer ?
94 Que j’emprunte 30 000 dollars pour pouvoir installer ma famille dans un logement décent, pour y installer des panneaux solaires, pour aider à financer les études de mes enfants ou pour m’acheter un Sport Utility Vehicle de General Motors contribuera de la même façon aux taux d’endettement agités avec un doigt vengeur par les calculateurs d’une économie soudainement et miraculeusement redevenue « morale ». Selon que mon salaire est plus ou moins modeste, on nous accusera plus ou moins violemment d’irresponsabilité financière, moi et le banquier qui m’aura accordé mon prêt.
95 Et pourtant les vraies questions ne sont-elles pas à déplacer sur un autre plan : outre les emplois que j’ai contribué à créer ou à maintenir à travers ces dépenses, la maison que j’ai ainsi pu faire construire, les panneaux solaires que j’y ai installés, les enseignements universitaires qu’ont pu suivre mes enfants ne constituent-ils pas autant d’ajouts à la somme de ressources dont dispose l’humanité pour assurer son bien-être ? Ne faut-il pas se réjouir du fait que, par quelques détours bancaires que les financements aient pu passer, la maison ait été construite, les panneaux installés et les enfants mieux éduqués ? Si quelque chose devait faire l’objet d’une condamnation morale, ne serait-ce pas le choix de celui qui aura utilisé son prêt pour se procurer un SUV, qui va contribuer à augmenter notre dépendance envers l’économie pétrolière, à endommager encore davantage notre environnement et notre climat ? Si tel est bien le cas, pourquoi alors les mêmes voix condamnatrices de l’endettement américain se pressent-elles généralement de prôner le soutien par l’État de l’industrie automobile, le sauvetage de GM ou la relance de « la croissance » ?
96 Ce qu’il y a de véritablement honteux, n’est-ce pas qu’on m’évicte de ma maison ou qu’on me fasse interrompre les études de mes enfants, au nom d’une certaine rationalité économique ou financière (poids de la dette, taux d’endettement) éminemment discutable ? Si les marchés s’affolent, et si les banques refusent de se prêter de l’argent, s’il faut injecter des centaines de milliards pour prévenir un grippage complet de la machine financière, la principale urgence ne devrait-elle pas être de récuser les pseudo-rationalités aberrantes qui dirigent nos investissements vers les sinistres fantômes d’une « croissance » autodestructrice ? Plutôt que d’exiger de faire « rembourser » ceux qui ont eu l’inconscience de débourser sans (trop chercher à) compter, ne serait-il pas plus judicieux de chercher à comprendre qui « prête », « donne » ou « rend » quoi à qui lorsque 30 000 euros changent de mains ?
97 C’est précisément en ce point que le modèle du debitum conjugale redevient pertinent. Pour coincés dans l’entrejambe et « obscurantistes » qu’aient pu être les théologiens médiévaux, ils ont su développer une compréhension de la « communication » et du « bien commun » qui est encore, par bien des égards, en avance sur la plupart de nos efforts actuels dans ce domaine[15] [15] Voir sur ce point l’enquête minutieuse menée par Andrea…
suite. Lorsqu’ils appliquent leurs disputationes à ce qui se passe sous les jupons ou dans les braguettes de leurs contemporains. Ce qui constitue peut-être la façon qu’ont trouvée ces inconscients-là de jouir, ils en dégagent une pensée du commun bien plus adaptée à faire face à la crise financière actuelle que la plupart des recettes de cuisines concoctées par nos économistes orthodoxes.
98 On gagnerait en effet beaucoup à considérer l’endettement qui finance la construction de maisons, l’installation de panneaux solaires ou l’éduction des jeunes et des moins jeunes comme relevant d’une dette commune, dans laquelle aucune des parties contractantes n’a véritable commencé par donner quelque chose que l’autre serait ensuite chargée de rendre. N’est-ce pas toute l’humanité qui bénéficie d’une réduction de nos empreintes carboniques, ou d’une augmentation de notre intelligence collective ? N’est-il pas légitime que ce soit à chacun de la financer un peu, quelle que soit la famille qui en bénéficie plus directement ? Comment (et pourquoi) pourrions-nous « rembourser » le stock d’infrastructure, de connaissances, d’inventions, de savoir-faire, de normes sociales dont nous héritons dès lors que nous sommes humains ? Comme le mariage de la doctrine scolastique, la socialité humaine nous invite à « rendre » à autrui ce que personne ne nous a transmis sous la forme d’un échange. Comme le debitum conjugale, la vie sociale consiste à se rendre des services (bien davantage qu’à se vendre ou se prêter des choses). Comme le debitum conjugale, cette « dette sociale » dont débattaient encore vigoureusement les révolutionnaires de 1793 passe souvent par un devoir d’assistance, qui nous invite à aider l’autre à ne pas tomber dans la misère et la déchéance, ainsi qu’à prévenir les feux (environnementaux) qui menacent la maison du voisin avant de venir ravager la mienne.
99 Contrairement à la façon dont les scolastiques envisageaient le debitum conjugale, nous savons toutefois que la satisfaction de cette dette sociale peut viser à la production de plaisirs partagés sans avoir à craindre la marque d’aucun péché originel. Il n’y de culpabilité à ressentir ni du côté de la dette elle-même, puisqu’être humain c’est être indissociablement débiteur et créancier envers le commun qui permet notre individuation, ni du côté des plaisirs qu’elle contribue à générer. Si la recherche de tels plaisirs mérite effectivement de rencontrer des limites morales ou éthiques, celles-ci ne sauraient se mesurer au simple poids quantitatif d’aucun endettement de ce type, mais seulement à l’usage des ressources communes dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier.
100 Il va de soi que la circulation de biens, de services et de compétences entre humains peut sans doute avoir besoin de modalités d’échanges, de prêts, de ventes, de déboursements et de remboursements ponctuels, pour lesquels des impératifs gestionnaires et comptables ne sont nullement condamnables ni évitables. Ce qu’il importe toutefois de se rappeler, et que de nombreux commentateurs semblent oublier en parlant d’endettement des ménages ou des États, c’est que la réalité sous-jacente à de tels calculs comptables relève de communautés politiques, économiques et environnementales qui inscrivent tous les humains au sein d’un même concubitus planétaire partagé, où nous sommes tous conjoints sans qu’il faille forcément entendre dans ce dernier terme un jeu de mots grivois ou sarcastique.
Déboulé
101 Depuis l’effondrement de Wall Street à l’automne 2008, l’imprévu a jailli par deux fois en des lieux qui semblent compter pour si peu dans les rapports de forces mondiaux. Révolte de la jeunesse grecque en décembre, grève générale en Guadeloupe puis en Martinique en janvier et février derniers.
102 Dans ces petites îles, vestige du domaine colonial français, le taux de chômage est quatre fois plus élevé qu’en métropole. Les prix ont explosé, notamment celui de l’essence. La patience s’est évaporée et 126 revendications ont été avancées, ce qui indique assez clairement la volonté de changer complètement d’existence. Cette grève générale inattendue a pris un caractère d’évidence parce que ses dizaines de milliers d’acteurs, dans leur variété sociale et politique, avaient médité de longue date sur son contenu.
103 Au cœur du mouvement guadeloupéen, l’effervescence libératrice des énergies et aspirations collectives a emprunté de multiples chemins : barrages, débats, piquets de grève, négociations sous surveillance, assemblées et « déboulés ». On pourrait traduire déboulé par grande manifestation. Ce serait affadir son contenu, lui faire perdre de sa charge de colère contre une foule d’injustices et d’humiliations, son contenu artistique et musical, sa charge de bonheur d’être ensemble et d’ouvrir une voie d’espoir pour tout le monde. Le déboulé ne peut pas être traîne-savates ; il est un fleuve rythmé, impétueux qui a envahi les villes à plusieurs reprises. Il faut imaginer l’énergie nécessaire pour quitter l’usine, la plantation, la sucrerie, la rhumerie et autres lieux d’exploitation pour rejoindre sous un soleil de plomb les grands déboulés qui ont outrepassé leurs dimensions antérieures du plus loin qu’on s’en souvienne. Ajoutons que plusieurs déboulés de 2009 ont porté, par la date et le lieu de rassemblements choisis, la mémoire vivante et douloureuse des grèves passées et maintes fois écrasées dans le sang. Le déboulé signifie également : pas d’avenir aux luttes sans mémoire des luttes. Le mouvement des hommes et femmes de Guadeloupe n’a aucunement besoin d’être glorifié et montré en exemple pour « édifier les masses » ou se donner une posture avantageuse. On aura beau répéter : « faisons la grève générale comme en Guadeloupe, créons des comités LKP partout », il n’en résultera rien que des simulacres de stratégie, d’idées et de programmes.
104 Le mouvement guadeloupéen n’est pas à imiter mais à comprendre, car il porte comme tout grand mouvement sa part d’universalité fructueuse. Au demeurant tout « déboulé » exige d’être repensé, comme celui de la population parisienne surgissant à Montmartre en mars 1871 pour garder ses canons, ou encore le « déboulé » de milliers d’ouvrières du textile dans les rues de Pétrograd le 8 mars 1917 qu’aucun parti ou leader n’avait prévu ou programmé.
105 L’histoire continue avec ses chocs, ses redondances, ses régressions et ses innovations. Les déboulés futurs seront peut-être des moments inauguraux d’une nouvelle vie pour les humains, une nouvelle façon de considérer les autres et soi-même.
Diversité
106 Dans les systèmes vivants, la perte de diversité oriente les structures concernées vers un comportement périodique inducteur de pathologies. Notre hypothèse est que cette crise est celle du paradigme néoclassique qui, en refusant la diversité au nom de son utopie, a appauvri le système, engendrant une crise endogène. Or, un paradigme refusant la diversité contient sa propre fin.
107 La pensée néoclassique repose sur un certain nombre d’hypothèses utopiques qu’on peut résumer rapidement. Il y a tout d’abord la neutralité de la répartition sur l’optimum de Pareto : une économie qui ne comporterait qu’un seul milliardaire et des millions de pauvres peut équivaloir, voire dépasser, une économie où les revenus sont répartis de façon égalitaire. Si ce résultat peut surprendre, il n’est que le corollaire de la loi si classique de Jean Baptiste Say : l’offre crée sa propre demande. Dans ce cas, en effet la non-solvabilité d’une partie de la population ne risque pas d’engendrer de problèmes de sur-production. L’hypothèse de neutralité repose aussi sur l’idée que les agents à l’intérieur de l’économie sont les mêmes – tous parfaitement rationnels. Ils poursuivent tous leur intérêt personnel, ce qui ne peut que concorder avec l’intérêt collectif dans la version smithienne, et avec l’équilibre général dont on omet soigneusement qu’il comprenait un commissaire priseur. D’ailleurs dès lors que cet intérêt personnel reste dans les limites du fairplay, il ne saurait s’agir de dole ou de ruse. Pourvus de rationalité et bien légitimement égoïstes, nos agents accèdent au statut de « représentatifs ». Enfin, l’incertitude est probabilisable dans le pire des cas, et transférable dans le meilleur des mondes, aux agents les moins averses aux risques, qui parfaitement rationnels, peuvent l’endosser…d’autant qu’ils sont parfaitement informés.
108 Sous ces hypothèses, condition sine qua non d’une absence de régulation, on aboutit à un équilibre optimal. Bien que d’évidence, ces hypothèses étaient été irréalistes, il a semblé possible de faire « comme si… ». Or, justement, la crise impose un retour au réel: rationalité limitée, opportunisme, asymétries d’information, incertitude : tout cela existe bel et bien – et c’est même cette homogénéisation utopique qui été sélectionnée et entretenue au détriment de la diversité, seule garante d’un équilibre dynamique. L’utopie performatrice libérale est parvenue à démontrer ses incohérences.
109 Cette iniquité assumée, légitimée par une conception bien particulière du comportement des agents, a permis de mener une sélection adverse systématique en faveur des passagers clandestins qui ne rencontreront jamais de contrôleurs et le savent bien. Les mécanismes d’incitations pervers des agences de notations et des financiers, l’absence de contrôle de ces derniers, ont permis de sélectionner un seul type de comportement économique : l’opportunisme couplé au mimétisme rationnel. En effet, pour les agences de notation, copier l’information coûte moins cher que de la produire, ce qui est aussi vrai des traders, qui n’ont qu’à acheter comme leur voisin pour s’assurer les mêmes bénéfices, bien que douteux…
110 Dès lors, l’absence de diversité comportementale devient absence de diversification de portefeuille, et bulle spéculative. Quant aux banques, elles ne sont pas sans ignorer l’incohérence temporelle des politiques de refinancement par les Banques Centrales qui, ex ante, préconisent la prudence et, ex post, renflouent les imprudentes. Elles ont donc tout intérêt à rechercher des bénéfices en oubliant soigneusement qu’il s’agit de primes de risques… Privatisation des bénéfices, et socialisation des pertes : un fantasme de joueur de casino !
111 Pour ce qui est des Etats, à chacun selon ses moyens : dumping social et écologique, paradis fiscaux pour les uns ; protectionnisme unilatéral pour les pays développés, dévaluations et relances solitaires, unilatéralisme du dollar américain. Tout cela renforce provisoirement ces passagers clandestins au détriment de la coopération et de la diversité, ce qui contribue encore à affaiblir le système dans son ensemble.
112 Quelles solutions sont envisageables ? Passons rapidement sur le faux débat entre régulation et relance, qui ne visait qu’à préserver l’orgueil du libéralisme anglo-saxon et de l’austérité franco-allemande, et à provoquer un effet d’annonce sur les marchés financiers. Les promesses de régulation mondiale de la finance (fin des bonus, agences de notation, hedge funds, paradis fiscaux, surveillance des agences de notation et des risques financiers, transparence…), quand bien même elles seraient tenues, pourront limiter certains comportements de passagers clandestins, mais pas tous, et elles n’amélioreront la répartition que marginalement. La relance mondiale limite les asymétries et les comportements de passager clandestins entre pays a priori, mais les sommes sont encore insuffisantes[16] [16] Galbraith montre que Roosevelt a dépensé 2500 milliards…
suite, et là encore, on ne sait que trop peu de leur répartition et de leur usage.
113 La prise en compte de la diversité n’est pas encore d’actualité. Le G20 traite en 2009 d’une crise financière débutée en 2007, avec deux ans de retard[17] [17] Symptomatiquement, le risque sur les taux de change n’a…
suite. Seules les institutions libérales économiques et financières sont supposées réguler la crise, alors même qu’elles ne sont pas exemptes de responsabilités dans la situation actuelle, comme on l’a vu. La dimension sociale quant à elle est totalement occultée.
114 Nous vivons une crise économique et sociale, et bientôt une crise politique. L’Organisation Internationale du Travail et l’Organisation Mondiale de la Santé auraient pu voir accru leur rôle en matière de lutte contre les dumpings sociaux et environnementaux. Plus généralement, la question de la répartition de la richesse et des pouvoirs au sein de la gouvernance mondiale, cause réelle de la crise, n’a pas été abordée. Et l’on ne peut s’attendre à une guérison, si le traitement ne sert qu’à masquer les symptômes.
115 En réponse à cette crise, nous sommes convaincus qu’il faut promulguer la diversité monétaire, économique et politique, afin de rétablir le potentiel de croissance dynamique équilibrée du système.
116 Pour assurer une diversité monétaire, il faut mettre sur la table l’augmentation des Droits de Tirage Spéciaux du FMI sur la base d’un panier de monnaies. Les revendications chinoises et russes vont favoriser une répartition du pouvoir monétaire international plus équitable, donc plus robuste. Comme autres mesures monétaires, on peut penser à abolir l’indépendance des Banques Centrales, à nationaliser au moins partiellement les banques et/ou les chambres de compensation, à développer le microcrédit à des taux décents.
117 La diversité économique exige également une approche nouvelle qui favorise des formes alternatives de développement au travers d’une répartition plus équitable et d’une réorientation des fonds vers les Pays en Voie de Développement et les chômeurs, c’est-à-dire vers ceux dont la propension marginale à consommer est la plus forte. Il convient aussi de favoriser des formes alternatives de production (coopératives, commerce équitable), qui assurent un meilleur respect de l’environnement et des droits du travail. Enfin, il s’agit de favoriser la créativité, de financer l’éducation, la reconversion et la recherche à des fins écologiques.
118 La diversité politique, enfin, doit porter à la fois sur les contenus et sur les décideurs. La politique internationale doit aussi être sociale: assurer le respect des droits du travail dans les Pays en Voie de Développement en soumettant les financements internationaux au respect des accords de Kyoto et à l’approbation du BIT. À l’horizon s’esquisse le besoin d’une répartition plus démocratique des droits de vote dans les organisations internationales.
119 C’est le renoncement ou l’incapacité à prendre de telles mesures qui relèverait de la croyance utopique, selon laquelle un système pourrait se perpétuer sur la base de logiques autodestructrices. La crise en cours démontre que la diversité ne relève pas de l’idéal, mais d’une condition de survie.
Droit au revenu
120 « Quem vê cara não vê coração » (qui regarde le visage ne voit pas le cœur) est un dicton brésilien qui concerne la plupart des analyses de la crise économique.
121 Il faut d’abord affirmer que la crise ne regarde pas uniquement le « monde financier», mais la façon dont le capitalisme a prétendu attribuer la valeur et produire le monde lui-même. Alors que le fordisme cherchait à créer les moyens de la vie sociale, le post-fordisme investit la vie sociale elle-même par un nouveau régime d’accumumation mesuré et contrôlé par la finance. C’est justement la difficulté à mesurer les nombreux flux qui traversent l’activité sociale qui met le capitalisme en situation de crise permanente. Autrement dit, la crise se situe bien dans la valeur, au cœur du capitalisme.
122 En Amérique Latine, le néolibéralisme a ouvert la voie à ce nouveau régime d’accumulation en rompant avec les vieilles forces oligarchiques et néo-esclavagistes par la rapide insertion des pays dans la globalisation, la privatisation générale des services et la création d’un marché censé se confondre avec l’espace social. Mais les vieilles et nouvelles luttes autour de la citoyenneté, contraires aux projets néolibéraux, ont mené, dès les années 1990, à une crise économique et sociale dans le continent qui a permis l’émergence de nouveaux gouvernements et nouvelles politiques constituantes. Au Brésil, malgré les nombreux pactes conservateurs, le gouvernement Lula inaugure une série de mesures qui mobilisent une société productive par la distribution de revenu, l’accès aux services et à la connaissance. Ignorant la vieille idéologie, il s’agit d’un mouvement contraire à l’accumulation post-fordiste qui cherche la valorisation et non pas l’expropriation de la vie et des relations sociales. La Bolsa Família, plus vaste programme de distribution de revenu au monde, concerne aujourd’hui plus de 11 millions de familles dans toutes les municipalités brésiliennes. Il est, en grande mesure, responsable de la plus importante redistribution de revenu de l’histoire du pays avec une réduction annuelle importante du coefficient Gini des inégalités.
123 Pour les économistes, la crise globale fut la grande surprise. Alors que l’élite du pays accusait Lula d’ignorance par rapport aux effets de cette crise et de racisme vis-à-vis des yeux bleus responsables du collapsus, le nombre de pauvres a continué à diminuer considérablement. Malgré la chute du PIB entre octobre 2008 et mars 2009, plus de trois cent mille brésiliens sont sortis du seuil de pauvreté, amenant l’OIT à qualifier le programme d’« anti-cyclique ». La même étude a prouvé que, même sous la crise, la réduction de la pauvreté concerne aussi les chômeurs malgré la diminution de l’offre d’emploi. C’est ainsi que Lula non seulement a evité la réduction du programme mais annoncé son expansion à 1,8 millions de bénéficiaires. Cela signifie qu’en 2010, quelques 50 millions de personnes seront touchées, directement ou indirectement, par la distribution de revenu.
124 Ces quelques données confirment la vocation du droit au revenu à renforcer les réseaux de travail social et metropolitain, bien au-delà de la subordination au rapport salarial et indépendemment de la dynamique de croissance industrielle. L’expérience brésilienne de la Bolsa Família montre que la citoyenneté ne doit pas forcément passer par le commandement du capital ou par la croissance quantitative de l’emploi. Ce qui doit être distribué, ce sont les moyens même de production de richesses et de droits, de façon à rendre possible la mobilisation sociale. Les théories juridiques et économiques ont longtemps insisté sur la séparation entre liberté et égalité. Les droits libéraux étaient les “vrais” droits alors que les droits sociaux restaient subordonnés à la politique économique et à l’accumulation capitaliste. La liberté était subordonnée aux moyens de production et la lutte pour l’égalité bloquée par l’absence de liberté.
125 L’aspect radical de la Bolsa Família et d’autres programmes de même nature, dont le sens est difficilement saisi par le gauchisme latino-américain, se situe dans la mise en cause réelle de la doxa économique et dans les nouvelles opportunités de cette rupture. Distribution de revenu indépendante de la croissance et citoyenneté au-delà du rapport salarial représentent une forte puissance constituante qui inquiète et surprend, de gauche à droite, les « analystes » de l’économie. Ici, la dimension du conflit devient réelle: il s’agit de choisir le destin de la richesse produite par nous tous et des droits que notre existence réclame. En pariant sur la Bolsa Família, Lula suit le dicton populaire pour viser, quoique à distance, le cœur même du régime d’accumulation en crise.
Fabulation
126 AprèsLe silence de Lorna, les frères Dardenne ont dévoilé, lors de la rétrospective Beyond l’enfant qu’il leur a été récemment consacrée au Lincoln Center de New York, les premiers extraits de leur prochain film Fabulation, qui sera présenté à Cannes en 2010. Il s’agit d’un thriller psychologique situé dans le milieu du trading.
127 Pascal (Fabrizio Rongione) et Daniel (Olivier Gourmet) sont deux informaticiens employés pour une mission de longue durée par Electrabel, le principal producteur belge d’électricité. Nourris de lectures anarcho-autonomistes, ils ont la nostalgie des événements de mai 68 qu’ils n’ont pourtant vécus ni l’un ni l’autre. Suite au rachat de l’entreprise belge par le groupe français Suez, ils imaginent un stratagème pour mettre ce géant capitaliste en faillite et ainsi porter un coup majeur au système. En tant que responsables de l’implémentation des algorithmes de calcul de risque pour la filiale de trading énergétique scandinave Scandic Energy d’Electrabel, ils ont réussi à introduire sciemment un bug dans les feuilles de calcul utilisées pour limiter les risques des produits dérivés financiers échangés par les traders. Nicolas (Jérémie Renier), leur supérieur hiérarchique, surpris par leurs lectures subversives, les espionne et finit par découvrir leur machination. Nicolas se rend alors compte que les pertes possibles des portefeuilles détenus par la filiale sont déjà suffisamment élevées pour produire sa faillite et entraîner Electrabel avec elle, mais il se garde pourtant de dénoncer ses subordonnés, car il se sent lui-même responsable, de par sa négligence, de ne jamais avoir vérifié les calculs. Dès lors, il se rassure en s’efforçant de penser que les risques de pertes importantes sont minimes. En attendant, la firme fait des bénéfices considérables et Nicolas, emporté par les excès des traders fêtant leurs réussites, dépense sans compter au point de devoir emprunter à ceux-ci des sommes de plus en plus importantes malgré son salaire confortable. Il mène ainsi, lors de ses virées en Scandinavie, un train de vie qui contraste avec sa vie bien rangée en Belgique auprès de sa femme (Emilie Dequenne) et de ses deux jeunes enfants. De plus, la crise financière survient et le piège des informaticiens se met en marche. Les bénéfices se muent en pertes bien plus importantes, menaçant de mener Electrabel vers la faillite et de mettre le groupe Suez en mauvaise position. Nicolas perd alors pied. Il se rend compte que la faillite d’Electrabel va lui faire perdre son emploi lucratif et, suite à la découverte probable de sa responsabilité, il aura beaucoup de mal à retrouver une situation. De plus, il va devoir rembourser ses dettes rapidement, car les traders seront également dans une mauvaise situation financière. Et surtout, il va devoir expliquer à sa femme comment il a pu en arriver là. Incapable de faire face, il rentre chez lui et tue sa femme et ses enfants avant de se donner lui-même la mort. Le film se termine avec l’annonce de l’intervention des gouvernements belges et français pour renflouer les caisses de la société Electrabel. Cette intervention providentielle empêche que soit découverte la machination des deux informaticiens puisque la crise financière est généralisée et les limites des modèles mathématiques de calcul de risque sont évoquées pour expliquer les pertes colossales.
128 Encore une fois, les Dardenne ont su capter dans leur film le désarroi actuel du monde du travail. Ici, ils mettent à nu les acteurs du travail immatériel et démontent les rouages du capitalisme cognitif en suivant le développement parallèle d’une crise subjective et de la crise financière. Le scénario conjugue les références à l’affaire Coupat (l’ouvrage L’insurrection qui vient du Comité Invisible apparaît plusieurs fois à l’écran) et à l’affaire Romand (déjà adapté au cinéma par Laurent Cantet dans L’emploi du temps en 2001 et par Nicole Garcia dans L’adversaire en 2002, ce dernier basé sur le roman homonyme d’Emmanuel Carrère). Cependant, c’est d’un autre fait divers que s’inspire l’intrigue de Fabulation : le massacre familial d’un cadre d’Electrabel en 2001 dont le récent licenciement ne semblait pourtant pas suffisant pour en expliquer le geste[18] [18] Jean-Philippe de Vogelaere, « Massacre familial: cinq…
suite. Mais loin de vouloir expliquer un fait-divers inquiétant, le film des Dardenne saisit plutôt, comme le suggérait Deleuze, « la possibilité de se donner des intercesseurs, c’est-à-dire de prendre des personnages réels et non fictifs, mais en les mettant eux-mêmes en état de “fictionner”, de “légender”, de “fabuler” »[19] [19] Gilles Deleuze, Cinema 2 : L’Image-Temps, Paris, Éditions…
suite. Et c’est bien au concept deleuzien de fabulation que le titre du film fait référence : « une parole en acte, un acte de parole par lequel le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparerait son affaire privée de la politique, et produit lui-même des énoncés collectifs »[20] [20] Ibid. , p. 289. …
suite. L’évocation de cet épisode n’est donc qu’un prétexte pour y discerner une fable politique et éthique qui dépasse largement le fait-divers en lui-même : le drame de la rupture du lien entre l’homme et le monde[21] [21] Ibid. , p. 220. …
suite.
129 En effet, l’intrigue est tissée d’une multiplicité de crises de la croyance dans le lien entre l’homme et le monde. D’abord, la perte de croyance dans le monde réel des traders qui lui préfèrent une croyance dans les mondes virtuels des marchés et une fuite dans les fêtes permanentes permises par les bonus démentiels[22] [22] John Lanchester, « Cityphilia », London Review of Books,…
suite. La crise financière arrive alors comme la revanche du monde réel sur ces bulles temporaires qui éclatent par défaut de confiance. Pour Nicolas, la perte de croyance dans le monde n’arrive plus à le retenir près de sa famille et le mène inéluctablement vers son crime abominable. Enfin, la perte de croyance dans le monde des informaticiens qui pensent parvenir à mettre le système capitaliste à mal par leur machination au profit d’un autre monde utopique et qui ne pensent pas aux conséquences que leur piège pourrait avoir sur la vie réelle des gens. En imaginant une nouvelle forme de terrorisme d’extrême-gauche qui ne s’attaquerait plus directement aux cibles matérielles ou humaines, mais viserait le cœur du capitalisme cognitif, le film montre l’ambiguïté de ce type d’actions dont les conséquences finissent par se confondre avec les dérives du système lui-même.
130 Un des moment les plus marquants du film est un hommage à « La Passion de Jeanne d’Arc » (1928) de Carl Theodor Dreyer : il s’agit d’une longue séquence pratiquement silencieuse où les gros plans des visages des traders scrutant l’évolution du marché sont illuminés par les nombreux écrans de leurs ordinateurs. En transposant chez les traders les expressions d’état de grâce que Dreyer avait capté chez Jeanne D’arc (interprétée par Renée Falconetti) lors de son procès, les Dardenne mettent en évidence que la supposée rationalité du marché repose en fait sur les comportements irrationnels des traders. Le jeu de la caméra captant le regard quasi-mystique des traders est pourtant contrasté avec des plans des deux informaticiens filmés uniquement de dos face à leur écran. Les cinéastes poursuivent ainsi leur travail autour du concept de visage d’Emmanuel Levinas dont Luc Dardenne nous avait déjà fait part lors de notre entretien après la sortie du Fils[23] [23] Luc Dardenne, « Dans le dos de l’ange de l’histoire »,…
suite : si le visage de l’acteur peut mentir, simuler, et que l’on ne peut plus percevoir dans son regard la trace de Dieu, son corps est ce qui lui reste pour exprimer même involontairement son rapport éthique au monde.
Fallout 3
131 (sortie en France le 30 octobre 2008 sur Xbox, PS3 et PC)
132 Fallout 3 comme ses prédécesseurs est un jeu vidéo qui se déroule dans un univers post-apocalyptique « à la Mad Max » où le monde et l’humanité, après avoir été presque anéantis par une guerre nucléaire, se relèvent peu à peu. Les jeux Fallout sont de type RPG (role playing game, en français : jeux de rôles). Le joueur doit faire évoluer son personnage au fur et à mesure des combats contre des ennemis et des personnages avec lesquels il va interagir.
133 Ce jeu, qui est relativement classique et très grand public comparé à Fallout 1 et 2, est, en 2009, une démonstration d’un syndrome de fin du monde qui touche tous les domaines du divertissement.
134 À la différence de Mad Max et des récits de science-fiction qui, en leurs temps, nous mettaient en garde contre les dérives du monde moderne et de la technologie, Fallout 3 s’inscrit dans une nouvelle lecture des histoires de fin du monde « made in » 2005-2012.
135 L’apocalypse n’est plus une pensée effrayante, mais on s’y est habitué, au point presque de souhaiter qu’elle vienne, de sa main aveugle, bousculer nos vies et changer nos impératifs de manière brutale, radicale et immédiate. L’univers post-apocalyptique de Fallout, lorsqu’on s’y balade, devient un souffle de vie qui s’impose à nous comme une évidence, conclusion possible et souhaitée de notre civilisation hyper-totalisante.
136 Cet univers et ses homologues nous offrent une « nouvelle vie » dont les conditions de réalisation (si cela devait se produire) échappent totalement à notre contrôle et à notre responsabilité individuelle. Le désastre, quelle que soit sa forme, devient alors un « deus ex machina » nous sauvant de nous-même ; car après tout, nous n’avons ni l’envie, ni la force de changer le monde, malgré la conscience aiguë que nous en avons.
137 La crise que traverse notre économie (symptomatique de 2009, mais ne nous leurrons pas : cela fait quinze ans que ça a commencé) peut donc être envisagée comme une prémisse douloureuse à une fin du monde qui s’annonce interminable.
138 Fallout 3 est un jeu de rôle qui n’innove pas particulièrement dans le genre, et pourtant il est investi de cette morne fascination pour la fin de l’humanité à une beaucoup plus grande échelle que ses deux grands frères -préférant rêver notre nouvelle société plutôt que de la dé-construire.
General Motors (syndrome)
139 Emblème du Fordisme, celle qui fut longtemps la première entreprise mondiale avec un quart de million d’employés directs et 2,5 millions d’emplois chez les sous-traitants, a été emportée par la crise financière de 2007-2009. Endettée à hauteur de 27 milliards de dollars par des emprunts sous forme d’obligations souscrites par les investisseurs, lestée de 20 milliards d’engagements dans son système de protection sociale (maladie, retraite, accident du travail) elle ne gagnait plus d’argent que dans sa filiale de crédit GMC. L’argent frais des traites des consommateurs remboursant leur prêt chaque mois était placé sur le marché financier et apportait les profits. Quand le marché financier s’est effondré à la suite de la crise des subprimes, General Motors a plongé et s’est avérée incapable de faire face à ses créanciers, mais aussi à l’avance de trésorerie pour faire tourner ses usines.
140 L’économie matérielle la plus fordiste qui soit, la production de voitures, la plus « matérielle » qui soit, se trouve ainsi la plus liée au profit financier qui est lui-même lié à l’exploitation des externalités positives. Cet enchevêtrement de l’économie financière avec le fordisme résulte d’un double mouvement : d’un côté l’alourdissement des coûts de protection sociale quand cette dernière n’est pas mutualisée dans un système global ; de l’autre la saturation du marché des véhicules particuliers dont le renouvellement constant n’est viable que par l’octroi d’un système de crédit au consommateur. Il n’est donc pas exact de présenter l’industrie automobile comme « saine » et la finance comme l’élément malsain. La vérité est que la finance vient au secours d’une économie déjà à bout de souffle et qui serait en coma dépassé si elle avait à payer en plus de la dette sociale la dette écologique (la pollution qu’elle accumule).
141 L’économie financiarisée constitue simplement l’acharnement thérapeutique sur une économie matérielle moribonde.
142 L’exemple de Carrefour, l’un des géants mondiaux de la distribution alimentaire, montre le même mécanisme. Les marges arrière pourtant léonines que cette entreprise pratique à l’égard des paysans producteurs ou des industriels fournisseurs ne lui permettent pas de faire les 15 % réclamés par les actionnaires. Alors l’argent frais qui est collecté tous les jours aux caisses avant de payer les fournisseurs à 90 jours (délai raccourci récemment à 45 jours, mais peu respecté) est placé sur les marchés financiers avec un rapport juteux. Jusqu’à la crise.
143 Du coup le géant Carrefour titube. Comme les autres, ayant perdu ces marges mirifiques sur l’argent frais placé sur le marché de la finance mondiale, l’entreprise s’est mise à pressurer davantage ses fournisseurs, qui ont répercuté sur les producteurs (de lait par exemple).
144 Ceux qui pensent l’industrie française à l’abri feraient bien de méditer. De te fabula narratur ! Le syndrome General Motors va faire des dégâts dans l’économie matérielle.
145 Revenons à la firme de Détroit. Sa valeur capitalisée en bourse (le prix de l’action au cours du jour, multipliée par le nombre d’actions) est tombée en moins d’un an à 1 dollar à l’automne 2008, pour être cotée quasiment zéro en février 2009. Pendant ce temps, Google caracolait à 100 milliards de dollars !
146 Après de longues négociations, la nouvelle administration américaine de B. Obama a imposé la solution draconienne suivante : mise de l’entreprise sous la protection de la loi de faillite (qui suspend le remboursement des créances), évincement de Wagoner, le pdg, obtention d’un crédit de l’État en échange de 60 % du capital ; le syndicat des ouvriers de l’automobile a obtenu 27 % en échange d’une prise sur sa caisse de la moitié de la dette sociale de GM (soit la bagatelle de 10 milliards de dollars). Les créanciers qui détenaient des obligations en échange des prêts consentis GM pour plus de 30 milliards n’obtiennent qu’un petit 10 % des actions. Et pour finir GM est priée comme Chrysler de préparer d’urgence des modèles propres obéissant à des rejets de carbone sévèrement limités.
147 Au pays de la libre entreprise, de la sacro-sainte propriété privée, la plus grande entreprise du monde est à la fois nationalisée, protégée du démantèlement et de la faillite, les actionnaires comme les créanciers privés sont largement expropriés, les syndicats ouvriers sont introduits dans la cogestion de la dette sociale (en attendant la constitution d’un système de couverture sociale universelle) et l’on assiste à une planification impérative écologique.
148 Les journaux hexagonaux n’ont accordé qu’une attention distraite à ce séisme lourd de conséquences par son montage qui implique directement le syndicat dans la gestion du déficit du système de protection sociale, selon la solution imaginée en 1977 pour sauver New York de la faillite : un certain Bloomberg, devenu le Maire depuis, avait obtenu que le syndicat des employés municipaux place ses fonds dans l’emprunt de renflouement. L’implication du syndicat des ouvriers de l’automobile américain dans la gestion du fonds d’épargne salariale assurant la protection sociale et les retraites va faire de lui, avec l’État Fédéral, un véritable patron des décisions stratégiques en matière d’emploi. L’avenir de la fabrication de voitures implique cette transformation de la gouvernance de l’entreprise. Le syndrome General Motors n’a pas fini de produire des effets.
Krise comme Kenya
149 La France, l’Italie, l’Allemagne, les USA « sombrent dans la crise », entend-on dire de toutes parts. Et l’on ajoute que la crise en question est « mondiale ». Non sans raison, bien sûr. Mais qu’entend-on par ce mot de « crise » et par son caractère « mondial » ? Est-ce bien la même crise qui frappe la France et le Kenya ?
150 Avant la fin 2007, l’économie extérieure du Kenya se portait bien malgré une succession de maigres saisons pluvieuses. En 2007, le secteur du tourisme a connu un boom, avec un record de deux millions de visiteurs. La production de thé et de café a chuté et la part d’apport intérieur a produit en conséquence une flambée des prix internationaux en compensation. Le revenu du secteur de l’horticulture représentait 63% de plus que l’indice de l’année 2006. Les versements de Kényans expatriés ont atteint 573,6 millions de dollars.
151 Puis vinrent les élections présidentielles de décembre 2007, au cours desquelles le gagnant, Mwai Kibaki, a été accusé d’avoir truqué le scrutin, provoquant ainsi des émeutes interethniques où plus de 1000 personnes ont trouvé la mort et au moins 3500 ont subi des blessures en l’espace d’un mois. Des centaines de milliers de personnes, y compris des petits propriétaires produisant des récoltes destinées à la consommation nationale comme à l’exportation, ont été expulsés de leurs domiciles et demeurent à ce jour réfugiés, dépendant de l’aide humanitaire. Les turbulences générées par la violence sur l’économie ont empiré après une grave sécheresse courant 2009, en conséquence de quoi 10 millions de personnes souffrent aujourd’hui de la faim, et la crise économique internationale rattrape le cours des fertilisants à hauteur d’une augmentation de 300% à cause de la hausse générale du prix du pétrole. Les recettes du tourisme ont connu en 2008 une baisse de 19% (280 millions de dollars). La production de thé est tombée de 7% et la qualité de la récolte a été affectée par la sécheresse au premier trimestre 2009, tout comme la production de café. Les demandes dans l’ordre de la production haut de gamme ont également chuté consécutivement à la récession. L’horticulture a été affectée en termes de demande comme de production. La crise globale a impacté les versements des expatriés pour un total de 39,5 millions de dollars en janvier 2009 contre 61,1 millions en octobre 2008.
152 Face à cette urgence, le gouvernement s’est vu paralysé par des affrontements internes à la coalition forgée sous la pression internationale. L’accord signé par les partis rivaux – le Parti de l’Unité Nationale et le Mouvement Démocratique Orange – en 2008 a été si vaguement formulé qu’il peut être interprété en tout sens qui convient à l’un ou l’autre des signataires. Le résultat a été, on l’aurait prédit, un embouteillage politique.
153 Les deux partis sont incapables de travailler ensemble et leurs ministres tiennent des réunions décisionnaires séparées. Quatre réunions de cabinet hebdomadaires de la coalition ont été annulées en avril 2009 et chaque parti a imputé à l’autre ces annulations. Le conflit a même paralysé le parlement à cause du désaccord des partis sur la question de savoir qui placer en tête du House Business Committee.
154 L’une des raisons principales du bain de sang de 2008 portait sur la propriété foncière. Depuis l’indépendance du pays en 1963, les terres saisies par les colons ont été rachetées par l’élite kényane émergente, la plupart revenant aux Kikuyu et provoquant ainsi le conflit. Dans de nombreux cas, les nouveaux propriétaires étaient d’un groupe ethnique différent de ceux qui possédaient originellement les terres et des tentatives de chasser les « envahisseurs » ont été mises en œuvre. Selon la Kenya Land Alliance, plus de la moitié des terres arables du pays est entre les mains de seulement 20% de la population. Une portion significative est détenue par des branches de la famille de dirigeants de divers groupes ethniques, devenues puissantes alors que l’équation politique kényane se modifiait.
155 Il ne peut y avoir de stabilité au Kenya sans résolution de la question foncière. Toutefois, seulement 20% de la superficie totale du pays est propice à la culture et la plus grande part détenue par l’élite politique est intouchable ; le ministre de l’Agriculture James Orengo a annoncé qu’il distribuerait des terres gouvernementales aux dépossédés. En dépit de cela, le gouvernement aurait récemment accepté de céder 40500 hectares de bassins fluviaux fertiles au Qatar, qui compte y produire des fruits et légumes pour sa propre consommation intérieure. Avec plus d’un tiers de la population kényane au bord de la famine, tous les éléments sont réunis pour raviver les braises de l’émeute au Kenya.
156 Il est remarquable qu’au moment où le président Kibaki a annoncé des mesures pour endiguer la crise le 1er juin 2009, il n’ait pas considéré l’importance de la question foncière. Il n’a pas davantage semblé nourrir de plans pour réaliser une indépendance relative de l’économie. Kibaki a surtout insisté sur les projets infrastructurels, l’irrigation, le soutien à l’agriculture et l’exportation. Même si ces questions sont brûlantes, elles ne demeurent que de peu d’importance pour les légions de réfugiés intérieurs vivant dans des taudis et survivant de maigres rations, tout comme pour les paysans devenus incapables de se nourrir parce que leurs récoltes de subsistance ont viré au fiasco, ainsi que pour les citadins de bidonvilles surchargés dont le nombre n’a cessé de grandir avant même la crise actuelle.
157 Si le gouvernement ignore le problème des terres, il pourrait bientôt se retrouver la cible de violentes contestations comme ce fut le cas dans le secteur du Mont Elgon où la milice de la Sabaot Land Defence Force (SLDF) dominait entre 2006 et 2008. La SLDF fut finalement mise en échec à l’aide de tactiques analogues à celles de l’écrasement colonial du mouvement de libération Mau Mau dans les années 1950. Des ONG internationales ont reporté de nombreux cas de tortures à mort et d’autres violations des droits de l’homme par les forces de sécurité dans le secteur du Mont Elgon.
158 En février 2009, Philip Alston, le Rapporteur Spécial de l’ONU sur la question des exécutions arbitraires, extrajudiciaires ou sommaires, a indiqué que « des exécutions extrajudiciaires répandues, systématiques et soigneusement planifiées, sont perpétrées de façon régulière par la police kényane » et que « l’investigation, les poursuites et tous les procédés judiciaires sont lents et objet de corruption ». Quelques jours après les annonces d’Alston, Oscar Kamau King’ara, directeur de la Fondation Oscar, et Jean-Paul Oulu, le chef de la communication de la Fondation, ont été abattus à Nairobi. King’ara avait confié aux médias que la Fondation avait accumulé de la documentation relatant plus de « 8000 cas d’enlèvements et d’exécutions », et en avait informé Alston. À moins que le gouvernement agisse de façon décisive non seulement pour sécuriser ses exportations, mais également pour prendre en charge l’inégalité économique et réformer les appareils judiciaires et de sécurité, il ne saura éviter les effusions de sang et les violations des droits de l’homme.
159 Les crises que vivent le Kenya, les USA, l’Italie ou la France sont sans doute liées entre elles par de nombreux effets de pression, de vases communicants et de jeux politiques imbriqués entre eux. N’est-il toutefois pas leurrant de parler de « la crise » ? Il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur les résistances, les espoirs et les mouvements activistes qui dynamisent la société kényane, envers et contre tout. Mais ces quelques mots sur la crise (permanente) que vit le Kenya, depuis des décennies de colonisation et de post-colonialisme, ne suffisent-ils pas à nous faire mesurer les énormes différentiels de niveaux qui nourrissent certes « la crise » – mais que masque la référence à « la crise » ?
Liquidité
160 La liquidité est décidément devenue la pierre angulaire des marchés financiers : on se plaint lorsqu’elle disparait, on en injecte pour sauver le système, on en déplore l’abondance et ceux qui y en sont à l’origine (la Chine). Certains, à l’instar Zigmunt Bauman[24] [24] Zigmunt Bauman, La vie liquide, Rodez, Rouergue, 2006. …
suite ou de Pascal Michon[25] [25] Pascal Michon, Les rythmes du politique, Démocratie et…
suite, y voient même tout simplement le syndrome de la vie moderne : une vie liquide débarrassée de profondeur, de verticalité, de matérialité, de solidarité pour s’épandre en l’horizon fluide, horizontal, de la mondialisation néolibérale. Dans tous les cas, notre condition vitale est la liquidité, soit que nous en soyons tributaires pour la survie du capitalisme (et donc de la croissance de notre pouvoir d’achat), soit qu’elle soit le symptôme de l’ère (post)moderne.En premier lieu, il faut rappeler qu’une des propriétés évidentes de la liquidité est, comme le rappelle le régulationniste Michel Aglietta, son caractère social. Elle tire son existence d’un collectif d’acheteurs et de vendeurs permanents. Elle décrit, par extension, la taille et la facilité de circulation au sein d’un espace d’échanges : plus il y a de vendeurs et d’acheteurs, plus un marché est liquide, et donc plus les actifs qui y sont échangés peuvent l’être sans délai ni coût de transaction. La liquidité n’est donc pas ici la description d’un état (selon les définitions M1, M2, M3 des banques centrales[26] [26] Les banques centrales définissent le montant total des…
suite), mais ce qui unit collectivement l’ensemble des participants au marché financier, ce en quoi ils croient, ce qui fonde leur adhésion, ce qui les retient de liquider leurs positions dans l’instant. Au sens premier, la liquidité est bien redevable de ce processus de « transcendance immanente » décrit par Frédéric Lordon et André Orléan[27] [27] Voir leur contribution « Genèse de l’État et genèse…
suite. Elle s’impose à tous les acteurs comme une condition sine qua non d’existence du marché et comme ce à quoi les différents agents sont prêts à se soumettre – ce qui peut conduire à des pertes comme à des gains (chacun ayant le droit et la possibilité de vendre ou d’acheter). Elle est aussi une condition aux relations sociales immanentes entre les acteurs : par mon engagement à ne pas me retirer définitivement du marché (auquel concourent les différents flux de dividendes) et à réinvestir les surplus accumulés, je compense le mouvement vendeur créé par mes propres gains (issus de la vente de tel ou tel actif).
161 Au sens le plus strict, la liquidité est donc l’affirmation d’un commun qui lie les agents de la finance, pour le meilleur et, en ce moment, pour le pire. En outre, il n’existe pas de différence fondamentale entre les propriétés génétiques endogènes du processus de formation d’une croyance financière et celles qui fondent l’adhésion à une forme monétaire. Plus encore, les deux processus semblent étroitement articulés l’un à l’autre : ils fondent un espace spécifique où l’indistinction croissante entre la liquidité ultime (la monnaie) et les différents degrés de liquidités tracent un continuum du financement qui ne fait pas jouer le marché des actions et des dérivés contre le marché du crédit, mais qui mobilise le crédit pour l’achat d’actifs financiers et qui mobilise les dérivés pour assurer les créances et les actifs. On parle de « marchéisation » des banques au sens où elles interviennent de plus en plus sur les marchés financiers, de « leviérisation » du marché dans la mesure où les agents s’endettent excessivement auprès des banques.
162 Comprendre la puissance de la finance, c’est donc d’abord abandonner l’image traditionnelle de ce monde où des « héros » modernes s’arrachent du conformisme ambiant et amassent des fortunes gigantesques jusqu’à se faire les oracles et les exégètes d’un univers dont les pauvres profanes sont bien incapables de comprendre les mécanismes. Tout au contraire, la richesse dans le monde de la finance n’y est déterminée que par la polarisation mimétique des agents autour d’une opinion qu’ils croient être l’opinion commune (autoréférentialité) et qu’ils partagent ! Car voilà peut-être l’aporie des marchés financiers, la persistance de ces agents qui, tout en se faisant les zélateurs de l’individualisme libertarien, ont bâti un véritable « communisme du capital » (Negri), au sens où sa valorisation n’est plus le résultat d’un cycle A-M-A’ tel que Marx avait pu l’identifier, mais émane de la construction bien réelle d’un imaginaire commun soudé autour du mythe de la liquidité. En conséquence, plutôt que de déplorer l’économie-casino, notons, au regard de l’effondrement présent, la fragilité de ce commun qui, loin de tracer une voie d’émancipation, entraîne les opérateurs dans un état de servitude quasiment homologue en ses formes à celles analysées par Spinoza dans le Traité Théologico-Politique. Plongées dans la crainte permanente de voir se matérialiser les risques de leurs prises de positions, la prolifération de dérivés (et de dérivés de dérivés)[28] [28] Les produits dérivés (comme les CDO ou ABS) sont des instruments…
suite s’analyse alors comme la domination d’affects de crainte sur les affects positifs d’espoirs de gains. La dynamique affective domine alors sur l’apparente rationalité financière, non que la finance soit irrationnelle ou fasse preuve d’une irrationnelle exubérance (Shiller) mais parce qu’elle signe son incapacité à se définir activement au sens d’une « communauté d’action ». Contrairement à l’image du trader jeune en perpétuel mouvement à l’activité incessante, le spinozisme opère un retournement des plus mutilants : face à l’instabilité permanente du marché, aux dynamiques de propagation affectives qui le caractérisent, l’individu y est profondément et presque intégralement passif, toujours en passe de subir l’évènement tragique pour lui et par suite pour les autres (également ignorants). Incapable de s’inscrire dans l’optique d’une « contre-effectuation évènementielle », pour reprendre le vocabulaire deleuzien, la communauté financière est incapable de devenir active car, comme le rappelle Philippe Zarifian, « passer de la passion à l’action pose une exigence de niveau élevé en particulier lorsqu’on évoque un collectif, une communauté d’individus. Il ne suffit pas d’être affecté par des passions joyeuses, d’entraide et d’amitié par exemple, passions qui comme toutes les passions restent instables et fluctuantes. Il faut que cette communauté parvienne à comprendre clairement les causes internes de sa propre puissance »[29] [29] Philippe Zarifian, « Puissance et communauté d’action »…
suite.
163 Face à cette profonde impuissance de la finance à être en mesure de connaître les causes qui la déterminent, la crise agit comme un catalyseur, elle révèle à posteriori un commun en train de se fragmenter, une institution en plein délitement. La sédition y prend les formes les plus prédatrices (retrait d’actifs, ventes massives, gel des prêts interbancaires), tandis que s’y produit la désagrégation anarchique de l’institution par un processus homologue au processus agrégatif constitutif. La liquidité passe alors par plusieurs états de crise, durant lesquels, à la polarisation mimétique génératrice du phénomène de bulle, voit se substituer une multiplicité de prétendants (or, euros, dollars sous la forme de bons du trésor américain) prétendant incarner la liquidité (avec tous les déséquilibres et les réorientations brutales corrélatives). Ces prétendants échouent, l’un après l’autre, à refonder un ordre de croyances et d’adhésion suffisamment puissant pour réenclencher le procès d’accumulation (chute d’un segment de marché des dérivés par exemple, puis chute du marché des CDS[30] [30] Les Credit Default Swap sont des instruments financiers…
suite, puis chute des cours de bourses, puis prime de risques[31] [31] La prime de risque sur les bons d’États est censée mesurer…
suite excessives sur les bons d’États des pays émergents, etc.).
164 Si l’analyse de la finance doit servir d’enseignement, c’est, en fait, d’abord par les interrogations qu’elle suscite quant à la nature d’une institution et de sa capacité à durer dans le temps (du fait des rapports qu’elle régule, des représentations qu’elle impose, des affects qui lui sont attachés). À ce titre, la régulation, loin de désigner, un volet de mesures à même de prévenir des risques ou de limiter les forces procycliques, devrait être entendue comme intervention dans la conjoncture plurielle, complexe et agonistique des affects, afin que l’institution (financière) se perpétue. En effet, l’idée que le monde de la finance pourrait être un horizon calme et sans tumultes est une fiction. Même durant la période fordienne, des tensions permanentes étaient générées, seulement elles se matérialisaient par des problèmes de taux de change et d’inflation. Les gouvernants avaient en charge de créer les institutions comme celles de Bretton Woords propres à les relayer et à les rendre soutenables en intégrant des possibilités de désaffection ou d’indignation.
165 Réguler, à nouveau, serait donc s’orienter vers de nouvelles politiques d’empowerment où la communauté financière loin de demeurer dans une passivité constitutive, intellectualiserait les relations qu’elle entretiendrait avec les autres sphères et communautés économiques, sociales, politiques. L’impression d’un capitalisme, qui comme le disait Deleuze, opère une « plus-value de flux »[32] [32] Voir le cours de Vincennes de Deleuze sur L’Anti-Oedipe…
suite intellectuels, technologiques, c’est-à-dire cognitifs, a longtemps justifié l’espoir d’un moment dialectique de renversement par (hier) le prolétariat en lutte, (aujourd’hui) le cognitariat des multitudes nomades. Cet espoir pourrait laisser la place à un horizon plus limité, mais néanmoins émancipateur. En effet, ni la proposition d’une nationalisation intégrale ou partielle du secteur bancaire, ni l’hypothétique alliance des multitudes ne seront suffisantes. Là encore, il sera nécessaire de favoriser les enchaînements imaginatifs et politiques propres à initier un tel programme[33] [33] Voir la proposition de Frederic Lordon d’un système socialisé…
suite. En somme, nous sommes condamnés à inventer – et cette nécessité, au sens spinoziste du terme, est déjà une étape dans la voie d’un devenir actif[34] [34] Voir Pascal Sévérac, Le devenir actif chez Spinoza. Paris,…
suite.
Little Big Planet
166 (sortie en France le 7 novembre 2008 sur PS3 et PSP)
167 Little Big Planet est un jeu de plateforme où le joueur doit diriger Sackboy dans des niveaux infestés de dangers. Le personnage se déplace de droite à gauche sur l’écran, il peut courir, sauter et s’accrocher aux éléments de décors. L’environnement original, le moteur physique performant (qui gère le réalisme de la chute des objets par exemple) et la difficulté honnête du jeu en font l’un des meilleurs actuellement sur le marché.
168 Le jeu dispose d’un éditeur de niveaux extrêmement complet et puissant permettant de réaliser facilement ses propres niveaux, ensuite il est tout aussi facile de mettre ses créations en ligne sur Internet et d’en faire bénéficier toute la communauté des joueurs. Cette pratique existe depuis les tous premiers jeux vidéo, elle s’appelle le « modding », elle consiste en l’enrichissement du contenu original d’un jeu par les joueurs eux-mêmes, qui créeront de nouveaux niveaux, de nouvelles histoires et de nouvelles manières de jouer. Le « modding » et la création de « mods » sont très répandus dans le jeu vidéo, certains jeux comme « Half-Life » ayant une communauté de plusieurs millions de joueurs qui ont, au fil des ans, développé toujours plus de contenus pour enrichir le jeu.
169 Little Big Planet a été baptisé le premier jeu vidéo 2.0, en référence au web 2.0 (comprendre l’Internet communautaire où c’est l’utilisateur qui apporte du contenu, par exemple : Youtube, Myspace, Facebook, etc). En 2009, il est tendance d’aimer le web 2.0, de s’émerveiller de ses possibilités, il est tendance de prendre une pratique existante, de la resservir « à la nouvelle sauce » et de l’affubler d’une appellation douteuse.
170 Syndrome de la fascination naïve des utilisateurs du web et de ses pratiques. Un jeu est 2.0, demain, votre voiture sera 2.0 et dans quelques mois vos enfants…
Masochiste (économie)
171 « L’homme est l’esclave de ce qu’il possède, que ce soit son argent, sa femme ou sa patrie »[35] [35] Sacher Masoch, « Basil Hymen », in Das Eigenthum, Vol. …
suite.
172 À travers son écrit, « Le problème économique du masochisme »[36] [36] Sigmund Freud, « Le problème économique du masochisme »,…
suite, Freud s’interroge sur l’origine de la libido qui, selon lui, commande la vie psychique de l’homme. Tandis que la libido est une économie conservatrice de la vie, le masochisme suggère la présence d’un instinct destructeur au sein de cette économie libidinale : le masochiste agit comme s’il pouvait trouver un intérêt à éteindre la vie en lui, un intérêt qui s’opposerait à l’économie de l’espèce. Quelques décennies avant Freud, Sacher-Masoch offre une lecture économique et sociale de cette tendance à l’autodestruction. Selon lui, il n’existe pas d’opposition entre pulsion de vie et instinct destructeur ; l’intransigeance de l’un complète la violence de l’autre. D’autre part, cette économie libidinale à caractère destructeur ne s’oppose en rien à la cruauté de l’économie sociale et politique. Ce qui sévit dans chaque personne sous la forme d’un instinct vital individuel, n’est en réalité rien d’autre que l’autoconservation compulsive de l’espèce. Cette « volonté de vie »[37] [37] Rappelons que pour Schopenhauer et pour Sacher-Masoch cette…
suite s’accommode très bien avec les intérêts égoïstes de l’individu moderne et la structure économique que celui-ci met en place.
173 Sacher Masoch en déduit un rapport quantitatif entre l’énergie vitale, la propriété et la mort : plus un individu est « riche » en énergie vitale, plus il a tendance à posséder et à accumuler, plus il est aussi assujetti à l’angoisse de perdre cette énergie accumulée. Selon la même logique, plus le patrimoine qu’il détient est important, plus il pâtit de la peur de mourir. Au contraire, l’absence de propriété et l’extinction de son énergie vitale le libèrent de la peur de perdre.
174 La leçon que tire Sacher Masoch de cette équation est très simple : face à cette « écologie » générale de l’espèce, l’individu, en prise avec une dynamique autodestructrice, lutte contre la volonté de vie qui l’anime et va à l’encontre de toute forme d’appropriation matérielle et financière.
175 L’économie masochiste propose alors deux possibilités pour se libérer de la propriété et se réaffirmer en tant qu’individu : la dépense désinvolte et le gaspillage d’une part et l’ascétisme qui interdit toute nouvelle possession de l’autre. Dans les deux cas, le principe d’économie est poussé par un instinct destructeur qui s’oppose à l’accumulation de travail, d’argent et de propriété. Dans le premier cas, nous sommes proches de la « dépense improductive » énoncée par Georges Bataille : une économie basée sur le don et le sacrifice. Dans une société régie par une telle économie, l’individu ou l’état valorisé n’est plus celui qui accumule la richesse mais celui qui dépense et donne davantage. Le travail n’a de valeur que l’énergie dépensée, et le produit obtenu par ce travail ne vaut que dans la mesure où il peut être sacrifié ou donné. L’argent est estimable, mais uniquement pour la dépense qu’on en fait, pas pour en faire des économies. La deuxième stratégie masochiste rejoint la première par le chemin inverse : partant d’un ascétisme radical, il s’agit de se libérer de tout bien et d’éradiquer les besoins matériels. Dans cette perspective, l’homme est riche seulement du prix des choses dont il peut se passer. La valeur de l’argent provient de l’usage qu’on en fait ; en réduisant au minimum la nécessité de cet usage, on élimine cette valeur.
176 La limite de ces deux stratégies, dans la société actuelle, est, d’une part, d’aboutir à un suicide économique du sujet si elles sont poussées à l’extrême ; et de l’autre, si elles ne le sont pas, de générer des compromis malheureux.
177 Il existe en fait une troisième stratégie proposée par Séverin, le héros de La Vénus à la Fourrure de Sacher-Masoch.[38] [38] Gilles Deleuze, Présentation de Sacher Masoch, suivi de…
suite Loin de toute abstinence ascétique, celui-ci vit au contraire une sensualité intensive. Mais c’est dans la sublimation esthétique de sa sensualité que Séverin trouve l’économie libidinale propre à son masochisme. En tant qu’artiste dilettante, il donne lieu à des œuvres inachevées ; il ajourne l’aboutissement de son travail de la même manière qu’il retarde sa jouissance sexuelle par le biais de la douleur, ceci afin de garder toujours en hausse la tension mentale et sexuelle impliquée dans la création et dans l’amour. De cette façon, il interdit à l’investissement libidinal d’aboutir à un résultat. Dans cette perspective, il ne s’agit plus de dépenser avec excès, ni de refuser toute dépense, mais d’envisager une dépense intensive qui déjoue l’économie politique. L’enjeu et la valeur unique de cette économie libidinale basée sur l’inachèvement et la suspension sont la prise de conscience de soi, en tant qu’individu, dans une résistance acharnée contre l’économie de l’espèce. Mais cette conscience de soi n’est-elle pas le fondement nécessaire pour toute action politique ?
Mercuriales
178 Les « crises » du capitalisme passent généralement par un affolement des prix : au lieu d’osciller autour de montées et de baisses incrémentales, les cours du marché s’envolent ou s’effondrent brutalement. On a fait de cette soudaine et extrême volatilité le symptôme du dérèglement et des excès du capitalisme financier : les cours en Bourse de Lehman Brothers ou de l’UBS ont ainsi pu passer, en quelques jours, de 60 à 6 dollars, voire à 13 cents. Lorsqu’on salue « la crise » comme la sanction d’un salutaire « retour à l’économie réelle », à quel modèle serein, pacifié, transparent et rationnel de fixation des prix fait-on implicitement allusion ? Un exemple tiré de la réalité de l’économie – en l’occurrence celle du recyclage – aidera peut-être à dégonfler la bulle idéologique de telles références illusoirement nostalgiques.
179 Comment s’établit le prix du papier recyclé dans la France d’avant et d’après « la crise » de 2008 ? Par l’intermédiaire de Mercuriales. Ce terme hérité de la France d’Ancien Régime désigne encore aujourd’hui la publication régulière des cours de certaines matières premières et de certaines denrées. Faute de la centralisation que procure une cotation en Bourse, le prix des lots de papiers et de cartons à recycler, ainsi que celui des rouleaux de papiers et de cartons issus du processus de recyclage, sont négociés directement entre les entreprises, qui tendent à se constituer des réseaux de clients et de partenaires. Chaque directeur commercial a ses contacts privilégiés, ses habitudes, ses préférences, ses allergies, qui contribuent ensemble à orienter la provenance et la destination les flux de déchets et de biens reconditionnés qui traversent son entreprise, ainsi qu’à fixer le niveau des flux monétaires qui dirigent la circulation des marchandises en question.
180 Sauf s’il est un débutant dans son métier ou un nouvel entrant sur ce marché, les Mercuriales ne l’aident cependant qu’assez peu dans ce travail de fixation des prix. Ces publications hebdomadaires – répondant aux noms bucoliques de L’Usine nouvelle, Recyclage-récupération ou Revipap – fondent en effet les cours qu’elles annoncent sur ce que veulent bien leur dire les différents professionnels de la branche en question. Le Mercurialiste décroche son téléphone, appelle ses contacts au sein de diverses entreprises et recense les prix que celles-ci jugent dans leur intérêt de lui communiquer. Comme par ailleurs la publication des Mercuriales est financée par la publicité qu’y insèrent ces mêmes entreprises, ces branches de « l’économie réelle » participent d’une logique comparable à celle qui a joué un rôle si critiqué dans la bulle spéculative en biaisant les évaluations établies par les agences de notation financière : l’instrument censé attester la fixation de la valeur « réelle » est noyauté par des convergences d’intérêts qui en sapent la fiabilité. Les différentes Mercuriales, en compétition commerciale entre elles, constituent donc davantage un lieu d’affichage de velléités marchandes et une arme d’intoxication qu’un reflet fidèle des prix effectivement en vigueur.
181 Les esprits historiens s’amuseront de voir notre multiplicité de Mercuriales actuelles, issues de la plus grande liberté du marché, s’exposer aux mêmes critiques qu’avait à subir, sous l’Ancien Régime, l’organe officiel du despotisme monarchique, le Mercure de France, dont tous les journalistes (et compétiteurs) se moquaient au xviiie siècle pour sa servile inféodation à la voix de son Maître. S’il est douteux que, comme le voulait Audrey Lorde, les instruments du maître ne puissent jamais servir à démanteler la maison du maître (the master’s tools will never dismantle the master’s house), il reste prudent, aujourd’hui comme en 1750, de se méfier du « réalisme » des portraits du Maître financés par les deniers du Maître.
182 Le plus intéressant de l’affaire tient toutefois moins à ce qui s’écrit (de plus ou moins trompeur) sur la valeur supposée de ces déchets-marchandises qu’à ce qui ne s’en dit pas : les prix réellement payés par telle entreprise achetant telle quantité de papier à recycler, ou vendant telle quantité de carton reconditionné, restent en effet quant à eux parfaitement secrets. Alors que les transactions boursières, (justement) incriminées pour leur caractère vaporeux, sont enregistrées, centralisées et publiées de façon ouverte (même si la titrisation et les multiples jongleries de reconditionnement du risque brouillent rapidement les pistes quant à savoir qui possède exactement quoi), la réalité des prix paraît faire l’objet d’un remarquable tabou dans bon nombre de domaines de « l’économie réelle ».
183 Ce qui ne manque pas de produire des effets coquasses, assez dignes finalement des plus virtuoses aberrations de la finance. C’est ainsi qu’au même moment, alors que chaque Mercuriale donnait son cours officiel de la semaine, la même entreprise de recyclage a pu payer 40 à un premier client la « marchandise » que constituait une tonne de carton recyclable, tout en exigeant d’un second client qu’il paie lui-même 40 euros pour qu’on vienne débarrasser les « déchets » que constituait un lot de carton parfaitement similaire au premier – et ceci en fonction du moment où ont été signés les contrats, de la puissance d’intimidation des partenaires, etc.
184 Rien de scandaleux ni finalement de très surprenant à cela : pacta sunt servanda. Et pourtant, les zones d’ombres et les jeux d’illusions qui entourent et traversent la façon dont les prix se constituent au sein « l’économie réelle » peuvent nous conduire à faire apparaître plus distinctement les contours spécifiques du capitalisme, derrière le rideau de fumée de la référence à « l’économie réelle ». Ce qui est bien réel dans cette économie – et cela se manifeste d’autant plus clairement que le marché des matières premières est l’un des plus déréglementé qui soit –, c’est la nature captatrice du capitalisme, qui se nourrit de tous ceux qu’il arrive à piéger dans un recoin obscur d’un labyrinthe qu’il n’a nul intérêt à éclairer trop généreusement.
185 Toute une veine du discours actuel sur « la crise » feint de croire que la rapacité prédatrice, trompeuse et irresponsable serait le propre du mouton noir de la spéculation financière, auquel tous les honnêtes commerçants du capitalisme industriel sont appelés à lancer la pierre de l’opprobre. Les dénonciations outragées des obscures et impénétrables magouilles de la titrisation financière tendent à faire oublier que, malgré ses prétentions affichées à la transparence (des prix), c’est la logique capitaliste dans son ensemble qui nourrit le type de distorsions, d’asymétries d’information, d’occultations, de dissimulations, de secrets, de collusions et d’emberlificotage qu’illustrent les Mercuriales (aussi bien que emballements boursiers). Si « la crise » nous rappelle quotidiennement quelque chose sur la nature du capitalisme, c’est avec quelle facilité ces pratiques de dissimulation basculent « naturellement » en chantage ouvert (chantage à la perte d’emploi, chantage à la perte de marchés ou chantage au risque d’effondrement systémique), sitôt que les choses tournent mal ou que s’esquissent de nouvelles et irrésistibles perspectives de profits.
Mineurs
186 Tandis que la crise tourbillonne, la période semble illustrer un manuel de popularisation des théories de Darwin, et la question lancinante sera Qui saura en réchapper ? Mais chaque cyclone a son œil. Le seul point positif est que cette situation soulève clairement le voile sur les formes qui organisent le social – et laisse apparaître, au regard de tous, l’injustice en acte dans nos sociétés, sans qu’il y ait d’endroit où la dissimuler.
187 Face à cette « crise », qui s’impose en nous par la question de l’injustice sociale, c’est peut-être l’idée de « mineurs » qui aide à la repenser dans sa relation particulière à l’enfance et à la jeunesse. En effet, l’enfance, dans sa dimension la plus large, apparaît dans cette quête, ou plutôt, dans ce rejet viscéral de l’injustice. Combien sont-ils, les héros de la littérature qui nous habitent comme autant de compagnons nous rappelant avec force le rejet de l’enfant face à l’inique ?
188 Cet état qu’est la jeunesse, et que l’on peut comprendre comment étant un moment où l’être est en prise directe avec le monde dans ce qu’il a d’injuste, de tyrannique et de révoltant, entraîne l’adolescent à ne pas se satisfaire du monde tel qu’il est. Ces derniers temps, d’ailleurs, la jeunesse et les mineurs (parfois même de très jeunes gens) se sont illustrés comme étant les principaux instigateurs d’une « crise » politique. En effet, ils sont devenus les acteurs principaux des mouvements sociaux, luttes dans les lycées, luttes contre « les bandes armées de l’État » en 2005, lutte contre le CPE, et jusqu’aux luttes des Universités et aux barrages en Guadeloupe, mais aussi luttes en Grèce, au Danemark, en Italie, au Canada ou en Afrique de l’Ouest. Ils sont là, et ils occupent la scène politique, qu’ils défrichent chemin faisant même si le monde tel qu’il est et les adultes les considèrent difficilement comme de réels « acteurs politiques ». En deçà et au-delà des mots ou des formes institutionnalisées de la révolte, le point commun de leurs luttes est de se manifester dans leur rejet de cette injustice sur laquelle se fonde le social, et qui vient régir leurs vies jusque dans leur intimité.
189 Actuellement, il n’y a pas que les dérapages policiers, tuant des mineurs (Canada, France, Grèce) qui soient là pour indiquer la violence avec laquelle la jeunesse est réprimée. En France, par exemple, on assiste aussi à un dispositif de durcissement des peines à l’encontre des mineurs, qui s’articule à la volonté de ficher et de réprimer dès le plus jeune âge, ainsi qu’à l’irruption de plus en plus fréquente de l’appareil de cœrcition dans le champ de l’école et de l’éducation. Aujourd’hui, l’injustice criante de leur situation conduit ainsi les mineurs à penser et à agir pour « s’en sortir », alors même qu’ils sont vulnérables, fragiles, et souvent aussi un peu inconscients des dangers qui les guettent. Comment ne pas s’inquiéter des risques qu’ils encourent, eux qui ont désormais l’audace d’affronter l’appareil policier dans un corps à corps de rue, tout en subissant, pour certains, de plein fouet les impasses économiques et sociales ? La jeunesse devient alors aisément « délinquante ». Cette jeunesse, de poches percées et de culottes trouées, se compose d’adultes en devenir, à tout moment menacés d’être brisés par l’expérience de l’enfermement, de la stigmatisation et de l’humiliation.
190 Au xixe siècle, ce sont les « mineurs », ceux de Germinal, qui sont devenus l’emblème à la fois du développement et de la lutte contre les méfaits du capitalisme industriel. Après la fermeture des aciéries européennes au cours des dernières décennies, ce sont peut-être ces autres « mineurs » qui reprennent le flambeau de nouvelles formes d’une même revendication de justice, au sein d’un capitalisme en mutation. Comme le firent en leur temps Guattari et Deleuze à propos de Kafka et du genre mineur en littérature, jeter un regard sur l’agir de la jeunesse nous amène à repenser l’ordre des choses, et nous permet de chercher à questionner les singularités en actes dans cette expression mineure de la politique en temps de crise.
Mondialisation
191 La plupart des opposants au capitalisme libéral de l’après-fordisme considèrent négativement la mondialisation, pour souvent même la dénigrer totalement. C’est tout particulièrement le cas en France, où un attachement viscéral à l’État et à sa structure jacobine a conduit la gauche à assimiler progressivement le terme à une « américanisation » ce qui la mettait de surcroît d’accord avec la droite dans une même logique souverainiste.
192 Dès 1973, la formidable audience de la lutte des Lip symbolisait le commencement de cette « résistance » générale au dépassement d’une industrie nationale. Les délocalisations, pratiques récurrentes du capitalisme, étaient restées acceptables durant les trente glorieuses parce quelles respectaient le cadre hexagonal. Ni la gauche ni les syndicats ne contestaient l’État aménageur qui pouvait alors déménager la sidérurgie Lorraine vers les ports, ou décentraliser les usines d’OS loin des forteresses ouvrières de la ceinture rouge, tant que cela respectait « l’intérêt général », c’est-à-dire national.
193 Par contre, quand le refus du travail eut définitivement cassé le fordisme des pays occidentaux, et contraint le capital à trouver de nouveaux bassins de travail au-delà de ses frontières, la gauche assimila la mondialisation à une dépossession. Au point que la marche géo-économique du capitalisme vers l’Ouest qui finissait par atteindre l’Asie a pu même être perçue un temps par des gens, tel qu’Attali, comme laissant derrière elle des espaces désertifiés.
194 C’est que la fin de l’hégémonie industrielle de l’homme blanc, mâle et qualifié, est impensable, sauf à la confondre avec la menace de sa disparition. Et c’est tout particulièrement le cas dans les États centralisés qui perdent progressivement leur prépotence dans un procès global de circulation où s’affirment de nouveaux territoires productifs. Tant les marchés de dimension continentale (Union Européenne, Nafta, Mercosur, Asean) que les villes (métropole, cluster, city region) révoquent ensemble la transcendance souverainiste traditionnelle. On voit alors l’État, tout comme la classe, résister contre la globalisation.
195 Or la mondialisation permet aussi précisément désormais à bien d’autres points de vue de s’exprimer et d’agir face au capital. Les analyses en termes de genres, cultural ou colonial, qui remettent en cause cet universalisme blanc des siècles passés, sont d’ailleurs particulièrement issues des USA, première nation à s’être victorieusement opposée au premier empire colonial. Quoi que cela en coûte aux républicains hexagonaux qui croient encore avoir seuls inventé et normé définitivement la démocratie, il s’agit d’une innovation permanente considérablement enrichie aujourd’hui par des formes issues de jeunes pays (Chiapas, Brésil) et de jeunes technologies (Net, portable) !
196 Concrètement, des centaines de millions de gens de l’ancien Tiers-Monde s’évadent ainsi des campagnes et de leurs potentats, pour aller travailler dans l’industrie des villes et gagner un salaire. Car la ville apporte toujours de nouvelles formes de liberté, de sorte que se contenter de dénoncer des revenus et conditions de travail bien évidemment encore très inférieurs aux nôtres n’est qu’un triste refus de l’histoire. Qui donc d’ailleurs déplore aussi en Europe que ses propres arrière-grands-parents aient fait exactement la même chose, en allant se faire embaucher/exploiter dans les sinistres usines de Zola ? Au nom de quoi croirait-on qu’au Brésil ou en Chine, ces dernières années, les nouveaux urbanisés regrettent leur campagne natale ? Car non seulement les gens accèdent à la liberté de circuler et de dépenser leur salaire, mais, surtout, ils apprennent aussi à lutter pour l’augmentation du revenu. Partout et jusqu’en Chine, les conflits s’affirment déjà, et y compris face à la crise actuelle, pour contraindre les États aux investissements publics d’un nouveau new deal.
197 La forme mondialisée du capitalisme fait donc quitter l’asservissement rural aux deux tiers de l’humanité, brutalement certes, mais on comprend mal pourquoi la gauche souscrit à un ethnocentrisme qui voudrait toujours réserver le rapport capital-travail à l’Occident. Surtout que ce refus de la globalisation est encore plus exacerbé chez l’extrême-gauche léniniste qui, pour le coup, se coupe véritablement de ses «masses émergentes » ! La défense des travailleurs de l’Occident ne peut bien évidemment se fonder sur un cantonnement de ceux du reste du monde dans l’ancien rapport colonial. Certains Verts annoncent aussi sans rire que Chinois et consorts ne pourront jamais même espérer atteindre notre mode de vie – sinon en la détruisant, la vie… L’accueil des non-blancs comme acteurs du rapport capital-travail continue décidemment à rappeler de très sombres précédents pour une gauche toujours profondément impliquée dans un colonialisme occidental encore puissant.
198 Le capital est mondial et le travail le devient aussi en luttant pour sa liberté de circulation. Nous avons encore plus qu’avant besoin des autres, qu’ils soient migrants ou sédentaires, pour nos luttes à mener, ici et ailleurs, contre le capital global. On ne peut mettre constamment en avant les valeurs de la coopération et des réseaux sans comprendre que la mondialisation est un formidable terrain à investir de nos points de vue pour vivre et produire autrement.
Occupation
199 On dit d’un travailleur qu’il est occupé lorsqu’il s’active à faire quelque chose. On dit d’un territoire qu’il est occupé lorsqu’une armée hostile lui impose un contrôle oppressif. En régime capitaliste, les crises se manifestent le plus souvent par le fait que des employés perdent ce qui constituait leur occupation. Au-delà des angoisses et des souffrances subjectives qu’elles ne manquent jamais de causer, ces crises sont donc aussi l’occasion de se demander quels aspects de nos occupations relèvent du travail, quels autres (voire parfois les mêmes) relèvent de la colonisation.
200 Un tel questionnement fait apparaître un énorme coût (généralement caché) de la crise actuelle : depuis bientôt une année, nos esprits sont « occupés » par des discours d’économistes et d’experts de la finance (sur les produits dérivés, la titrisation, les taux d’endettement, les subprimes, les high yields et les fluctuations trimestrielles des chiffres d’affaires des grandes entreprises). Cette obsession relative aux fluctuations du PIB et aux soubresauts de la sphère financière nous soumet à un véritable « état de siège » : ces préoccupations économistes occupent nos esprits de la même façon qu’une armée hostile contrôle le territoire d’un pays conquis.
201 La principale victime de la « crise », c’est donc peut-être notre capacité à penser (autre chose que la maximisation du PIB). Autant que les travailleurs qui ont perdu leur occupation, ce qui est mis à mal, ce sont toutes les capacités mentales occupées par des soucis et des calculs d’apothicaires de la croissance.
202 La principale victoire contre la « crise » ne consisterait donc pas à en sortir (ce qui nous demande d’apprendre à nous y repérer pour lui survivre ou pour la faire déboucher sur une « relance »), mais à s’en dégager : ne pas s’engager dans la réflexion qui pense la crise à partir de ses données-déjà-données, mais faire un pas de côté qui s’abstienne de répondre aux questions posées (malgré leur caractère « préoccupant »), un pas de côté qui nous permette de nous occuper de l’occupation de nouveaux territoires d’émancipation.
PAC (Philosophie analytique continentale)
203 La « crise » n’est pas seulement financière ou économique. Elle ne date pas non plus du seul automne 2008. Sous « la crise » dont tout le monde parle, il se trame depuis des années d’autres crises, d’autres dérives, d’autres bulles – qui participent sans doute de transformations liées entre elles. Ainsi le fétichisme scientiste du PIB et des modélisations mathématico-économiques est-il peut-être relayé, au cœur du monde philosophique, par un scientisme qui pourrait bien, lui aussi, entrer d’ores et déjà en crise.
204 Britannique à l’origine, puis revendiquée dans les années 1980 par un groupe de philosophes français, la distinction philosophie analytique / philosophie continentale est mi-idéologique, mi-historiographique. Elle a surtout servi d’instrument de polémique et de propagande de la part de ce groupe préconisant un exercice purement argumentatif de la philosophie, par opposition à un usage historique de la philosophie pratiquée en Europe continentale. Leur position s’est durcie quand apparut le mouvement post-analytique américain, formé de philosophes tout à fait considérables, anciens analytiques eux-mêmes, qui ont voulu en finir avec une certaine dictature intellectuelle et académique aux USA (Putnam, Rorty et Cavell, ainsi que leurs élèves, relayés en Europe par plusieurs wittgensteiniens). La philosophie analytique est alors entrée dans sa crise. Par delà l’empirisme logique issu de Vienne qui avait dominé la philosophie universitaire américaine pendant les années 1940-1960, ces « postistes » ont voulu réactiver une philosophie américaine autochtone (celle des transcendantalistes Emerson et Thoreau, qui étaient des penseurs de gauche et des pragmatistes, dont Dewey, un penseur de la démocratie) et revisiter l’œuvre de Wittgenstein trop souvent déformée par une lecture analytique.
205 Le boom des sciences cognitives en France dans les années 1980-90 est venu opportunément étayer la prétention des analytiques européens de constituer « la philosophie tout court », employant le mot « analytique » non plus au sens ancien du terme, lorsqu’il s’agissait d’analyser le langage (époque du « tournant linguistique » de Frege, Russell, Wittgenstein), mais au sens d’une philosophie de la cognition, « naturalisée » au sens de Quine, c’est-à-dire réincorporée aux « sciences de la nature ». Avec un message (implicite) séduisant : la philosophie est soluble dans la science, surtout dans les sciences cognitives.
206 Partie à l’assaut des grandes institutions françaises, pratiquant une politique académique offensive, doublée d’une capacité d’auto-proclamation hors du commun, cette mouvance cherche à imposer des normes et un « politiquement correct » à l’ensemble de la profession, tout en moralisant à l’extrême les normes cognitives dont elle se prévaut pour mieux asseoir sa légitimité et incarner un certain idéal disciplinaire. Nourrie de la critique de la philosophie française des années 1960-70, du rejet de son « irrationalisme » jugé immoral et de son relativisme peu conforme aux normes cognitives -comme en témoignent ses réactions, il y a quelques années, à l’affaire Sokal– la philosophie analytique française bénéficie du relatif vide philosophique provoqué en France par la disparition des Foucault, Deleuze, Derrida, du conformisme centriste qui a succédé dans les milieux universitaires à la politisation et au positionnement gauchiste, et du déclin de l’édition qui ne favorise plus guère actuellement que les manuels et les dictionnaires. Au fond, l’activité philosophante des analytiques se réduit à ce que l’on peut appeler un travail de « science normale » (pour reprendre l’expression de Kuhn) au sein d’un « paradigme » (inspiré par les sciences cognitives) dont les attendus échappent à toute discussion possible. Argumenter, ils le veulent, mais seulement avec des gens déjà d’accord avec eux. Il en découle un formatage des esprits en rupture avec ce que l’Europe, mais aussi l’Amérique d’avant la Seconde Guerre mondiale, ont toujours considéré comme de « la philosophie ». Devenue une branche non empirique des sciences cognitives, la philosophie est « naturalisée » au sein de Quine, mais aussi moralisée, professionnalisée et dépersonnalisée : il n’y a plus d’« auteurs », ni de passion philosophique (au sens où la philosophie, depuis Descartes et les Lumières, a toujours été, comme d’ailleurs la politique, une « passion française », pour reprendre l’expression de Zeldin). La philosophie, comme la science dont se réclament les analytiques, est une activité collective pratiquée en labo, et non un job d’intellectuel à la française. La philosophie sera scientiste ou ne sera pas…
207 Cette philosophie dégrisée, technocratico-théorique, étroite, certes (reconnaissons-le) fort sérieuse, mais aussi souvent scolastique et médiocre, est en rupture de ban avec le talent et la tradition des écrivains philosophes à la française du xviie au xxe siècle, annonçant la fin de l’« exception française » en philosophie. Elle s’est étendue sur toute l’Europe où elle mériterait l’appellation de philosophie analytique continentale (PAC) sans toutefois dominer (encore ?), tout en se targuant d’être le « mainstream » en philosophie, voire « la philosophie tout court ». Le bilan intellectuel et conceptuel de ce courant est-il à la hauteur de ses prétentions affichées ? A-t-il fait ses preuves dans les institutions prestigieuses où il a pratiqué entrisme et noyautage, en abusant souvent de la confiance de collègues crédules ? Peut-il vraiment s’intégrer au champ philosophique français, au lieu d’y constituer une enclave sectaire (ce qui est un moindre mal, il est vrai) ? Peut-il, mérite-t-il de jouir d’un prestige analogue à des formations intellectuelles du passé (phénoménologie, structuralisme) ? Quelles interactions intellectuelles est-il susceptible d’avoir avec des partenaires issus d’autres courants ? Quel espace de jeu cette philosophie étroitement corsetée laisse-t-elle à la liberté d’esprit et à la créativité, ainsi qu’à la critique, lorsqu’elle s’indigne vertueusement sitôt que ses productions intellectuelles ne sont pas encensées ? Fermée comme elle l’est, peut-elle s’ouvrir à une vraie discussion (alors qu’elle se prétend argumentative) avec des gens ne partageant pas les mêmes présupposés ? Le concept de « philosophie analytique », ou plutôt son usage français, est typiquement « réactif » au sens de Nietzsche, le produit des forces réactives d’un groupe qui veut l’hégémonie. Autrefois la philosophie analytique a été un programme de recherche courageux et intellectuellement vivifiant, une philosophie montante ; aujourd’hui, elle fait figure d’idéologie réactive.
Papiers (réalité de)
208 C’est au moins à deux titres que l’industrie du recyclage pourrait servir d’emblème à « l’économie réelle ». D’une part, loin du culte de l’immatériel dans lequel se complaît l’analyse du capitalisme cognitif, elle se coltine la collecte, le déplacement, le triage et le traitement de réalités éminemment matérielles, qui ont tout le poids, toute la masse, toutes les couleurs et toutes les puanteurs du « réel ». D’autre part, en se situant à la charnière du déchet, qui constitue le point terminal de la chaîne consumériste, et de la matière première, qui en constitue le point initial, le recyclage est en quelque sorte doublement réel : il permet de toucher du doigt à la fois ce qui reste d’irréductiblement matériel, après que les objets ont cessé de nous rendre service, et ce qui constitue la réalité brute à partir de laquelle ces objets sont formés. Si « l’économie réelle » peut effectivement être touchée du doigt, ce devrait donc bien être dans ce cas-là ! Sauf que ceux qui mettent vraiment les mains dans le cambouis du recyclage savent que, même dans ce cœur de la « réalité » économique, on ne touche qu’accidentellement cette réalité du doigt : les poubelles jaunes ne déversent qu’un réel malodorant, malsain et intouchable, qu’il faut saisir qu’avec des gants, puisque la vitesse du tapis convoyeur ne laisse pas le temps de les manier avec des pincettes.
209 Comment cette économie « réelle » vit-elle donc « la crise » ? En quelques semaines, la tonne de papier journal recyclé passe de 140 euros à 60 euros, tandis que le carton recyclé qui se vendait 80 euros trouve à peine des acheteurs à 20 euros. En juin 2008, l’entreprise de recyclage offrait 30 euros pour une tonne de carton à collecter alors qu’en novembre, il faut la payer 30 euros pour qu’elle vienne vous débarrasser de la même tonne du même carton usagé, dont plus personne ne veut, parce que plus personne ne parvient à vendre les rouleaux de papier qui s’accumulent à la sortie de la chaîne de production. Un esprit naïf pourrait se demander quelle est donc la bizarre réalité de cette économie prétendue « réelle ». A-t-on soudainement arrêté de consommer du papier et du carton ? Les journaux n’ont-ils pas continué à s’imprimer, les marchandises à s’emballer, les derrières à se torcher ? On répondra au naïf par les lois de l’offre et de la demande : les cours tiennent moins à la masse « réelle » de ce qui se consomme « réellement » qu’à « l’alchimie » complexe de différentiels et de taux marginaux qui traduisent des baisses de consommation relativement faibles, du point de vue des chiffres absolus, en des écroulements spectaculaires des prix. Dans quelle mesure ces variations soudaines des prix sont-elles les effets « naturels » des lois spontanées du marché libre ? D’un certain point de vue, l’économie des matières premières comme le papier, et celle du recyclage en particulier, pourrait offrir l’illustration presque parfaite d’un marché compétitif à travers lequel s’auto-organisent et « s’harmonisent » les forces productives d’une multiplicité d’agents indépendants. Pas de monopole, ni même d’oligopole, mais plein de petits vendeurs de vieux papiers, plein d’acheteurs de cartons recyclés et de nombreuses entreprises de collectes, de triage et de traitement, le tout animé par une saine compétition tous azimuts.
210 À y regarder d’un peu plus près, cette organisation spontanée de l’économie réelle s’avère toutefois reposer sur une réalité bien différente de celle du marché et des intérêts privés qu’il est censé harmoniser. Si Ikea accepte de payer 30 euros pour se débarrasser de « déchets » soudainement dépourvus de toute valeur d’échange, c’est que tout un cadre légal – issu de décisions politiques visant à protéger un bien commun – lui interdit de recourir à la solution plus « économique » qui consisterait à déverser ses tonnes de carton usagé dans la première rivière venue. Il aura fallu tout un millefeuille de prescriptions communales, de lois nationales et de directives européennes pour éviter que les producteurs de déchets ne brûlent ceux-ci ou ne les envoient à la décharge – et pour permettre aux entreprises de recyclage de survivre dans une période où la baisse des prix des matières premières non recyclées devrait, en bonne logique économique, les exclure de tout marché « librement » compétitif.
211 Le caractère doublement réel de l’industrie du recyclage invite donc à dépasser les mythes de « l’économie réelle ». Ce n’est pas la réalité du marché des biens matériels qui maintient en vie le commerce des papiers recyclés, mais bien la mise en place de mesures politiques relatives à la réalité non-marchande que constituent des déchets sans valeur, mais non sans impact sur notre environnement commun. C’est une autre réalité que la réalité marchande de l’économie – celle de l’impact que nos formes de vie ont sur notre environnement physique et mental – à laquelle il nous faut faire référence pour dépasser à la fois les aberrations des spéculations financières et les impasses de « l’économie réelle ». À quoi sert donc le papier (recyclé ou non) qui circule dans nos économies ? Outre l’impression de tel livre de Rabelais et les délices clandestins du torche-cul, outre la substantifique mœlle de Multitudes et les tracts enjoués d’une ultragauche ultraminoritaire, il nous déverse surtout des flots de brochures publicitaires, d’encarts publicitaires, de quotidiens gratuits payés par la publicité, quand ce ne sont pas les images en quadrichromie de mannequins filiformes ou les profondes spéculations de L’Équipe. Qu’y a-t-il précisément de « réel » là-dedans ? Est-ce parce que le papier est matériel ? La « réalité » de cette économie de discours et d’images s’évaporerait-elle si tout cela arrivait désormais sur nos écrans d’ordinateurs, au lieu d’encombrer nos boîtes aux lettres ?
212 Lorsqu’on oppose l’économie réelle aux délires de la finance et aux rêves de l’immatériel, on se croit dûment « réaliste » en mettant l’accent sur le fait que le gros de la consommation concerne des marchandises matérielles, qui correspondent à des besoins (tout sauf intellectuels) de la population, et qui se stabilisent naturellement autour de prix équilibrés par le jeu transparent d’une offre et d’une demande proprement informées. Ce que fait voir le commerce des papiers recyclés prend pourtant le contre-pied de tous ces truismes. Pour ne pas nous laisser asphyxier sous les déchets que la publicité produit avant même que nous ne la jetions dans la poubelle, le plus important est une réorientation de nos valeurs (immatérielles), qui corresponde aux aspirations de notre intelligence collective et qui ne soit pas livrée au jeu superficiel d’une offre et d’une demande aveuglées à ce qui constitue notre intérêt partagé et notre bien commun.
Performance
213 L’activité de quantification qui règle la vie des États est, depuis un quart de siècle déjà, mise au service d’un principe : l’efficacité. Que dit ce principe ? Il affirme qu’une allocation de ressources (ou une décision) peut être optimale, c’est-à-dire la meilleure possible relativement aux conditions qui définissent un état du monde et à l’information disponible sur cet état. Être efficace requiert donc de disposer de données chiffrées permettant d’établir une relation mesurable entre un résultat (de nature politique) et un coût (apprécié en termes de dépense publique). L’idée s’est donc lentement imposée qu’un gouvernement est efficace lorsqu’il parvient à rendre la moindre dépense qu’il engage exactement ajustée au résultat qu’elle produit au meilleur coût. Et tel est le rôle de l’évaluation qui accompagne désormais, en amont comme en aval, la décision politique, en remplissant, pour le secteur non-marchand sa fonction de substitut de ce qu’est le prix pour le marché (comme l’a montré E. Monnier).
214 L’introduction de ce principe d’efficacité en politique pose quatre problèmes. Le premier est l’asservissement du processus de prise de décision à la quantification. C’est que, sans chiffres, les gouvernants ne peuvent ni fixer des objectifs, ni définir des indicateurs de performance, ni mesurer le degré de réussite d’une disposition de politique publique, ni celle de la productivité des administrations. Bref, sans chiffres, il leur est impossible de soumettre l’action publique au principe d’efficacité ou de produire des résultats pour justifier le fait qu’elle l’est. La volonté d’ évaluer a engendré une sorte de dépendance : quel gouvernant sensé songerait aujourd’hui à prendre une décision qui ne reposerait sur aucun argument chiffré ? Or, cette dépendance a ses revers. Le premier est de fausser le jugement des dirigeants, qui tend de plus en plus à être formulé à partir des seules « réalités informationnelles » que créent les systèmes de recueil et de traitement des données administratives. Dans la mesure où ces réalités sont construites sur des hypothèses théoriques, elles ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont vécues par les citoyens ; et l’on constate régulèrement qu’un écart se creuse entre les décisions des gouvernants et les attentes de ceux auxquelles elles sont adressées. Le second revers est la réduction du champ du politique. Tout responsable avisé sait qu’il peut s’assurer d’atteindre un objectif qui lui est assigné en soumettant à évaluation les seuls engagements dont il est sûr par avance qu’il pourra établir qu’ils ont été tenus. Ce qui le conduit à exclure d’autres objectifs, soit parce qu’ils ne peuvent donner lieu à quantification, soit parce qu’ils fourniraient une information embarrassante. Et les enquêtes montrent que ces usages déviants sont la norme.
215 Le principe d’efficacité pose un second problème : celui des finalités en fonction desquelles elle doit être mesurée. Il n’est pas rare qu’une action publique poursuive plusieurs buts également légitimes en même temps ; la question se pose alors de savoir si l’efficacité relevée dans une de ses dimensions ne s’obtient pas au détriment de celle qui devrait également prévaloir dans une autre. Le troisième problème est de savoir si l’efficacité se mesure, en politique, comme un simple rapport entre une action et son coût budgétaire. Répondre à cette question est délicat, car même ceux qui admettent la possibilité d’établir un tel rapport savent que plusieurs modèles d’allocation de ressources concurrents existent pour accomplir une même action de façon juste et économe. Il faut donc trancher, et le faire à l’aide de critères éthiques ou idéologiques – ce qui revient à récuser la neutralité du chiffre. Le quatrième problème a trait à la relation entre efficacité et sens de l’action publique. Chaque domaine d’action publique (santé, éducation, justice, défense, sécurité, etc.) est directement lié à une valeur collective politique, qui est aussi un droit constitutionnel dont le plein exercice est, en régime démocratique, garanti par l’État. Or, cetype de valeurs résiste au découpage en variables et paramètres alimentant une statistique, qu’elle soit descriptive ou de gestion. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’associer un taux de réussite à la vie, à la liberté, à la démocratie, à la santé, au savoir ou à l’égalité n’a guère de sens. Il est bien sûr possible de saisir ces valeurs politiques en considérant les modalités sous lesquelles elles se traduisent sur un plan financier dans le cadre d’une politique publique qui actualise des droits civiques et sociaux (travail, éducation, santé, sécurité, justice, dignité, etc.). Ce que permet la quantification est alors une personnalisation de l’attribution des prestations déterminant qui peut recevoir quoi, dans quelles conditions, à quel niveau, pour quelles raisons, avec quels effets. Mais cette individualisation contribue à faire peu à peu s’évanouir la pertinence des questions relatives à ce qu’une politique publique change pour l’ensemble de la société.
216 L’assujettissement du politique au principe d’efficacité porte des conséquences qui s’observent aujourd’hui avec les lois sur l’Université, l’Hôpital ou l’École. Il conduit à justifier une action publique fondée sur un critère d’équité (servir les plus méritants) en abandonnant le principe d’égalité (au nom de son inefficacité avérée) ; ou d’établir une hiérarchie de préférences en écartant les mesures jugées les moins rentables (politiquement ou socialement) au profit de celles qui le sont plus. Ce qui s’estompe dans ces usages est le fait d’envisager la collectivité comme une communauté de destin. Une autre conséquence est la suivante : lorsqu’on gouverne en suivant des tableaux de bord détaillés, la pratique s’installe d’exercer une égale surveillance sur chacun des éléments déterminant la montée en charge et les effets d’une décision politique en établissant une sorte d’équivalence entre le tout (une valeur collective) et les parties qui le composent (les dispositions qui l’actualisent). Cette égalité de traitement du tout et de chacune de ses parties contribue à délier l’efficacité de tout contenu autre qu’une injonction à être efficace ; et cette injonction se réduit elle-même à l’observation de l’évolution positive d’un indicateur sans qu’il ne soit jamais nécessaire de savoir ce que cette évolution pourrait indiquer.
217 Le principe d’efficacité se présente aujourd’hui sous un autre nom : la performance (mesurée en gains de productivité et en économies budgétaires), portée par une maxime claironnée à tout va : l’Etat doit passer d’une logique de moyens à une logique de résultats. Mais sous ce changement terminologique se pose toujours la même question : peut-on réduire la dépense publique sans amoindrir le politique et restreindre les pratiques de la démocratie ? C’est cette question que l’usage compulsif qui est fait aujourd’hui du terme performance dans l’administration française permet d’ignorer.
Pirates
218 Depuis les pirates qui écument les mers de Somalie jusqu’au site de téléchargement libre « Pirate Bay », récemment condamné, et dont les logiciels comme Ipredator et d’autres vont permettre aux internautes de contourner les lois de la propriété, la question de la piraterie revient sur le devant de la scène. Allons nous sombrer dans un monde de pillage et de prédation générale ? N’était-ce pas la crainte de Carl Schmitt, le grand juriste du IIIe Reich, de voir les États terrestres, protecteurs de la sécurité et de la propriété, submergés par les puissances maritimes, libérales et océaniques ? Mais n’était-ce pas déjà le débat qui opposait Hobbes et Milton ? Et si la grande épopée de la flibusterie n’avait été que l’écume du même mouvement qui a fait la Réforme, avec la période de guerres terrestres et maritimes qu’elle ouvre et jusqu’à la révolution puritaine anglaise ? Cette idée nous vient à lire la fameuse Histoire générale des plus fameux pirates publiée en 1724 à Londres par un mystérieux Captan Johnson dont le grand historien anglais Christopher Hill a montré qu’il n’était autre que Daniel Defoe, l’auteur de Robinson Crusoé.
219 C’est que très vite le trop vaste empire espagnol et catholique, avec ses conquistadors qui rapportent chaque année la flotte de l’or, est apparu comme le grand pilleur. Et comme aujourd’hui les USA, il doit lutter contre tous pour assurer son hégémonie : il s’agira de piller le pilleur, de le butiner. Mais il y a aussi que l’océan est en phase avec la nouvelle théologie. C’est que sur l’océan il n’y a plus ni roi ni pape, on est seul avec Dieu, on a tout quitté. Obligés de vivre chaque jour sans être trop assuré du lendemain, on sait vite qu’il est impossible de s’approprier la mer, de la retenir entre ses doigts. Les individus cependant sont ainsi déliés pour contracter des alliances nouvelles, des libres alliances : le droit de partir est la condition du pouvoir de se lier. Et la grande question politique deviendra alors peu à peu « comment rester ensemble » alors qu’on peut toujours partir, se délier.
220 Les corsaires protestants ont donc été lancés à l’assaut de l’empire catholique espagnol, qui s’était arrogé la plus grosse part du nouveau monde. Gaspard de Coligny, amiral de France à partir de 1552, et devenu chef du parti protestant, est l’un des premiers à comprendre la nouvelle situation géopolitique. À partir de 1562, et jusqu’en 1628 c’est La Rochelle qui deviendra la véritable capitale du parti huguenot. Pour prendre un exemple, les corsaires de Henri IV lui rapporteront 800.000 écus or dans l’année. Même histoire aux Pays Bas, où « les gueux de la mer » chassent le Duc d’Albe envoyé en 1566 par Philippe II – le mot flibuste vient de l’hollandais Vryjbuiter « libre butiner ». Dès son accès au trône en 1558, Elisabeth 1ère d’Angleterre protège les forbans et les contrebandiers anglais, et arme elle-même de grands corsaires qui seront bientôt appelés les chiens de la mer, Raleigh, Drake et les autres.
221 Mais la véritable apothéose de la piraterie protestante vient avec la montée et l’échec de la révolution anglaise de Cromwell, dans la dispersion de tous ces puritains radicaux que sont les Levellers, Diggers, Ranters et autres Quakers. On peut évoquer la « plantation » par Roger Williams de la colonie de Providence dans Rhode Island, dans les années 1630, où il accueille les Quakers pourchassés. Dans les années 1630, la Providence Island Company (dont le trésorier John Pym, puritain fervent, est l’âme de l’opposition à Charles 1er) s’empare d’une île des Caraïbes pour en faire une terre d’asile pour les dissidents religieux. Puis en 1655 l’amiral William Penn (le père du Quaker) sur ordre de Cromwell, s’empare de la Jamaïque, qui devient le grand centre de la flibuste. Voilà ce qu’écrivait Winstanley, en 1652 : « Au commencement des temps, le grand créateur, la Raison, fit de la terre un trésor commun afin de subvenir au besoin des bêtes sauvages, des oiseaux, des poissons et de l’homme. Au commencement, il n’était soufflé mot de la domination d’une espèce humaine sur les autres. Mais, dans leur égoïsme, certains imaginèrent d’instituer qu’un homme enseigne et commande à un autre. Et il advint que la terre se hérissa de haies et de clôtures du fait de ceux qui enseignent et gouvernent ; des autres, on fit des esclaves. Et cette terre où la création avait entreposé des richesses communes à tous, la voici achetée et vendue ».
222 Le temps des flibustiers est ouvert, et particulièrement dans les Caraïbes il fleurit entre 1630 et 1670. C’est une société de rescapés, de proscrits et de dissidents. Ils ont appris des indiens à boucaner, sécher la viande et tanner le cuir, ainsi que l’usage des plantes médicinales ou du tabac ! C’est que dans les nouveaux mondes, tout est offert à profusion par la divine Providence. On pourrait même aller jusqu’à dire que les boucaniers rouvrent certaines formes très archaïques des sociétés de cueillette et de chasse, qui se figurent le monde en termes d’itinéraires, de butinages racontés et de pactes, et non d’espaces enclos. La figure biblique de l’alliance permet d’ailleurs de repenser le rapport aux autres, au monde et à Dieu comme série de pactes. Surtout on n’est plus dans une économie du don et de l’échange, mais de la « prise », que l’on retrouve jusque dans le titre d’un livre du philosophe hollandais Grotius Le droit de prise. La tempête de l’histoire a brisé tous les liens, et le bateau pirate c’est l’utopie multireligieuse et multiraciale d’une libre adhésion, après la tempête, même si on s’y donne des règles plus dures, comme dans une anti-réalité. Mais la règle des règles reste le droit de partir : après la bataille, un pirate peut toujours quitter librement son équipage en demandant sa part du butin.
223 Toutes ces idées nous viennent du grand poète de la révolution puritaine, Milton, l’auteur du Paradis perdu, mais aussi l’inventeur du divorce par simple consentement, et celui qui a justifié le régicide pour rupture du pacte politique. C’est l’inventeur du droit de rompre. Parce que sur l’océan tout se délie, que tout est sans cesse délié, il faut repenser les amarres, les attaches, les cordes, les nœuds, et les pactes. Milton c’est la pensée de cette nouvelle société en archipel, incapable de s’installer, toujours prête à recommencer ailleurs, par opposition à l’État-Nation, terrestre et centralisé, dont le philosophe Hobbes, partisan de la monarchie, fait alors l’éloge face au désordre des mers.
224 Il y une suite contemporaine à cette épopée : le mouvement des logiciels libres, à l’origine de l’Internet comme utopie « politique », qui a enthousiasmé une génération entière de pionniers, avant la guerre que livre les grands monopoles informatiques aux « hackers ». Comme si le capitalisme devait bifurquer entre une logique de travail mais aussi de propriété cumulative (les grandes industries culturelles qui protègent les droits d’auteur), et une logique de prédation marginale mais aussi d’appropriation forcée (les fournisseurs d’accès à tous les réseaux). Et c’est aussi toute la question juridique et politique de l’évolution des États face à la mondialisation qui liquide les vieilles frontières : les pirates rôdent au ban de nos sociétés, renforçant notre désir de sécurité à tout prix.
Pollen (crise des transports)
225 On peut y être allergique, mais son abondance est plus qu’un symbole. Elle va de pair avec la vie tout court. Souvent nomade au gré des vents, le pollen de nombre de cultures dont l’espèce humaine dépend fortement, a besoin d’être transporté à bon port. Pour rétribuer sa course, les plantes offrent leur nectar aux convoyeurs. Le bourdon et l’abeille sont les plus connus. Sans cet incessant transport, la vie s’arrête, le concombre dégénère, les caféiers perdent 35 % de leurs cerises, les pommiers et les amandiers 100 % de leurs fruits, le tournesol pique du nez, le sainfoin fane.
226 L’abeille se nourrit du nectar, elle le rapporte à la ruche pour nourrir ses larves et se garder de la mauvaise saison. Cigale et fourmi à la fois. De quoi mettre d’accord les moralistes et les économistes. Abeille prévoyante, n’est-elle pas l’emblème des assurances ? Sa piqure qui lui coûte la vie n’est qu’une ultime défense. Pas comme la guêpe, cet éboueur des carcasses. La fourmi est travailleuse mais acide, la cigale tapageuse, l’abeille a longtemps fourni la cire (donc la lumière dans la nuit) et surtout la douceur du miel. Nous révérons l’abeille, même si nos économistes, mauvais entomologistes n’ont d’yeux que pour le travail de la fourmi et la consommation de la cigale.
Quiproquo fertile : la pollinisation
227 Mais une autre vie bien plus vitale se joue dans ce ballet. Le grand quiproquo de la pollinisation. On croit faire quelque chose, mesurer son temps, son effort, mais autre chose se fait dans le même plan à autre échelle ou sur un autre subtilement superposé.
228 Qui produit quoi et pour qui ? L’abeille produit de la cire et du miel pour elle et sa descendance, pour les ours aussi et pour ce prédateur apprivoisé qu’est l’apiculteur (labor improbus omnia vicit, le travail malhonnête a raison de tout, Virgile). Mais à côté de son travail, elle produit quelque chose de mille fois (au sens strict) plus précieux : la flore de la biosphère, donc la faune, donc nous.
229 Mais, alors tout va bien. Cousons sur le drapeau de l’Europe douze abeilles au lieu des étoiles arrogantes. Napoléon l’avait fait sur sa robe de sacre, soucieux de remplacer le lys de la monarchie et le bonnet phrygien de la révolution. Le dessein majestueux de la vie s’accomplit à l’insu du plein gré des abeilles. Sublime, forcément sublime même si cette finalité sans fin se joue de leur travail puisqu’un autre travail (conception, accouchement) opère. La mesure de ce tout autre travail (création, œuvre, tout soin du vivant) défie la mesure.
Crise dans la pollinisation
230 Seulement voilà. Il y a quelque chose de pourri au royaume du pollen. Le transport n’y est plus. Désenchantement du monde à la Marcel Gauchet ? Pas du tout. Prenez le transport au sens propre. Les abeilles sont décimées. Les causes se bousculent au portillon, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas comme conclut le lobby agro-industriel. Gentil Gaucho, suave Régent (ces désherbants et autres insecticides) y sont pour quelque chose. Manipulations génétiques ratées qui, pour protéger d’une maladie, ont bloqué à un autre bout du système complexe des gènes un mécanisme qui protégeait les abeilles d’un parasite avec qui elles avaient vécu depuis des millions d’années ? Virus peut-être sorti d’élevage industriel d’essaims désormais reproduits pour pallier leur raréfaction naturelle du fait de la disparition des jachères mellifères ? Introduction imprudente sur le continent américain d’abeilles africaines ? Ondes sur toutes les longueurs pouvant troubler l’orientation magnétique des butineuses ? On se perd en conjectures comme écrivaient les gazettes.
231 Le résultat est là : à partir de 2006 le syndrome de disparition (Colony collapse disease) frappe les États-Unis et pas mal de pays du monde entier (dont l’Europe). Le parallèle avec les formes de grippe est frappant. A ceci près que les dégâts provoqués par la perte de ces convoyeuses pourraient s’avérer moins réparables que ceux de la grippe espagnole.
232 La situation est sérieuse. Pire que le réchauffement climatique. Sans les transports de la pollinisation nous répéterons après Yves Bonnefoy : Demain encore, régnant désert !
233 Cette crise a au moins trois morales.
234 Le transport et la mobilité sont le nerf de la vie. Honorons les nomades, ce n’est pas nous qui leur réservons une place au banquet de la vie, c’est eux qui nous permettent d’y prendre place.
235 Ce qui est réellement productif n’est pas ce qui brille (argent bien sûr mais aussi cire ou miel) ou qui se voit ou qui pèse. L’important est subtil et léger comme l’air.
236 L’ouvrage de création, d’invention (dont celui de la vie tout court) est fragile, complexe. Nul n’entre ici avec les gros sabots du tracteur industriel et de la comptabilité pour qui n’existe que ce qui rentre dans le bilan. Pour sortir de la crise prêtons davantage attention au circuit du pollen qu’à celui des marchandises même si ces dernières ont le goût de miel.
Pyramide
237 Il existe certains égyptologues (très) hétérodoxes pour affirmer que les pyramides de Gizeh ont été construites en commençant par le haut et en construisant à l’envers les niveaux intermédiaires des plus élevés aux plus bas. Si ces archéologues avaient raison, les architectes du Pharaon auraient alors devancé de bien des siècles les hommes d’affaires madrés qui utilisèrent, pour escroquer des particuliers, des banques, des fonds d’investissement, des systèmes de vente pyramidale parfois qualifiés de « chaînes de Ponzi » – du nom du célèbre promoteur de coupons-réponses internationaux qui, dans les années 1920, finança le retour sur investissements des premiers adhérents à son opération de spéculation par le capital des nouveaux arrivants.
238 Récemment, un vaillant architecte de pyramide à l’envers fut l’illustre Bernard Madoff, ex-maître nageur désormais bien connu, supposé grand ponte du Nasdaq des années quatre-vingt-dix, homme de confiance de nombreux riches et puissants de ce monde, qui promettait des bénéfices de 8 à 12% garantis par an (poussant jusqu’à 17%) sur de longues périodes. La confiance qu’inspirait ce talentueux bâtisseur de pyramides, juché au sommet de son ouvrage, lui a permis, depuis les années 1960, de recruter des adhérents toujours plus nombreux, élargissant progressivement la base de son monument financier, en reversant aux membres plus anciens des bénéfices qui n’étaient autres que les sommes récemment confiées à ses soins par les plus récents, dans l’attente de retours sur investissements qui ne pouvaient bientôt plus découler que d’une base de clients à venir, toujours en extension. On dit, chez les économistes, que la limite d’une chaîne de Ponzi, est rapidement atteinte lorsque la base de la pyramide devrait, pour que l’affaire se montre toujours rentable et que les nouveaux arrivants reçoivent exactement leur dû, excéder la taille de la population mondiale.
239 Bernard Madoff n’est (heureusement) pas parvenu jusqu’à ces dimensions-là… Son bel hedge fund qui était censé lui assurer la propriété, au cœur de la chambre secrète de sa pyramide, de suffisamment de liquidités pour être solvable, ne se révéla contenir au final que des caisses vides, déjà pillées, lorsque la pyramide chancela par le haut. Car, au contraire d’une authentique pyramide humaine de danseurs, d’athlètes, de gymnastes, la pyramide d’un montage financier, la tête en bas, tombe par le haut, ou bien par le milieu. Si d’anciens clients se retirent soudain en réclamant ce qui leur est dû, ils court-circuitent violemment la belle construction, déjà menacée par la base instable de ne plus trouver de nouveaux adhérents afin de financer les précédents.
240 Les pyramides de Ponzi, de Madoff, celles des banques albanaises qui, en 1997, provoquèrent les émeutes meurtrières dont on se souvient, nourrissent un homme seul ou une entreprise unique au sommet, par l’élargissement constant de leur fondement. Et, lorsqu’il n’y a plus de nouveau rez-de-chaussée pour nourrir le premier étage qui nourrit le deuxième, et ainsi de suite, tout se retrouve piteusement par terre, et personne n’y mange plus rien.
241 Si les bâtisseurs de pyramides à l’envers cristallisent aujourd’hui la colère médiatique, qualifiés de malfrats, de profiteurs, stigmatisés comme les canards boiteux d’un système normalement valide et solide, il faudrait aussi voir ces constructeurs de châteaux dans le ciel comme les artistes maudits de ce dont une économie capitaliste est toujours l’art. Comme le reconnaissait déjà Adam Smith : l’élargissement de nouveaux marchés, de pays émergents, par exemple, à qui l’on promet l’enrichissement pour payer l’accroissement plus important de la richesse des précédents, qui paient eux-mêmes pour les consommateurs anciens trônant fièrement à la pointe, de sorte que tout le monde grimpe, mais que la montée de la base sert à l’élévation plus importante encore du sommet. Car toute économie de marché pousse par la base et grimpe par son élargissement jusqu’aux limites, sans doute, de la population mondiale, des marchés disponibles, des masses exploitables (si on raisonne comme Marx) ou (si on pense comme Schumpeter) des innovations technologiques envisageables. Reste à savoir si l’ensemble a la solidité des pyramides de Gizeh, qui ne bougent plus depuis longtemps dans le sable d’Égypte, ou de celles de Madoff, qui se sont rapidement effondrées.
Relance (rejet)
242 À écouter ce qui se dit tout autour de nous, vivre une « crise » équivaudrait surtout à attendre « une relance » (version « de droite »), voire à la précipiter par des interventions étatiques (version « de gauche »). Prime à la casse pour relancer l’industrie automobile ; voyages présidentiels pour aider nos industries (nationales) à « gagner des contrats ». Qui peut s’opposer à ces efforts de « relance », dès lors qu’ils visent à « réduire le chômage », « augmenter le PIB » et le « pouvoir d’achat » ?
243 Et si c’était tout ce vocabulaire de la « relance » qu’il faudrait apprendre à rejeter ? Que vendent les présidents, hier hérauts du marché libre (« de droite »), aujourd’hui harmonieusement reconvertis en hérauts de l’activisme étatique (« de gauche ») ? Surtout des centrales nucléaires, des avions, des armes… Qui en appelle à une levée de boucliers contre le scandale absolu de l’exportation tous azimuts du nucléaire ? Qui rejette cette relance comme un jeu de roulette russe planétaire ? Qui prend la peine de dire l’évidence : que les armes font plus de mal à ceux qui les portent et qui en sont visés, qu’elles ne font de bien à ceux qui les exportent et en font leur gagne-pain ? Que le nucléaire ne « réduit l’effet de serre » qu’en nous préparant des catastrophes parfaitement certaines (à l’échelle des millions d’années impliquées par leur durée de vie mortifère), aussi dangereuses que la montée des océans ?
244 Entre la relance de « l’économie » et le rejet de mort dans notre environnement, c’est à la même roulette russe planétaire que jouent droite et gauche en un parfait consensus. C’est ce consensus de la relance qu’il faut rejeter. C’est au jet de nouveaux dés qu’il faut procéder, c’est à de nouveaux risques qu’il faut apprendre à s’exposer : non plus les risques certains de la roulette écologique, mais les risques assumés de la roulette politique. Dire ce que personne n’ose dire sans « se suicider politiquement ». C’est de ce suicide de la politique (obsolète et suicidaire) que naîtront de nouvelles perspectives de survie, d’action et d’émancipation.
Reporting (confession)
245 Peut-on lier la crise à un type de normativité, c’est-à-dire à une manière de gouverner les hommes et leurs comportements, à un mode de gouvernement qui consisterait dans une activité constante de reporting ? Un tel mode de gouvernement ne serait en crise que dans la mesure même où il résiste aussi à la crise, protégé de celle-ci par une sorte d’indifférence, non pas du tout morale bien sûr mais structurelle. Faire rapport permet en effet de gouverner à partir du réel recueilli, plutôt que de gouverner directement le réel. Ce qui permet ainsi une indifférence structurelle du gouvernement par le rapport, c’est une absence d’hypothèse, voire de concept : le gouvernement par reporting ne connait pas la crise dans la mesure où il ne repose pas sur un concept, sur quelque chose comme une proposition ou une valeur qui pourrait devenir le lieu ou l’objet de la crise. Il se contente apparemment de décrire. La question n’est pas de se plaindre a priori d’une telle absence (a fortiori étant donné qu’il s’agit avant tout de la manière par laquelle le gouvernement se pense et se légitime, bien plus que de sa réalité), mais de pointer le danger qu’il y aurait à conclure, sur cette base, qu’il n’y a dès lors pas de gouvernement (et donc pas de crise de celui-ci). Au contraire, il s’agit bien de la sorte, via cette absence, de gouverner, et peut-être même de gouverner à outrance (en ce sens, aucun rapport n’est jamais seulement descriptif). Mais cette action de gouverner ne se présente plus ainsi comme l’expression d’un projet. C’est même cela qui justifie qu’il s’agit là d’une forme outrancière de gouvernement : débarrassé de son projet, gouverner perdrait même les limites inhérentes à tout projet. Gouverner quelque chose est comme tel une activité qui présente des limites, des limites qui lui viennent au minimum de son caractère transitif dans la mesure où cette transitivité induit l’expression d’un projet, d’un cadre. À l’opposé, le gouvernement contemporain serait potentiellement sans limite, dès lors qu’il n’est plus transitif et qu’il peut se passer de tout projet, c’est-à-dire dès lors qu’il s’agit de gouverner à partir de ce qui se fait, ou encore à partir de ce qui se rapporte.
246 Dans son Histoire de la sexualité, Michel Foucault soulignait que le sujet ne devait pas être pensé comme préexistant à ses discours, mais comme le résidu d’un discours qu’il était tenu d’avoir sur lui-même : il s’agissait précisément de penser le langage même descriptif comme un discours, un acte par lequel du pouvoir circulait. La question de la subjectivité était posée là à partir de l’envers du problème philosophique classique. Non plus : comment la subjectivité peut-elle fonder la connaissance de la vérité ? Mais : quelle expérience le sujet peut-il faire de lui-même, dès lors qu’il existe historiquement sur lui un certain discours de vérité et une certaine obligation de s’y lier ? Foucault opère ainsi un triple déplacement, du thème de la connaissance vers celui de la véridiction, du thème du pouvoir comme domination vers celui de la gouvernementalité, du thème de l’individu vers celui des pratiques de soi, et il noue ces trois thèmes dans son analyse du pouvoir pastoral. L’obligation de tenir un discours sur soi est un mode de gouvernement qui produit des effets de doute sur le sujet, effets de doute sans cesse renouvelés (« Qui suis-je vraiment ? ») dont le sujet lui-même émerge.
247 Ce gouvernement par l’aveu avait les limites suivantes : il se déployait à partir d’une série de centres (le confessionnal, la prison, le divan), réclamait quelques références compliquées (Dieu, la conscience…) et surtout il était pieds et poings liés avec cela même dont il manifestait l’émergence, à savoir le sujet humain. Le gouvernement contemporain relève encore de cette même matrice de la véridiction comme mode de gouvernement et de subjectivation, mais il s’est émancipé des quelques limites signalées ci-dessus : il n’y a plus de centre, plus de référence, plus d’exclusivité humaine. Avec ce dernier dépassement, il ne s’agit bien sûr pas de se débarrasser de la force individualisante du gouvernement, mais seulement de ne plus réserver cette force aux seuls individus humains, de manière à individualiser potentiellement tous les aspects du réel, des plus collectifs aux plus fragmentés. Désormais, non seulement les individus, mais aussi les parties d’individus (chaque geste, chaque comportement) et les groupes d’individus seront l’objet d’une confession propre. L’aveu circule, exigeant de tous un rapport à soi et subjectivant toute instance susceptible de faire rapport sur elle-même. Les gestes, même les plus banals, ne sont plus pensés comme les gestes de tel individu mais sont rapportés, tracés, comptés, corrélés à d’autres gestes, produisant ainsi incessamment la matière même du gouvernement et du contrôle des comportements. Les collectifs eux-mêmes (des entreprises responsables aux centres de recherches évalués…) sont pris dans des processus de subjectivation comparables à l’aveu chrétien : ils promettent, rendent compte, comparent leurs bonnes pratiques, sont évalués, remis à leur juste place par d’autres rapports, parfois même poursuivis pour diffusion d’informations trompeuses ou pour publicité mensongère. Comme dans la pastorale chrétienne, une pression existe qui pousse « chacun » à la confession et un soupçon entoure chaque aveu d’être incomplet ou travesti par complaisance. Le régime qui prévaut est encore celui de la véracité ; un régime qui met en jeu la qualité de vérité des choses seulement depuis les qualités du sujet qui la dit, c’est-à-dire depuis ses engagements, ses promesses, les traces qu’il accepte de laisser. Plutôt que de gouverner directement les comportements, avec les décisions que cela réclame à leur sujet, l’enjeu de la norme sera la communication sur les comportements. La véracité est l’élément discriminant dans un monde gouverné par la transparence et la responsabilité, dans la mesure où chacun n’y est plus redevable que de ce qu’il a dit, c’est-à-dire de ce qu’il a bien voulu dire. C’est à partir de cette volonté supposée à la source de tout rapport et de toute trace que s’exerce un contrôle diffus. Le compte rendu n’est pas ou pas seulement considéré comme « vrai », adéquat – ou faux et inadéquat –, mais comme trahissant un rapport du sujet à lui-même et comme tel, révélateur de son être ou de sa morale. Se déployant horizontalement, sans la transcendance d’une valeur ou d’une vérité, les confessions s’affrontent, comme s’affrontent de purs rapports à soi, transparents ou opaques.
248 Hors de toute normativité prédéfinie (pré-vérifier), et même de manière à échapper aux hypothèses que réclamerait la définition de normes communes (avec à la fois les conflits et la déresponsabilisation qui en résulteraient), chaque collectif, chaque individu, chaque comportement est désormais l’objet d’un reporting constant. Chaque geste est engagé par des rapports sur la base desquels d’autres rapports sont faits, en écho et en corrélation, tel un gigantesque confessionnal. Dans celui-ci, l’enjeu normatif lui-même devient l’objet d’un marché (le gouvernement), au moment même où l’on croit que le marché devient l’objet d’une question morale (la crise).
249 Qu’est ce donc que « la crise » quand elle ne peut être celle des hypothèses ou des projets du gouvernement ? Ne serait-ce pas celle de l’accroissement le plus absolu d’un moralisme contemporain, celle qui résulte du moralisme sans valeurs à l’œuvre dans l’ère du rapport ? Une crise au sens d’acmé : le point culminant, le plus aigu, d’un processus vieux comme le christianisme, mais qui s’est généralisé à ce qui apparaissait, auparavant, comme non subjectivable ni, par conséquent, moralisable. Tel serait le paradoxe qui lie le gouvernement à la crise : s’il y a crise, c’est à la mesure d’un gouvernement qui gouverne d’autant plus qu’il semble se passer de toute hypothèse de gouvernement, comme si seules les hypothèses avaient pu être l’objet de la crise.
Ressources
250 Alors que les ressources naturelles commencent à manquer, les ressources humaines sont déclarées en excédent. L’exploitation n’est plus inscrite dans la nature comme un rapport de dette réciproque. Le mineur n’a plus de mine à creuser, ni sous ses pieds ni ailleurs. La consommation ne suffit plus à mettre en œuvre le capital. La spéculation s’emballe. La pauvreté s’installe.
251 Avoir de la ressource, ni humaine, ni naturelle, mais les deux, c’est avoir de la capacité d’agencer, de mettre en valeur, de relier. Les ressources se mettent en mouvement au-delà de leur transport à pied d’œuvre, parcourent les chemins de l’imagination loin du temps imparti au travail. Pas besoin de les exploiter, de les connaître directement, il suffit de se les représenter, de connaître les procédés, de les modifier, de chercher, de mettre en valeur.
252 Le malthusianisme recule devant les hypothèses d’une économie qui trouve d’autres vecteurs de l’échange que le seul langage de la monnaie. Dans les systèmes d’échanges locaux, les services se multiplient, avec les équivalences possibles. Le revenu, détaché de l’assujettissement individuel au travail, investit dans la création de ces capacités inventives.
253 Dans la production distribuée chacun à la ressource d’agencer ses dispositions à celles des autres, d’articuler son individualité aux dispositifs collectifs de l’intellect généralisé. Sur les ressources qui restent, qui abondent, un autre monde est à construire.
Retour (au réel)
254 « Retour au réel par la case désastre » ? Ce titre d’un éditorial du Monde des 12 et 13 octobre 2008[39] [39] Le Monde, 12 et 13 octobre 2008, « Retour au réel par…
suite, alors qu’explosent au cœur de nos sociétés les bombes spéculatives déposées dans les palais boursiers, est le merveilleux symbole d’une étrange maladie de la pensée. La crise réveille chez les commentateurs la nostalgie d’un passé merveilleux, qu’ils idéalisent alors qu’ils ne l’ont pas ou pas vraiment vécu.
255 L’illusion magistrale est de croire possible quelque « retour au réel », comme s’il pouvait y avoir un bon réel, celui d’hier par exemple, et un mauvais, tel que sali par les jeux d’argent de notre temps et leurs virtualités. Comme si l’on pouvait extirper de notre glue de réalité contemporaine un réel tangible, compréhensible, appréhendable via notre intellect, voire saisissable par nos doigts de main ou de pied !
256 Le réel d’aujourd’hui n’a rien à voir avec le réel d’hier. La lettre du réel – c’est-à-dire son expression concrète – se réinvente sans cesse par la grâce de nos imaginaires. Y « retourner » serait au mieux y retrouver un esprit pour orienter et participer à la réinvention, éternellement recommencée, d’un réel plus réel que le réel…
257 Pourtant, toujours dans Le Monde en ce même mois d’octobre 2008, le philosophe Alain Badiou écrit : « Le retour au réel s’impose »[40] [40] Le Monde, 18 octobre 2008, « De quel réel cette crise…
suite. Dans son article « à chaud », il décrit la crise financière tel un « film catastrophe » avec happy end. Badiou qualifie de « réelle » la vie des spectateurs de ce navet aux conséquences désastreuses. Il sépare l’irréalité des dominants, dans leur bulle d’abstraction financière ou politique, de la réalité des « gens », confrontés à la rage de dents du gamin, à la panne de la voiture ou au régime de nouilles pour cause de porte-monnaie troué. Cette vision romantique a quelque chose de séduisant, surtout pour le quidam se voulant vaguement de « gauche ». Au premier regard, elle ressemble à celle d’un auteur de science-fiction tel Philip K. Dick[41] [41] La référence à Philip K. Dick se justifie d’autant…
suite, grand inspirateur de films comme Blade Runner ou Minority Report, dont les personnages sont des gens de rien. À l’agent trop servile de l’administration ou au patron de multinationale gouverné par son profit, il oppose les figures du clochard sidéral, du potier intuitif ou du gosse des rues qui bidouillent sa radio. Parfois même, il renverse le cliché qui oppose le réel populaire à l’irréel du pouvoir. L’homme du peuple a tôt fait de se transformer en homme-machine, gouverné par quelque mécanique, tandis que le chef d’entreprise et le chasseur de primes, par les ressorts de l’empathie, tombent parfois dans des méandres d’humanité qui semblent sacrément réels… Là où le « retour au réel » de Badiou se pose comme un impératif de bon sens, voire de sens commun, il n’est chez les anti-héros de Philip K. Dick qu’un rêve impossible.
258 Ce réel, auquel il s’agit de retourner, est-ce celui de l’homme de Cro-Magnon ? Ou celui du Monde, lorsqu’il titre sur une image : « Hiroshima : ce que le monde n’avait jamais vu »[42] [42] Le Monde, 10 mai 2008, « Hiroshima : ce que le monde…
suite, avant d’expliquer trois jours plus tard que cette photo du plus grand charnier nucléaire de tous les temps n’était peut-être qu’un leurre ? Cette photo, donnée pour vraie une première fois, puis mise en doute, n’était – semble-t-il – qu’une image des ravages d’un tremblement de terre de 1923 autour de Tokyo[41] [41] La référence à Philip K. Dick se justifie d’autant…
suite. Issue d’une collection de la vénérable Hoover Institution de l’Université de Stanford et validée par la publication du livre d’un historien américain avant que l’institution et l’historien ne se déjugent face aux réactions de leurs pairs japonais, elle semblait non seulement crédible mais attendue, donc d’une certaine façon légitime. Elle vivait dans la tête de milliers, de millions de lecteurs potentiels. Au-delà de son identité tragique, du nom d’une ville japonaise explosée par l’histoire, cette photo impossible en devient une icône floue : non pas celle d’un désastre précis, mais celle de cet « accident des connaissances » ou de cet « accident intégral » que Paul Virilio a décrits mieux que quiconque. Dire de l’image de Hiroshima, publiée par le Monde, qu’elle n’est pas réelle serait absurde. Son être fantôme en fait bien au contraire l’essence du désastre.
259 Voilà pourquoi les appels au « retour au réel » sonnent selon moi comme la sirène d’une armada de pompiers. À l’instar du Monde, les nouveaux pompiers du « revival » de la bonne morale économique croient encore, ou font semblant de croire, qu’il est possible de piloter notre monde de fictions par le biais d’un réel identifiable, cernable, mesurable à l’aune de nos dix doigts. Ils agissent comme s’ils pouvaient taper à la porte du ciboulot de chaque « trader », de chaque spéculateur, afin de leur expliquer, en leur galaxie de casinos boursiers, les bienfaits de la vertu ascétique, ô combien terrestre. Qu’ils en aient conscience ou non, le retour que nous chantent ces moralistes pesants fleure bon le bonheur indépassable de la mine de charbon, de l’effort physique et du métro boulot dodo. Ces ennemis de l’imaginaire pensent pouvoir être entendus par quelque introuvable responsable de l’apocalypse financière. L’idée qu’ils pourraient eux-mêmes travailler à réinventer le réel leur échappe totalement. Contre l’abstraction si redoutable de l’argent qui crée de l’argent, qui crée de l’argent, qui crée de l’argent, etc., ils se veulent des sages. Tout pleins de leurs vérités, les voilà qui s’engouffrent dans une machine à voyager dans le temps. Ils désirent corriger le passé dans le « bon sens » : celui du réel, ou plutôt de leur vision du réel. Et sans même s’en rendre compte, ils ajoutent des fictions réactionnaires à la fiction délétère des temples boursicoteurs…
Révolution
260 À chaque crise, le business éditorial nous gratifie de toute la variété des solutions connues. Il est entendu que les changements à apporter sont d’ordre 1, pour paraphraser les psychothérapeutes de Palo Alto : pour être éligibles au titre de solutions plausibles, ils doivent ressortir entièrement à la gamme des solutions existantes, ou encore pouvoir s’effectuer entièrement à l’intérieur des coordonnées définies par le système lui-même : être adéquats à sa reproduction. « Plus de la même chose » définit le type des changements tolérables du point de vue interne. Or le propre de ces changements est de déplacer le problème, voire de l’aggraver au lieu de le résoudre.
261 La crise est la pulsation spécifique du capital. L’incertitude de marché et les échecs concomitants en sont le pain quotidien. Le fléchissement chronique de la rentabilité (hausse anomale de la masse salariale), comme l’épuisement des filons de besoins et, partant, des usages engendrés par le bouleversement capitaliste des conditions de production d’anciens usages (crise de la demande), est une caractéristique génétique de ce système. La suraccumulation chronique n’est que le défaut chronique d’accumulation rentable, pour synthétiser en une formule le problème de la demande finale et celui de la cost-pushed crisis. Or la pathologie financière est inhérente à la crise, dont elle n’est qu’un aspect. Il n’y a pas l’économie réelle d’un côté, la monétaire de l’autre ; pas à reconduire l’économie dans les ornières de la production, comme si le problème était de fourguer plus de camelote dans le contexte de l’épuisement de la biosphère. Les méchants spéculateurs ne sont pas d’une race différente de celle des gentils investisseurs qui fournissent de bons emplois. La raison, fort simple à quiconque fréquente quelque peu Le Capital, en particulier le chapitre XV de la section IV du livre I consacrée à la plus-value relative, est que le capital en personne, précisément, ne produit aucune richesse, contrairement au vulgaire racontar amplement répandu, si, par richesse, on entend capacité corporelle, technique, art de faire et, éventuellement, artefact. Le capital, loin d’être lui-même technicien, machinise des dispositions techniques en les excorporant. Seule la force de travail idoine au service de sa machine lui est convenable, comme série d’éléments interchangeables (Sartre l’avait bien vu), et non le corps des producteurs, points de vue indispensables au monde qu’ils constituent. Le capital ne produit donc que de la valeur, c’est-à-dire des heures de travail commandées monétairement, qui sont, partant, la mesure de son pouvoir. L’amoncellement démentiel de pacotille qui passe aux yeux des ilotes comme un exploit de cette « civilisation » n’apparaît comme masses d’usages qu’à quiconque est incapable de percer l’apparence en direction de l’essence pour ne trouver dans ces prétendus usages que le reflet de la valeur.
262 La crise financière n’est qu’un aspect de la crise constitutive du fonctionnement capitaliste. Il n’y a donc pas de pathologie financière d’un système par ailleurs équilibré. La crise « réelle » et la financière ne s’enchaînent pas selon une séquence bien réglée. Le fléchissement généralisé de l’accumulation rentable s’accompagne du gonflement de la bulle financière. Comme Pierre-Noël Giraud l’a très bien définie[43] [43] Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, Paris, Seuil,…
suite, cette bulle est la promesse d’écroulement du commerce des promesses. Le marché des titres mobiliers est le marché des promesses de revenus futurs. The last to take off is the winner, c’est-à-dire que le dernier agent n du marché en question à persuader un autre spéculateur (n+1) qu’il sera apte lui-même à persuader le spéculateur suivant (n+2) d’acquérir à la hausse des droits sur les revenus engendrés par l’activité future est gagnant : il retire ses billes juste avant que n+1 ne se rende compte qu’il s’est porté acquéreur de monnaie de singe.
263 À mesure que l’investissement productif (de valeur et de plus-value) cesse d’être rentable en général (crise de l’accumulation), les capitaux se réfugient aussi nécessairement que le soleil se lève dans la sphère du capital fictif, ce marché des promesses de revenus –futurs. Seulement, pour que ces promesses se réalisent, il faut que les marchandises pourvoyeuses dudit revenu futur non seulement se produisent, mais « se réalisent », c’est-à-dire se vendent. Or, comme les investissements productifs se fuient précisément parce que les capacités d’absorption rentable par le marché diminuent, il n’y a pas plus, mais encore moins de revenus futurs raisonnablement escomptables qu’il n’y en a à tirer de la production présente. La bulle est le symptôme de l’incubation et le signe avant-coureur de la phase aiguë, de la crise en personne. Cette dernière intervient avec le refus, chez les créanciers indirects (la banque), de consolider la dette ; le refus de continuer de détenir des titres chez les créanciers directs (agents des marchés de titres) est concomitant. L’heure de la crise a sonné, qui procède à la purge périodique du capital : tous les effets suscités par la monnaie de crédit s’interrompent en l’absence prolongée de demande finale. Lipietz recourt toujours à l’image de l’oiseau qui, dans le dessin animé américain, pédale dans le vide avant de tomber dans l’abîme : cette image est l’image exacte de la crise.
264 Que vient faire la révolution là-dedans ? C’est l’autre nom de la crise. À ce titre, rien de plus qu’une catégorie du capital. Il est encore temps d’abandonner l’idée que la révolution produira la fin de la révolution, cette aliénation ajoutée à l’aliénation, pour le dire à la Lévinas. La révolution, le capital l’opère tous les jours sous nos yeux en modifiant continûment, voir en bouleversant épisodiquement les conditions de production. Or le communisme est l’ensemble des socialisations locales, relationnelles (Beziehungen) et non fonctionnelles (Verhältnisse, ou rapports, précisément les fameux Produktionsverhältnisse imputés par Marx lui-même au capital). S’il a des chances de perdurer à travers la catastrophe de la catastrophe (sic) qu’est le camp agambénien comme nomos moderne de la politique, il faut en débarrasser l’imaginaire de tous les hochets modernes. À ceux-ci succéderont les notions d’éclosion parasitaire et de sabotage, voire d’interruption du mégamachinisme global. Rien n’attend moins l’accomplissement communiste que le développement du capital. Une révolution de plus ne sera jamais la bonne, mais ôtera certainement au communisme existant davantage encore, si possible, de chances de survie.
Ruse
265 La ruse, définie comme l’art de tromper, de dissimuler, est l’un des moyens qu’utilise la raison en économie, dans le monde qui est le nôtre. Plus précisément, on peut dire que la raison utilise des voies qui tournent le dos à la raison. En ce sens, le « progrès », compte tenu des rapports de production capitalistes dans lesquels il s’insère, n’est jamais progressiste en soi, par nature, mais possède un caractère ambivalent. Il est en même temps source potentielle de libération et d’émancipation pour l’humanité, et moyen d’accroître l’exploitation et l’oppression.
266 Prenons quelques exemples. La production d’armes, qui ne peut évidemment pas être définie comme un progrès pour l’humanité, a, en même temps, suscité une énorme impulsion du développement de la recherche et de l’innovation. Le radar, l’informatique, la miniaturisation des appareils électroniques, les machines à calculer automatiques, autant d’inventions du secteur militaire ayant par la suite des retombées dans le secteur civil. De même, les dépenses militaires, source de dangers et de destructions immenses pour l’humanité, suscitent-elles des investissements qui peuvent « développer l’emploi ». Aux États-Unis, en 1938, à la veille de la guerre, le taux de chômage est encore de 17%, après plusieurs années de New Deal. C’est la guerre qui fera disparaître le chômage. Ruse de la raison ? La guerre de 1914, source d’une boucherie épouvantable, aura en même temps pour effet la chute signe de « progrès » dans l’exercice du pouvoir des Empires russe, allemand, austro-hongrois, et ottoman. Ruse de la raison ? Le développement du machinisme, au xixe siècle a signifié une source potentielle de richesse et d’émancipation du travail pour l’humanité, et, en même temps, a permis dans l’immédiat des journées de travail de 14 heures, y compris pour les enfants. Ceci explique d’ailleurs pourquoi les premières révoltes ouvrières se sont illustrées par des destructions de machines. Ruse de la raison ?
267 Les crises économiques qu’a connues régulièrement le capitalisme ont un certain nombre d’effets favorables à des « sorties de crise ». En effet, elles permettent une augmentation des taux de profit, en particulier grâce à des rapports de forces qui permettent un développement de l’exploitation, et une restructuration du capital elle-même favorable à « la reprise » économique. En même temps, les crises s’accompagnent de licenciements, de chômage, d’atteintes aux salaires et aux prestations sociales. Ruse de la raison ? Et si l’on construisait un monde sans ruse, où la raison, pour triompher, utiliserait les voies de la raison ? Utopie ? Peut-être, mais cela ne vaut-il pas la peine d’essayer ?
Saluer la crise
268
La critique ne fait nullement apparaître des lois éternelles en constituant ses résultats principaux au-delà de l’espace et du temps (événements historiques de la société), mais
Du fait généralement admis qu’il y a des crises (de la mathématique, de la médecine, du commerce extérieur, conjugales etc.), on ne parvient pas de façon automatique à la conclusion de la grande crise totale dont ces crises ne seraient que les manifestations momentanées (spontanées et éphémères), apparemment indépendantes les unes des autres. Ce fait peut même empêcher une telle compréhension.
269 Notes de Bert Brecht au sujet de la revue Krise und Kritik qu’il espérait lancer avec Walter Benjamin pendant l’automne 1930. A ce moment décisif de l’histoire, de Krisis, en pleine crise économique et après les premiers grands succès électoraux des nazis, les deux critiques décident de travailler ensemble dans une revue qui aurait vocation à définir le rôle de l’intelligence dans la crise et de la préparer aux conflits à venir. Malheureusement, cette revue restera à l’état de projet. Facsimilé (Archives Bertolt Brecht, 332/49) tiré du livre Benjamin und Brecht, die Geschichte einer Freundschaft d’Erdmut Wizisla (Suhrkamp, 2004).
270
Présents : Ihering – Benjamin – Brecht.
Pour
le premier numéro,
Brecht propose un article plus « tape-à-l’œil », par exemple
« Saluer la crise »
271 Extrait du compte rendu d’une réunion de préparation pour Krise und Kritik. Facsimilé (Archives Walter Benjamin, TS 2475) tiré du livre Benjamin und Brecht, die Geschichte einer Freundschaft d’Erdmut Wizisla (Suhrkamp, 2004).
Sans-papiers
272 « Cette main-d’œuvre étrangère est une main-d’œuvre que j’aime beaucoup. » Ces mots sont ceux de Francis Bouygues, et datent de 1970. Un tel amour, loin de s’être tari avec la fermeture des frontières à l’immigration de travail, a pu être vivifié par la situation d’illégalité dans laquelle la main-d’œuvre étrangère a été très largement plongée. C’est cette insécurité quant à leur situation – la vulnérabilité même de leur vie – qui est la condition sine qua non de l’exploitation féroce dont font l’objet ceux qu’on appelle aujourd’hui les «sans-papiers».
273 Au cœur de cette entreprise de subordination se déploie un dispositif de gestion policière (au sens de Foucault ou de Rancière) de l’immigration. Ainsi, le centre de rétention administrative, ou CRA, au-delà des comparaisons historiques qu’il ne manque pas de soulever, semble être tout entier tourné vers l’ostentation d’une inégalité radicale. Mais il s’agit là de la forme la plus extrême de ce dispositif. Bien d’autres expériences viennent signifier l’inégalité de tous les «étrangers» sur le territoire : celle du passage en préfecture où, l’arbitraire faisant loi, l’étranger est immédiatement en position de « sujet déférent »[44] [44] Alexis Spire, Accueillir ou reconduire, Paris, Raisons d’agir,…
suite, ; toutes les situations de travail, aux conditions extrêmes, dont Nicolas Jounin[45] [45] Nicolas Jounin, Chantier interdit au public, Paris, La Découverte,…
suite nous décrit très bien le quotidien des humiliations et autres insultes racistes dont ils font l’objet ; le danger permanent du déplacement : «Quand tu sors de chez toi le matin, tu sais pas si tu vas arriver au travail ou te retrouver au Mali» ; mais aussi toutes ces petites choses, insignifiantes prises séparément, mais qui, mises bout à bout dans une vie, semblent scander en permanence à ces personnes qu’elles n’ont pas ici toute leur place. « Tu dois supporter, t’as pas le choix. Tu dois supporter les humiliations, toutes les humiliations. Y’a pas le choix, t’as pas de papiers… »
274 Qu’implique une telle expérience du tort ? «Y’a pas le choix» est sans doute l’expression qui revient le plus souvent dans la bouche des personnes sans-papiers. Le dispositif policier relègue au rang d’objet ces hommes et ces femmes et les plonge dans une vulnérabilité extrême. Quelles sont dans ces conditions les possibilités de construction d’un sujet politique ? Comment peut alors émerger une figure polémique particulière qui permettrait au principe égalitaire de venir insuffler l’énergie nécessaire à une négation de la gestion policière de ces populations migrantes ? Il faut bien comprendre que cette expérience du tort déborde ceux qui sont simplement « sans-papiers », situation somme toute toujours contingente, pour devenir l’expérience de toute une « communauté ». Ainsi, en octobre 2005, à la station Château d’eau, alors qu’une «rafle» est en cours, la situation va dégénérer et virer à l’émeute. Face à la caméra de S. Georges, un sans-papiers explique : « Les gens, ils en ont ras-le-bol ! C’est inhumain ce que pratique l’administration! C’est inacceptable ! Chaque fois que j’entends les politiques parler d’humanité, de trucs comme ça, j’ai… j’ai envie de pleurer ! Alors c’est pour ça je suis prêt à faire tout! A faire la grève de la faim, à révolter, à faire n’importe quoi pour avoir… la dignité! C’est pour ça, je… je peux plus continuer à vivre comme ça ! Impossible… Impossible… ». Révolte soudaine et spontanée face à une pression sourde et permanente. De façon, à la fois plus radicale, mais aussi plus désespérée, l’incendie du CRA de Vincennes apparaît comme particulièrement porteur de sens, eu égard à l’émergence d’une polémique autour du traitement qui est réservé à ces populations. Seulement l’émergence d’une dimension politique n’a rien de mécanique. Et le désespoir est lui aussi une réponse à la violence de la logique policière : mutilations, veines tailladées, ingestion de lames de rasoirs, pendaisons… Tout est bon pour échapper à l’expulsion, d’autant que souvent c’est la mort, si ce n’est physique, au moins sociale, qui les attend de toute façon, si jamais ils sont effectivement reconduits.
275 Cette fine ligne de crête, entre dignité, violence, rage et désespoir, où l’action peut à tout moment basculer et les individus se perdre, semble être l’espace critique où se situe la politique. Celle-ci se noue dans une expérience radicale du tort. Il s’agit du croisement de l’expérience de la discrimination, du rapport inégalitaire Nord-Sud, des modes de penser et discours qui structurent ce que l’on appelle l’«expérience post-coloniale», et qui n’est autre que “l’expérience d’une hiérarchie des êtres”[46] [46] Patrick Cingolani, La République, les sociologues et la…
suite. Mais par-dessus tout, c’est l’expérience de cette vulnérabilité extrême : dans la rue face aux contrôles d’identité, au travail, quant à la santé, quant au logement, à la scolarisation de leurs enfants, aux relations familiales, etc., autrement dit à toute forme de sociabilité. «T’es pas libre. Tu peux pas sortir. Tu peux pas prendre un verre. Tu peux pas circuler. Les meufs elles veulent pas de toi…». Et c’est pourquoi l’expérience de la grève, dans ce supplément de dignité que confère le travail, est un apport fondamental du «mouvement du 15 avril», lancé il y a maintenant plus d’un an par une poignée de militants de la CGT. Si le mouvement de St Bernard avait permis de dépasser l’identité de clandestin pour atteindre celle de sans-papiers, on passe aujourd’hui de sans-papiers à travailleur sans-papiers. Cette nouvelle forme du «mouvement des sans-papiers» renouvelle les pratiques syndicales, et entrouvre enfin la possibilité de sa pleine inscription dans l’histoire des luttes sociales pour l’émancipation.
276 Et la crise dans tout cela, me direz-vous ? En ce qu’elle est une forme de « délocalisation sur place » (selon l’expression forgée par E. Terray), l’embauche de travailleurs sans-papiers, comme solution à la nécessité de diminution de la masse salariale (qui d’autre peut travailler 70 heures par semaine, payé 35 ?), pourrait connaître un avenir radieux. S’il devait effectivement se développer, un tel phénomène, couplé au million de chômeurs de plus attendu pour 2009, ne peut que rendre encore plus impératif une recomposition des lignes de fractures, non plus en termes d’identités (français/immigrés), mais bien, pour le dire rapidement, en terme de luttes contre l’exploitation, pour l’émancipation.
Socialiser les pertes
277 Vivons-nous vraiment une crise du capitalisme ou son business as usual ? Le montant inouï des sommes impliquées, les milliers de milliards d’euros volatilisés dans les coffres des banques, refinancés par les États du jour au lendemain, évaporés le surlendemain, avec les hauts le cœur et les vertiges que cela ne manque pas de causer, tout cela ressemble non seulement à une crise, mais – comme le disent et l’espèrent certains – à la crise, à « la mère des crises », celle qui nous débarrassera une fois pour toutes du monstre capitaliste.
278 Les esprits raisonnables peuvent opposer à cela que c’est le plus vieux truc dans la panoplie du capital que de socialiser les pertes après avoir privatisé les profits (et après avoir prudemment planqué son argent en Suisse). Que des petits porteurs se fassent flouer dans leurs rêves de petits profits, que même de grosses fortunes se fassent escroquer par un imposteur de haut vol, que les États soient appelés à la rescousse, au nom de l’intérêt général, pour éponger les dettes et colmater les brèches qui ont nourri le festin des plus riches – voilà bien le business as usual du capitalisme tel qu’il se renouvelle périodiquement depuis maintenant plusieurs siècles. Il faudrait être singulièrement naïf pour ne pas voir ce que ses théoriciens répètent depuis des décennies, à savoir que la crise est son business as usual, sa façon de se développer (par trials and errors), de se reconfigurer sans cesse, de se condenser et de se redéployer (par diastoles et systoles). Rien de nouveau sous le soleil, diront les cyniques.
279 Allons plus loin. Peut-on se souvenir d’une seule année, au cours des trois dernières décennies, où nos pays (riches) ne se soient pas dits et sentis « en crise » ? Le discours de la crise est permanent depuis les années 1970, même lorsque le PIB croissait à un rythme qui aurait pu justifier une suspension de l’état de siège économique. Le business as usual du capitalisme (récent ?) ne repose donc pas seulement sur une alternance de déploiements conquérants (durant lesquels sont privatisés les profits) et de rétrécissements périodiques (au cours desquels sont socialisées les pertes) ; il repose aussi sur un sentiment de crise permanente qui garde tout le monde sous pression constante – afin de prévenir toute forme de redéploiement basé sur une logique autre que celle de la reproduction du capital.
280 Loin de peindre le capitalisme en phase terminale, on pourrait donc lui trouver au contraire les signes d’une vitalité étonnante, tant il est parvenu à mobiliser rapidement des ressources inouïes, grâce à une coordination planétaire, pour venir au secours du système bancaire qui lui sert de poumon d’oxygène. N’est-ce pas un gage de triomphe que de voir non seulement les USA, l’Europe occidentale, le Canada, le Japon et l’Australie, mais aussi bien le Brésil, l’Inde, la Chine et la Russie trembler de peur devant ses hoquets (au lieu de danser de joie et de verser de l’huile sur son bûcher) et signer des déclarations communes pour s’assurer de sa pérennité ? Qui l’aurait imaginé il y a seulement 20 ans ?
281 Quoiqu’en disent les cyniques, il y a toujours quelque chose de nouveau sous le soleil. Le défi est de repérer quoi. L’hypothèse du capitalisme cognitif a pour fonction de nous aider dans ce travail (tâtonnant) de repérage. Elle nous incite à hasarder l’intuition suivante : la socialisation des pertes est le symptôme du socialisme du capital.
282 Une partie de la thèse n’est guère nouvelle : à chaque fois que « la société » (sous la forme instituée de l’État) intervient massivement pour sauver le capitalisme de ses dérives suicidaires, de nouveaux pans de l’activité productive sont intégrés sous la coupe d’un contrôle social explicite. Le processus de déploiement évoqué plus haut de façon unilatérale s’avère donc double : d’une part, certes, le pouvoir d’État aide le capitalisme à se redéployer à plus vaste échelle en rachetant (à prix fort) ses fourvoiements calamiteux ; d’autre part, le capitalisme se trouve ainsi en position de poursuivre son travail d’exploration sur des dimensions d’activité que l’État pourra venir coloniser lors de la prochaine « crise ». L’enjeu des conflits exacerbés qui se déroulent durant un moment de crise est donc d’imposer autant de contrôle social que possible sur les captations opérées par le capital. Le moment de socialisation des pertes apparaît de ce point de vue comme un moment de conquête socialisante des nouveaux horizons productifs défrichés par l’expansion (éminemment hasardeuse) opérée par la logique du capital.
283 Mais ce que l’hypothèse du capitalisme cognitif nous permet d’entrevoir est encore différent de cela. Dire que la socialisation des pertes est le symptôme du socialisme du capital, c’est suggérer que la socialisation est antérieure au contrôle social, opéré après coup, par l’État. Même si cela a toujours été partiellement le cas, la chose devient de plus en plus patente au fur et à mesure que la production repose de plus en plus directement sur la production de services et de biens immatériels. Ce qui produit la richesse (et non seulement ce qui la réglemente ou se l’approprie) apparaît de plus en plus clairement comme relevant de relations sociales inhérentes à la vie sociale elle-même : savoir parler, argumenter, convaincre, communiquer, apprendre, plaire, résister aux chocs émotionnels, compatir, assister, soigner, conforter, résoudre des problèmes, organiser, inventer, créer – tout cela participe de compétences multiples que ne peuvent produire ni une école, ni une université, ni une famille, ni une paroisse, ni un hôpital, ni un journal, ni un site Internet, mais qui se construisent au fil de l’ensemble des interactions que chaque individu entretient avec les autres à l’intérieur de et à travers ces différentes institutions. En parlant de « capital humain », l’économisme régnant tend certes à réduire ces compétences multiples, impalpables et transindividuelles à celles d’entre elles qui peuvent se mesurer individuellement et s’échanger contre des revenus financiers. Mais en reconnaissant le rôle central que joue ce « capital humain » dans nos modes de production actuels, il sanctionne du même coup la nature immédiatement sociale du capital.
284 Un tel « socialisme du capital » ne constitue toutefois nullement le dernier mot d’une politique qui se voudrait « de gauche ». Sa mise à jour permet au contraire de clarifier une triple distinction au sein des différents courants qui se réclament encore de « la gauche ».
285 Un premier groupe, qu’on qualifiera de socialistes libéraux, regroupant la plupart de ceux qui, depuis les années Mitterrand, ont occupé des positions de pouvoir dans les différents gouvernements, essaie de gérer au mieux la production sociale de l’humain au sein des régimes capitalistes de captation et de reproduction de richesses (régimes qui sont, on l’a vu, en constante évolution). Ce courant tend à reconnaître que c’est le « capital humain » qui est décisif dans les modes de production actuels, mais il n’en tire de conséquences que dans le cadre des présupposés de la théorie économique orthodoxe dominante, qui constitue « l’idéologie spontanée » du régime capitaliste (individualisation, productivisme, consumérisme, fétichisme du PIB, etc.).
286 Un deuxième groupe, qu’on qualifiera de socialistes étatiques, ne peuvent concevoir d’alternative au régime de captation capitaliste qu’à travers une extension du contrôle social opéré par l’État (lequel est généralement conçu dans sa dimension nationale). On trouverait dans ce groupe le gros des forces qui se sont mobilisées pour rejeter une constitution européenne accusée d’être « libérale », c’est-à-dire d’affaiblir les pouvoirs de l’État (national). La socialisation des pertes appelée par la « crise » actuelle leur donne l’opportunité de promouvoir leur cause, dans la mesure où nous vivons un moment de colonisation par le pouvoir étatique des zones productives défrichées par les errances du capitalisme. La complémentarité entre les explorations opérées par le capital et les conquêtes récupérées par l’État suggère de relativiser le rôle d’« opposition » que prétend jouer ce courant de la gauche : les dynamiques de déploiement de l’État et du capital ont été si intimement liées entre elles au cours du xxe siècle que leur « lutte » frontale peut apparaître aussi bien comme une danse commune, certes mouvementée, mais finalement assez harmonieuse. En bornant sa réflexion au cadre étroit fourni par l’opposition État-Marché, ce courant de « la gauche » s’inscrit dans une dynamique qui s’avère souvent être terriblement conservatrice, surtout lorsque les modalités d’action de l’État (national, « républicain ») se trouvent remises en question.
287 Un troisième groupe, qu’on qualifiera d’autonomistes, tente d’échapper au double carcan que constituent, d’une part, les présupposés économistes sur lesquels reposent les conceptions et les captations capitalistiques de la productivité sociale et, d’autre part, le recours obligé à l’État pour contrer les dérives du « Marché ». En décalage avec ces deux attitudes qui restent toutes deux largement prisonnières de cadres obsolètes, il s’agit de repérer aussi précisément que possible ce qu’il y a de nouveau sous le soleil de la socialisation immédiate de la production de richesses. La tâche, difficile et forcément tâtonnante, consiste à reconnaître (et imaginer) les nouvelles possibilités politiques offertes par l’autonomisation d’une force de travail qui participe de plus en plus directement d’une intelligence collective, qui se laisse de plus en plus problématiquement capter par la logique individualisante et réifiante du régime capitaliste, et qui se soumet de moins en moins volontiers à des formes de contrôle étatique qui limitent inutilement sa liberté d’invention et d’association. Bien au-delà du socialisme du capital, ce courant aspire à tout ce qui peut promouvoir l’autonomisation de la vie sensible et intelligente.
Spectre
288 Une histoire de fantômes est une histoire de quiconque ou de toute chose qui « persiste à ne pas avoir lieu ». De quoi l’histoire parlerait-elle sans fantômes ? Il n’y a simplement aucun mot pour l’exprimer, ce ne serait pas possible ; les mots n’en feraient rien. Une histoire de fantôme doit bien se tenir. Brèche comblée. Il faut quelqu’un pour la combler, la couvrir, et tenir le rôle du chaînon manquant, de l’objet transitionnel, de l’intermédiaire. Le fantôme ne dissimule rien si ce n’est ce qui ne peut se montrer ou être montré.
289 La lutte pour la réalité a plusieurs noms. Selon Judith Butler, elle a lieu entre des vies réelles et irréelles (in-déplorables). La lutte et la violence sont sans limites. Le combat est aussi infini que l’inimitié de l’ennemi est infinie. La violence à l’égard de « ceux qui ne vivent déjà pas tout à fait », contre ceux qui n’ont pas de nom, est invisible. Ces vies irréelles ne feront jamais l’objet d’une déploration publique.
290 Au cours d’une crise, quelques-uns ont peur, davantage espèrent : ceux qui ont été exclus pendant longtemps reviennent pour détruire l’ordre qui les a exclus. Mais les oppressés ne sont pas les seuls à revenir, ils sont suivis des oppresseurs. Le droit au retour est et demeurera controversé, tout comme le lieu où les revenants trouveront à nouveau place, ainsi que la façon dont ils devront vivre avec ceux qui scandent que c’est désormais leur lieu. La peur de ce qui arrive (que ce soit de l’histoire ou du futur) est plus grande que la peur de ce qui est. Les gens ont peur. Ils s’arment. Mais les vieilles armes semblent ne porter aucune atteinte aux ennemis nouveaux, et il n’est pas certain que de nouvelles armes aient davantage d’effet sur les vieux ennemis. Au sein d’une crise, les fantômes sont plus visibles que jamais. Pendant un cours laps de temps, ils sont tous tangibles et tout le monde jouit de la présence la plus indésirable de chacun.
Stress
291 Il paraît qu’on est stressé au travail. C’est très nocif pour la performance des entreprises de notre pays. Qu’est-ce qu’on va faire ? Pour Patrick Légeron, pape de la stressologie française et conseiller des Ministres, « les actions individuelles peuvent prendre la forme de programmes d’apprentissage à la gestion du stress. Les approches cognitivo-comportementales sont à cet égard très intéressantes. Elles offrent aux individus la possibilité de développer de véritables compétences à mieux contrôler leurs réponses de stress, dans les dimensions physiques (techniques de relaxation), psychologiques (réévaluation « cognitive »), émotionnelles (intelligence émotionnelle) et comportementales (affirmation de soi). Il est aussi important d’aider les individus à mettre en place des facteurs de protection (hygiène de vie, loisirs, support social) pour augmenter leur propre résistance au stress ».
292 Un médecin du travail raconte l’histoire suivante : une personne qui travaille dans la grande distribution vient le voir pour prolonger un arrêt de travail. Elle ne « tient » plus au travail et ne veut pas y retourner, car on lui demande de mentir aux clients. Comme le commentait ce médecin : vous pouvez toujours essayer de dire à cette personne de « gérer son stress », elle a un problème de « souffrance éthique ». La souffrance éthique désigne des situations où le zèle répond à une prescription qui implique de façon explicite ou indirecte d’effectuer des tâches dont les conséquences sont clairement nocives pour autrui. La souffrance éthique intervient lorsque le sujet en arrive à exécuter des ordres que pourtant il réprouve. Pour éviter le stress, il conviendrait donc de recruter quelqu’un qui soit « adapté » au poste : un menteur ! Oui, mais alors, il faudrait que le recruteur n’éprouve pas de souffrance éthique lui non plus : un cynique ! Et le médecin du travail ? De préférence sourd et muet. Le menteur, le cynique, le sourd saccagent le travail. Et puis ils votent, pour leurs semblables. C’est pourtant avant même tout vote (et après) que le travail est un enjeu central et politique. Ne le laissons pas à ceux qui parlent au nom de « ceux qui se lèvent tôt ».
Suicides agraires (Inde)
293 Depuis une dizaine d’années, la crise agricole a touché l’Inde rurale dans de nombreuses provinces, y compris les plus prospères comme le Punjab, l’Haryana, le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, et le Karnataka. Des milliers d’agriculteurs à la tête de petites et moyennes exploitations se sont suicidés depuis 1997. Les suicides ont continué sans reflux sauf au Kerala, où les chiffres ont chuté en 2008, grâce aux mesures prises par le gouvernement du Front de Gauche Démocratique arrivé au pouvoir en mai 2006 (Patnaik, 2009). Les zones de cultures où les récoltes sont destinées à l’exportation sont les plus affectées.
294 Les suicides d’agriculteurs font partie d’un problème beaucoup plus vaste. Dans un pays où deux tiers de la population tire son revenu de l’agriculture, sa subsistance est devenue de plus en plus fragile à cause de la baisse des profits, du manque de crédit et d’assurances abordables, de l’intégration à des marchés d’exportation tirés par subventions agricoles massives dans les pays riches, tandis que l’on assiste à une diminution du soutien de l’État indien à l’agriculture depuis que ce dernier a souscrit au début des années 1990 aux dogmes de libéralisation défendus par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. À quoi il faut ajouter d’importantes réductions dans l’approvisionnement en eau pour l’irrigation, la dégradation écologique de la terre en particulier causée par l’usage généralisé de pesticides et de fertilisants (et aujourd’hui de semis génétiquement modifiés), et enfin une plus forte amplitude saisonnière due au changement de climat. La plupart des agriculteurs, sujets au suicide, sont lourdement endettés et cet endettement est au fondement même de la crise agraire. Des dépenses croissantes dans les intrants agricoles pour l’exploitation et pour l’irrigation locale, financées par un recours à un crédit cher, assorties à une chute des prix des cultures comme le coton vendues sur le marché mondial ont poussé les agriculteurs la tête la première dans le gouffre de l’endettement. Bien que le prix global des marchandises ait augmenté de 2007 jusqu’à la mi-2008, où il a connu une nouvelle chute brutale, les agriculteurs demeuraient trop lourdement endettés pour être, à nouveau, solvables en une ou deux saisons. De plus, le système étatique a continué de proposer des prix plus bas aux agriculteurs que ceux qu’il versait pour des cultures importées. D’une manière générale, la volatilité des prix globaux a eu des effets négatifs inverses sur les petites exploitations qui ne passèrent à des cultures très rémunératrices que pour découvrir que leurs prix s’étaient effondré au moment où ils étaient capables de les commercialiser (Ghosh 2009 cite le coton et l’arachide en exemples).
295 En matière d’intrants (engrais et semences), la dérégulation censée corriger les distorsions du marché loin de faire chuter les prix les a doublés au cours de la décennie 1990. Au même moment, pour les importations, les marchés des fertilisants et des semis ont connu une dérégulation au début des années 1990, mais la correction des « disparités de marché » n’a pu provoquer une baisse des prix. Les prix des fertilisants et des semis ont en fait doublé au cours de cette décennie. Dans de nombreuses régions arides, les coûts de l’irrigation ont grimpé fortement du fait de l’affaissement des nappes phréatiques et de l’assèchement des puits forés par les paysans. Pour financer les intrants et le forage des puits, les agriculteurs ont dû recourir à un crédit officiel libéralisé et de moins en moins tourné vers l’agriculture. Depuis 2005, l’accès au crédit agricole en bonne et due forme s’est amélioré, mais cet argent est parti dans les poches des semenciers, des vendeurs de matériel agricole et des grands propriétaires (Chandrasekhar 2008). Les petits exploitants ne disposant pas de terre pour servir de garantie trouvent difficilement des crédits bancaires et sont livrés au crédit informel accordé par des prêteurs locaux ou par les vendeurs de matériel agricole à des taux d’intérêt oscillant entre 2 et 5% par mois. Ces mêmes prêteurs jouent parfois les intermédiaires entre les agriculteurs et le marché, achetant les récoltes à un prix moins élevé que le cours.
296 Entre le début du siècle et les années 2004-05, les gouvernements indiens centraux et provinciaux ont tenté (et largement en vain) de consolider la dette des agriculteurs. Ces mesures comprenaient un moratoire temporaire sur les remboursements aux banques du secteur public, des « améliorations » des mécanismes d’obtention de crédit et des aides financières aux familles d’agriculteurs s’étant suicidés. Plus récemment, au niveau central, après avoir gagné les élections en 2004 sur la promesse d’une renaissance de l’agriculture et au cours de campagne pour les nouvelles élections nationales, le gouvernement de l’United Progressive Alliance a annoncé un plan d’aide au désendettement à hauteur de 600 millions de roupies dans le budget 2008-09. Ces mesures sont toutefois limitées aux emprunts contractés de façon déclarée auprès des prêteurs locaux et ne touchent pas les propriétaires de plus de deux hectares. Elles excluent de la sorte tous les petits propriétaires qui ont contracté des crédits non déclarés auprès de prêteurs locaux ainsi que les agriculteurs aux faibles ressources habitant des régions arides et possédant plus de deux hectares.
297 Une autre solution racoleuse, la Politique d’Investissement et d’Équipement Agricoles annoncée en 2007 par le gouvernement de la plus grande des provinces indiennes, l’Uttar Pradesh, devait fournir « plus de liberté » à l’agriculteur en éliminant les intermédiaires (Ghosh 2007). Selon ce dispositif, les agriculteurs peuvent directement vendre leur produit à un acheteur à un prix sur lequel ils se seront mis d’accord préalablement. Toutefois, les acheteurs ne pourront être que des grandes entreprises ayant planifié plus de 25 milliards de roupies d’investissement sur les trois années à venir. Cette politique promeut également la culture sur contrat où l’acheteur peut fournir tous les inputs et l’expertise, l’agriculteur se contentant de fournir terrain et main d’œuvre. Les concepteurs de ce contrat agricole qui inclut un contrôle d’exécution de la part de l’entreprise comme cela se fait aux États-Unis ignorent ou passent volontairement sous silence son impact sur les agriculteurs américains.
298 Alors que les dépenses globales des ménages consacrées à l’alimentation n’ont cessé de croître dans ce pays depuis les années 1970, les salaires réels des agriculteurs ont chuté au cours de la même période (Ghosh 2007). Simultanément, des profits toujours plus importants sont extorqués par des monstres comme Cargill et Monsanto qui n’ont que peu d’égards pour la survie des agriculteurs ou pour le développement soutenable de l’environnemental (Grain, 2009). Dans ce contexte, les agriculteurs étasuniens ne peuvent survivre qu’à l’aide d’importantes subventions d’État. Il est peu probable que l’État indien soit capable de suivre le rythme en matière de subvention en pleine ère de libéralisme. Une grande partie des agriculteurs de même que d’autres secteurs plus importants seront amenés à appeler l’État à leur aide, générant d’autres problèmes majeurs. Ainsi l’impact de ce modèle sera probablement bien pire sur les agriculteurs indiens, qui, à la différence des agriculteurs nord-américains sont à la tête de petites exploitations marginales. Et le désarroi actuel des campagnes va s’accroître du fait de cette politique à contresens.
299 Pour conclure : la crise agraire en Inde a ouvert un réel espace pour un changement authentique du mode de vie et du développement soutenable. Toutefois, les mesures prises par le gouvernement central et la plupart des États indiens ont : soit, suivi une approche à court terme ; soit, pris des mesures à grande échelle qui ont toutes chances de livrer à eux-mêmes les petits agriculteurs ou de faire empirer leur situation. Un pas vers une amélioration réelle même si elle n’est que temporaire aurait pu être fait en suivant l’exemple de l’État du Kerala où le gouvernement a remboursé la dette contractée par des petits propriétaires envers des prêteurs privés ou envers des banques et il a établi un prix plancher de soutien (ou « prix d’existence ») plus élevé que le prix du marché. Il reste encore à voir si le modèle du Kerala conduira à un mode de vie soutenable à long terme alors que les fondamentaux de la production agricole et les structures d’échange demeurent inchangés. Une réorientation vers le développement soutenable devra probablement renverser le cours de la libéralisation accueillie à bras ouvert par le gouvernement central et les Etats indiens durant la décennie 1990. Il faudra aussi abandonner le paradigme scientifique et technologique qui a fourni les bases des processus de production depuis le début de la Révolution Verte dans les années 1960.
Téléchargement illégal
300 Ces dernières années, le téléchargement illégal de fichiers numériques sur Internet – films, musiques, jeux et logiciels payants – est sûrement la pratique la plus subversive surgie dans le champ culturel. L’accès à la culture, sa propriété matérielle et symbolique et ses possibilités d’échanges sont questionnés. Un rapport inédit entre masses, culture, industrie, émancipation et démocratie, apparaît dans le piratage-partage. Nouveauté de cette dynamique culturelle : elle émerge du côté des spectateurs et non pas de celui des créateurs, elle réinvente l’appropriation culturelle et développe donc un paradigme de l’émancipation, « téléchargement illégal » et « crise du capitalisme » sont étroitement liés. Car, la pratique du « piratage » par une partie de la population mondiale, connectée à Internet, anticipe et dépasse des formes de propriétés et d’échanges qui montrent aujourd’hui leurs limites.
301 Peer2Peer, BitTorent et autres formes de téléchargement de fichiers sur Internet s’appuient sur une logique de partage. À partir d’une interface informatique, on cherche un film ou de la musique convertis en fichiers numériques. Une fois le fichier trouvé, un protocole d’échange permet de le télécharger (download) sur le disque dur d’autres utilisateurs. Plus un fichier identique est présent chez de nombreux utilisateurs, plus il sera aisé alors de l’acquérir. Le fichier acquis, on se met en principe soi-même à le fournir à d’autres utilisateurs (upload). Pour imaginer comment un premier fichier est piraté puis téléchargeable, tous les scénarii sont possibles. Ceux et celles qui placent le fichier originel sur la toile sont à proprement parler des pirates. Les autres, en le téléchargeant et le partageant, deviennent à leur tour des pirates selon la loi. Ici, il n’existe donc pas de piratage sans partage. L’enjeu de cette nouvelle pratique est alors de taille.
302 Pourquoi et comment dénoncer le « partage » dans des législations criminalisantes ? La contradiction entre le discours publicitaire du « connecting people » de l’industrie du spectacle et des médias de masse, et la mise en pratique effective mais criminalisée de cet ensemble connecté, devient alors flagrante. Il s’agit, au contraire, de culpabiliser et de dénoncer ceux et celles qui téléchargent « comme des voleurs » ; les spots anti-pirates présents en introduction des DVD loués en vidéoclubs l’illustrent bien. L’objectif est alors d’insister sur la dimension immorale de la pratique, tout en éludant ses vertus partageuses pour mieux la criminaliser. L’acharnement législatif contre le piratage-partage oblige à questionner la potentialité de ces pratiques et expériences. Pourtant, la démocratisation de la culture est aujourd’hui un principe bien ancré dans l’espace public et, en même temps, le fruit d’une histoire ambiguë. C’est l’idée, selon les termes de Malraux, travaillée par les expériences culturelles du Front Populaire, incarnée dans le système républicain et impérial des beaux-arts, marquée par la Révolution française et héritée de la vieille idée kantienne de rendre accessible à un plus grand nombre le plus d’œuvres d’art. C’est alors au rôle de l’État d’assurer cette diffusion, et d’organiser la séparation entre ce qui est œuvre et ce qui ne l’est pas. Tout cela éclate face au piratage-partage où s’installe un rapport inédit entre émetteurs et récepteurs culturels : c’est le pouvoir du n’importe qui, de l’anonyme, qui s’exerce et pas seulement celui de la République des savants. C’est ainsi une activation forte de l’idée démocratique, telle que pensée par Rancière par exemple dans La haine de la démocratie et Le spectateur émancipé. Le téléchargement illégal crée alors les pistes d’une réflexion autour de la démocratie culturelle qui dépasserait le principe de démocratisation de la culture. Notons, enfin, que le piratage-partage n’est pas toujours pensé par ses acteurs comme une pratique subversive, à l’exception notable des campagnes du site The Pirate Bay () et du Piratpartiet suédois. Dans ces pratiques, une invention de la politique liée à la fibre sensible des individus, renvoie à la question des subjectivités contrariant le pouvoir – pensé lui comme un ensemble d’abstractions réelles.
303 La question des industries culturelles posées par Adorno et Horkheimer dans Dialektik der Auflklärung, (1944) est alors réactualisée. Ce sont les œuvres issues de ces industries qui sont le plus facilement piratables. Par le jeu de la diffusion médiatique, elles mettent en place des opérations promotionnelles de grandes envergures. En parallèle de quoi, elles donnent aussi l’occasion, malgré elles, d’être largement piratées. Par exemple, les films les plus attendus et les plus secrets, comme Star Wars, se retrouvent sur la toile, avant même d’être projetés sur les écrans de cinéma. L’attente et l’hystérie consuméristes qui cherchent à être créées chez le spectateur/consommateur se retrouvent subverties et cette dimension répressive de l’industrie culturelle/spectaculaire est anéantie par le piratage-partage. La répression du piratage-partage de biens culturels se dote de l’arsenal HADOPI ; alors que la propriété intellectuelle est déjà protégée, le piratage est d’ores et déjà devenu une pratique criminelle. On voit ici comment l’État se retrouve contraint à légiférer. Il ne se présente pas comme un garant universel et impartial de la citoyenneté, mais comme un ensemble d’institutions et de principes attaqués par des pratiques déviantes ou rebelles. Le pouvoir montre le visage désenchanté de celui qui acculé doit réagir face à l’inventivité des individus connectés : un visage de la réaction. La sanction négative et pénale prévue est l’exclusion d’un marché. Société de l’information et échange marchand sont rendus indissociables. La répression du téléchargement illégal doit être celle du plus grand nombre.
304 Enfin, le discours énonçant que cette criminalisation protègerait les créateurs, en pénalisant et éduquant (le principe de riposte graduée) doit être déconstruit. C’est plutôt la longue chaîne de leurs ayant droits qui est défendue. Nombres d’artistes – musiciens en particulier – ont déjà compris le nouveau rapport qui se joue entre eux et leurs auditoires. Du côté des pirates-partageux, l’ambiance est vivifiante. Le phénomène dépasse le refus d’acheter des biens culturels et déborde le vol thésaurisant, car ce que permet cette forme de piratage, c’est le partage. Plus d’utilisateurs accumuleront des fichiers partagés, plus le fond partageable sera élargi. Ce processus d’accumulation culturelle contrarie l’accumulation de capital – qui montre aujourd’hui clairement ses limites dans la crise économique. Dans cette pratique, nous observons aussi une communauté esthétique se construire grâce à la mobilisation des publics eux-mêmes, sans impulsion venant des artistes, sans principe fondateur ni barrière entre cultures légitimes et illégitimes. Sans non plus utiliser des moyens tolérés et reconnus par et dans l’espace public bourgeois. Ainsi, les réseaux d’échanges mettent en pratique une forme de potlatch numérique, mais qui n’implique ni destruction, ni désappropriation de la part de ceux qui donnent (upload) et reçoivent (download). Une éthique pirate s’invente, créant de nouvelles formes de reconnaissance des créateurs, assoiffée de partage, d’échange, de mise en commun par et pour les publics. Il suffit de saisir HADOPI dans un moteur de recherche Internet pour constater la richesse du débat.
305 Dans l’action de télécharger, les processus et rapports liés à la production sont contestés et s’imbriquent à la crise du capitalisme. De nouvelles formes d’échanges se mettent en place. Les réseaux de solidarités se réactivent et se réinventent. La relation intime entre spectateurs et créateurs est bouleversée, le piratage-partage en est une forme de dépassement. Ce qu’elle montre est aussi classique qu’inédit aujourd’hui : inventer c’est partager et partager c’est inventer.
Vieilles (peaux)
306 Après la crise, il y aura plein de vieux, enfin, ce sera surtout des vieilles. Déjà qu’il y en a plein, il y en aura plus. Des vieilles qui ne consommeront pas et qui dépenseront tout. Elles boufferont leur retraite, elles boufferont leur maison, elles boufferont la laine sur le dos de leurs enfants. Elles ne se sentiront pas coupables, ce sera dur de leur en vouloir, elles auront perdu la tête. Ce seront nos parents, puis nous, nos enfants puis leurs enfants. Il y aura plein de femmes, des Africaines, des Antillaises, des Magrébines, des Polonaises, des Colombiennes… pour laver, torcher, donner la bêquée à toutes ces vieilles et leur faire chanter des chansons. Elles rigoleront entre elles, les vieilles avec les femmes venues d’ailleurs, enfin elles rigoleront quand les unes ne seront pas en train de s’étouffer en mangeant trop vite et les autres en train de se casser le dos. Il y aura des familles aussi, elles seront satisfaites et complices, ou elles seront suspicieuses et hostiles. Des familles clients-rois qui traiteront les soignantes comme leurs domestiques et leurs parents comme les vestiges sacrés de ce qu’ils ont été : « elle prendra du fromage blanc, vous lui mettrez ses chaussures noires ». Il faut vous imaginer au milieu avec pas droit au chapitre.
307 Aujourd’hui, les chartes de qualité garantissent la bientraitance. Y’a comme un doute. Est-ce qu’elles ne vont quand même pas vous taper, vous brutaliser, vous massacrer au petit matin toutes ces étrangères ? Vous êtes au fond de votre lit, vous ne pouvez pas bouger d’un cil (vous souffrez de la maladie de Parkinson), vous tremblez dans votre couche-culotte, vous avez peur et vous ne pouvez même pas claquer des dents (votre prothèse dentaire vous a été confisquée et rendue à votre famille, l’établissement déclinant toute responsabilité en cas de perte)… Il vous faut filer de là, et en vitesse, l’énergie du désespoir vous pousse au milieu du couloir. Des formes blanches s’agitent autour de vous : « faut vous laver ! faut vous habiller ! ». Chaque fois qu’une forme blanche s’avance, vous criez… Chanthou est cambodgienne, toute une histoire dont vous ne saurez rien. Mais ça fait quinze ans qu’elle est aide-soignante, alors, elle vous voit venir de loin dans le couloir, à poil, les fesses pas très propres. Elle vient de finir son service, elle n’est déjà plus en blouse, ça lui donne une idée. Elle s’approche tout doucement, vous chuchotte au creux de l’oreille : « Vous ne sentez pas très bon, vous savez ». C’est agréable de la suivre jusqu’au lavabo, de s’abandonner, elle ne donne pas d’ordre, vous sentez qu’elle se soucie de vous et vous avez raison. C’est dommage parce que le jour de l’évaluation de Chanthou, on ne vous demandera pas votre avis, d’ailleurs vous auriez du mal à l’exprimer, et pas seulement à cause de votre maladie. Comment expliquer un sourire, une attention, une présence ? Ce travail inestimable. Chanthou non plus ne sait pas trop comment en parler. « Peut-être, c’est mal, dit-elle, je n’étais pas fière, j’ai un peu forcé, et puis j’étais en civil, ce n’est pas la méthode ». Y aller avec la séduction et la ruse, en effet, n’est pas prescrit dans les manuels des « bons gestes ». Grâce à son stratagème, elle a pourtant réussi là où les autres avaient échoué. Il était temps ! Votre famille arrive dans un quart d’heure. Qu’est-ce qu’elle aurait pensé ? « On nous aurait encore dit qu’on maltraite ». La ruse de Chanthou relève de la bientraitance réelle, non de sa représentation idéalisée. Et les blouses, étaient-elles maltraitantes ? Elles ont respecté votre refus, n’ont pas forcé votre consentement. On ne vous a pas chopé, savonné, rincé comme une assiette.
308 L’art du soin gériatrique, pour être compris, implique de rompre avec le paradigme surplombant de la « maltraitance » définissant les soignantes comme des délinquantes en puissance. Le travail gériatrique n’est fait que de « petites victoires », rien de glorieux ou qui puisse s’exhiber en vitrine. Le réel du grand âge résiste, il est inscrit dans le corps rétracté, dans les douleurs multiples, dans l’angoisse, la confusion, les troubles cognitifs. Il est angoissant pour les familles qu’on le leur rappelle et tout ne peut sans doute être dit ou montré. Grâce au savoir-faire de Chanthou, à l’heure des visites, vous serez calme et bien habillé, vous sentirez bon. Un tel travail attentionné, quand il est bien fait, efface ses propres traces, on n’en voit rien. C’est cela le respect.
309 Ce travail attentionné (ou care) requiert une implication particulière, une certaine forme de sensibilité et de réceptivité à l’autre. On ne peut le réaliser correctement énervée, trop fatiguée ou contrariée. Des conditions matérielles et organisationnelles adéquates sont nécessaires. En promettant (via les chartes de qualité) un idéal que les soignantes ne pourront tenir, on les met en échec et on les disqualifie au regard des familles. Des problèmes qui devraient faire débat – dans l’organisation du travail, dans la cité – sont occultés au profit d’un jugement péjoratif sur le personnel soignant. Tout le monde – collègues, familles – est appelé à « fliquer » et à contrôler tout le monde. La suspicion est généralisée. Il devient alors très difficile pour les soignantes de créer des formes d’actions solidaires et plus encore de converser d’égal à égal avec les familles. Nous sommes à un carrefour de la vie gériatrique : cela pourrait être un peu chouette ou cela pourrait être un cauchemar total. Tout dépend de notre capacité à écouter les femmes expertes en soins des corps et des âmes âgées et reconnaître que ce sont elles qui savent ce qu’il convient de faire pour que ce soit le moins insupportable.
Volkswagen
310 Au sein de la sociologie du travail française, les accords d’entreprise originaux que le groupe Volkswagen a conclu en Allemagne depuis 1993 ont fait l’objet de toutes les attentions. L’une des hypothèses les plus répandues en France est que les accords VW incarneraient un modèle de « régulation locale » des relations professionnelles, et même du marché du travail. La « décentralisation des négociations salariales et des politiques de l’emploi » serait une voie pertinente pour endiguer le chômage, en prenant exemple sur l’Allemagne ou encore la Suède. Or la convention collective de branche prime devant la législation du travail en Allemagne, contrairement à la situation française. VW dispose, depuis l’après-guerre, d’une convention collective nationale distincte de la convention collective de branche, mais sans écart notable d’avec elle. Les accords VW conclus à partir de 1993 ont déstabilisé cette tradition: la semaine de quatre jours de travail sur la base d’environ 30 heures est instaurée sans une compensation salariale comparable au standard de la convention collective de branche de l’automobile. Afin d’éviter l’image d’une abolition de la norme conventionnelle de branche, le syndicat IGM s’est efforcé d’aligner la convention collective générale de la métallurgie sur le nouveau type d’accord, en y inscrivant des clauses dérogatoires, en 1994. Ce passage a permis l’extension du modèle VW à d’autres entreprises.
311 Cet accord négocié sur le site le plus important site de VW concernait l’ensemble des sites allemands. Le négociateur syndical, M. Peters, a ensuite été nommé Chef national du syndicat de la métallurgie. L’accord a aussi été appuyé par le gouvernement régional de la Basse-Saxe, qui détient 20% des actions de l’entreprise, et dont le premier ministre, M. Schröder, préparait alors sa candidature en tant que futur Chancelier de la République fédérale. Toute la négociation s’est déroulée dans le contexte d’un important débat public concernant la dernière phase de l’application des 35 heures. L’intitulé « pacte pour l’emploi » initié par VW a également donné lieu à des pourparlers officiels sur le plan national, regroupant le syndicat fédéral (DGB), les représentants patronaux et le gouvernement Schröder, à partir de 1998. En 2003, ce dispositif est remplacé par la législation Hartz, inspirée des recommandations d’une commission présidée par l’ancien DRH de VW, M. Hartz (également organisateur des accords VW de 1993). Inspirées de la méthode VW, qui consistait à maintenir l’emploi en échange d’une grande flexibilité des horaires de travail, assortie de baisses de salaire de l’ordre de 20%, les lois Hartz ont été associées au leitmotif « développer et exiger » ; développer l’activité et exiger des efforts. Le contenu définitif des lois, proche du workfare anglo-saxon, allait surtout dans le sens d’une réduction drastique des allocations chômage et d’un durcissement sans précédent de leurs critères d’attribution. À la surprise des syndicats, cette limitation annoncée des droits établis provoqua un mouvement social massif impliquant près de 300 000 citoyens et qui coïncida avec une grève sauvage aux usines du site automobile OPEL à Bochum.
312 Aujourd’hui, le débat public se poursuit, portant aussi bien sur l’appréciation du modèle VW que sur le bilan empirique de la législation Hartz. Il se déroule dans un contexte où les principaux responsables de l’accord VW de 1993 ont été inculpés sinon condamnés pour corruption, dont le secrétaire du comité d’entreprise VW de l’époque, M. Volkers. Sur le plan institutionnel, la participation de l’Etat allemand à l’entreprise VW, par le biais du gouvernement de Basse-Saxe (« loi VW »), nourrit un conflit -mmuniqués du département de relations publiques de VW, les constats sociologiques et statistiques ont établi le ralentissement des activités collectives, associatives ou sportives dans la ville, une augmentation de l’alcoolisme et des divorces parmi les salariés concernés. Le dispositif VW favorise le maintien d’un emploi ouvrier masculin statutaire, qualifié et bien intégré, au détriment d’autres groupes du salariat -plus fragiles ou moins reconnus. Le mouvement social contre la législation Hartz touche aussi bien les publics précaires que les classes moyennes diplômées qui se sentent indirectement concernées, à côté de certains groupes ouvriers. L’opinion publique bascule vers une appréciation négative des lois Hartz.
313 Le dispositif organisationnel de VW, inauguré dans les années 90, a montré certaines limites intrinsèques. En 2006 déjà le management s’est lancé dans une vaste restructuration de la production impliquant 10.000 suppressions de postes au sein du groupe. L’échec le plus manifeste du « modèle VW » est l’annonce officielle du management de VW (début 2009) de vouloir abroger l’accord-maison de 2007, négocié avec l’IG Metall dans la continuité des accords de 1993, et qui comporte la garantie de maintenir les postes statutaires existants en Allemagne jusqu’en 2011. Cela malgré une augmentation des ventes en 2008, un maintien global de la production et des bénéfices en 2009 et le licenciement de la totalité des personnels précaires et intérimaires du groupe début 2009, soit 16.500 personnes en Allemagne et dans le monde.
314 La gestion flexible amorcée au début des années 1990 a systématiquement réduit toutes les marges sur le plan des coûts, des prévisions, des rythmes et horaires de la production, de l’acheminement et du stockage, de la division internationale du travail au sein du groupe, etc. Dès lors, la moindre inflexion conjoncturelle produit un maximum d’effets, en l’absence d’amortisseurs organisationnels ou temporels. Le dispositif qui se présentait comme une solution à la récession amplifie les effets des crises. La première grève de son histoire a touché le site de Wolfsburg, en novembre 2004, associant une majorité absolue de salariés. La fin du modèle VW initial coïncide avec une crise de la représentation étatique d’un gouvernement de grande coalition qui se contredit ouvertement sur la nationalisation partielle et le sauvetage du secteur automobile, sur la nécessité d’instaurer un salaire minimal légal, et sur la pertinence d’un plan de relance ou d’une réglementation européens.
Vulnérabilité
315 En même temps que la « crise », sont apparus des « populations vulnérables », des « économies vulnérables », des « ménages vulnérables ». Ainsi la Banque Mondiale défend-elle la création d’un vulnerability fund pour les pays en voie de développement, dont les économies, fragiles, endettées, insuffisamment diversifiées, sont ou seront les plus violemment touchées par la crise financière. De même, les énoncés politiques et journalistiques sur « les plus vulnérables » se multiplient-ils.
316 Mais quel sens cela a-t-il de parler de vulnérabilité à une crise financière ? Poser le problème en ces termes implique la perspective d’une dépendance à ce qui peut survenir, d’une impuissance devant un fléau qui s’abat, fléau qui requalifie ladite « crise » en réalité indépendante, autoproduite, dont l’effet vulnérant porte atteinte à l’intégrité et menace la perpétuation d’une entité.
317 Campant des êtres singuliers ou collectifs affectables et affectés par des « circonstances » néfastes, ces expressions livrent donc le récit d’un coup du sort, à la manière dont les Grecs interprétaient l’exposition à la Fortune qui rend la vie bonne vulnérable.[47] [47] Cf. Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge,…
suite
318 C’est aussi parce qu’elle renvoie au vocabulaire de l’indétermination que l’idée de populations « vulnérables » est digne d’attention. Comme le relevait Robert Goodin dans son essai Protecting the Vulnerable[48] [48] Robert E. Goodin, Protecting the Vulnerable. A Reanalysis…
suite, on ne saurait dire que le condamné à mort est simplement vulnérable au bourreau : l’absence de prédétermination, l’éluctabilité du phénomène ou du geste redouté sont inhérentes au concept.
319 Or le qualificatif « vulnérables » est utilisé ici pour des entités qui ne sont guère dans une position d’ouverture au monde et à tous les possibles. Si la vulnérabilité est la notion qui corrèle fréquemment, dans les théories morales, « l’idée d’une atteinte-à-ne-pas-porter-à-l’intégrité d’un X »[49] [49] Jean-Marc Ferry, Les puissances de l’expérience. Tome…
suite, de quelle intégrité peut-il s’agir ici, puisque l’idée d’intégrité se réfère elle-même à ce qui est sain, intact, à ce qui n’a subi aucune altération ? Les économies susceptibles de prétendre au Vulnerability Fund sont des économies claudiquantes, dans un état de pourrissement annoncé dès les germes, et elles-mêmes toxiques (car porteuses d’exploitation et de destruction). Quant à ces « unités économiques » que sont les « ménages les plus vulnérables », quid, là aussi, de ce passé intact que les « circonstances » feraient s’effondrer ?
320 Sans doute la rhétorique de la maladie et de l’immunité n’est-elle pas dénuée de connotations politiquement perverses, comme l’a démontré Roberto Esposito, mais le recours à la métaphore de la précarité du corps « s’essayant sans assurance à ajourner le négatif de la souffrance sociale, des maladies, tout un spectre de terreurs et d’ombres qui peuvent à tout moment emporter une vie »[50] [50] Guillaume Le Blanc, Vies ordinaires, vies précaires, Paris,…
suite aurait sans doute été plus opportun. Le vocabulaire de la précarité suggère en effet la nécessité d’organiser un maintien, de trouver les moyens d’assurer une perpétuation, d’ajourner sans cesse une disparition. Sauf qu’entre temps, « précaire » est bizarrement devenu synonyme, en France du moins, de « à durée déterminée ».
321 Enfin, en renvoyant à l’incertitude et à l’indétermination, la vulnérabilité se distingue de l’idée de risque, réservée, elle, au monde de la finance et de la banque, et qui suppose, elle, une déterminabilité, au moins partielle : le risque est un possible connu, et qui peut faire l’objet d’une quantification (ou en tout cas le mot renvoie à des « circonstances » sur lesquelles est projeté le fantasme d’une calculabilité).
322 Il implique qui plus est un dommage causé par nos propres décisions, et constitue en ce sens un produit inévitable de nos actions sur le monde[51] [51] Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une…
suite. Un risque est donc produit par une tentative de maîtriser l’avenir. Dans cette perspective, il est possible d’être rationnel vis-à-vis des dommages anticipés de nos propres décisions, en calculant à l’avance les pertes que nous pourrions subir et en nous prémunissant contre elles. Cela signifie certes, comme l’a montré Niklas Luhmann, que ce que nous pouvons obtenir avec le calcul des risques, c’est surtout un « programme de minimisation de la repentance[52] [52] Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin : de Gruyter,…
suite ».
323 Reste que cet usage, pour les uns de la vulnérabilité, pour les autres du risque distribue inégalement la capacité à agir, la rationalité et la maîtrise. Aux uns le vocabulaire de la complexité, aux autres celui d’un royaume des ombres qui se cache derrière le monde visible. Aux uns le risque, calculé, calculable, « pris », qui, même lorsqu’il n’a pas été prévenu, reste synonyme de testostérone, aux autres l’absence de protection et l’impuissance.
Zèle
324 Le zèle exprime une ardeur, un empressement, voire une ferveur à la tâche, qui peut conduire à réaliser celle-ci de façon irréfléchie et à « faire du zèle ». C’est-à-dire, non seulement à en faire plus que ce qui est demandé, ce qui est le propre du travail réel (et dont l’opposé est la grève du zèle), mais à réaliser de sa propre initiative, sans y être contraint explicitement par un système de menace ou d’intimidation, des actes qui portent préjudices à autrui. Le zèle comporte ainsi une connotation péjorative. « On avait vu s’étaler chez certains détenteurs de l’autorité publique, un zèle odieux au service de l’envahisseur », écrit De Gaulle, dans ses Mémoires de Guerre de 1959. Il semblerait aujourd’hui que le zèle ne pose plus seulement un problème moral, mais aussi un problème de santé publique ! Attention: le zèle tue ! Si on en croit les experts du travail commentant la vague de suicides dans les grandes entreprises en 2007, ceux qui se suicident au travail se recrutent parmi les hommes et les femmes les plus engagés dans le travail, les plus impliqués, les plus zélés, parmi les meilleurs. Méfiez-vous : le travail tue parmi ceux qui respectent au plus près les règles du jeu néolibéral. Les premiers touchés seraient ceux qui avaient une conscience professionnelle exacerbée. Les « meilleurs éléments », ceux qui y croient : à la performance, à la qualité, à l’entreprise de demain… Ils y croient contre toute attente, contre la parole des vieux de la vieille, de ceux et celles qui en savent un bout sur le travail. Ils y croient jusqu’au désespoir. Mais le réel est tenace… un jour ils se le prennent en pleine figure, ils n’en dorment plus et vlan ! Exit les meilleurs. Il va falloir faire avec les pires. Avec ceux qui peignent la girafe, se « lèvent tard », n’ont aucun sens du « mérite » et qui n’aiment pas le fric ? Les « mauvais », aujourd’hui, dans le monde du travail, ce sont plutôt ceux qui ne font pas d’esbrouffe, qui continuent sous vent de crise à soigner des malades mentaux ou des petits vieux, à ouvrir les dossiers avant de les signer, à ne pas mentir aux clients, à bidouiller de la qualité réelle et non de la qualité-vitrine, à recevoir les étudiants, à se soucier des autres plutôt que de se vendre ou de les vendre. Admettons que tout se casse la gueule : heureusement, s’il n’en reste qu’un, ce sera un mauvais ou une mauvaise. On va peut-être enfin pouvoir bosser correctement.
Annexe
Liste des auteurs de L’Abécédéaire :
325
- Abel Olivier
- Arora Saurabh
- Assouly Olivier
- Barbosa Mendes Pedro
- Badaire Quentin
- Baudouin Thierry
- Berns Thomas
- Bordier Julien
- Cavalcanti Felipe
- Chanson Simon
- Chauviré Christiane
- Citton Yves
- Dahlberg Goran
- Ferrarese Estelle
- Garcia Tristan
- Gava Jean-François
- Guizardi Francini
- Holloway John
- Holder Samuel
- Houba Pascal
- Jeanmart Gaelle
- Kassam Amin
- Kyrou Ariel
- Le Marchand Arnaud
- Lestel Dominique
- Mendes Alexandre
- Molinier Pascale
- Moulier Boutang Yann
- Neumann Alexander
- Neyrat Frédéric
- Ogien Albert
- Onaner Can
- Querrien Anne
- Robert Damien
- Sagradini Lucia
- Schmidt Roman
- Szaniecki Barbara
- Taddéi Julia
- Valier Jacques
- Venturini Marco
- Veron Daniel
- Zellner Nicolas
Notes
[ 1] N.Taleb, Le Cygne Noir, Paris, Les Belles Lettres, 2007, p.206.
[ 2] W.Benjamin, 1933, Die Welt im Wort (n°10, 1ère année ; in : « Expérience et pauvreté », in : Oeuvres, II, Paris, Folio, pp.364-372.
[ 3] Günther Anders, Et si je suis désespéré que voulez-vous que j’y fasse ?, Paris, Allia, 2004, p.65.
[ 4] Haruki Murakami, Kafka sur le rivage, Paris, 10/18, 2003, p.247.
[ 5] On en découvre une célébration remarquable dans le film documentaire de Thibaut de Longeville et Lisa Léone, Sneakers, le culte des baskets, Studio Canal, 2006. Disponible en DVD
[ 6] Ibidem.
[ 7] P.K.Dick, 1976, Blade Runner, J’ai Lu, p.73-74.
[ 8] Voir en particulier Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2002 et Les Révolutions du capitalisme, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2004, ainsi que Bernard Stiegler, Mécréance et Discrédit : Tome 3. L’esprit perdu du capitalisme, Paris, Galilée, 2006 et Économie de l’hypermatériel et psychopouvoir (avec Philippe Petit et Vincent Bontens), Paris, Mille et une nuits, 2008.
[ 9] Voir sur ces points Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste – Pratiques de désenvoûtement, Paris, La Découverte, 2005 et Frédéric Neyrat, Instructions pour une prise d’âmes. Artaud et l’envoûtement occidental, Strasbourg, Éditions de la Phocide, 2009.
[ 10] Voir Bruno Latour, L’Espoir de Pandore, Paris, La Découverte, 2001 (chapitre 9), ainsi que Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1996.
[ 11] Hannah Arendt, « Le travail », in La condition de l’homme moderne, Pocket, Paris, 1994, p. 174.
[ 12] Maurizio Lazzarato, Le gouvernement des inégalités. Critique de l’insécurité néolibérale, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 53.
[ 13] On trouve le texte de Pierre Lombard qui concerne ces questions, In IV Sententiarum Dis.31 Qu.2
[ 14] On trouve une bonne illustration des problèmes posés par les commentateurs des Sentences dans l’exégèse qu’en donne Thomas d’Aquin dans les Scripta Super Libros Sententiarum Petri Lombardi, livre IV, distinctio 31 et 32 (disponible sur http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/DE/)
[ 15] Voir sur ce point l’enquête minutieuse menée par Andrea di Maio, Il Concetto di comunicazione. Saggio di lessicografia filosofica e teologica sul tema di « communicare » in Tommaso d’Aquino, Roma, Editrice Pontifica Università Gregoriana, 1998.
[ 16] Galbraith montre que Roosevelt a dépensé 2500 milliards de dollars pour la relance américaine seulement… Les 1000 milliards pour une relance mondiale semble un bien piètre investissement en comparaison.
[ 17] Symptomatiquement, le risque sur les taux de change n’a été qu’effleuré.
[ 18] Jean-Philippe de Vogelaere, « Massacre familial: cinq morts inexpliquées », La Dernière Heure, 24/10/2001, http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/28293/massacre-familial-cinq-morts-inexpliquees.html
[ 19] Gilles Deleuze, Cinema 2 : L’Image-Temps, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 289.
[ 20] Ibid., p. 289.
[ 21] Ibid., p. 220.
[ 22] John Lanchester, « Cityphilia », London Review of Books, Vol. 30, No. 1, 3 janvier 2008, p. 9-12, http://www.lrb.co.uk/v30/n01/lanc01.html
[ 23] Luc Dardenne, « Dans le dos de l’ange de l’histoire », Multitudes 11, Hiver 2003, http://multitudes.samizdat.net/Dans-le-dos-de-l-ange-de-l
[ 24] Zigmunt Bauman, La vie liquide, Rodez, Rouergue, 2006.
[ 25] Pascal Michon, Les rythmes du politique, Démocratie et capitalisme mondialisé, Paris, Les prairies ordinaires, 2007.
[ 26] Les banques centrales définissent le montant total des liquidités à partir de la base monétaire M3. Ainsi M3 comprend les pièces et les billets, les dépôts, les livrets (type livret A), les comptes épargne-logement, donc tout ce qui est de la monnaie ou qui s’en rapproche parce que très liquide.
[ 27] Voir leur contribution « Genèse de l’État et genèse de la monnaie » dans Frédéric Lordon et Yves Citton, Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects, Paris, Éditions Amsterdam, 2008.
[ 28] Les produits dérivés (comme les CDO ou ABS) sont des instruments financiers dérivés de titres financiers classiques (comme des créances) et qui en dépendent. Ainsi les titres issus de la titrisation des crédits hypothécaires (transformation en titres échangeables) dépendaient du remboursement de ces crédits. L’intérêt des produits dérivés était qu’ils permettaient, théoriquement, de réduire les risques en les disséminant.
[ 29] Philippe Zarifian, « Puissance et communauté d’action » in Spinoza et les sciences sociales op. cit., p.178
[ 30] Les Credit Default Swap sont des instruments financiers servant à protéger un créditeur contre le risque de défaut de son débiteur. Si le débiteur fait défaut, le banquier/assureur contrepartie du CDS reprend le titre de créance à sa valeur initiale, avec le risque d’une faillite si l’assureur n’a pas prévu de devoir reprendre autant de titres (cas de l’assureur américain AIG ayant dû être nationalisé).
[ 31] La prime de risque sur les bons d’États est censée mesurer le risque de défaut du débiteur, ici l’État. Plus, elle est élevée, plus le créancier est en droit d’exiger des taux d’intérêts élevés sur ces obligations.
[ 32] Voir le cours de Vincennes de Deleuze sur L’Anti-Oedipe et Mille plateaux du≈22/02/1972 disponible sur le site http://www.webdeleuze.com.
[ 33] Voir la proposition de Frederic Lordon d’un système socialisé du crédit ou encore les propositions d’André Gorz et des partisans du capitalisme cognitif d’un revenu inconditionnel et d’une autre organisation du temps libre, premières étapes dans une réflexion de ce type.
[ 34] Voir Pascal Sévérac, Le devenir actif chez Spinoza. Paris, Honoré Champion, 2006.
[ 35] Sacher Masoch, « Basil Hymen », in Das Eigenthum, Vol. II, p.286. cité par Torben Lohmüller dans « The economic problem of Sacher-Masochism », in Phantom of Desire, München, éd. Belleville, 2003, p. 70.
[ 36] Sigmund Freud, « Le problème économique du masochisme », 1924, in Névrose, psychose et perversion, éd. Presses Universitaires de France dans la collection Psychanalyse.
[ 37] Rappelons que pour Schopenhauer et pour Sacher-Masoch cette « volonté de vie » n’appartient pas à l’individu mais à l’espèce humaine dans son ensemble et qu’il ne peut exister d’individualité autonome, « libérée » de la volonté de vie.
[ 38] Gilles Deleuze, Présentation de Sacher Masoch, suivi de La Vénus à la fourrure de Léopold Von Sacher-Masoch, tr. fr. Aude Willm, éd. de Minuit, 1967.
[ 39] Le Monde, 12 et 13 octobre 2008, « Retour au réel par la case désastre », éditorial non signé.
[ 40] Le Monde, 18 octobre 2008, « De quel réel cette crise est-elle le spectacle », par Alain Badiou dans les pages « Débats » du quotidien.
[ 41] La référence à Philip K. Dick se justifie d’autant plus que ce texte est un « remix » du préambule du livre d’Ariel Kyrou : ABC-Dick, sous-titré « nous vivons dans les mots d’un écrivain de science-fiction (Inculte, 2009).
[ 42] Le Monde, 10 mai 2008, « Hiroshima : ce que le monde n’avait jamais vu », puis Le Monde, 14 mai 2008, « Très suspectes photos de Hiroshima », par Sylvain Cypel.
[ 43] Pierre-Noël Giraud, Le commerce des promesses, Paris, Seuil, 2001.
[ 44] Alexis Spire, Accueillir ou reconduire, Paris, Raisons d’agir, 2008.
[ 45] Nicolas Jounin, Chantier interdit au public, Paris, La Découverte, 2008
[ 46] Patrick Cingolani, La République, les sociologues et la question politique, Paris, La Dispute, 2003.
[ 47] Cf. Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge, Cambridge University Press, 1986
[ 48] Robert E. Goodin, Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsabilities, University of Chicago Press, 1985, p. 112.
[ 49] Jean-Marc Ferry, Les puissances de l’expérience. Tome II : Les ordres de la reconnaissance, Paris, Cerf, 1991, p. 121.
[ 50] Guillaume Le Blanc, Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, 2007, p. 168.
[ 51] Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001, p. 41.
[ 52] Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin : de Gruyter, 1991, p. 19.