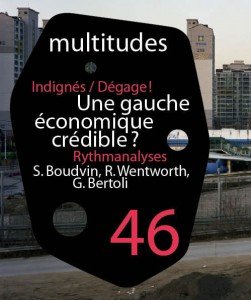En 2008, un nouveau musée a été inauguré à la périphérie de Paris : la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI), un musée national français consacré à l’histoire de l’immigration. La CNHI, comme son nom l’indique, ne se désigne pas comme un musée mais comme une « cité », marquant ainsi la volonté des créateurs de faire en sorte que le « citoyen » participe activement à l’activité de ce lieu, selon le modèle de la cité antique et de sa vie démocratique. Le terme de « cité » fait aussi référence aux cités parisiennes qui, non loin du Vincennes résidentiel, ont accueilli depuis des décennies les immigrants venus tenter leur chance à la périphérie de la capitale. Cette dénomination de « cité » crée donc aussi l’attente d’un lieu de mémoire qui reconnaîtrait sa situation périphérique comme l’un des discours principaux de l’historiographie française et européenne.
On ne saurait ignorer toutefois que, dans ce cadre, le terme de « cité nationale » est tout à fait contradictoire. Sur le plan institutionnel, il fait référence au statut d’un Musée national français qui officialise ses régions inofficielles et excentrées. Sur le plan discursif, ce lieu abrite un discours babélien d’une Cité et sa façon de parler « intimement familière », à laquelle vient se confronter le discours officiel d’une « famille nationale » – pour faire référence à l’étymologie du mot de la « nation » (natio), signifiant les descendants nées d’une seule ligne généalogique. La Nation « une et indivisible » se trouve ainsi confrontée à une immigration de cultures multiples qui peine à être intégrée dans la grande famille de la Nation. L’essai présent – écrit d’un point de vue délibérément « étranger » qui se distancie des débats hexagonaux consacrés à ce sujet – explore cette tension conceptuelle, qu’il s’agira de concevoir aussi bien dans l’ordre discursif du musée que dans la langue dont celui-ci se sert : le français en tant que langue nationale des façons de parler décentralisées de la francophonie.
Une carte postale du bord de la langue
Avant de considérer le musée en soi, regardons un objet qui nous est parvenu depuis le bord du musée, à savoir l’un de ces petits souvenirs, une carte postale, que l’on peut acheter dans le magasin du musée et à partir de laquelle le musée peut promouvoir son concept bien au-delà de Paris. La carte postale a un air amical et jovial : deux cœurs transpercés par des flèches sur un fond rose clinquant sourient à l’observateur. Les cœurs sont constitués de minuscules signes qui font penser à des pictogrammes et à l’écriture en général, mais qui ne semblent toutefois pas obéir à une codification conventionnelle. Les cœurs sont situés près l’un de l’autre, comme s’ils éprouvaient une affection mutuelle, sans pour autant entrer en contact. Seules les flèches semblent dirigées vers un point commun, invisible, situé en dehors de la surface de l’image, et là-bas semblent attendre la promesse d’un effleurement qui, n’étant que sous-entendu, s’annonce d’autant plus tendre.
« Couci-couça », c’est l’inscription sur cette carte postale. Tout comme les cœurs, elle est issue d’un langage amoureux. Dans le langage familier, « couci-couça » permet de répondre à la question bienveillante : « comment vas-tu? » avec, justement, cette sorte de non-réponse : « ni bien, ni mal ». Cette réponse « couci-couça » correspond néanmoins à autre chose qu’à un « comme-ci comme-ça » indifférent. À travers cette formule, la personne interrogée répond à l’attention particulière, à la sollicitude de la personne qui l’interroge, en lui manifestant, de façon allusive, une preuve d’amour, car l’expression « faire così così » tend vers une sphère érotique. Toutefois, la tendresse de cette expression participe d’un câlin ou d’une cajolerie, et c’est la langue elle-même qui la met en place.
« Couci-couça » fait partie de ces « mots voyageurs », un mot voyageur qui semble, au premier abord, très français, voire même, si l’on peut dire, unilinguement français. En même temps, du point de vue de sa signification amoureuse, cette expression apparaît étrangère et surdéterminée par son extérieur. D’après Marie Treps, « couci-couça » est étymologiquement d’origine italienne : au XVIIe siècle, « cosi-cosi » signifiait quelque chose comme « ainsi-ainsi » (Treps, 2003 : 224-225).
Cet « ainsi ainsi » n’est que pure rhétorique et reste donc indécidable dans le sens décrit par Paul de Man. Il lui manque l’objet grammatical sans lequel une comparaison – « X est comme Y » – est dénuée de sens. En ramenant le rapport de similarité – constitutif du sens – entre l’objet et un autre, un tiers, au sens d’un tertium comparationis, à l’objet même, cette expression (« ainsi ainsi ») mène la figure principale de la métaphore ad absurdum. Bien qu’en français contemporain « cosi-cosi » fonctionne comme une métaphore autoréférentielle, l’expression s’explique, du point de vue de l’histoire de la langue, par la rencontre de deux langues. En effet, lorsque le français « comme-ci comme-ça » pénétra dans la sphère intime du langage familier des immigrés et y rencontra l’italien « cosi cosi », cela donna naissance au mot mixte « couci-couça ». La structure métaphorique demeure, au sein de cette nouvelle création, tout aussi mystérieusement hermétique qu’avant, sans faire référence à quoi que ce soit d’extérieur : qui dit « couci-couça » affirme dès lors être entièrement et exclusivement chez soi, auprès de soi, dans une ipséité monadique et tautologique qui est comme elle est, sans intervention de l’extérieur, et qui affirme ainsi l’état d’une « identité » refermée sur elle-même.
Toutefois, de façon très singulière, c’est justement dans l’autoréférentialité de cette expression qu’éclate le potentiel poétique de la langue qui parvient, au sein d’un seul mot, à entremêler le plus intimement possible deux langues – une langue maternelle et une langue étrangère, le français et l’italien – et à démontrer ainsi que la langue elle-même est sensible aux caresses. La langue, au sens de « code linguistique », désigne tout d’abord la langue unique, la langue nationale, la langue de la culture et de la littérature, ou, si l’on parle de la France, la langue de la République, des Lumières et du sens commun (Wahnich 1997). C’est justement cette seule et unique langue maternelle faisant office de garant pour une chose communément appelée « identité culturelle » que Jacques Derrida remet en question quand il écrit au sujet de la francophonie, de façon si paradoxale : « Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne. / Elle ne m’appartient pas » (Derrida, 1996 : 13). Derrida, en attirant l’attention sur l’impossibilité structurelle de posséder la langue, rallie ses réflexions à la figure heideggérienne d’un « acheminement-vers-la-langue ». Quand Derrida situe sa francophonie « au bord du français », « ni en lui ni hors de lui, sur la ligne introuvable de sa côte » (Derrida, 1996 : 14), il parle par surcroît de ce « bord » continental, défini géographiquement, qui laisse parfois déborder l’Europe jusqu’à des régions d’outre-mer lointaines. Pour Derrida qui a fait l’expérience de « l’acquisition du langage » au sein d’une école française dans un Alger colonisé, la francophonie est depuis toujours divisée par le trait d’union entre les adjectifs « franco-maghrébin », et le désir de la langue est toujours habité par l’expérience traumatisante d’une véritable terreur de la langue – l’appropriation de « la langue interdictrice-interdite » demeurant impossible (Derrida, 1996 : 59).
De la sorte, l’affirmation naïve d’une identité langagière se réfère toujours au moins à l’un de ces deux mythes d’origine : au mythe d’un lien généalogique avec le sang de la « langue maternelle » ou bien à celui d’un lien territorial avec le sol d’une « patrie ». Derrida va à l’encontre de cette conception dogmatique fondée sur les notions de mono- et multiculturalisme, et de mono-, bi-ou plurilinguisme, en introduisant le terme de « monolinguisme de l’autre » qui fissure le noyau même de toute langue, en l’identifiant comme une langue incontrôlable et non-maîtrisable qui vient de l’autre et revient vers l’autre.
« Couci-couça » est donc, de façon presque idéale, l’expression d’une seule et unique langue maternelle, au même titre que la mère, qui nous enveloppe tendrement et nous offre une demeure protectrice, ne peut être remplacée. Et en même temps, c’est pourtant l’autre, ou la langue de l’autre, qui est constitutif de l’intimité de cette étreinte. L’intimité de l’identité est, selon Derrida, depuis toujours une expérience de l’aliénation : « ma langue “propre” m’est une langue inassimilable. Ma langue, la seule que je m’entende parler et m’entende à parler, c’est la langue de l’autre » (Derrida, 1996 : 47). « Couci-couça » n’est pas que la démonstration ponctuelle du mélange de deux langues à partir d’un exemple dont l’étymologie nous fournit la clef, c’est aussi et surtout une affirmation de la créolisation comme structure fondamentale de chaque « langage » au sens d’un monolinguisme qui – même s’il concerne la langue maternelle en soi et fait donc appel à la généalogie, l’origine, la provenance, le sang et le sol en tant qu’autorités – provient toujours de l’Autre. Dans l’expression « couci-couça » la langue touche à elle-même et se présente comme double. Deux langues, deux discours historiques, deux sphères et deux cultures se rencontrent, et de leur confrontation, naît quelque chose de nouveau, un tiers, qui nous appelle d’un air radieux et nous invite dans le monde rose, multiculturel de la Cité.
À la périphérie
Pour les Parisiens et les touristes, la Cité constitue, depuis l’exposition universelle de 1931, une destination prisée que l’on choisit habituellement entre amis ou en famille. On fait son sac et on se met en route vers la périphérie de la ville, tout comme on part à la mer avec son sac de plage. On quitte le centre historique de Paris, ses grands musées et leurs discours en langue officielle, avec la ligne 8 qui passe devant la Bastille et nous conduit à l’est, juste devant le boulevard périphérique, là où la ville s’arrête et où la banlieue commence. La Porte Dorée se situe juste avant le terminus, dans le 12e arrondissement, aujourd’hui un quartier résidentiel bourgeois, à l’intérieur du Boulevard Périphérique. Pourtant, autrefois, c’était une région excentrée et mal famée, que l’on surnommait, encore jusque dans les années 20, « la zone ».
Vers 1900, Paris était, à l’extérieur des anciens murs de la ville, entièrement cerné par une ligne de protection militaire de 250 m de large. Il s’agissait d’une zone non-aedificandi, un espace désert et non constructible qui devait permettre de libérer le champ de vision, d’avoir une vue dégagée sur les attaquants et sur le champ de tirs. Seules des constructions en bois provisoires étaient autorisées. Cette zone demeura, longtemps encore après sa période militaire, un no man’s land situé en dehors de la ville, et les nouveaux venus et les déracinés s’en servirent comme zone d’habitat (Le Hallé, 1995 : 266-275). Le prolétariat parisien, tout comme les flux de travailleurs étrangers recherchaient dans cette zone la possibilité d’échapper aux prix élevés de l’immobilier. Ainsi se forma un type de population particulier, à la recherche d’une terre promise : les « zoniers » de Paris que les photographies d’Eugène Atget ont gravés sur la rétine de notre mémoire culturelle. C’est littéralement dans des « immobiliers mobiles », en dehors des murs de la ville, que les « chiffonniers » se sont installés ; ils vivaient dans des camps de caravanes et de cabanes, dans cet endroit extra-muros, derrière la Porte Dorée (Atget, 2000 : 194-199).
D’un point de vue étymologique, la Porte Dorée tire son nom de cette zone périphérique. La construction qui servait de porte de la ville se situe en effet « à l’orée » du Bois de Vincennes que côtoient les quartiers du 12e arrondissement (Murphy, 2007 : 27). Au fil du temps, le mot “porte de orée” se transforma en “Porte Dorée”, et, tout comme la liaison de l’écrit fit disparaître la signification qui se logeait, à l’origine, au sein de deux mots séparés, c’est aussi la zone à la périphérie qui disparut. La périphérie, si elle était bien lisible dans l’écriture, dans l’espace séparant chacun des mots, sembla se dissoudre lors de la liaison des mots, sans toutefois omettre de laisser une trace qui persiste secrètement dans la liaison « Dorée ».
À partir des années 1920, les chiffonniers furent chassés, les murs de la ville démantelés et les baraques rasées. C’est ainsi qu’apparut, à l’est de Paris, un nouvel espace, une surface libre de plus de 110 hectares qui accueillit, en 1931, une nouvelle ville, une nouvelle « terre promise » : la métropole universelle de l’Exposition coloniale. Une station de métro fut aménagée rien que pour cette dernière, amenant ainsi les huit millions de visiteurs sur les lieux de l’exposition pour leur faire vivre « le tour du monde en un jour » (Murphy, 2007 : 9-23) On y exposait de l’art et de l’artisanat endogène, et le gouvernement français fit même venir des « indigènes » des colonies jusqu’à Paris afin de les présenter au milieu de leurs architectures d’origine, dans des cabanes en bois et des temples exotiques. La pièce maîtresse était un village de pêcheurs sénégalais, reconstitué d’après le modèle européen des expositions coloniales (Deroo, 2005 : 104-145 ; Taffin, 2002 : 184 et suivantes).
Un seul bâtiment était censé exister de façon permanente : le bâtiment principal de « l’Empire français », conçu par Albert Laprade. On installa au rez-de-chaussée le salon du ministre des colonies, Paul Reynaud, ainsi que le salon du Maréchal Lyautey, gouverneur du Maroc. La grande salle des fêtes s’élance en hauteur, au-delà du premier étage, là où se situent les salles d’exposition.
Bien longtemps après la disparition des pavillons provisoires du Bois de Vincennes, le Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie fut créé dans ce palais des colonies à titre de musée colonial permanent. Le bâtiment, placé sous la protection des monuments historiques, se présente aujourd’hui à nous de façon pratiquement inchangée, mais il porte un nouveau nom : le « palais de la Porte Dorée ». Cependant, ce nom souligne un paradoxe architectural car la condition préalable pour une porte historique de la ville « à l’orée du Bois de Vincennes » se fonde justement sur la loi du non-aedificandi. Ainsi considéré, le palais des colonies enfreint, de par son architecture impériale et monumentale, sa propre loi, à savoir cette interdiction de construire qui devait assurer la protection de la capitale en aménageant ses vulnérables frontières en zone de contrôle dans le but de protéger le centre des intrus. L’écriture elle-même, dans le nom historique de la « Porte d’Orée », laissait sous-entendre cette interdiction de construire en munissant cette région, où la périphérie de la ville rencontre l’orée du bois, d’un nom composé. Ce tracé de frontières entre les mots attirait l’attention sur un espace désert particulier, une place littéralement vide entre les lettres, une tache blanche sur un plan de la ville qui rappelle la loi relative à un espace interdit sur lequel il est défendu de construire ou d’écrire. C’est dans cet espace que fut érigé le palais de la Porte Dorée qui s’interdit lui-même, en son propre nom et de par sa propre loi, l’autorisation préalable à sa construction. C’est justement cette maison impossible qui abrite depuis peu la CNHI.
Les regards sur l’immigration
Il fallut attendre pas mal de temps pour que la CNHI puisse voir le jour. Un groupe d’historiens avait fondé en 1990 l’Association pour un musée de l’immigration et réclamé un lieu de mémoire consacré à l’histoire de l’immigration en France semblable à Ellis Island aux États-Unis. Plusieurs tentatives furent nécessaires; elles échouèrent devant l’hésitation du gouvernement Mitterrand tout comme face à la résistance du gouvernement chiraquien. C’est seulement en 2002, après avoir été réélu, que Jacques Chirac accepta le projet et le confia à son ministre de la culture Jacques Toubon.
Lors du discours d’ouverture qu’il tint le 10 octobre 2007, Jacques Toubon a souligné la nécessité de ce musée : « L’histoire de la France, la construction de son identité, de sa civilisation, est largement celle de millions d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays d’origine, pour s’établir en France et devenir français. […] Or cette histoire est quasiment méconnue et elle n’est pas reconnue. […] [L]a Cité […] se destine à devenir le lieu où le patrimoine de l’immigration sera, non seulement conservé, mais aussi mis en valeur » (Toubon, 2008 : 4). Jacques Toubon revêt dans ce discours la fonction de porte-parole. En vertu de son poste de Président du conseil d’orientation de la Cité, il parle « pour » la Cité, « pour » le curatorium et le conseil des historiens. D’un point de vue grammatical, Toubon remplit donc le rôle de la première personne dans l’ordre discursif du musée.
D’après la théorie du musée de Mieke Bal, le discours du musée est comparable à un acte de langage : « Dans les expositions, une “première personne”, l’exposant, parle à “une deuxième personne”, le visiteur, d’une “troisième personne”, l’objet exposé, qui ne participe pas à la conversation » (Bal, 1996 : 3-4). L’acte de langage du musée est énoncé à la première personne et sur le mode constatif : il observe et constate l’histoire de la France de façon affirmative et va éclairer le peuple français sur un aspect de son histoire qui est « quasiment méconnu ». Cet acte de langage autoritaire se trouve fondamentalement à la base de la création de tout musée national. Le destinataire, l’instance que Bal identifie comme « deuxième personne » et à laquelle s’adresse l’acte de langage, c’est le peuple français dont il faut changer le « regard contemporain sur l’immigration ». L’objet de l’acte de langage, c’est l’histoire de l’immigration et la part de cette tierce personne immigrée au devenir du peuple français. En résumé : « la Cité » (1ère personne) parle « au peuple français » (2e personne) au sujet des immigrés (3e personne). Je reviendrai plus tard, de façon plus détaillée, sur la rhétorique particulière de cette note éditoriale de Jacques Toubon, mais pour le moment, entrons dans l’exposition en elle-même.
Repères de l’immigration
L’exposition permanente au premier étage est consacrée à l’histoire de l’immigration en France au cours des deux siècles derniers et porte le titre de « Repères ». Le long de neuf séquences thématiques désignées comme repères, le visiteur se laisse guider par un ordre qui le conduit chronologiquement de la première vague de migration à la France multiculturelle d’aujourd’hui : Émigrer, Face à l’État, Terre d’accueil, France hostile, Ici et là-bas, Lieux de vie, Au travail, Enracinements, Sportifs, Diversité.
Chacune de ces thématiques est traitée sous trois aspects. Dans un premier temps, le discours historique « officiel » est présenté sur des tables lumineuses à travers des textes, des images et des enregistrements sonores : photographies, fac-similés de documents d’archive, décrets de loi, coupures de journaux relatent les chapitres glorieux tout comme les chapitres sombres de l’histoire de l’immigration française. Ce discours macro-historique est, dans un deuxième temps, complété par des objets d’ordre micro-historique, personnels, authentiques que les migrants ont pu sauver au-delà des frontières, dans leur bagage à main, lors de leurs traversées vers Marseille ou de leurs voyages en train : les choses essentielles, et surtout transportables, pour survivre à l’étranger, tels une casserole pour cuire le riz, une paire de ciseaux de tailleur, un violon, un poste de radio TSF, une poupée, des laissez-passer, des photographies, et pour finir, la valise même (Neef, 2006 : 23-49). Les objets du souvenir que les immigrés ont fait parvenir au musée sont si nombreux qu’une « Galerie des Dons » a été mise en place. L’exposition montre aussi des souvenirs individuels des immigrés sous forme de lettres et d’enregistrements vidéo avec les récits de témoins de l’époque. Et enfin, dans un troisième temps, se mêlent au matériel historique authentique des œuvres d’art qui commentent le tout : des tableaux, des caricatures, des séries de photos, des sculptures, des installations vidéo et des aires de jeux interactifs.
L’immigration en soi se refuse à toute observation centrale car ses événements et ses objets viennent justement d’un extérieur qui reste pour l’instant, si l’on part du canon culturel national, invisible ou – pour reprendre les mots de Mieke Bal – « muet ». L’exposition permanente prend en compte ce refus de soumission expositoire en optant pour une pratique d’exposition particulière où l’histoire de l’immigration se raconte de par le croisement permanent de différents points de vue. Par exemple, on trouve exposés dans le repère « Face à l’État » des photos et documents audio historiques sur la politique du Premier ministre André Postel-Vinay qui essaya en 1974 de limiter l’immigration de travailleurs étrangers par des lois strictes. La voix du ministre est contrée par une autre voix, celle de Michel Yapi, un « Africain clandestin » qui témoigne dans un court-métrage ayant pour titre « un clandestin légal » sur son statut en tant que « non-citoyen » français. Dans cet acte de langage muséal, la voix de la loi se divise en deux voix qui parlent simultanément et en contrepoint l’une de l’autre : à côté du discours officiel du législateur s’insère le discours non-officiel du sujet de droit « clandestin », et le statut du soi-disant « clandestin » se révèle alors, dans la polyphonie bakhtinienne de ces deux voix, comme une construction paradoxale qui est à la fois le produit de l’existence d’un homme et de la législation qui interdit cette existence. La Cité parle au nom du gouvernement et au nom des migrants, et c’est sur ce discours créolisé qu’elle fonde son autorité historiographique.
Parmi les objets exposés, il y en a toujours quelques-uns qui renvoient à une certaine position marginale de l’histoire de l’immigration, à ses espaces intermédiaires législatifs ainsi qu’aux marges économiques de l’existence que mènent les migrants. Dans un geste méta-muséal, c’est aussi sur lui-même que le musée pointe le doigt, sur ses techniques d’exposition interactives et basées sur le dialogue, mais, ce faisant, il ne dissimule pas, il ne tait pas pour autant l’histoire du bâtiment ni celle du 12e arrondissement. Une petite série de photographies d’Eugène Atget des années 1912-1913 témoigne des alentours historiques de la Cité en tant qu’ancienne zone. La xénophobie des politiciens et des médias français est affichée ouvertement. Une galerie de photographies de Delahaye est consacrée aux graffitis des tagueurs anonymes que l’on trouve dans les banlieues explosives de Paris, une autre aux immigrés qui ont réussi à se faire un nom : Picasso, Goya, Kusturica.
Le sac migrant revient souvent dans l’exposition, par exemple dans la section « Nouveaux objets, nouvelles pratiques ». Tout coloré, il remplit son rôle d’icône de la culture multiculturelle. Au final, nous aussi portons avec nous un sac semblable ; à la différence près que le sac de l’immigré renferme souvent l’ensemble de ses possessions, ce qui n’est pas le cas de nos ’sacs de plage’ ; le sac, de l’extérieur, ne laisse toutefois pas transparaître cette différence. Le bord de mer comme lieu symbolique de l’arrivée semble, de la même façon, véritablement omniprésent dans le musée. Dans une certaine mesure, la tour-lit de Togo constitue elle aussi une sorte de bord. Comme le sac, la plage aussi prend des formes différentes : lieu touristique et terre promise, mais à la fois et tout au contraire, par exemple dans la série de photographies d’Olivier Jobard, frontière indépassable entre l’Afrique et l’Europe.
Un créole sans accent
« C’est ici la douce France? » – demande, dans une caricature de Georges Wolinski, un immigrant arabe, le premier d’une chaîne humaine descendant d’un bateau, et qui patauge dans l’eau en direction de la plage. À la Cité comme dans la caricature de Wolinski, les nouveaux-venus en provenance de toutes les régions du monde parlent français, même quand ils sont en train de nager depuis un horizon indéterminé vers le rivage. C’est curieusement souvent sans accent que les immigrés parlent, dans les installations vidéo du musée, de leur « déracinement », de leur être étranger, de leur « identité » française et non-française : témoignages d’un créole particulier.
Le dernier repère de l’exposition permanente porte le titre « Diversité » et est consacré à la rencontre des langues. Les panneaux d’affichage expliquent les liens historiques entre les langues : le Français a connu des influences romanes, celtiques, germaniques et plus tard également des influences arabes, perses, asiatiques et américaines. Les visiteurs apprennent que, dans le dictionnaire français, 8 600 mots sur 60 000 ont une origine étrangère. Ils se retrouvent ensuite devant un panneau portant l’inscription « Rencontres » : « À travers les siècles, la France s’est imprégnée de la multiplicité des échanges et des apports culturels venant de l’étranger. Ces adoptions, emprunts, métissages, façonnent le quotidien et contribuent, au fil du temps, à l’élaboration du patrimoine national, bien commun hérité de l’histoire ».
C’est de nouveau la première personne du discours muséal qui parle sur ce mur. Elle explique la francophonie en vertu de son expertise en matière de diversité, d’échange et de mélange. Et elle reconnaît une dette, des prêts que les étrangers nous ont accordés. On estime ces emprunts en relation avec un « patrimoine national » qui doit être honoré, tout comme Jacques Toubon l’avait formulé dans son discours d’inauguration : « La Cité […] se destine à devenir le lieu où le patrimoine de l’immigration sera, non seulement conservé, mais aussi mis en valeur. »
Le « patrimoine », ou l’héritage culturel, a d’abord quelque chose à voir avec la transmission des significations et des valeurs, ainsi avec la tradition, mais aussi avec le transfert, l’envoi ou la traduction. Le concept énonce une obligation entre les générations qui, au-delà de leur propre vie, se chargent des descendants. Hériter repose, du point de vue de la loi, sur un contrat qui s’étend à la famille et à la généalogie, et qui lie les contractants entre eux d’après des liens de parenté. Le droit de succession est de tout temps lié à une génération, une famille, une maison ou une nation, et il présuppose le statut familial des contractants. Ce droit de succession nécessite une attestation notariale ; elle se sert du nom de famille que l’on peut vérifier à l’aide d’une pièce d’identité, de la signature ou, si nécessaire, d’un test ADN. Le mot « patrimoine » indique en outre que c’est le nom du père, du patron, du maître de maison qui peut justifier de la légalité d’un héritage et que c’est « la patrie » qui joue un rôle ici.
Mais qu’en est-il lorsqu’un immigré comme Michel Yapi est « clandestin », ou – en langage politiquement correct, comme on s’efforce de le pratiquer depuis l’affaire Saint-Bernard : un « sans papiers »? (Rosello, 2001 : 2) Quel héritage ou quel « patrimoine » doit-il alors déclarer à la CNHI ? Ou qu’en est-il encore s’il débarque sur une plage sans rien – comme l’écrit Edouard Glissant – non pas comme le « migrant domestique (familial) avec son coffre, sa cuisinière, ses casseroles et ses portraits de famille » – et, comme on devrait ajouter aujourd’hui : avec sa pièce d’identité –, mais en tant que « migrant nu » ? (Glissant, 1996 : 14) S’il nage illégalement, et donc dans une certaine mesure, sans nom, d’une plage à l’autre, comme Kingsley, sans même un sac de plage, quel don peut-il donc faire à la Galerie des Dons ? Et comment peut-il réclamer à la nation française les emprunts, comment peut-il s’identifier devant son créancier si son identité lui est refusée voire interdite en vertu des lois de l’immigration ? S’il possède encore le pouvoir de la mémoire, mais si, contrairement à Kingsley qui a trouvé en Oliver Jobard un traducteur, il ne copossède pas la langue (Jobard, 2006) – comment pourra-t-il alors prendre la parole dans la CNHI pour rendre compte de sa propre « histoire de l’immigration » ? « La première violence » envers l’étranger réside, c’est ainsi que Derrida décrit la loi de l’hospitalité absolue, dans le fait que l’étranger « doit demander l’hospitalité dans une langue qui par définition n’est pas la sienne, celle que lui impose le maître de maison, l’hôte, le roi, le seigneur, le pouvoir, la nation, l’État, le père, etc. » (Derrida, 1997, 21).
L’historiographie de l’immigration se déroule nécessairement en marge du descriptible au même titre que l’immigration sans papiers, car faire acte d’« étrangeté » en tant qu’immigré présuppose toujours que cela se déroule dans la langue de l’hôte. Rendre compte du patrimoine de l’immigration doit obligatoirement se faire dans le cadre de la francophonie, et le patrimoine sera toujours et exclusivement reconnu par la nation après coup, comme quelque chose qu’on a découvert ultérieurement, et qui a d’abord dû surmonter son caractère résolument étranger par assimilation (langagière) à l’hôte ou au patron. Prendre part à l’acte de créolisation que la cité s’est fixé pour objectif implique en premier lieu que la propre langue maternelle devienne étrangère. Mais la créolisation signifie pour Glissant que les éléments culturels mis en présence doivent obligatoirement être « équivalents en valeur », faute de quoi la créolisation ne peut véritablement avoir lieu : « La créolisation, c’est le métissage avec une valeur ajoutée, qui est l’imprévisibilité. » (Glissant, 1996 : 18-19).
Couci-couça
La Cité souhaitant expliquer et éduquer afin de changer le regard sur l’immigration, la visite se termine par un jeu didactique adressé à la « deuxième personne » (les visiteurs). Le principe du jeu consiste à combiner des mots sur un écran tactile. Parmi les mots proposés, on trouve des mots écrits en blanc sur fond noir et des mots écrits en noir sur fond blanc. Les visiteurs suivent avec attention les instructions de l’installation et les enfants sont particulièrement ravis de cette invitation à jouer. De leur index, ils poussent les mots d’un côté à l’autre ; au lieu de construire des phrases, ils trient les mots dans un ordre différent dont la codification en couleurs ne pourrait être plus claire : les étrangers noirs à gauche et les blancs familiers à droite. Ils apprennent de la sorte que « pyjama » est à l’origine un mot étranger tout comme « zéro », « hasard », « tabou » et « couci-couça ». Voilà un étrange marquage de ce qui est étranger, qui semble reproduire de façon ironique ce qui s’est passé dans les scènes fondatrices de la République. En 1793, Garnier de Saintes avait en effet proposé un décret : Les étrangers « qui obtiendront un certificat d’hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore sur lequel sera tracé le mot hospitalité » (Wahnich, 1997, 10 & 23).
Dans cette installation qui est conçue par la première personne du discours muséal comme un exercice au métissage, le processus créatif de la créolisation engendre des effets entropiques. Le français s’avère être une langue, et non pas la langue. La francophonie prévoit en permanence des pièges dans lesquels le familier se révèle en réalité étranger, « unheimlich » dans le sens de Freud, littéralement clandestin, secret et illégal. Les deuxièmes personnes dans le musée national se voient présenter, de manière impressionnante, l’expertise de la première personne qui incombe à la francophonie et qui n’hésitera pas, sous le signe de la tolérance, à admettre l’étranger en le marquant dans sa différence.
« Repère », c’est littéralement une marque, un signe distinctif. « Se repérer » signifie se reconnaître, mais aussi : se donner à connaître. En ce sens, « couci-couça » s’est rendu reconnaissable comme étranger et non originaire du français et vient de la sorte, ex negativo, appuyer l’idée d’une francophonie originelle et pure. En vérité, la francophonie n’est jamais monolingue, elle se déroule « au bord du français, uniquement », comme l’écrit Derrida, « sur la ligne introuvable de sa côte » (Derrida, 1996 : 14). Glissant nomme ce bord « archipélique », faisant ainsi allusion à la marge géographique de la francophonie dans les Caraïbes qui constituent le cap le plus extérieur de la capitale et où la langue créolophone a délaissé l’identité d’une unique racine pour s’embarquer dans la poétique de la relation, afin que la mer des Caraïbes s’épanche dans « des flux “planétaires” » (Glissant, 1996 : 25). La langue débarque sur cette plage « comme un arrivant sans origine» et se convertit à soi-même, dans ce câlin intime que nous réserve déjà « couci-couça », en parlant « différemment » au sein de la monolangue même. L’intention de la Cité d’ériger un monument au patrimoine culturel des immigrés demeure, au sens de l’hospitalité absolue, une chose énigmatique et, compte tenu de l’utopie ou du fantasme d’une langue d’une république universelle au service d’une ambition politique planétaire, cette intention se présente comme « une tâche infinie ».
Traduit par Catherine Rogister