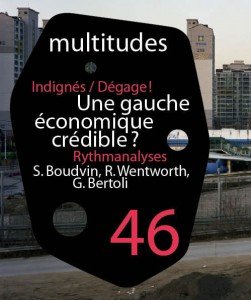Le Mouvement du 15 Mai, rassemblé environ un mois sur la Puerta del Sol de Madrid autour du chant No nos moveran (repris des combats des républicains espagnols de 1936), s’inscrit dans un vent de révolte qui agite depuis de nombreux mois tout l’espace méditerranéen. Des rues de Sidi Bouzid aux villes de Syrie, en passant par la place Tahrir et la place Syntagma d’Athènes, des gestes comparables se répandent d’un pays à l’autre, témoignant dans chaque cas de circonstances particulières mais aussi d’un décalage croissant entre des espoirs soulevés et des frustrations indignées.
On ne saurait pourtant en rester à célébrer des analogies importantes mais superficielles entre tous ces mouvements du printemps méditerranéen. D’une part – comme l’illustre l’exemple islandais (insuffisamment discuté) et comme l’indique l’entretien avec le rappeur sénégalais Thiat publié dans ce numéro de Multitudes – les soulèvements indignés contre les pouvoirs dominants ne se limitent pas géographiquement à la seule aire méditerranéenne. D’autre part, c’était déjà de « l’indignation » (bien plus que tel ou tel point technique de la réforme des retraites) qui avait fait descendre des millions de Français dans les rues à l’automne 2010 ou qui poussait, dès décembre 2008, les jeunes Grecs à occuper la télévision d’État pour proclamer « Arrêtez de regarder et sortez tous dans la rue ! »[1].
C’est de l’analyse précise de chaque cas particulier que peut émerger une idée adéquate de ce que ces mouvements ont en commun (une indignation prête à passer à l’acte, la mobilisation par les réseaux sociaux, une force d’auto-organisation) et de ce qui les sépare (les compositions de classes propres à chaque société, le niveau de répression, les relais médiatiques).
Les micropolitiques de la Puerta del Sol
L’Espagne produit des millions de chômeurs dont près de 40 % de jeunes et autour de 1,2 million de familles sans revenu. La gestion par le PSOE de Zapatero du plan d’austérité du FMI et l’acceptation du pacte social par les syndicats les ont mis hors jeu aux yeux d’une large partie de la population. Plusieurs groupes d’activistes – comme les anonymous, les V de Vivienda[2], les ipotecados, qui militent respectivement pour la liberté sur Internet, sur les questions de logements et enfin sur les problèmes bancaires de particuliers et de familles endettées – se sont réunis pour appeler à la manifestation du 15 mai autour de mots d’ordre nombreux[3]. Ces petits groupes militants, en prise réelle sur le quotidien de millions de personnes, ont réussi à faire coaguler un mouvement par le biais d’un message quasi subliminal en postant sur la plate-forme YouTube, dès le 8 avril, une vidéo qui exprime et condense le dégoût général et l’indignation latente[4] : les mots corruption, monarchie, tristesse, précarité, corporations, peur, capitalisme, abus de pouvoir, austérité, manipulation, dépit, bipartisme, syndicats vendus, église, isolement, guerre, contrats poubelles, hypothèques, renflouements, mensonge, répression, Wall Street, quote-part, Moody’s, désinformation, impuissance, délocalisation, mileurismo, spéculation, anxiété, impérialisme, banques, dépression, FMI s’enchaînent rapidement sur une musique légèrement angoissante et entretenant le mystère. Un mystère renforcé par le fait que ce message, largement relayé sur l’Internet, n’est revendiqué par personne – ce qui ne va pas empêcher les gens de se réunir à la date du 15 mai et au lieu dit, au soleil, du moins à sa porte. Le succès de l’opération va être tel qu’à partir du 15 mai le camp s’installe et croît rapidement. Les dimanches voient des records d’affluence, preuve s’il en faut de la popularité du mouvement auprès de la population.
Le camp, organisé autour de ses nombreuses commissions et de ses assemblées générales, permet d’exprimer et de donner forme aux revendications d’une classe moyenne en plein recul social, d’une jeunesse extrêmement précarisée, de nombreux chômeurs, de retraités aux maigres pensions et de toutes celles et ceux qui subissent la crise et en sont indignés, fatigués, révoltés par le système capitaliste. Ce sont ces bouts de multitudes qui se sont réapproprié l’espace public pour se parler, pour ré-accaparer la parole politique dont tous s’estiment dépossédés et qui font convergence pour s’inventer un futur commun.
Deux facteurs structurants de ce mouvement expriment la radicalité et la force de ce qui se déroule. La mise en application de cette démocratie réelle n’a été possible à la Puerta del Sol que par un degré d’auto-organisation élevé, qui impressionne tous ceux qui sont passés par le camp. Cette capacité à l’auto-organisation repose sur plusieurs éléments : une volonté de transparence facilitée par le recours à la mise en ligne de tout le matériel élaboré au sein des différentes commissions, matériel qui est présenté et également débattu lors des assemblées générales ; le refus de s’aligner sur quelque parti ou quelque « chef » que ce soit, ce qui implique aussi le renouvellement systématique des différents postes à responsabilité (porte-parole, secrétariat, coordination…). À cette crainte du leader et de la récupération politique, le mouvement a su répondre pour l’instant en développant ce très fort degré d’organisation collective, et surtout en insistant sur l’élaboration de consensus comme moyen de prise de décision commune, afin d’éviter toute division et donc de rassembler largement.
Articulations macropolitiques
À partir de la Puerta del Sol, le mouvement s’est diffusé dans la plupart des grandes villes espagnoles, où on peut espérer qu’il travaille désormais en profondeur après que les occupants de la place madrilène ont décidé de lever leur camp. Non seulement la popularité dont bénéficient les manifestants et surtout la possibilité de communiquer de façon quasi immédiate ont permis au mouvement du 15 mai de déjouer les sirènes de la répression, mais un nouveau rapport de force a émergé sur la scène politique nationale, qui s’est notamment traduit dans l’abstention massive lors des dernières élections et par la défaite du PSOE. Les Indignés sont non seulement des voix qui parlent, mais aussi des votes qui comptent par leur refus même de continuer à soutenir des politiques de soumission de gauche. Les commissions et assemblées ne se sont pas contentées de gérer l’évacuation des poubelles sur les places occupées ; elles ont articulé des demandes macropolitiques appelées à recadrer les débats à venir.
Ce mouvement ne repose pas sur une liste de revendications classiques négociables immédiatement, mais est porteur de propositions « qu’en tant que citoyens nous considérons comme essentielles pour la régénération de notre système politique et économique » : élimination des privilèges de la classe politique, lutte contre le chômage (à comprendre comme une lutte contre la production du chômage par le capitalisme contemporain bien davantage que comme une demande d’emplois précaires et mal payés), établissement d’un revenu minimum d’existence, amélioration des services publics, régulation des institutions financières, refondation des principes et des mécanismes de la fiscalité, libertés citoyennes et démocratie participative, et réduction drastique des dépenses militaires.
C’est l’affirmation d’entrée de la citoyenneté pour tous qui fait commun, qui fait légitimité ; la ville et ses quartiers sont posés au cœur des actions comme lieux des discussions et de l’élaboration des mots d’ordre qui sont différenciés dans ce commun. Dans les AG de quartier, le système du consensus, jusque-là prédominant, est progressivement mis de côté pour une règle de vote majoritaire aux quatre cinquièmes. Dans un tel passage vers la politique et le collectif, les manifestants rencontrent de nouveaux défis, le risque de connaître des divisions, de ne pas tomber d’accord sur les mots d’ordre.
Un problème de classe
Que reste-t-il du mouvement du 15 mai, maintenant qu’a cessé l’occupation de la Puerta del Sol ? Un problème qui ne fait que se déplacer. Quelques semaines après la grande mobilisation madrilène, des dizaines de milliers d’Athénien(ne)s se rassemblent presque quotidiennement au cri de « Tant que le gouvernement, la troïka et la dette ne s’en iront pas, nous ne partirons pas » : No nos moveran ! Souterrain et apparemment rangé par la police et les balayeurs, le mouvement se déplace. Ce qui reste, après le démontage des campements, est en effet la prise de conscience profonde de l’injustice sociale que le capitalisme impose par la force ; exercée en général sur les populations de la périphérie, elle grignote aujourd’hui jusqu’au cœur des pays les plus riches. Avant-hier (et aujourd’hui encore en Côte d’Ivoire), on mâtait les populations récalcitrantes en envoyant des troupes pacifier les colonies. Hier, on déléguait aux comptables du FMI le soin de serrer la ceinture des Indonésiens ou des Argentins. Aujourd’hui, ce sont des Européens qui se voient soumis (non sans horreur) aux remèdes de cheval qu’on appliquait jusqu’à peu (sans trop d’arrière-pensées) à des populations lointaines.
Ce problème pourrait être identifié comme un problème de classe si les organisations marxistes dans leur ensemble ne continuaient pas de réserver l’identité de classe aux seuls travailleurs d’usine. On a dit que, dans leurs profils socio-économiques moyens, les indignés de la Puerta del Sol ou de la Bastille à Paris appartenaient moins au « peuple » (ouvrier) qu’à une « petite-bourgeoisie » en mal de bohème, sur-éduquée et sur-diplômée, une classe paradoxale à la fois supérieure (par ses compétences relationnelles et ses attentes existentielles) et systémiquement frustrée par une exacerbation des inégalités. Au fur et à mesure que cette exacerbation (promue par la logique néolibérale dominante) concentre la richesse dans de moins en moins de comptes en banque et laisse de plus en plus de « supérieurs » sombrer dans une précarité relevant de la déchéance, une convergence possible s’esquisse entre des acteurs qui restaient jusqu’ici étanchement compartimentés.
De même que l’Espagnol de 2011 se retrouve dans une position étrangement comparable à celle de l’Argentin de 1999, de même la fille (pourtant bien éduquée) de cadre supérieur (endetté) se trouve partager certaines galères réservées jusqu’ici aux fils de caissières. Les différences entre les classes, l’exploitation du travail salarié, ne se sont bien entendu nullement abolies. Les pressions inégalitaires tendent toutefois à instaurer des porosités qui laissent apparaître de nouvelles solidarités (plus ou moins ponctuelles), donc de possibles convergences des luttes, aux conséquences encore imprévisibles. En même temps que la base sociale des politiques de gauche (le prolétariat) reculait au sein des pays les plus riches, une nouvelle multitude (le cognitariat précaire) prenait forme. Hormis quelques résistants héroïques, de nombreux sans-papiers exploités sans merci et bon nombre d’exclus réduits aux impasses de la misère la plus « indigne », nous sommes désormais tous des petits-bourgeois déclassés, des endettés actuels ou potentiels, des indignés par les limites du welfare.
De l’indignation à l’engagement et à la lutte
Comme le rappelle un beau texte d’Alexandre Matheron, rédigé il y a dix ans mais dont nous republions ici un extrait, tant il éclaire bien l’actualité des mouvements en cours, l’indignation se définit chez Spinoza comme l’affect politique par excellence, consistant en « la haine que nous éprouvons pour celui qui fait du mal à un être semblable à nous ». Si nous vivons une époque caractérisée par l’indignation, c’est que nous avons quotidiennement sous les yeux, dans la rue ou à travers nos petits écrans, les conditions « indignes » dans lesquelles sont condamnés à vivre « des êtres semblables à nous ». Ce sentiment est d’autant plus fort que nous suspectons que des êtres qui nous sont chers (nos enfants, nos parents, nos amis, voire nous-mêmes) sont susceptibles de tomber dans de telles conditions de vie indignes du fait de la régression des protections sociales mises en place par l’État-providence. Comme le montre bien l’analyse d’Alexandre Matheron, il suffit que cette indignation puisse entrer en connexion entre les individus pour que « l’insurrection soit à l’ordre du jour ».
Les Indignés qui occupent les places des grandes villes sont obligés de rentrer temporairement chez eux. Ils vont y reconstituer et y augmenter leurs forces. Aussi enfermés qu’ils soient dans un quotidien indigne de leurs aspirations, de leurs qualifications, et des promesses auxquelles ils ont cru, ils sont déjà devenus mutins. Et ils s’apprêtent à devenir luttins, feux-follets, impatiences, irréconciliables. Mais ils y vont doucement, de biais, transversalement aux canaux de communication : la rue certes, mais aussi le réseau ; la foule mais aussi les amis. Une expérience partout déjà : ce n’est pas négociable. Leur plate-forme, le pouvoir ne l’a pas prise en compte.
De la clameur d’indignité à la pratique co-immuniste
Qu’est-ce que les Indignés espagnols reprennent dans l’air de No nos moveran (qui fait écho à No pasaran) ? Une force de résistance. Cette résistance est d’abord physique : occuper un espace (refuser de s’en faire déloger), rester campé sur ses positions (à la Puerta del Sol), c’est revendiquer une histoire commune (celle des mouvements d’émancipation qui ont animé le xxe siècle), c’est revendiquer un lieu commun (une place publique) comme un acquis important à défendre[5].
Ce que conservent les mutins c’est l’histoire collective que le capitalisme entend balayer. « Défendre des acquis », c’est défendre les résultats de luttes dont on sait par sa famille et ses amis qu’elles ont valu la peine. L’activisme n’est pas une innovation permanente : il s’inscrit dans un commun hérité des désirs, des luttes et des intelligences du passé. L’État-providence mis en place lors du xxe siècle présentait d’innombrables insuffisances (de par son caractère national, inégalitaire, partiel, bureaucratique, contrôleur). Il s’inscrivait néanmoins dans un mouvement de prise en charge commune de l’individuation qui mérite d’être approfondi, et donc préservé – un mouvement de construction collective d’un « co-immunisme » qui reste un idéal éminemment progressiste[6]. Le « non » de No nos moveran est donc simultanément une force de résistance (apparemment « négative ») et une force d’affirmation : occuper un espace commun pour s’opposer aux forces qui menacent de le liquider, c’est simultanément affirmer la nécessité de cultiver ce dont cet espace commun est porteur.
Il est absurde d’opposer résistance et affirmation : ce sont les deux faces d’un même mouvement[7]. C’est le propre du néolibéralisme dominant que de dissocier les deux, en voulant nous faire croire qu’il peut y avoir de l’affirmation (de nouveauté, innovation, réforme, progrès) purement positive, inventive, créative – face à laquelle les opposants apparaissent comme des retardés, inertes et ronchons, conservateurs et nostalgiques, prisonniers du passé et d’habitudes inamovibles. On n’innove jamais sans prendre appui sur les forces du passé qui font le présent. La table rase du chant révolutionnaire a changé de camp dans la grande liquidité capitaliste d’aujourd’hui. Les indignés-mutins-luttants résistent aux forces de liquéfaction de l’individualisme consumériste, qui se font passer pour des forces de progrès néolibéral, ils résistent au nom d’une conservation des acquis de la Libération qui, à la suite des fronts populaires des années 1930, a affirmé un mouvement réellement futuriste, l’égalité en droits de tous et toutes.
Il ne nous ferons
Les manifestants français qui ont tenté d’émuler sur la place de la Bastille l’occupation de la Puerta del Sol ont inventé leur propre traduction de la chanson espagnole : « Non, il ne nous ferons pas partir ! Parce que notre vie est sur cette place, il ne nous ferons pas partir ! Il ne nous ferons pas partir, c’est notre génération ! »
À travers la posture apparemment négative, réactive, de la résistance à un mouvement imposé de l’extérieur (No nos moveran), l’agrammaticalité apparente de cette traduction fait émerger l’affirmation d’une puissance constitutive mutine : nous ferons. C’est « eux » qui essaient de nous déloger, de nous reloger, de nous caser (dans un emploi, dans un isoloir, dans une catégorie administrative), mais c’est nous qui ferons l’avenir, sur la base de nos besoins, de notre intelligence et de nos désirs. « Ils » veulent nous traiter en objets, producteurs et consommateurs d’objets ; nous résistons par l’écriture à cette force aliénante en nous affirmant en tant que sujet, simultanément grammatical et politique.
Qui sont-« ils », d’ailleurs, ceux qui nous transforment en objets parfaitement insérés dans la machine productrice d’objets ? Sont-« ils » réductibles à une pluralité d’individus ? Monsieur Lagardère, plus Monsieur Bouygues, plus Monsieur Sarkozy, plus Monsieur Zapatero, plus Monsieur Leclerc ? Faut-il voir en « eux » de nouveaux Big Brothers d’une manipulation machiavélique ou démoniaque ? N’est-ce pas plutôt une logique (capitaliste), une certaine (ir)rationalité, un système, un mode de (dys)fonctionnement, à quoi il faut résister – derrière les individus qui en sont les vecteurs ? C’est « lui », c’est ce mode de (dys)fonctionnement qui fait pression contre nous, et contre lequel nous faisons pression en retour, par nos résistances et nos affirmations. C’est lui – « il » – qui ne nous fera pas partir comme il le voudra ; c’est contre « lui » que nous ferons advenir un autre monde possible (bien plus que contre « eux »).
L’émergence d’un populisme non fascisant
C’est précisément en termes de nouvelles syntaxes (d’agencements collectifs) et non d’individus que nous invite à penser, à écrire et à agir la nouvelle chanson traduite par les indignés. Le « populisme » de droite mérite d’être condamné parce qu’il clive la collectivité en « nous » contre « eux » – les Roms, les immigrés, les musulmans, les intellectuels : autant de groupements d’individus. La nouvelle grammaire fait advenir un nouveau populisme, émancipateur du seul fait qu’il substitue aux ennemis individualisés (« eux ») un (dys)fonctionnement systémique – « il » : le système financier, le profit capitaliste, le consumérisme, le productivisme.
Tel est bien le nouveau paysage politique qui commence à prendre forme. De la « droite » qui gagne les élections à la « gauche » qui gère les crises, c’est un même discrédit radical qui demande que se vayan todos ! À traduire : qu’« il aillent tous se faire voir chez les Grecs » – « il », c’est-à-dire ce néolibéralisme individualisateur, ce capitalisme écodestructeur, ce socialisme d’énarques en voiture de luxe. Autour de ce discrédit qui frappe l’ensemble du jeu traditionnel de la démocratie médiatique parlementaire, s’opposent un vieux populisme fascisant (celui des Le Pen, Haider, Fini, Blocher et autres Wilders, et de leurs concubins gouvernementaux comme Berlusconi, Sarkozy) et le nouveau populisme émergeant des mutins-luttins, dont il importe de faire la réelle alternative à la déliquescence politique et à la dérive néofascisante.
Une base commune
Ces multitudes se retrouvent autour de quelques points communs, dont il convient de tenter une première liste provisoire :
I. Ils refusent la démocratie officielle (celle des tyrans réélus à 90 % des votants, celle des sondages et des jeux télévisés) au nom de la démocratie réelle (celle par laquelle les gens prennent en main leurs devenirs).
II. Ils commencent par mettre en pratique ici et maintenant les idéaux dont ils revendiquent l’avènement.
III. Ils opposent à la violence des États et des marchés financiers l’agressivité non violente du Dégage ! tunisien, « réplique affirmative de la vie à la violence du pouvoir qui l’étouffe »[8].
IV. Ils refusent les habitudes d’identification individualisantes (starisation) ou tribales (partis, sectes, identités), pour cultiver par l’acte la construction et l’entretien d’espaces de vie communs.
V. Ils entreprennent d’élaborer des alternatives pratiques au consumérisme productiviste qui conduit notre système vers un triple abîme écologique, social et psychique.
VI. Ils réclament un système à (ré)inventer qui assure à tous une base commune de moyens d’existence non précaires, et qui permette à chacun l’individuation de singularités créatives.
VII. Ils manifestent une méfiance instinctive envers les institutions étatiques (nationales et supernationales comme l’UE) dont ils mesurent les dangers d’oppression en même temps que les nécessités de réglementation.
VIII. En partie grâce aux nouveaux moyens de communication numérisée, ils s’inscrivent d’emblée dans une communication par le bas, de culture locale à culture locale qui oppose la Méditerranée des multitudes à l’Europe des fonctionnaires bruxellois.
IX. Ils se posent comme citoyens pour inventer un commun entre des acteurs différents, contre la dégénérescence de la démocratie de représentation partout en Europe, et dans l’exploration et le partage de territoires communs dans et à partir de la ville.
Vers une diffusion par capillarité ?
Ce mouvement n’est pas seulement le fait de « jeunes » et d’activistes. Il n’est pas qu’un problème d’ordre public. Près de trois années de « crise » pèsent de tout leur poids, générant un malaise social qui a finalement jailli de manière imprévue et à travers des formes inédites. Celles-ci constituent les prémisses, les premières secousses d’un nouveau cycle de mobilisations. Ce mouvement a récupéré la confiance dans l’action collective, les slogans de la grande manifestation du 19 juin traduisent un passage du scepticisme et de la résignation à un début de conscience de pouvoir (Oui, on peut !) et d’espoirs renouvelés (Le futur est à nous). Avant de reprendre la rue, il va se transformer en une mobilisation plus discrète mais permanente, à travers une redistribution et une réorganisation géographique dans les quartiers, les entreprises, les universités… L’autre enjeu fondamental de la période est bien entendu la construction d’un réseau européen, transméditerranéen, qui a déjà commencé à se mettre en place à travers différentes initiatives[9]. La dissolution apparente de mouvements disparus des gros titres médiatiques ne signifierait pas forcément leur disparition, mais leur diffusion par capillarité.
La luttinerie qui vient
De telles métamorphoses conviennent bien aux mutins. Plus que des fiers héros, ce sont des joueurs qui peuvent changer de registre, de statut et de rôle au fil des besoins. Tous les mutins du monde se savent condamnés à se faire mutants – pour être insaisissables, pour affoler les identifications du contrôle, pour transformer la schizophrénie en force de libération, pour cultiver les devenirs multiples. Dans leur indignation, ils se réapproprient les mutations sociales induites par les développements récents du capitalisme.
Autant qu’une lutte « contre le capitalisme », la mutinerie qui vient doit être comprise comme une façon nouvelle de sortir de l’ornière capitaliste, non pas en prônant un retour en arrière – comme le font la plupart des discours de gauche agrippés à l’Étatisme, au souverainisme ou au républicanisme –, mais en imposant une réorientation aux dynamiques (à la fois réellement aliénantes et potentiellement émancipantes) déchaînées par les nouvelles technologies de l’information. La luttinerie qui vient surfe sur les vagues du déchaînement capitaliste.
Les Indignés savent que notre productivisme consumériste débouche sur le suicide collectif d’une société de consommation de soi[10]. Pour autant, ils ne rêvent ni de parti prolétarien, ni d’État national, ni d’élection présidentielle, ni de retour aux cavernes à la lumière des bougies. Ils veulent profiter des outils de bien-être produits par les deux derniers siècles d’industrialisation capitaliste et par les gains sociaux acquis grâce aux résistances ouvrières. Ils veulent infléchir nos modes de produire et nos modes de vie de façon à ré-humaniser les machines capitalistes qui sont en passe de nous écraser.
Les Indignés pensent que cette réorientation passe par le développement de la citoyenneté et l’institution de nouvelles formes de démocratie. Ils ne regrettent pas : ils entrevoient et expérimentent des modes d’organisation inédits. Leur horizon, comme celui de tous les luttants d’aujourd’hui, est celui de l’éthique environnementale, de l’authenticité existentielle[11], du revenu garanti, du peer-to-peer, de la taxe sur les transactions financières, de l’éducation gratuite et permanente, de la libération du temps créatif et de l’égalité entre tous les humains.