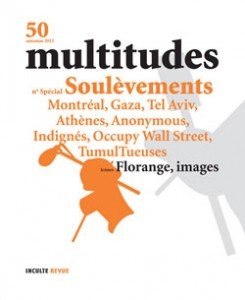« Avez-vous éprouvé, vous tous que la curiosité du flâneur a souvent fourrés dans une émeute, la même joie que moi à voir un gardien du sommeil public, – sergent de ville ou municipal, la véritable armée, – crosser un républicain ? Et comme moi, vous avez dit dans votre cœur : “Crosse, crosse un peu plus fort, crosse encore, municipal de mon cœur ; car en ce crossement suprême, je t’adore, et je te juge semblable à Jupiter, le grand justicier. L’homme que tu crosses est un ennemi des roses et des parfums, un fanatique des ustensiles ; c’est un ennemi de Watteau, un ennemi de Raphaël, un ennemi acharné du luxe, des beaux-arts et des belles-lettres, iconoclaste juré, bourreau de Vénus et d’Apollon ! Il ne veut plus travailler, humble et anonyme ouvrier, aux roses et aux parfums publics ; il veut être libre, l’ignorant, et il est incapable de fonder un atelier de fleurs et de parfumeries nouvelles. Crosse religieusement les omoplates de l’anarchiste !” »
Charles Baudelaire, Curiosités esthétiques, 1868
Il y a sept ans, mes amis de CTheory m’avaient demandé d’écrire au sujet des manifestations et émeutes qui grondaient dans les rues de Paris, ma ville natale. Je ne pouvais pas le faire depuis Montréal, leur avais-je répondu. À la place, j’avais donc écrit quelques lignes au sujet de l’expérience étrange de la politique à distance, des sentiments confus de celui qui voit sa ville brûler à travers les lentilles du dispositif médiatique. J’avais écrit à quel point je me sentais comme un travailleur émigré, en me remémorant ces images de Caracas en flammes sur CNN en 1989 ou de Los Angeles sur TV5 en 1992, alors même que je regardais Paris en proie aux mêmes flammes sur Radio Canada, à moins que cela ne fût la capitale de la douleur sur France 2. À la maison devant la télé dans ce bordel géant qu’est devenu le monde, étranger entre deux mondes, témoin des mêmes violences et des mêmes libérations, oh toujours si peu delibérations.
Sept années ont passé et je suis toujours ici à Montréal, la ville où je vis, métropole d’une province que je ne considérerai probablement jamais comme ma province, ville coloniale et colonisée, d’un pays où ont abouti mes errances. Une ville, un pays où je me suis établi, où mon fils est né et grandit, où j’enseigne et écris, toujours étranger, mais où tout aussi étrangement, je viens de retrouver l’espoir.
Car Montréal, cette ville, ma ville, s’enflamme, mais n’est pas en flammes du tout.
Alors que nous avons dépassé cette semaine le centième jour d’un mouvement étudiant en train de se muer en la plus tranquille des révolutions, alors que les gens prennent la rue d’assaut à coup de chants et de rythmes, recyclant chaque nuit le Tintamarre acadien, le Charivari français, ou les casseroles chiliennes, alors que nous suivons sur les réseaux sociaux et d’autres moyens digitaux les lignes de fuite d’un devenir-autre rhizomatique et définitivement molaire, alors que des jeunes adultes portent sans fléchir la parole de cette démocratie directe en mouvement devant les bouffons arrogants et suspectés de corruption qui font encore office de gouvernement et de législateurs de loi d’exception, alors que je vis tout cela dans la rue, de plus en plus mal à l’aise avec le cirque médiatique censé couvrir les événements, je me rappelle les paroles lapidaires de Baudelaire : « l’orgueil humain, qui prend toujours le dessus, et qui est la cause naturelle du rire dans le cas du comique, devient aussi cause naturelle du rire dans le cas du grotesque » (De l’essence du rire, 1855). Oui, moi qui me sentais si souvent comme Günther Anders, désespéré sans ne pouvoir qu’y faire, oui, j’ai retrouvé l’espoir dans un éclat de rire.
Bien sûr, je suis tenté chaque jour de retourner à mes vieux doutes. Bien sûr, je me débats et je débats encore avec moi-même au sujet d’encore une autre révolution annoncée sur Facebook. Bien sûr, je ne peux croire les gentilles formules des encore plus gentils Canadiens/Québécois qui nous promettent encore une sociale démocratie nationaliste ouverte à tous et toutes et garantie par une Chartre des Droits et Libertés qui aurait érigé la tolérance envers autrui comme vertu cardinale de notre société – oui, vous avez bien lu, nationalisme et tolérance comme premier et dernier mots de cette proposition contre-intuitive, à moins que cela ne soit l’inverse selon l’histoire lue à rebours : tolérance d’abord, nationalisme pour finir. Bien sûr, je pense souvent à ces cortèges de révolutionnaires comme cette queue spontanée qui se forme toujours ici dans l’attente de l’autobus (du changement), ô combien gentille, et si convenable. Bien sûr, je déteste que tout ce mouvement ait commencé par une affaire d’argent, toujours l’argent, les frais, les dettes et les taxes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais une petite voix murmure quand même dans ma tête : « et pourquoi pas ? » Oui, pourquoi pas, après tout ? De toute façon, mes étudiants ne s’embarrassent pas avec mes doutes importés du vieux monde ; ils en rient de bon cœur et retournent dans la rue pour crier et gazouiller, chaque nuit depuis trois mois. Elles rient de moi comme de tous les pouvoirs établis, ils rient des rapports et des sondages médiatiques comme elles rient lorsqu’une averse s’abat sur leur manifestation, ils rient et chantent, même la pluie nous appuie. Même sous une pluie d’insultes et de gaz lacrymogènes, même sous une pluie de brutalités policières et d’arrestations abusives, même sous une pluie de mépris et d’humiliations, oui, même alors, ils et elles rient et continuent de chanter, même les pluies nous appuient.
Car Montréal, cette ville, ma ville, s’enflamme, mais n’est pas en flammes du tout : les giboulées de rire éteignent les feux de la violence avant même qu’ils ne s’embrasent.
Nous sommes plus de cinquante, et nous désobéissons civilement.
Nous sommes plus de cinquante, amis que nous importent les chiffres ?
Nous sommes plus de cinquante, et nous ne comptons pas nos clicks,
nos tweets et nos status updates.
Car Montréal, cette ville, ma ville, s’enflamme, mais n’est pas en flammes du tout : les averses paradoxales des douches de données numériques éteignent les feux avant même qu’ils n’incendient le réel, quoi que cela puisse bien vouloir encore dire.
Non, après tout, cela aussi est un réflexe du vieux monde, un symptôme d’infection par l’agent Baudrillard, plus besoin d’ajouter quoi que cela veuille dire. Vous savez ce que cela veut dire quand vous en faites l’expérience. Vous savez ce que cela veut dire de se sentir vivant lorsque vous pourriez vous plaindre, vous lamenter ou même porter le deuil. Vous devrez probablement faire une pause et vous pincer de temps en temps en vous disant, quoi, pas de morts ? Où sont les cadavres, où sont les corps à corps meurtriers ? Comment est-il possible que les flics exténués ne tuent pas, comme il arrive toujours dans ces cas-ci, malheureusement ? Comment est il possible, pouvez-vous vous demander, que Montréal ne soit pas en flammes ?
Nous rions dans les rues car nous savons que le simulacre s’est bouclé sur son référent « réel », et qu’il n’y a plus qu’un monde pour le vivre, en riant. Oh oui, c’est passé bien proche : juste après l’annonce de la loi spéciale, la fin de semaine passée, nous avons eu bien peur. Très peur. Oui, il y avait, et il y a encore, de la violence plein les rues et les journaux, de la violence physique et de la violence symbolique. Oui, un étudiant a perdu un œil à Victoriaville, d’autres, bien plus nombreux ont été frappés et jetés dans des cars de police (une moyenne de 150 par nuit, plus de cinq cents en une nuit, cette semaine). Oui, la paranoïa était dans l’air, ON pouvait la sentir. Certains racontaient même que les clowns l’alimentaient avec une parade militaire du jour de la Reine – qui est aussi le jour des Patriotes au Québec, au fait : en une autre tentative désespérée d’intimidation symbolique, les rumeurs disaient qu’ils avaient dévié les troupes de l’itinéraire annuel lors de leur promenade printanière, pour les faire passer par le centre-ville. Ça y est, ON se disait, ça recommence comme en octobre 1970, et la danse du terrorisme et de la résistance, du contre-terrorisme et de la répression, cette danse macabre. Mais en attendant, je le répète, Montréal ne brûle toujours pas, la danse macabre n’a pas encore commencé.
Voilà pourquoi, en ce pluvieux mardi, j’ai pris mon kit spécial émeute, mon casque de vélo et mon écharpe, ma caméra et mon enregistreur, et je suis descendu dans la rue, sans savoir ce qui s’en suivrait, combien nous y rejoindraient et combien resteraient chez eux, intimidés et effrayés. En arrivant sur la Place des Arts, lieu du rassemblement, je me le demandais encore. Il n’y avait pas beaucoup de monde pour l’instant, et il y avait encore de la tension dans l’air. Mais j’ai commencé à remarquer de plus en plus de tambours et de musique, et même des slogans marrants, oui, des slogans marrants. Il y avait quelques signes que l’espoir puisse survivre : les syndicats embarquaient dans le mouvement, les virtualités d’une grève générale répondaient à celles des troupes. Mais plus encore, il y avait de la musique et des rires. Un collègue d’une autre université avait trafiqué la poussette de ses enfants pour la transformer en boggie kart, il blastait des chants révolutionnaires comme Libérez-nous des libéraux, les gens dansaient et chantaient aux alentours, pendant les deux longues heures où nous attendions que le cortège se mette en branle. Le soleil s’est mis à briller, nous brûlions un peu, le printemps érable était de retour. Les rumeurs de chiffres incroyables commençaient à circuler dans la foule, certains disaient que nous étions près de cinq cent milles. Je commençais à me détendre. Je remarquais une pancarte où le carré rouge emblématique du mouvement était représenté par de la sauce bolognaise sur un plat de spaghettis. Un autre déclarait que « 78 », le numéro de la loi spéciale, n’était pas « sa position préférée ».
Alors nous avons commencé à marcher. Nous avons très vite réalisé, si nous en doutions encore, que nous allions désobéir à la loi : une des organisations étudiantes avait intentionnellement dévié le cours de la manifestation de l’itinéraire officiel que les deux autres organisations étudiantes avaient donné à la police, sous l’obligation de la loi spéciale. Nous avions tourné à gauche au lieu de tourner à droite, bien sûr. Il y avait beaucoup de flics et d’escouades anti-émeute, des voitures pour les transporter et des camions pour embarquer les contrevenants. Les voitures de police barraient la rue à gauche, le cortège avançait, elles reculaient d’un pâté de maison, d’un bloc, le cortège avançait à nouveau, les flics reculaient à nouveau, et ce sur cinq blocs, durant une demie heure de vive tension. Finalement, la retraite policière a sonné, et les troupes ont disparu à distance d’un autre bloc. Nous avons continué à suivre un itinéraire improvisé, et toujours aussi illégal, alors que les serviteurs de l’ordre nous accompagnaient sur une rue en parallèle, comme deux cortèges déviés. Nous ne les avons retrouvés que quelques rues plus loin, oh à peine une poignée, qui gardait dérisoirement l’immeuble de cette institution si populaire, Loto Québec. C’est alors, je crois, que j’ai compris.
Vous voyez, je n’étais pas à Montréal durant la semaine précédente. J’étais à Amsterdam et Rotterdam pour participer au Festival Hollandais d’Arts Électroniques (DEAF) de V2. J’étais revenu brièvement en ville le dimanche, pour mieux repartir aussitôt dans les cantons de l’est pour y passer le jour des Patriotes avec ma famille et des amis. Je n’ai pas vu les troupes défiler, ni la loi passer. Je n’ai pas traîné dans les rues la nuit avec les étudiants et étudiantes en provoquant la police, en tentant de lui échapper pour finalement se faire arrêter en nombres. Non je ne l’ai pas fait. À la place, je prenais du bon temps dans les bars passé l’heure des choses sérieuses du festival, ou je me reposais près d’un lac en regardant nos enfants jouer. Je n’étais pas déconnecté, cependant. Je suivais les événements sur Facebook, sur les sites des journaux et des chaines de télé, depuis une rive ou une autre, tout en écoutant Chumbawamba chanter, Laughter in a time of war.
Take my life and sing it back to me
My big mouth, it’s my own worst enemy
Funny how it all sounds better in harmony
Laughter in a time of War
Oh my soul
The people at the top have further to fall
Je ne riais pas encore, pourtant. J’étais plutôt en rage, en fait, ma grande gueule et mon petit cerveau plein de mots encolérés et de concepts puissants, ou pas si puissants. Mon éducation marxiste, mes attitudes punk de jeune adulte, mon Deleuze et mon Foucault, tout cela était remixé par les événements dans mon cerveau. Une mauvaise rengaine, même si la petite voix dans ma tête continuait à murmurer de prendre mon mal en patience, de descendre dans la rue pour en faire l’expérience, que le printemps arabe n’avait pas commencé sur Facebook ou sur Twitter, mais avec un type qui s’était immolé en Tunisie. Personne ne s’est encore immolé icite, il y a encore de l’espoir que cela n’arrive pas, la voix mineure dans ma tête insistait. Mais il y avait encore un vent de folie dans l’éther, et toujours autant de paranoïa, de désinformation, de propagande et de mensonges : j’étais envoûté par la représentation digitale, où les différences entre les vérités et les mensonges s’estompent dans un nuage de zéros et de uns. Oui, je me sentais étranger aux événements encore, perdu dans le faux désert du numérique, et cela me mettait pas mal en colère.
Voilà pourquoi, en ce mardi matin nuageux à Montréal, j’ai décidé de descendre dans la rue À qui la rue? À nous la rue ! Voilà pourquoi j’ai décidé d’aller voir par moi-même, avec mon dérisoire kit spécial émeute et mes concepts à moitié cuits. J’avais l’intuition que j’y assisterai au combat de deux modes de démocratie, de la démocratie représentative et de la démocratie directe, et je me demandai bien à quel point le choc serait frontal. Et bien je dois bien dire que le seul choc frontal dont j’ai fait l’expérience durant cette après-midi glorieuse fut celui de la nudité de deux jeunes femmes qui courraient dans le cortège, déshabillées pour leurs droits, rigolant sauvagement comme des amazones graciles et désarmées. Au lieu d’un choc frontal, j’ai suivi pendant quelques centaines de mètres les méandres de la trajectoire d’un « élément radical » qui portait une pancarte sur laquelle était dessinée une simple flèche qu’accompagnait la légende : « voici mon itinéraire ».
Oui, je pense bien avoir compris, en ce mardi. Cette loi spéciale n’est qu’un simulacre, ces soi-disant représentants politiques en sont les ouvriers, ces flics, trop fatigués pour penser, trop perdus pour rejoindre la légitime contestation, en sont les serviteurs, les préposés, et ces journalistes, les dealers (oui, un anagramme de leader). L’État démocratique est devenu cette fabrique à capital symbolique, dans une stérile pratique de l’arbitraire du signe auquel personne ne semble croire encore (en tous cas pas ceux et celles qui font l’expérience directe dans la rue). Cette version de la démocratie, supposément représentative, de l’ordre et de la loi, a dépassé sa durée de vie anticipée, elle n’est plus de son temps, elle ne persiste que comme un zombie, comme une ombre sur le printemps. Le rire la dissoudra comme une pluie acide. Le rire prévaudra, avec quelque chance.
Les nuits suivantes, parmi les tintamarres, dans l’embarras du silence orgueilleux de ceux qui font encore mine de gouverner pendant que leur jeunesse tient la rue, pendant que la population joint doucement la contestation en frappant en rythme sur leurs batteries de cuisine, alors que des institutions aussi « progressistes » que le barreau du Québec s’est plaint du peu de constitutionnalisme de cette loi-matraque passée sous le bâillon, la loi spéciale n’est même pas appliquée, et les arrestations massives se font au nom d’un règlement municipal, et par la même, la vraie armée. Ah grotesque simulacre, tu nous fais bien rire. À Montréal, nous t’enterrons chaque jour en un cortège rigolard, comme pour le Bonhomme Carnaval, quoi qu’en disent les scribouillards de Macleans. Sans un brin de cynisme, de plus en plus nombreux chaque jour, nous continuons à rire.
Nous sommes plus de cinquante,
et nous nous moquons du grotesque simulacre en boucle,
Nous sommes bien plus de cinquante,
et nous rions d’un temps où il pourrait y avoir la guerre,
Crossez religieusement les omoplates des républicains et des anarchistes,
nous continuerons à nous en battre les côtes.