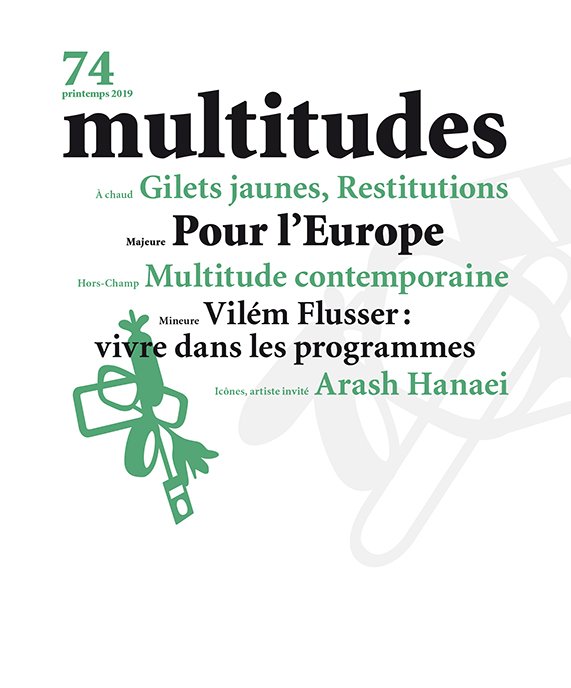Programmes de gouvernement et formes des vivants
C’est au fond dans un des courts textes inédits publiés par Multitudes que Flusser formule, sans ambiguïté ni opacité, un problème crucial de sa réflexion autour des programmes : celui de « réfléchir sur la différence entre le vivant et l’artificiel, et de la rendre évidente, avant qu’elle ne s’efface ». Derrière cette question très ample, on a l’impression de déceler des interrogations précises autour des devenirs de nos sociétés biopolitiques ainsi que de nos écologies. Peut-être qu’autour de cette frontière (entre ce qui est vivant et ce qui est artificiel) se débat la possibilité pour nos vies de ne pas cesser de dégager des formes et de les entre-tisser dans des milieux associés.
La programmation bio politique des comportements
Flusser avait entamé sa réflexion en effaçant la distinction (niaise) entre le territoire des opérations techniques et celui des vies « humaines ». Par une logique inexorable d’indétermination, la société moderne aurait rapproché les deux domaines jusqu’à leur identification. Il nous invite à reconnaître un mécanisme de feedback loop entre « la simulation artificielle du comportement vivant dans des objets animés » et la « simulation de cette simulation dans les hommes ». Au cœur de cette boucle récursive, la simulation postule une réduction au programme des conduites du vivant : à savoir, l’extraction d’une synthèse de traits pertinents et constants du comportement des vivants par une démarche de décomposition analytique. Ce qu’on applique aux machines n’est pas une véritable capacité de comportement vivant, mais plutôt, la reproduction d’une certaine abstraction de celui-ci. Par un effet de retour fatal – celui d’une simulation de la simulation machinique – les êtres vivants de ce régime intégré artificiel-naturel sont informés par la synthèse du programme artificiel : à la fin de la chaîne, leur comportement passe de l’état de source à celui de produit.
Même si Flusser ne semble pas s’intéresser à ce terme, la notion de « bio politique » ne nous semble pas inopportune pour interroger le régime d’indistinction entre les programmes de la technique et les formes de vie que sa théorie établit. Ses textes des années 1980 et 1990 sont d’ailleurs contemporains de ceux de nombreux penseurs du paradigme bio politique des sociétés modernes (de Foucault jusqu’aux protagonistes de l’Italian theory, comme Esposito ou Agamben). La question flussérienne de la programmation identifie un régime de superposition entre l’économie technique et les conduites des vivants qui renvoie, par le truchement d’un lexique cybernétique, à l’ensemble des phénomènes de gouvernement des vies qu’on a pris l’habitude d’appeler bio politique. En ce sens, la figure du « fonctionnaire », dont Flusser nous livre le portrait comme prototype de la subjectivité programmée, renvoie aux formes de gouvernamentalités économiques et a politiques qui caractérisent les phases avancées de l’expérience bio politique. Ces mêmes phases représentent ce que le théoricien des media autant que des philosophes politiques comme Agamben appellent le temps « post-historique ».
Les apories de la post-histoire
La post-histoire des programmes constitue, selon Flusser, l’achèvement tardif d’une disjonction entre « sujet-transcendant » et « monde-objet », apparue précocement dans la trajectoire de la pensée et dans la pratique des sociétés occidentales. La logique de la programmation, au demeurant, ne représente que l’expression la plus accomplie de ce paradigme de transcendance, tellement accomplie qu’elle aura capturé dans son intérieur le sujet-maître lui-même, avec son objet-matière. Le parcours historique avait décrit l’évolution progressive des rapports (de manipulation et connaissance) entre sujet et monde, alors que le moment post-historique désigne la phase où ce même dispositif disjonctif et transcendant s’affirme jusqu’à absorber et effacer les deux pôles (humain et objectif) qui l’ont généré. L’époque des programmes annonce ainsi une sorte d’immanentisation de la transcendance qui emporte tant les sujets (culturels) que les objets (naturels). C’est également l’époque d’une pleine immanentisation du principe gouvernemental et de la traduction du problème politique en un pur problème économique. Dans ce cadre, la tragédie des camps nazis semble représenter (autant chez Flusser que chez certains critiques des processus bio politiques) une sorte de percée où le régime historique est poussé à l’extrême jusqu’à son retournement dans une sombre prophétie de l’univers post-historique.
Comment vivre donc dans la post-histoire ? Peut-on vivre (tout court) dans un monde post-historique ? Telle est la question incontournable que la réflexion flussérienne nous pose. D’un côté, la phase post-historique de la programmation semble fabriquer inexorablement les conditions d’une réduction globale des vivants (les humains d’abord) à des vies nues à gouverner techniquement. Elle nous révèle une nouvelle égalité écologique (combien amère…) entre les êtres humains et animaux, mais aussi les êtres végétaux et minéraux, tous transformés en une seule matière d’administration économique. C’est la face sombre et menaçante de cet horizon post-historique qu’on pourrait également qualifier d’« anthropocénique ». Autant la vache, dont Flusser nous parle, que son éleveur, sont pris dans le même dispositif de programmation (industrielle) qui transcende autant le sujet que l’objet : cela impose de l’extérieur tant à l’homme qu’à l’animal des formes – que Flusser appelle plus précisément des « modèles » – à simuler, voire à performer productivement. Le cauchemar (prophétique) de la post-histoire a le profil d’un élevage gouvernemental et programmatique généralisé, qui rencontre sa déclinaison humaine la plus transparente et univoque, la plus littérale, dans le tragique exemple des camps, d’hier et d’aujourd’hui. Ainsi, on ne peut pas vivre dans la post-histoire. On ne peut qu’espérer y survivre.
Mais qu’est-ce que vivre, selon Flusser ? Ne serait-ce pas ce résidu singulier d’ingouvernable qui excède tout dispositif de gouvernement, comme le suggère Agamben ? Ne s’agit-il pas d’une part improgrammable propre à tout vivant, ce qui s’avère insaisissable et débordant dans tout mécanisme de simulation ? Cet élément (aux noms multiples) constituerait le principe du vivant en tant que source d’une puissance d’émanation formelle qui ne répond pas à l’anticipation ni à l’extériorité de la programmation. Ce serait une forme qu’on ne peut pas simuler, un « modèle » qu’on ne peut pas modéliser : à savoir, une forme qui ne peut être que vécue et inventée en vivant. La vie en tant que processus intime de création, ajustement et accompagnement d’une forme, représente sans doute une expérience-limite qui ne peut qu’échapper et résister à toute entreprise de programmation et de gouvernement. La racine hylémorphique de la programmation et du gouvernement les rend foncièrement inaptes à incarner le mouvement (de formation, en tant qu’individuation), qui est propre au being alive. Tim Ingold nous a encouragés à saisir l’échelle environnementale, collective et incessante d’une telle expérience qui relie le vivant humain à toute autre forme de vie qui l’entoure. Selon l’anthropologue britannique, vivre serait d’abord ne pas être coupé (par toute extériorité autant programmatique qu’environnementale) de notre milieu et des affects par lesquels chaque vivant s’informe sans arrêt et s’individue en individuant en retour.
Pour une esthétique des vivants
Or, est-ce que l’ère post-historique est condamnée à se décliner uniquement comme royaume de l’économie des programmes ? Ne pourrait-elle aussi donner lieu à son opposé, à savoir à des expériences d’écologie des vivants ? La déchéance d’une certaine disjonction hylémorphique entre le sujet et le monde environnant n’entraîne pas fatalement leur soumission mutuelle à une seule programmation gouvernementale. Elle créerait aussi un potentiel d’immanence où des natures-cultures (Donna Haraway) s’inventent d’une manière circonstancielle et contingente, dans un libre agencement formel des rapports entre êtres humains, êtres « naturels » et êtres techniques. Un tel espace écologique se situerait au-delà du mythe naturel et du programme historique et artificiel. Il serait le fruit d’une double émancipation : de la démythification autant que de la déprogrammation, de la Nature autant que de l’Homme (deux transcendances spéculaires). Ni les vaches mythiques et cultuelles de la tradition, ni celles, processuelles et techniques de l’industrie économique n’habiteraient cet espace. La vache qui appartient à l’écologie post-historique est celle qui s’individue dans un libre jeu d’échanges, contaminations et modifications avec l’ensemble d’éléments qui l’entourent (humains et non humains). Elle n’a pas une forme préliminaire, elle n’est ni le produit ni la productrice d’un modèle mythique ou d’un modèle économique. Sa forme se joue, au contraire, dans une co composition avec les formes en devenir des vies qui sont en relation avec elle. En ce sens, l’être humain non plus n’aurait aucune forme essentielle, aucun modèle modélisable. Il n’aurait que la forme (ingouvernable, émergeante) qu’il tisserait avec les vivants de son milieu d’expérience en formulant sans arrêt des systèmes métastables et trans individuels de natures-cultures en devenir. C’est ainsi qu’on pourrait vivre (dans) l’époque post-historique.
Flusser adressait la question du partage entre le vivant et l’artificiel au milieu de création artistique, comme s’il confiait à l’ensemble des créations artistiques (autant professionnelles qu’ordinaires et anonymes) l’entretien de cet élément ingouvernable et commun des vies qu’aucune simulation artificielle ne peut absorber. En retournant l’affirmation, on pourrait déclarer que tout assemblage (impur, précaire, ludique) de formes de vie constitue un événement esthétique singulier qui échappe au programme. Le repousse, le détourne, l’oblige à se renouveler.