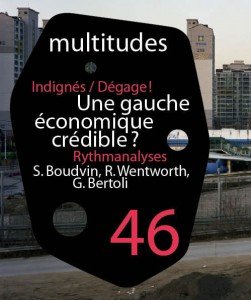Crawford Spence
La reconnaissance du travail comme catégorie sociale irréductible engendre une perte de pouvoir d’entraînement des conventions sociales qui encadrent l’exploitation. Ainsi que le fait remarquer Slavoj Zizek, proche des thèses du marxisme autonome à l’occasion, lorsqu’il se livre à l’analyse du concept de travail immatériel, « l’exploitation, au sens marxiste classique du terme, n’est plus possible[1] ». On voit ainsi apparaître une conception de la propriété comme forme de vol. Le loyer économique se substitue de fait au profit. On nous dit que le calcul du travail ne fait aucun sens, que le travail échappe obstinément à toute mesure. Le travail immatériel (et le travail en général) sont en effet difficiles à localiser, à tel point qu’ils constituent pour ainsi dire un « non-lieu en termes de capital[2] ». Tout se passe comme si le travail-pouvoir n’était plus ni soumis à l’emprise du capitalisme ni libéré de la mainmise capitaliste. Le travail-pouvoir est désormais tellement diffus que le capital ne peut retirer une valeur du travail qu’en dernier ressort. Mesurer la contribution du travail à la création de valeur en termes horaires, comme le propose l’économie politique traditionnelle, n’a pour unique conséquence que de produire le plus appauvri des calculs. Le travail immatériel échappe ainsi à toute mesure, à tel point que tenter de le mesurer ou de le représenter n’a aucun sens d’un point de vue philosophique. Ainsi que le font remarquer Hardt et Negri (2005), mesurer l’origine et la destination de la valeur : « exigerait une révolution dans les méthodes de comptabilité d’une ampleur comparable à celle de la théorie de la relativité d’Einstein sur notre conception des espaces réguliers et métriques de la géométrie euclidienne[3] ».
Le calcul économique n’a toutefois pas disparu, et l’analyse des calculs économiques et des fonctions qu’ils remplissent ne doit pas être abandonnée. La technologie de la comptabilité est bien vivante et continue à discipliner le travail, cherche toujours à décourager l’activité pour son propre compte[4] et à inculquer des idéologies bourgeoises intéressées au maintien du salariat, c’est-à-dire du travail dépendant. La comptabilité demeure ainsi, malgré sa nature intrinsèquement défaillante, le premier système de contrôle du capitalisme contemporain. L’économie postfordiste est marquée par un étrange paradoxe : plus les socialisations du travail rendent impossible toute mesure du travail, plus les tentatives du capital de mesurer et de contrôler le travail tendent à devenir frénétiques et complexes.
La comptabilité est une discipline puissante ; en tant que langage du commerce et du capitalisme, elle paraît omniprésente. Il n’en demeure pas moins qu’on en tient rarement compte. On estime généralement qu’il existe des disciplines autrement plus puissantes, tel le droit, principalement en raison de son pouvoir manifeste : après tout, si vous avez maille à partir avec la loi, vous en subirez selon toute vraisemblance les conséquences. Le pouvoir de la comptabilité est autrement plus voilé. Bon nombre des décisions de la vie courante sont en effet des décisions comptables. De l’achat de lait, du pain et du fromage à l’emploi, au logement, et aux vêtements, jusqu’à la vie elle-même (par exemple l’assurance-vie), tout est question de comptabilité. Si l’on vit en société, on ne peut y échapper.
Le pouvoir du calcul
Si Foucault vivait encore, il y a fort à parier qu’on le trouverait occupé à élaborer une généalogie de la comptabilité. La comptabilité est une pratique banale qui paraît anhistorique, apolitique et purement technique. Or rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Les pratiques de calcul jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de programmes gouvernementaux (sociaux ou économiques), dans la gestion de l’économie et dans la construction des États Nations. Les pratiques de calcul répondent ainsi aux exigences du pouvoir. Or ces pratiques expriment elles-mêmes un pouvoir qui leur est propre. Le pouvoir ne peut s’en passer. Sans pratiques de mesure, le patronat serait en crise. Les calculs créent des visibilités qui deviennent alors l’objet d’interventions de gestion, qu’ils soient empiriquement exacts ou non.
La comptabilité représente un exemple de pratique de calcul. On pourrait même dire qu’elle représente la pratique de calcul par excellence dans l’économie postfordiste actuelle, conditionnant subrepticement le monde socioéconomique. Bien qu’elle soit souvent perçue comme ayant pour unique but de servir les besoins d’information des investisseurs, elle revêt en réalité une importance bien plus fondamentale. Sans la comptabilité financière, l’agent qui opère l’investissement n’existerait tout simplement pas. Le sujet a besoin du langage pour se construire une identité. La compatibilité constitue un exemple d’un tel langage.
Ce à quoi nous assistons à l’heure actuelle, c’est à l’invasion du monolinguisme comptable. Tant que la mondialisation néolibérale continuera à se développer de manière incontrôlée, la langue anglaise n’aura de cesse d’éliminer tous les obstacles susceptibles d’entraver sa domination. On trouve ici un parallèle avec les normes internationales de comptabilité (IFRS, International Financial Reporting Standards). De nombreux pays adoptent désormais la même méthode pour communiquer les résultats de leurs organisations, éclipsant de fait les anciens systèmes de comptabilité nationaux. Cette homogénéisation linguistique entraîne également des formes particulières de gouvernance d’entreprise qui privilégient les besoins des investisseurs et cherchent à développer le capitalisme anglo-américain là où il tarde encore à poindre. L’IASB (International Accounting Standards Board), societé privée dont le financement est assuré pour l’essentiel par les Big Four (les 4 grands cabinets d’audit internationaux), tient ses quartiers généraux à Londres et son siège social dans le Delaware. L’IASB régit désormais la conduite des pratiques comptables dans plus de 100 pays[5]. Toute entreprise au sein de l’UE est désormais tenue de respecter les normes IFRS, donnant lieu à une privatisation sans précédent du processus de normalisation[6]. C’est que le calcul n’a pas disparu, engagé qu’il est dans un processus d’homogénéisation radicale visant à mondialiser la figure du sujet-investisseur anglo-américain.
À la recherche du travail
Pour Marx, le capital fixe (ou en termes comptables : les immobilisations) correspond à « l’homme lui-même[7] », au travail humain. Or la comptabilité financière ne reconnaît pas ce principe marxiste, privilégiant plutôt l’idée selon laquelle le travail ne représente pas une source de valeur dans l’économie moderne mais au contraire que la valeur est créée par le capital et les investissements effectués par le capital. Une lecture même cursive de résultats comptables annuels suffit à démontrer que la comptabilité relègue le travail à la catégorie des dépenses dans le système de comptabilité financière, mais qu’elle procède ensuite autant que possible à une l’établissement d’un équivalent marchand de la valeur du travail (matériel et immatériel) au moyen du système des actifs (assets) : or le travail n’est pas un actif, contrairement à l’essentiel du produit du travail. Une telle représentation du travail donne l’impression que le capital constitue la source de valeur.
Le système de comptabilité est fondé sur les actifs. L’actif constitue la mesure principale traditionnelle du système de comptabilité, et tous les autres éléments du système sont mesurés par rapport aux actifs : les revenus sont ainsi la mesure de l’utilisation des actifs; les dépenses constituent une mesure de l’utilisation d’actifs; et la combinaison de ce qui est dû aux créditeurs sous la forme de passifs et de ce qui est dû sous forme de fonds est la mesure équivalente des valeurs des actifs. Au sens de la comptabilité financière, le travail se définit traditionnellement comme une dépense, une utilisation des ressources de l’entreprise, un coût à minimiser. Or quelle ressource le travail utilise-t-il ? Outre le paiement des salaires, qui utilise les comptes bancaires d’une organisation, le travail est une ressource productive dans la mesure où elle permet à l’organisation de fonctionner. La comptabilité financière peine à intégrer cette valeur, et la comptabilise comme une utilisation des ressources du système : notons toutefois que les produits de cette valeur « productive » sont comptabilisés au sein du système comprenant, entre autres actifs, la valeur de l’inventaire, le droit de propriété intellectuelle, les biens d’équipement et les écarts d’acquisition.
Sans le travail permettant à une organisation de fonctionner, tout ce qu’il reste, c’est l’argent. Or, pour intéressant qu’il soit, l’argent est aussi singulièrement inutile. Dans ce sens, le travail est un « actif » fondamental pour l’organisation (et non pas de l’organisation). C’est ici que le système de comptabilité se livre à une étrange pratique linguistique consistant à définir le travail comme une dépense au moyen d’un jeu de mot définitionnel. L’IASB définit ainsi un actif[8] : « Un actif est une ressource contrôlée par une société, conséquemment à des événements passés et dont l’entreprise est susceptible de tirer des avantages économiques futurs. »
L’argument traditionnel opposé à la représentation du travail comme actif d’une société, repose sur un argument qui a trait au « contrôle ». Les sociétés ne « contrôlent » pas leur travail. Sujet à contrat, le travail est bien entendu mobile, mais cela s’applique également à d’autres catégories d’actifs où les sociétés ont des droits contractuels d’accès partiels comparables, tels que les baux, souvent comptabilisés en comptabilité financière comme des actifs. Un argument plus fondamental en faveur du travail conçu comme dépense fait appel au critère de comptabilisation appliqué aux actifs, en particulier sous forme de « mesure fiable[9] ». Autrement dit, tout ce qui ne peut être mesuré avec fiabilité n’existe pas. On dira ici qu’il est impossible de donner une mesure fiable de la valeur de « l’actif-travail » et que par conséquent la seule mesure fiable est la valeur de l’utilisation des ressources de l’organisation (le coût des salaires). C’est cela que la comptabilité financière doit sacrifier pour assurer le maintien de son principe d’objectivité, dispendieux et totalement délirant.
Malgré le rejet de la notion d’actif-travail, le système de comptabilité cherche néanmoins à saisir la valeur du processus de travail tel qu’il se manifeste dans le système d’actifs (inventaire, droit de propriété intellectuelle, biens d’équipement, recherche et développement, écarts d’acquisition, goodwill et autres actifs incorporels). Il s’agit là bien entendu d’une pratique vouée à l’échec : une partie seulement de la valeur produite par le travail au profit de la société est ainsi saisie, en raison encore une fois des critères de « mesure fiable ». Chacune des mesures d’actifs constitue une approximation partielle d’éléments du capital immatériel, de l’inventaire aux écarts d’acquisition. La nature partielle de cette saisie laisse supposer de la même façon que l’immatériel excède la capacité du capital à le saisir. La comptabilité s’intéresse donc bien au travail, mais uniquement à ce qui peut être mesuré avec fiabilité.
Ce critère de mesurabilité signifie essentiellement que l’immatériel échappe à toute représentation. Les actifs incorporels telles que les marques illustrent bien cette idée. La valeur des marques pour une organisation n’est reconnue qu’au moment de la réalisation de la vente, c’est-à-dire par les écarts d’acquisition. Bien que les organisations consacrent des milliards de dollars au développement de marques, cette source de valeur ne peut être représentée sous la forme d’un actif, révélant de fait les contradictions internes du système de comptabilité. Cet élément est universellement reconnu comme un actif de fait, mais en raison de normes comptables perverses son existence est niée : « Les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en interne et autres éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles[10] », autrement dit comme des actifs. Le système de comptabilité en regorge d’exemples.
C’est la reconnaissance de ces limites qui explique l’intérêt grandissant pour la comptabilisation du capital immatériel. Atteignant des sommets dans les années 90, en particulier dans les pays scandinaves, le discours du capital immatériel s’est pourtant depuis effondré, au point que l’on ne trouve plus de Directeurs du Capital Immatériel. La raison semble être la suivante : la comptabilisation des actifs de capital immatériel est trop difficile et encourage des comportements dysfonctionnels destructeurs de valeur. La nature sociale de l’innovation et des idées s’accommode mal des pratiques de micro-management inéluctablement engendrées par les mesures comptables.
Quoiqu’il soit sur le déclin, le discours explicite du capital immatériel n’a pas toutefois entièrement disparu. Dans le monde universitaire, les chercheurs sont de plus en plus soumis à la tyrannie des classements de revues et aux évaluations de la recherche[11]. Les chercheurs sont désormais classés, promus ou titularisés en fonction du nombre de travaux publiés dans des revues à cinq étoiles ou de rang A. Dans le domaine du management et du commerce, ces revues sont pour la plupart publiées en Amérique du Nord, ne reconnaissent que les méthodologies positivistes et se limitent presque exclusivement aux explications quantitatives rendant compte des effets sur les prix des actions. Ces systèmes de classification ont été institutionnalisés à tel point que les travaux de recherche sont désormais soumis à une marchandisation. À HEC Paris et ESSEC Paris, les deux « meilleures » écoles de commerce en France, les chercheurs reçoivent des primes considérables s’ils publient leurs travaux dans des revues de rang A. C’est ainsi qu’on a vu l’émergence d’une nouvelle classe d’entrepreneurs universitaires qui savent profiter de l’institutionnalisation de leur propre travaux intellectuels réactionnaires, conservateurs et sans aucune utilité sociale. Ce qui se mesure est gérable et donc réalisable.
Conclusion
Les chercheurs en comptabilité reconnaissent les limites ainsi que la nature arbitraire des mesures comptables et en concluent que la fonction de la comptabilité n’est pas de fournir une garantie d’exactitude technique mais de permettre une construction subjective de rationalité au sein de toute organisation[12]. C’est à travers cette rationalité que le travail à son compte tend à être éliminé. La comptabilité n’est donc pas un jeu auquel le travail est tenu de s’adonner. Plus le travail s’implique dans la comptabilité, plus il tend à ignorer sa propre valeur. Même dans les cas où les mesures de comptabilité sont empiriquement plus exactes, comme pour le travail traité comme un actif et non comme une dépense, cela ne constitue pas véritablement un progrès. Comme il n’est plus à minimiser, le travail traité comme un actif serait alors quelque chose à maximiser et devrait faire l’objet d’investissements afin qu’il produise des solutions toujours plus complexes et plus innovantes. Cela aurait pour effet d’exposer aux interventions et aux contrôles, des domaines jusque-là inexploités de la vie sociale. C’est en général ce qui sous-tend les tentatives de comptabiliser et de gérer le capital immatériel. Dans certains sens, traiter les êtres humains comme des actifs constitue un retour à l’esclavage. La reconnaissance capitaliste du caractère productif du travail doit donc être traitée avec la plus grande prudence.
Les approches syndicales traditionnelles des négociations collectives emploient des pratiques et des chiffres comptables dans les négociations syndicales. Ce qui se passe dans ces circonstances est un débat limité aux fondements philosophiques de la comptabilité ; le travail réifie ainsi la maximisation de la richesse actionnariale, l’action rationnelle et les séparations entre capital et agent, et normalise les relations sociales. À ce stade, le travail promet des innovations moyennant 1 dollar de plus par heure, au nom de la productivité et de l’efficacité. Il demeure impossible de saisir complètement l’Intellect Général, mais plus le travail s’implique avec la comptabilité, plus la quantité d’informations divulguées tend à augmenter et plus la quantité d’éléments soumis à un calcul économique rationnel tend à être grande.
On peut qualifier la position postfordiste de mouvement ; un mouvement non pas en faveur de l’amélioration du travail et des conditions de travail mais au contraire un mouvement contre le travail[13]. Conçue comme langage du capital, la comptabilité doit faire l’objet d’une résistance et d’une critique dans ce contexte. Résister à la comptabilité signifie résister au travail, ce qui signifie résister au capital. L’auto-activité du travailleur ne peut se faire qu’en dehors du domaine de la comptabilité, ou dans les espaces que la comptabilité s’avère incapable de coloniser.
Le paradoxe de cette position est que la comptabilité représente elle-même un produit du travail. Les technologies de la comptabilité dont il est question ici ne fonctionnent pas toutefois comme des biens communs[14]. La comptabilité comme bien commun répondrait aux exigences des agents pour lesquels elle comptabilise. Les consommateurs, les producteurs et les sujets des informations comptables seraient engagés dans un débat continu sur la représentation du processus de travail. Cela aurait pour conséquence des interprétations polyphoniques du processus, qui ne seraient pas limitées au numérique ou au rationnel. De tels comptes valoriseraient leur subjectivité et leur partialité, et ne se focaliseraient pas sur les aspects organisationnels. Ce serait alors le travail et non le patronat qui déterminerait ce qui importe dans le processus de valorisation.