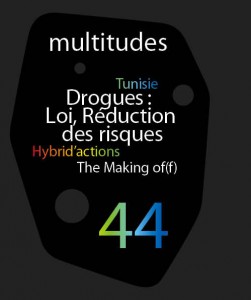Des femmes de retour vers les Balkans
Un nouveau type de migrants internationaux postcoloniaux, postsocialistes, et postfordistes est apparu ces quinze dernières années en Europe, aux Amériques et en Asie du Sud-est. Ces migrants internationaux bouleversent les conceptions intégratives généreuses des nations ouest-européennes et exigent de la part du chercheur un « repositionnement » idéologique, épistémologique et méthodologique : il s’agit de passer de l’approche classique du migrant-objet au migrant-sujet de son déplacement. En France circulent en réseaux des transmigrants du commerce, Marocains et Moyen-orientaux, des médecins musulmans syriens et bulgares, des femmes des Balkans ou d’Amérique Latine passées par l’Espagne.
Ces nouvelles migrations internationales sont donc accompagnées d’un regain des transmigrations féminines pour la prostitution à partir des Balkans, du Caucase et du pourtour méditerranéen vers les « clubs » du Levant espagnol, via Naples, Bari, Brindisi.
Associer la cocaïne à la passe pour en doubler le rapport
L’étape italienne sert à initier ces femmes, Ukrainiennes, Moldaves, Roumaines, Macédoniennes, Albanaises, Libanaises, Tunisiennes et Marocaines à la maîtrise de la « cocaïne pour le client », généralement un quart de gramme « sniffé » avant la passe. De la Junquera à Malaga, la « passe » se négocie désormais avec une telle dose de cocaïne. Le rapport, pour les femmes et surtout pour les nombreux Russes, Géorgiens et, évidemment, Espagnols, voyous ou policiers, qui les encadrent, est quasiment doublé. La Junquera (frontière du Perthus) lieu d’entrée privilégié associe aux revenus de ces activités quelques notables de part et d’autre de la frontière et surtout de Perpignan à Barcelone.
Nous avons enquêté auprès de soixante femmes, travaillant dans des « clubs » espagnols, de la frontière française à Malaga et Cadix[1].
Parmi elles, 35 % consomment régulièrement de l’héroïne : ce choix est justifié par la facilité d’obtention de ce psychotrope à l’Est, où elles aspirent toutes à retourner, après quelques années à l’Ouest, mais aussi par le caractère plus « souple » de l’usage de l’héroïne, dès lors que « l’accrochage » à la cocaïne est effectif. La cocaïne est préférée par 20 % d’entre elles qui disent n’en consommer qu’en fin de travail.
De trois à cinq ans après leur arrivée en Espagne, environ 50 % d’entre elles entreprennent une migration vers l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique ou encore la Tchéquie. Cette variante de la transmigration implique un passage par la France où elles retrouvent autant de femmes venues d’Italie. Elles sont encore rejointes par quelques milliers de travailleuses du sexe, venues d’Amérique Latine et passées quelques années par Madrid. Cette population, qui acquiert ainsi le statut de « transmigrante », regroupe environ cinq mille femmes et à peu près autant de parents et amis qui les accompagnent fidèlement. Ces accompagnant(e)s résident dans les villages voisins des clubs, rendent divers services aux habitants (soins aux personnes âgées, garde d’enfants, petite restauration, commerce de produits exotiques, etc..) et souvent négocient avec les transmigrants commerciaux marocains leur résidence dans un appartement du parc social de Perpignan, Nîmes, Montpellier, Avignon, Toulon… Les nouveaux univers sociaux qu’impliquent les interactions entre transmigrants d’horizons cultuels, culturels, économiques aussi différents, dans l’intimité de l’usage commun de ces appartements, à échanger toutes sortes d’informations obtenues aux quatre coins d’Europe et au-delà, mais aussi dans les plus proches voisinages, produisent une méta sociabilité débarrassée des habituels replis identitaires. Un cosmopolitisme migratoire est en train de naître, favorable à des déploiements transfrontaliers nouveaux.
Cette « heureuse perspective », à défaut de « happy end » prévisible, ne concerne, pour les travailleuses du sexe, qu’une minorité d’entre elles, qui retournent, selon leurs désirs, dans (ou près de) leur famille après huit à dix ans de pérégrinations européennes.
Le témoignage de Sardinella
Lorsque nous avons rencontré Sardinella, elle avait 27 ans. Elle travaillait dans un « club d’abattage » proche d’Almeria depuis environ 26 mois en qualité de « barmaid », en réalité à la passe. En attente de sa régularisation définitive elle avait projeté, une fois cette démarche accomplie, de retourner à la ferme proche de Shkodra (Shkoder), en Albanie, où elle était née et que ses parents exploitaient toujours. Sa « carrière » en Espagne avait débuté à La Junquera, six années auparavant, sur la frontière franco-espagnole, s’était poursuivie dans un club d’abattage – pour ouvriers agricoles étrangers – près de Valencia, puis dans un petit club sur une plage d’Alicante et enfin de nouveau dans un club d’abattage, près d’Almeria. Tout cela après un passage de deux années à Tarente, dans le Sud italien.
« C’est à quinze ans que l’envie me vint de partir pour l’Italie. Alors je suis passée par les religieuses. C’était la voie. Deux années de messes et de vêpres. Et puis le grand jour : le noviciat à Tarente. À Tarente, j’ai été en noviciat une année dans un grand appartement bourgeois aménagé en couvent. J’avais dix huit ans, et on m’a donné, lors d’une petite fête, des papiers de résidente. Mon bonheur était fait, celui de ma famille aussi. Mais le soir même je m’enfuyais dans les rues de Tarente, précipitant dans le malheur tous ceux qui, au même moment, me fêtaient.
J’ai rencontré Emilio, un faux dur de vingt-deux ans qui travaillait de temps à autre avec un pêcheur qui lui fourguait un peu de mauvaise coke et des poissons invendables pour le payer. J’ai trouvé un petit boulot à la criée et nous avons vécu comme des oiseaux au nid, ou comme des rats au fond du trou, c’est selon qu’on voit la vie comme deux tourtereaux adolescents ou comme deux adultes ratés. Emilio et son pêcheur m’expliquèrent qu’il serait bon pour tous que je travaille trois ou quatre heures, jusqu’à minuit, en me vendant dans la grande barque de pêche. Ils m’expliquèrent encore que je ferai la passe avec de la coke : à moi de la doser pour que le cave s’énerve sans pouvoir passer à l’acte ; et surtout qu’il ne s’endorme pas. Et pas d’overdose sinon il faudrait les jeter dans la lagune – ce qui n’est jamais arrivé. Cette histoire de coke, c’est les mafieux qui nous l’avaient demandée : “pour plus tard ; ça pourra servir” avaient-ils dit. Nous avons vécu quelques mois ainsi, Emilio avec quelques surplus de coke et mes sous et le pêcheur avec son commerce de dope ; et puis il a fallu travailler plus pour des policiers qui nous avaient repérés. Et tout se termina par la grande transaction finale : les mafieux envoyèrent le rafiot du pêcheur par le fond, à l’aide d’un bidon d’essence et triplèrent le volume de sa tête et de celle d’Emilio, après leur avoir arraché un œil ; non seulement mes associés ne payaient rien, mais ils traitaient ouvertement les mafiosi d’“aveugles ”. Ils s’en tirèrent borgnes, somme toute c’était généreux. On m’embarqua dans une grande vedette :
“La coke et le sexe, ça marche fort en Espagne, et puis t’es tellement moche que les vicieux aiment ton genre ; alors demain matin, direction Barcelone.” »
Dans un « club » de la Junquera
« Au début, en attendant d’avoir des papiers espagnols en règle, je faisais les nettoyages des chambres et du bar dans la journée. La nuit, j’allais dans un bosquet voisin “travailler pour les flics ” : un fourgon se plaçait là tous les soirs de neuf heures à minuit pour la “sécurité” qu’ils disaient ; en fait c’étaient mes proxénètes-flics. Je leur reversais la recette, et ils n’oubliaient pas la passe… Après minuit, j’orientais les clients qui voulaient la passe plus la coke vers mon hôtel à la Junquera. Des Africaines y louaient aussi des chambres. Chaque soir un gars venait de Perpignan avec les doses toutes prêtes. C’étaient mes seuls revenus ; au total 800 euros par mois, à cause du prix de la coke ; mais les clients de l’hôtel en voulaient. Lorsque j’ai eu mes premiers papiers provisoires, à la fin de l’année suivante, tout a changé. On m’a officiellement embauchée au club, comme “serveuse” ; à la passe, j’étais d’une rentabilité très moyenne. C’est alors, comme “dernière chance” qu’on m’a mise aux enchères ; les principaux clients de Perpignan ont été avertis et un vendredi, entre 17 et 18 heures, une dizaine étaient là, rideau tiré. On m’a regardée sous toutes les coutures. Le patron arrêta les enchères et leur offrit un repas. Puis il vint me voir, dans une chambre ; là je reçus ma première sérieuse correction, c’est-à-dire avec la boucle de la ceinture : “fais ta valise, demain tu descends au Sud”. À l’hôtel, ce soir-là le veilleur vint me dire “je ne peux plus te garder… puis avec une douceur que je n’avais pas entendue depuis longtemps… Sardinella, je te regarde et je t’aime beaucoup ; alors crois-moi, tu n’es pas faite pour faire la pute, enfuis-toi en France ; ils vont te mettre dans un bordel d’abattage pour les ouvriers agricoles arabes, près d’Alicante”.
Somme toute, cette maison d’abattage était bien plus confortable que mes “hébergements” précédents : douze heures de travail par jour, dix minutes par client, vingt pour nous, y compris le nettoyage du lavabo et du drap. On m’avait dit que j’aurais affaire à des Arabes, et que ce serait terrible. En fait ils étaient plus propres, sur eux et dans leur tête que les tordus italiens et français. Dans ces conditions je faisais bien mon travail et, au bout de quatre mois, je fus “cédée” à un petit club proche d’Alicante, sur une plage. Les employés espagnols d’une grande boîte européenne fournissaient la clientèle : trois heures de bar et de nettoyage, six heures de travail en chambre à l’intérieur, et les deux dernières heures dehors, avec la coke, qui était livrée chaque jour par un Hollandais, en quart de doses. L’inévitable se produisit ; le patron me dit “désolé, Sardinella, je t’aime bien, mais bientôt nous aurons la réputation de l’annexe de l’hôpital psychiatrique ; et ça c’est pas bon.” Il m’a refilée à un bordel d’abattage près d’Alméria ; c’est là que tu m’as trouvée ; c’est la dernière étape avant l’Afrique, aussi il est temps que je rentre à Shkodra. J’y pense depuis au moins deux ans. Il ne me reste plus que quatre mois pour avoir les papiers définitifs ; aussi quand tu me dis que tu vas passer là-bas, en Albanie, je te remercie mille fois de parler à mes parents. Et de me dire… si tu veux bien t’intéresser à Sardinella. »
Lors de mon passage à Skhoder (ou Shkodra), deux semaines plus tard, ses parents parfaitement au courant de l’aventure Tarentaise de Sardinella, mais ignorant sa présence en Espagne, m’implorèrent ; il fallait qu’elle revienne. Son unique frère, qui venait de créer une petite pêcherie près du canal qui relie le lac de Skhoder à l’Adriatique, me demanda de lui dire qu’elle devrait se charger du commercial.
Quand je l’ai revue, trois semaines plus tard, je lui ai transmis les courriers de sa famille. Et le message de son frère. Troublée elle m’a dit : « Je ne peux partir ainsi ; à force de prendre de la coke, je suis passée à l’héroïne, c’est plus régulier et au total moins cher. Je ne peux aller ainsi chez mes parents (…) Je dois passer un mois dans un hôpital de la Croix Rouge, qui traite des cas comme le mien. »
Ce passage par le sevrage médical permit de diagnostiquer le VHC : un traitement adéquat fut prescrit… et l’adresse du site Internet canadien, fournisseur des médicaments peu accessibles aujourd’hui encore en Albanie, lui fut communiquée…
L’histoire de cette jeune Albanaise est commune, à quelques variantes près, aux jeunes femmes rencontrées dans les clubs espagnols. Leur retour au pays, lorsqu’elles sont porteuses du VHC ou du VHI, est problématique : à la mesure de l’accès aux soins.