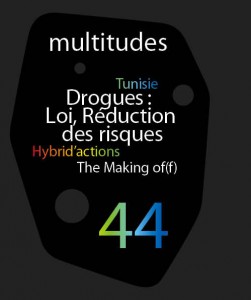Entre expertise et demande sociale
« Le peuple méprisé est bientôt méprisable. Estimez-le, il s’élèvera »
Alain
L’expertise collective de l’INSERM vient de rendre son verdict : la politique de Réduction des risques a obtenu des résultats incontestables, comme l’avait déjà prouvé l’évaluation nationale de l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire). C’est ce qu’avait découvert en 2003 un rapport du Sénat « La Drogue, l’autre cancer ». Quelques sénateurs s’étaient alors emparés de la question des drogues, ignorant que la politique de Réduction des risques avait été expérimentée par Simone Veil et persuadés a priori qu’il s’agissait d’une politique laxiste menée par la gauche. Mais ceux qui avaient espéré qu’on renoncerait à « donner de la drogue aux drogués » en ont été pour leurs frais : il n’y avait plus un seul expert pour contester l’utilité des traitements de substitution ni même plus globalement la Réduction des risques dont ces traitements faisaient initialement partie en France.
Ainsi donc, la politique de Réduction des risques a fait la preuve de son efficacité, avec, de 1994 à 1999 une baisse de 80 % des overdoses mortelles, des 2/3 de la mortalité liés au sida et de 67 % des interpellations liées à l’héroïne. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces chiffres, non pour contester les bons résultats obtenus mais pour en comprendre les enjeux – ce qu’ils disent et ce qu’ils ne disent pas. Mais le débat public n’autorise pas cette discussion : soit la Réduction des risques peut faire état de résultats « scientifiques », c’est-à-dire chiffrés, soit elle est taxée de laxisme et condamnée. Aussi, nous, les acteurs de la Réduction des risques, avons-nous dû nous approprier cette logique comptable au nom de la santé publique, même si nous étions comme moi-même tout à fait conscients des dangers de « la médicalisation des toxicomanes », pour reprendre la terminologie années 80 ou pour le dire plus précisément, de l’invocation abusive de l’autorité médicale. Nous nous sommes gardés de protester lorsque le dispositif a été légalisé et institutionnalisé en 2004 avec des objectifs limités aux risques infectieux et à la baisse de la mortalité par overdoses. La médicalisation du dispositif était la condition de sa survie. Je n’ai pas osé dire alors que cette logique purement médicale condamnait à terme ce dispositif, le rendant incapable de répondre aux enjeux actuels des conséquences de l’usage de drogue.
C’est d’ailleurs ce que le rapport de l’INSERM pourrait laisser penser : en résumé, la Réduction des risques a démontré son efficacité dans la lutte contre le sida et dans les conséquences sanitaires de l’usage de l’héroïne, mais elle ne parvient pas à faire face à l’épidémie d’hépatite, qui avec ses quelques 4 000 morts par an, est aujourd’hui une priorité incontestable de santé publique. Elle ne parvient pas non plus à contrer la hausse récente des overdoses mortelles. La question se pose d’abord en termes de moyens. Comment le dispositif pourrait-il être efficace alors qu’il n’a pas suffisamment d’équipes pour aller à la rencontre de ceux qui consomment actuellement des drogues, qu’il n’est pas en mesure de développer des expérimentations adaptées, et que ces actions de terrain ne sont pas soutenues par des campagnes nationales, tous moyens qui ont été mobilisés dans la lutte contre le sida. Mais comme toujours dans le débat sur les moyens des services, il faut aller au-delà de ce « toujours plus » tourné en dérision quand les principes qui fondent ces services sont contestés. C’est précisément le cas.
Car au-delà des moyens, le dispositif de Réduction des risques est confronté à deux contradictions majeures : une conception archaïque de la santé publique et la criminalisation de l’usage comme priorité de la politique des drogues.
Une conception archaïque de la santé publique
Cette conception archaïque invoque l’autorité médicale, en excluant la responsabilité des acteurs concernés. Avec la lutte contre le sida, l’expertise médicale s’est associée aux personnes concernées pour protéger effectivement leur santé. La difficulté initiale, réside dans le fait que, dans ce cas particulier, les acteurs concernés sont des « toxicomanes », malades de leur toxique ou délinquants selon la loi de 1970. Avec l’injonction thérapeutique, le traitement devient alternative à l’incarcération. C’est mettre la médecine au service de la justice. Si le Dr Olievenstein n’a cessé de vilipender la santé publique, réduite à une fonction de contrôle social, c’est qu’il est bien placé pour savoir que dans le champ des drogues, la santé publique avait été instrumentalisée par le gouvernement. Appartenant au corps des experts sollicités par le ministère de la Santé en 1970, il savait que la pénalisation de l’usage avait été imposée par Marcellin, alors ministre de l’Intérieur. Votée deux ans après 1968, la sévérité de la loi répondait à un impératif politique : réaffirmer l’autorité de l’État, tandis que la toxicomanie devenait symbolique d’une dérive contestataire. L’enjeu de cette loi était de reconstruire un consensus politique sur les valeurs de la Réduction des risques et d’autorité au nom de la protection de la santé. Ce détournement de la santé publique a eu de nombreuses conséquences, dont le désinvestissement de ce champ par les experts, tous persuadés que le problème était une question de société sans réelle incidence sur la santé publique.
Depuis, pas à pas, l’expertise de santé publique a dénoué les liens qui la liaient au pouvoir politique, elle a reconquis son champ propre et développé ses propres concepts. On sait désormais que l’interdit n’est pas justifié par la dangerosité. Ainsi l’alcool et le tabac, drogues licites, sont plus dangereuses que le cannabis, drogue illicite. On sait aussi que l’usage, au contraire de la dépendance, ne relève pas d’un traitement médical. Voilà qui remet en cause le fondement de la loi de 1970, mais la classe politique ignore avec constance cette évolution des cadres conceptuels. Le fossé se creuse entre l’expertise et la demande sociale et pourtant, cette expertise est plus que jamais sollicitée, mais sa légitimité tient en partie à une conception traditionnelle de l’autorité médicale. Ainsi, lorsque les sénateurs découvrent en 2003 les bons résultats obtenus par la Réduction des risques, ils l’attribuent au traitement médical, c’est-à-dire à la prescription de médicaments de substitution. Ils ont toutes les raisons de le penser puisque l’évaluation nationale a démontré que plus les médicaments sont accessibles, plus la baisse de la mortalité et de la délinquance sont attestées. Il reste une question que l’évaluation française n’a pas pu traiter : à quoi attribuer les très bons résultats obtenus par l’accès aux « médicaments de substitution » ? Car les médicaments en question ne sont pas des antibiotiques, dont les résultats sont systématiques, indépendants du contexte. Les études internationales montrent en effet que si les programmes méthadone contribuent tous à une amélioration de la santé et de l’insertion, il y a toutefois des variations importantes d’un programme à l’autre. Tout au long des années 80, le débat sur la méthadone oppose des études qui attestent d’une protection effective de la santé quelquefois pour plus de 80 % des patients tandis que d’autres font état de méthadone détournée vers le marché noir, de programmes rapidement abandonnés et enfin de décès dus à la méthadone. Une recherche américaine a tranché ce débat : menée pendant quatre ans sur 4 000 patients et comparant six programmes différents, la recherche a porté sur ce que les chercheurs ont appelé « la boite noire » du traitement, sans se limiter à une comparaison du profil des patients avant et après traitement. La réponse est que les bonnes pratiques obtiennent de bons résultats (Ball & Ross).
Le paradoxe français, c’est que ces très bons résultats ont été obtenus sans que les « bonnes pratiques » en question aient toujours été respectées. C’est aussi que le contexte de la prescription est très différent. Aux États-Unis, la prescription médicale de substitut était limitée à des programmes méthadone, très encadrés, et dont les posologies étaient limitées par des réglementations propres à chaque état. Avec le Subutex, nouveau médicament, prescrit par n’importe quel médecin généraliste, la France s’est lancée dans une aventure dont on ne pouvait pas prévoir l’issue. Il y a bien eu du reste des prescriptions erratiques et des détournements vers le marché noir, mais c’est pourtant cette prescription large qui a permis à des usagers très nombreux de soigner leurs nombreuses pathologies somatiques en stabilisant leur dépendance. L’évaluation nationale menée par l’Institut National de Veille Sanitaire montre que plus le médicament est accessible, plus la baisse des overdoses mortelles est attestée. C’est également vrai pour la baisse de la délinquance, avec une réduction de 67 % des interpellations liée à l’héroïne en quatre ans. Voilà qui suggère deux interprétations très différentes, l’une attribuant les bons résultats au traitement médical tandis que l’autre remettrait en cause la prohibition, les usagers d’héroïne pouvant enfin échapper au marché noir. Je considère que ces deux interprétations sont également explicatives, mais elles ne sont pas suffisantes car il ne suffit pas de mettre un produit en vente libre pour changer aussi rapidement les comportements de ceux qui consomment des drogues. Quant au traitement médical, ce qui a fait son extraordinaire efficacité, c’est la façon dont il a été investi à la fois par les praticiens et par leurs patients. L’évaluation nationale s’est contentée de mettre en relation le nombre de médicaments vendus et les résultats. Nous n’avons pas eu en France les moyens de mener une recherche évaluative sur cette fameuse « boite noire » autrement dit sur ce qui se passe entre le patient et l’équipe soignante. Mais si on considère la situation française, il faudrait aller au-delà de la relation soignant/soigné et prendre en compte tous les acteurs qui se sont investis les premières années dans cette nouvelle politique de santé soit principalement trois types d’acteurs :
– les usagers d’héroïne eux-mêmes : les héroïnomanes des années 80, premiers patients de ces traitements, étaient les survivants d’une « catastrophe sanitaire et sociale » pour reprendre le diagnostic de la commission Henrion (1994). Ils sont devenus demandeurs de soin, d’autant qu’à la même période, le traitement du sida est devenu efficace. Certains d’entre eux se sont regroupés dans des associations, ont participé aux actions terrain et diffusé une information d’autant plus crédible qu’eux-mêmes se sont approprié les changements de comportement. Le junky des années 80 ne s’imaginait pas en « acteur de santé », mais l’appel à la responsabilité a modifié à la fois les représentations et les comportements, ce dont atteste la baisse drastique des contaminations du sida dues à l’injection, de quelques 30 % à moins de 3 % aujourd’hui.
– des militants associatifs : issus en grande part de la lutte contre le sida mais aussi de l’humanitaire avec Médecins du Monde, ces militants ont développé des expérimentations associant des usagers de drogues ; ils ont légitimé les actions tant auprès des professionnels de santé que d’une façon plus générale dans l’opinion.
– des professionnels de santé : des pharmaciens et des médecins généralistes se sont regroupés dans des réseaux, de nouvelles pratiques cliniques se sont élaborées tout d’abord dans l’alliance thérapeutique, quelquefois en partenariat avec les associations de terrain et enfin avec une information issue de la littérature internationale. Ces réseaux ont apporté un soutien individuel aux praticiens qui le demandaient, ils ont organisé des formations, participé à des conférences nationales et internationales qui ont réuni tous les acteurs, sans se limiter aux professions médicales.
Cette mobilisation collective a été soutenue par le ministère de la Santé et son administration, qui, à partir des premières actions expérimentées sur le terrain a développé une véritable politique de santé publique. Mais menée au nom de l’urgence médicale, la programmation officielle a passé sous silence le soutien aux associations d’usagers de drogues. Ainsi, le plan 1999-2001 de la MILDT n’en fait pas mention : des drogués, comme partenaires, ça ne fait pas très sérieux ! Chaque nouveau gouvernement découvre à son tour les subventions à ces associations, interprétées comme du laxisme, sauvées dernièrement in extremis comme association de « malades » par la Direction générale de la Santé.
La criminalisation de l’usager
comme priorité de la politique des drogues
La politique de santé publique développée par l’administration de la santé, n’a jamais été discutée et décidée par les parlementaires. Aussi a-t-elle dû constamment démontrer qu’elle ne remettait pas en cause la loi de 1970. Il y a pourtant une contradiction évidente entre distribuer des seringues et interdire l’utilisation des drogues. C’est la raison pour laquelle Simone Veil a donné à ce dispositif un statut expérimental, associé à une évaluation, son intégration dans le dispositif légal devant entraîner un changement du cadre législatif. Mais en 1999, alors que les bons résultats étaient avérés, le gouvernement de gauche s’est refusé à dépénaliser l’usage – dépénalisation inutile, disait-on, puisqu’elle se pratiquait de fait, et qu’elle risquait de donner « un mauvais message ».
À partir de 2003, la lutte contre les usagers de cannabis est devenue la priorité de l’action gouvernementale en matière de drogue. Ce tournant a été d’autant plus aisé que l’épidémie de sida due à l’injection n’était plus une menace et que l’héroïne était devenue invisible. Par contre l’usage de cannabis, bien que toujours réprimé, n’avait cessé de progresser. Pour Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, la répression de l’usage n’a pas été efficace parce qu’elle n’était pas systématique. Inspiré de la politique de tolérance zéro menée aux États-Unis, un dispositif est mis en place dans le cadre de la lutte contre la délinquance, avec multiplication des interpellations et des gardes à vue, sanctions systématiques, comparutions immédiates et peines plancher. Seule innovation en matière de santé, la création de consultations cannabis qui, dans l’esprit de la classe politique, s’inscrivent dans la logique de la loi de 1970, faisant du traitement une alternative à la répression. Les professionnels de soin ont bien contesté cette focalisation sur le seul cannabis, ils n’en ont pas moins accepté ces subventions qui offraient l’opportunité d’apporter un soutien à des usagers en difficulté en élargissant l’offre aux polyusages avec abus d’alcool et autres drogues. Les spécialistes n’ont pas le choix : ils ont dit et répété que « la toxicomanie » n’est pas un concept médical, la dépendance n’étant pas spécifique aux drogues illicites, mais leur action s’inscrit toujours dans le dispositif légal de « la lutte contre la toxicomanie ».
L’expertise entre répression et soin
L’ambiguïté est aussi une constante de l’expertise. Si la santé publique a bien développé une expertise qui lui est propre, la façon dont cette expertise est menée n’en reste pas moins le produit d’une négociation. Elle doit s’inscrire dans un cadre délimité par la demande qui détermine en partie ses conclusions. Ainsi le rapport de l’INSERM a bien établi l’efficacité de la Réduction des risques dans la lutte contre le sida, mais il n’a pas remis en cause les missions du dispositif institutionnel de Réduction des risques limité aux quelque 200 000 usagers « problématiques », assimilés à la grande exclusion. Les millions d’usagers restant ont ainsi été abandonnés à la logique « répression ou soin » inscrite dans la loi. Limiter la Réduction des risques à la grande exclusion est d’autant plus absurde qu’on a toutes les raisons de penser que ceux qui consomment des drogues illicites aujourd’hui appartiennent en bonne part aux classes moyennes. Faute de données, il est impossible de savoir quelle part d’entre eux est exposée au risque de contamination par le virus de l’hépatite. Il y a bien quelques équipes qui interviennent en milieu festif et qui, à ce titre, touchent une population plus large mais ces équipes, peu nombreuses et majoritairement bénévoles, ne sont pas intégrées dans le dispositif institutionnel de Réduction des risques. L’INSERM n’a pas pris en compte leur action, « faute de données scientifiques » a-t-elle dit. L’expertise est aussi limitée par les données existantes, qui elles-mêmes sont déterminées par les budgets de recherche.
De même, l’INSERM n’a pas mis en relation la hausse récente des overdoses mortelles et le renforcement de la répression. Le lien a pourtant été établi dans des recherches internationales parfaitement validées. Au reste, l’expérience française en a fait la démonstration : la terrible mortalité des héroïnomanes des années 80 n’était pas due à la « toxicomanie » elle-même mais à la répression et à la clandestinité, qui démultiplie les prises de risques et fait obstacle à l’accès aux soins. Au reste, Michel Kazatchkine, Directeur Exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme l’a dit avec force, en conclusion de la conférence de Vienne de 2010 : « La criminalisation des usagers de drogues, nous le savons, est un vecteur de propagation de l’épidémie ». Il s’agissait ici de l’épidémie de sida mais Michel Kazatchine a franchi un pas de plus : « l’une des priorités pour le monde est de faire cesser les fonds alloués à la soit disant «guerre contre la drogue» qui s’est révélée être un échec et s’est trop souvent transformée en une guerre contre les usagers et leurs communautés. Les fonds publics devraient au contraire fournir à tous ceux et celles qui en ont besoin un accès aux services de Réduction des risques ».
La guerre à la drogue se mène au nom de la santé publique et les experts de ce champ sont aujourd’hui les seuls qui ont autorité pour la contester. Pourtant les conséquences de cette guerre sont loin d’être purement sanitaires. Aux États-Unis, la politique de tolérance zéro menée depuis plus de quinze ans a abouti à des incarcérations qui se comptent en millions sans pour autant susciter un véritable débat public sur la politique des drogues. Une porte s’est entrouverte aujourd’hui avec le cannabis thérapeutique. Un paradoxe au regard de la politique des drogues, l’usage thérapeutique étant sans doute marginal au regard de l’usage récréatif. Du moins les médecins peuvent-ils se prononcer et attester que « oui, il y a bien des usages thérapeutiques du cannabis » et l’opinion s’est retournée. Le même retournement a été observé en France, à chaque fois que l’expertise médicale s’est fait entendre, lors de la mise en vente libre des seringues, puis avec les traitements de substitution et dernièrement avec les salles de consommation.
Placer l’usager citoyen au centre du dispositif de Réduction des risques
L’opinion publique ne cesse de demander aux médecins de prendre en charge non seulement les drogués eux-mêmes, mais également la question des drogues. Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, les experts sont mis en demeure de trancher dans des débats publics qui débordent largement le champ propre de la santé. Sollicités au nom de « La Science », ils sont pris dans un étau : s’ils reconnaissent les limites de leur expertise, ils limitent leur pouvoir et leur influence. La dictature du chiffre impose le silence sur la façon dont ces chiffres sont construits. Les professionnels de santé qui se sont investis dans l’innovation sociale de la Réduction des risques savent pertinemment que son efficacité tient à l’alliance avec l’usager, considéré non comme un malade mais comme un citoyen ordinaire. C’est précisément ces pratiques innovantes que les études quantitatives n’ont pas mesurées. Pour autant, les évaluations ont été très nombreuses, la démarche de Réduction des risques allant à l’encontre aussi bien du cadre légal que des opinions collectives. Au niveau international, les résultats obtenus donnent aux experts les moyens de proposer des stratégies alternatives à la guerre à la drogue. C’est un tournant majeur dans les politiques de drogues. Nous aurions mauvaise grâce à contester un contre-pouvoir d’expertise qui s’avère, selon ses missions, effectivement protecteur de la santé publique. Encore faut-il que le savant, pris de vertige, ne se mue pas en prêtre des temps modernes. Le danger principal est la domination d’un seul type d’expertise. La santé publique n’est pas qu’une affaire médicale, elle concerne tout autant le citoyen ordinaire, fût-il consommateur de drogues. Il appartient aux experts sollicités par la demande sociale de ne pas l’oublier.