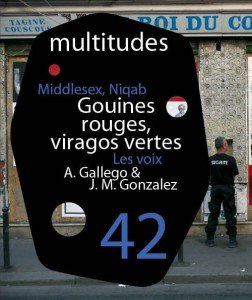Les lucioles se signalent à l’attention, virgules lumineuses dans le noir, formant des constellations mouvantes de mâles danseurs, si bien qu’on peut facilement négliger les larves luminescentes des femelles, vers luisants clignotant sur les feuilles comme des balises d’aéroport, autour desquels vrombissent les mâles. Outre la manière dont ce modèle mâle animé/femelles passives s’est imposé dans nos représentations des hommes et des femmes, leur différence de luminescence, et le fait que les femelles gardent une allure larvaire au cours de cette parade amoureuse, voilà qui gratte un peu nos constructions coutumières du masculin et du féminin[1]. J’ai grandi façon vers luisant dans une famille misogyne et me suis construite androgyne dans l’enfance, souhaitant échapper aux modèles de femmes disponibles alentour, et ne pas me revendiquer comme femme pour échapper au sexisme intellectuel – dans ma famille régnait un privilège accordé aux hommes, et d’abord par les femmes. À l’adolescence, je me suis vécue au-delà des catégories masculins-féminins. Cela me permettait d’échapper aux problèmes cuisants de féminité que je n’avais pas la force d’aborder du point de vue d’une invention de féminité non toxique, construite du côté d’humaines non genrées, et rassurée seulement par ce qui n’était pas normatif, tout en présentant aussi beaucoup de convoitise à l’égard des études intellectuelles qui m’avaient été présentées comme bastion masculin. La vraie difficulté me semble être de faire sauter le verrou de l’identité « femme », d’engager avec une belle assurance la nécessité de poursuivre la lutte pour l’émancipation des femmes, sans en rester à ces clivages entre lucioles et vers luisants, sans durcir ces complémentarités rageuses et régressives qui placent les femmes du côté de l’inerte, de l’obscur, du larvaire de l’amputé, tandis qu’on souhaiterait avoir des ailes ou sauter de sa feuille, sans valoriser finalement de manière réactionnaire les marqueurs sociaux d’oppression masculine comme des critères d’identité.
Empêtrée dans mes difficultés de clivage du côté du féminin et du masculin, je me suis tournée vers la psychanalyse, choisissant par une amie un psychanalyste mâle, dans cette pelote embrouillée des recours masculins et féminins pour construire une voix féminine qui ne soit pas une voix de fille (pas de mot en français pour dire cette jeunesse incertaine sans passer par la loi du père ou la règle de parenté). Du côté de la psychanalyse freudienne et lacanienne, difficile d’échapper à la castration, au Penisneid, à la différence des sexes, au nom du père… des marqueurs qui fixent les constructions du côté d’un partage des genres dont on ne dit pas assez nettement qu’il suit d’abord la pente d’un rapport de domination patriarcal, le renforce et le propage.
Le grand Phi de Philosophie
Difficile aussi pour quelqu’une, comme moi, lancée dans des études de philosophie, d’y poursuivre autre chose qu’un petit bonhomme de chemin, tant y règne la norme d’un discours masculin, qui s’exprime sous la figure de l’universel. Aucun besoin de revenir sur la sexuation des discours, puisque la prétention à la systématicité uniformise les singularités humaines : pas plus de philosophie de femmes, que de philosophie de classe, de race ou de pays. Le tenseur épistémologique du discours nivelle la singularité des voix, si bien que j’ai trop souvent entendu des femmes philosophes soutenir qu’aucune différence ne peut valoir entre les hommes et les femmes du point de vue de la raison.
En philosophie s’exerce plus drolatiquement, ou avec une apparence d’impunité plus extravagante qu’ailleurs la justification la plus absurde des préjugés phallocrates, un clivage sexué de la raison, la loi du Genre, alors même qu’on prétend y parler de chacun(e). La dissymétrie sexuelle des discours rationnels est proprement effarante. Nous aussi, filles philosophes, avons lu et relu des auteurs misogynes, d’Aristote à Hegel, de Rousseau à Nietzsche, pointant avec irritation dans la marge les innombrables passages infâmants où on nous disait femmes. La phallocratie, avec son phi majuscule, régnait en philosophie comme dans les discours dominants, sexuant le discours de la vérité, naturalisant le cogito mâle. Le petit théâtre sexué de la philosophie escamotait sous les usages de la logique une consolidation de l’inégalité et de la différence des sexes, sans la mettre en question, ni produire une critique de l’infériorité supposée des femmes, de leur domination sociale et de leur assujettissement politique. Le cogito universel était purement et simplement assimilé au genre masculin : l’Homme pense.
Vinrent des femmes qui nous le dirent : Beauvoir, au premier chef, mais j’appartiens à une génération qui situait son turban haut perché dans le sillage de Sartre, sur un mode subalterne comique, parce que les places du féminin et du masculin restaient distribuées dans son discours par sa propension à construire pour les sujets-femmes un projet d’émancipation se résumant à l’accès à l’universel, et qui relève d’un choix d’existence. La généalogie émancipatrice du Deuxième sexe, calée dans la répartition binaire des sexes des hommes et des femmes, paraissait désuète parce que nous la considérions à la traîne de Sartre, de sorte qu’être la compagne d’un philosophe virait au cuisant échec pour nous qui balbutions du concept. Sans compter, plus souterrainement, le mépris où nous tenions son œuvre, comme point rigoureuse, ni assez vaporisée dans les régions métaphysiques pour atteindre le point de fusion spéculatif ultime : changer de conception du monde, – un monde universel, cela va sans dire, où les différences sexuelles n’auraient plus cours…
Beauvoir nous semblait dépassée, parce que nous ne lisions pas dans son œuvre théorique une construction du masculin des femmes, ni du sexe, et que son œuvre littéraire nous paraissait en rester aux Mémoires d’une jeune fille rangée. Plutôt Artaud ou Michaux, Genet ou Deleuze. Zut ! Des hommes… En réalité, ces oscillations révèlent les constructions que nous tentions, ni soumises, ni désireuses d’endosser des postures de maîtres, mais prises dans la séduction d’une création qui conservait bien des traits de domination masculine. Nous ne voulions pas libérer les femmes dans un monde duel où le partage du féminin et du masculin reste posé, tandis que les femmes aspirent aux privilèges des mâles. De sorte qu’avec Beauvoir, avec son côté maîtresse d’école et sa révérence à l’égard du concept, on restait du côté des jupes plissées, des tailleurs sages. Ce qu’il nous fallait dans les années quatre vingt, c’était plutôt le transgenre, le n sexe, qu’on trouvait indifféremment dans les livres d’hommes et de femmes, devenir-femme des hommes, devenir-homme des femmes, de Janis Joplin à Monique Wittig, Hölderlin à Patti Smith. C’était surtout les clivages qui insupportaient, et tous ceux qui les assouplissaient paraissaient bienvenus. Foin des dualismes.
La critique du phallocratisme, de la domination masculine était bien portée au cœur de l’appareil théorique, par exemple chez Luce Irigaray. Les femmes sont irreprésentables dans le langage masculiniste et dans les théories phallocentriques dans la mesure où elles ne se laissent pas représenter à l’intérieur du système genré de la grammaire, ni des métaphysiques de la substance, centrée sur l’unitaire et l’identitaire. Ce « sexe qui n’en est pas un »[2]n’est pas un, mais multiple, et n’est pas un sexe parce qu’il ne se laisse pas ordonner sous les catégories majeures de l’unité et de l’identité masculinocentrées, si bien qu’il faut passer une fois pour toutes de l’analyse des dominations masculines à la critique du phallogocentrisme : phallus et logos se combinent pour porter la domination masculine au cœur même des systèmes théoriques.
Les systèmes de représentation portent en eux cette matrice phallocratique. Le « sexe » féminin fonctionne comme un point d’absence linguistique, qui n’est pas marqué à l’intérieur de l’économie masculine de la signification, de la substance, de sorte que le sexe n’est pas un manque ou un autre, ces catégories demeurant dépendantes des représentations phallogocentriques : le féminin est donc aussi ce sujet qui n’en est pas un. Cette entreprise ambitieuse d’une critique de la représentation, du sujet et des métaphysiques de la substance ne nous convenait pourtant pas davantage, car la femme s’y trouvait substantialisée, sans doute non comme l’Autre du masculin, mais comme le point aveugle du système. Penser la métaphysique traditionnelle – celle qu’on nous enseignait à l’université – comme reposant sur des théories biologisantes centrées sur le sujet mâle actif ne nous aidait guère à nous orienter dans la critique des « relations sociales de genre qui constituent et valident l’oppression sexuelles des femmes »[3], parce que nous ne nous reconnaissions pas comme « femmes ».
Les escaliers de Montmartre
Nous lisions les littératures féministes, mais nous avions du mal aussi avec la posture militante, nous n’avions pas assez de consistance pour l’action collective. Les sectarismes nous repoussaient : c’était la fin de l’héroïsme glorieux, du récit du grand soir, nous, adolescentes venues après mai 68, nous avancions par meutes, en baskets, et les femmes organisées politiquement étaient aussi inaccessibles pour nous que les hystériques femelles à choucroute et ongles peints, les taciturnes asexuées, ou les casées dans les paniers divers de la famille ou du métier, quels que soient leurs clivages. Nous évitions les femmes dominantes autant que les hommes, et notre engagement se faisait du côté des escaliers de Montmartre dans la nuit colorée des petits cafés, où nous restions suspendues par grappes, discutant avec les rares adultes qui n’avaient à notre égard aucune prétention de marquage familial, ni de posture d’éducateur, de sorte que nous avons grandies entourées d’adultes aussi marginaux et heureusement immatures que nous, et qui flottaient entre les genres.
Car les femmes, pour nous, ce ne pouvait être la femme que l’on oppose à l’homme. L’identité femme nous était aussi étrangère que l’identité homme. Nous étions du côté des bandes de filles, des nuages de femmes, des différentes figures de minorités, qui ne sont pas de même manière partie prenante de la hiérarchie sexuelle, selon leurs classes, leurs précarités, leurs capacités de ripostes… Bandes d’adolescentes réfractaires, tentant d’agir leur féminité sur le mode complètement androgyne d’une vie de filles, entre filles et avec des garçons, sexuelle mais sautant à côté de l’obstacle du genre, au cours de l’adolescence, avec la polysexualité de la jeunesse : c’était plutôt les jeunes en bloc informe, filles et garçons, qui s’opposaient aux adultes genrés, souffrant autant mais différemment des clivages, et cherchant par meutes à s’y soustraire.
Ces différentes voies de construction, au sein desquelles d’ailleurs le dualisme Homme/ Femme faisait rage comme ailleurs, nous rendaient réfractaire au féminisme de nos aînées, parce que femmes, nous ne voyions pas ce que c’est. Il fallait passer du « molaire » de l’identité femme, au moléculaire des différentes constructions féminines. Ça, c’était une trouvaille, que nous avons vécue avant de la trouver formulée, par exemple dans certains textes de Guattari, sous le nom de transversalité moléculaire, distinguée des identités molaires[4]. Au hiérarchies identitaires, qui se situent au niveau des formes constituées, des entités définies, des lucioles molaires, Guattari oppose les processus moléculaires, qui les constituent sur le plan des forces. Leur dynamiques transversales, connectent, forment et déforment les modes molaires constitués, et les mettent en circulation. La transversalité concerne donc aussi bien la pratique politique des groupes que la fabrique du concept : les groupes, y compris révolutionnaires, réinjectent en leur sein des pratiques de domination, lorsqu’ils passent à l’identitaire, au molaire, à la tendance réifiée en entités bien constituées, centralisées et obéissant à leur tête ; tandis que les pratiques sont toujours moléculaires, c’est-à-dire fluides et plurivoques, avec des tensions incomplètes de structurations acentrées. La transversalité concerne autant l’allure pratique que la théorie des systèmes, exclusifs, hiérarchiques, universels, identitaires dans le cas du molaire, connectifs, acentrés et singuliers pour le moléculaire. En outre, cette différence entre les formes identitaires bien définies, les lucioles molaires et les nuages de forces moléculaires larvaires s’explique en fonction d’un axe politique de domination : c’est la position majeure de domination qui favorise la densité molaire ; tandis que les sursauts pour s’y soustraire, les ripostes pour redéfinir les forces en présence s’effectuent plutôt sur un mode moléculaire. Cela explique en outre la propension avec laquelle les minorités dominées adoptent des conduites de type molaire pour résister ou lancer l’offensive. Le féminisme de nos aînées nous semblait trop identitaire, trop molaire, nous ne pouvions, moléculaires, nous y sentir à l’aise.
Nous avons plutôt agi notre libération de femmes du côté des minorités, des marginalités, avec les revendications homosexuelles des années quatre-vingt. La polysexualité transgenre ouvrait la voie, avec le trouble qu’elle apporte dans le genre, et la constatation que les partages féminins/masculins sont éprouvants et mutilants pour les filles comme pour les garçons. Cela ne change en rien les problématiques de la domination masculine, mais la stigmatise comme un fardeau que les hommes ont à porter autant les femmes, quelles que soient d’ailleurs les positions de pouvoir qu’ils occupent, et qui se retourne aussi durement à l’occasion contre les masculins dominés, selon les clivages sociaux de classe, de race, de pouvoir économique ou intellectuel, quelques soient les marqueurs de domination dont les femmes écopent de toute façon. Du coup, les trouvailles émancipatrices de la psychanalyse pouvaient être débrouillées sans se ranger au sexisme exorbitant du Phallus, différence majeure, sexuant par le manque aussi bien les sujets féminins que masculins. Ce sont les études lesbiennes et gaies, les problématiques des sexualités queers, le travail sur les marges, les marginalités et les minorités qui nous ont donné accès au féminisme.
Sexualités à n genres
Cette ouverture venait par hasard de Proust, croisé dans l’adolescence et d’un livre à vrai dire obscur, déniché dans une librairie, dont l’auteur m’était parfaitement inconnu, qui procédait à la déflagration des conceptions binaires de la sexualité. Cet auteur, c’était Deleuze, et les concepts qu’il mettait en œuvre allaient être affûtés encore, je l’ignorais à l’époque, de sa rencontre avec Guattari : sexualités à n genres.
Tout au long de la Recherche, qui me semblait, adolescente, autant un manuel de poésie qu’une sorte d’entomologie des pratiques sexuelles et d’anthologie de l’amour, du désir et de la jalousie, s’esquivait la fracture Homme-Femme, partout où on s’attendrait qu’elle surgisse. La figure d’Albertine, notoirement construite autour d’un homme, établissait aussi dans le récit la brume d’une homosexualité féminine, diffuse et séductrice, et surtout, l’hétérosexualité formait en sourdine une sorte de ligne de référence exténuée, une portée musicale issue des descriptions sociales de Balzac, mais atténuée et contredite chaque fois qu’elle faisait mine de s’affirmer. Sur cette portée, comme au jugé, Proust envoyait des volutes autrement inventives, portraits tremblants de variations, tous au-delà des sexes normés, des identités genrées.
Il ne s’agissait plus ni d’Homme, ni de Femmes, mais de passer à une sexualité à n genres : pas question non plus de sectionner les humains en retranchant les masculins ou en les féminisant, selon la stratégie de Monique Wittig, que je lisais avec passion mais sans le pincement au cœur que me donnait Artaud, parce que son univers me semblait trop renfermé, clos sur une identité lesbienne assortie d’une certitude du féminin qui me heurtait, alors que je m’en tenais toujours à mon immaturité trans-genre. Avec Proust, Artaud, je cherchais, en littérature aussi, une écriture fragmentaire, loin des totalités, des centres, des œuvres canoniques, une cadence de l’incomplet, de l’oscillant, qui faisait écho, mais sur le plan du style, au dégoût à l’égard des totalités bien formées. Cela s’appliquait autant au style en philosophie qu’à la pratique littéraire : lutter contre l’unité, le sujet souverain, la substance, lutter contre les identités. Un engagement théorique fort que je trouvais pratiquement dans certains livres de philosophie ou de sciences humaines, dans le statut marginal de la littérature vis-à-vis de la philosophie, autant que dans nos pratiques hésitantes de jeunes intellectuelles : du côté de la matière, loin de l’unité de l’esprit, loin de l’identité du concept, loin des clivages Âme/corps, Universel/particulier, Homme/animal, Blanc/noir, Riche/pauvre, Actif/passif. Partout où passaient les hiérarchies binaires inégalitaires.
Faire passer les clivages du côté du fragmentaire dévaluait aussi l’hypothèse d’une complétude homosexuelle, et même d’une physique des femmes rétablissant la balance des inégalités en leur faveur. Le transsexualisme de Proust est radical parce qu’il rapporte l’homosexualité à l’hétérosexualité statistique dominante, comme deux formes identitaires jumelles. On aurait tort de confondre sa théorie de la sexualité avec « une homosexualité globale et spécifique », où les hommes renverraient aux hommes et les femmes aux femmes au titre d’entités constituées, de sexes définis biologiquement, ou construits par les pratiques inégalitaires du genre, sur un mode molaire. Elle consiste en une « homosexualité locale et non spécifique », permettant une découverte du transexuel, qui nous décollait de la naturalité du sexe : « Le troisième niveau est transsexuel (“ce qu’on appelle fort mal l’homosexualité” [disait Proust]), et dépasse aussi bien l’individu que l’ensemble : il désigne dans l’individu la coexistence de fragments des deux sexes […]. Une communication aberrante se fait dans une dimension transversale entre sexes cloisonnés […]. L’homme cherche aussi bien ce qu’il y a d’homme dans la femme, et la femme, ce qu’il y a de femme dans l’homme, et cela dans la contiguïté cloisonnée des deux sexes »[5], objets construits, non identités naturelles.
C’est en passant par les thématiques de la transsexualité, les études lesbiennes et la pensée queer que le féminisme a repris son évidence, à partir d’une critique de cette identité féminine affrontée au masculin, qui ne nous semblait pas beaucoup plus avantageuse que la polarité phallocratique normative du masculin/féminin. S’il n’y a pas un sexe biologique naturel, qui fonde en nature ou en droit l’asservissement des genres et des partages sociaux, alors, de même, les entités « femmes » « hommes » sont construites par des modes sociaux de subjectivation divers. Si ce sont les modes de production sociaux des genres qui déterminent les différences sexuelles, l’analyse doit se porter dès lors vers ces modes de subjectivations.
Plus besoin alors de conserver les dualités lucioles et vers luisants. Cela devenait éclatant avec l’excellent livre de Judith Butler[6], Gender Trouble. L’apparente contradiction entre la révolte contre le statut inférieur des femmes et le refus d’une identité de femme, même revendicatrice, la difficulté avec les postures majeures de tous bords trouvent dans ce livre des réponses très stimulantes : porter décidément au cœur du féminisme la question critique de l’identité des femmes, donc la question du genre, et du sexe, décoller le sexe et le genre de toute naturalité, pour opérer une critique de l’hétérosexualité dominante, non pour évincer les hommes de ces procès de libération, mais pour faire voler en éclat les schémas de domination qui s’y logent : Hommes/Femmes. Comme Judith Butler le dit très bien, c’est tout ensemble l’hétérosexualité obligatoire et le phallogocentrisme qu’il faut mettre en pièces, et ce, en traquant dans les théories comme dans les pratiques militantes les surgeons très nombreux de domination qui s’exercent, et réintroduisent des schémas de type actif/passif, y compris dans ses sphères les plus abstraites, à commencer d’ailleurs par le partage du théorique et du pratique.
De sorte que s’éclairait le problème : les philosophies occidentales sont infestées de répliques idéologiques phallocrates validant une supériorité masculine à l’égard des femmes. Cela tient autant à la puissance opératoire des clivages sociaux opprimant les femmes ou les cantonnant à des rôles subalterne, qu’à des styles théoriques de pensée centralisés et hiérarchiques, – où les degrés de subordination reproduisent et multiplient à toutes les échelles ces marqueurs binaire d’assujettissement maître/esclave, dominant/dominé, mâle/femelle. On les trouve dans les travaux sociologiques, juridiques, aussi bien que dans les théories politiques d’émancipation, qui ne prennent en compte que l’oppression de classe, sans la pluraliser en la croisant avec la production d’inégalités sexuées selon le genre. Ils règnent bien entendu de manière incontestée dans tous les systèmes dualistes opposant le corps à l’esprit, la matière à la forme, l’animal à l’humain, l’inanimé au vivant.
De sorte qu’on échappait définitivement au mythe d’une raison non genrée, porteuse d’une aptitude universelle à la théorie, au langage ou à la création, en cessant de penser le genre ou le sexe en termes substantifs. Dans le cadre de sa critique de la représentation, Irigaray substantialisait encore les femmes sous l’aspect de ce qui échappe par essence au phallogocentrisme. Sans doute élargissait-elle « la critique féministe en dévoilant les structures épistémologiques, ontologiques et logiques d’une économie masculiniste de la signification » mais, comme le remarque Butler, « la force de son analyse se trouve justement limitée par sa portée globalisante »[7], l’empêchant de s’intéresser aux analyses différenciées des contextes culturels et historiques variés où se cristallisent les différences sexuelles. Porter l’oppression de genre à ce degré extrême de puissance opératoire, la rend inoffensive, elle-même fonctionnant comme une forme d’impérialisme idéologique parce qu’elle est abstraite au-delà de tout contexte historique et politique.
Cette différence des sexes, s’affirmant comme nature dans la plupart des textes des théoriciens mâles occidentaux, poursuivait paradoxalement sa course dans le féminisme identitaire des années soixante qui s’érigeait contre elle, jusqu’au choc en retour, salvateur, de ce féminisme dans les théories contemporaines transversales de la culture. Pas de sexe donné, par de genre naturel. De ce point de vue, les gender studies nous ont réveillées de notre sommeil dogmatique.
Pluraliser les devenirs-femmes
Judith Butler n’est pas la seule à mener ce combat : Teresa de Laurentis critique elle aussi la notion de différence(s) sexuelle(s), qui piège la critique féministe dans le cadre identitaire d’une opposition universelle entre les hommes et les femmes, et rend impossible d’articuler les différences entre les femmes concrètes et la Femme universelle[8]. C’est du côté de cette pluralisation que les études féministes se vivifient, se relancent et se transforment, en tenant compte de la diversité des modes de subjectivations, et des types de domination. Qu’il s’agisse des féminismes black ou latina, contestant que le féminisme américain puisse parler d’une seule voix blanche, de classe moyenne, ou des féminismes émergeants des pays du Tiers-Monde, la critique porte sur le caractère souvent trop européocentré des théories féministes. Les constructions occidentales du genre ne s’appliquent pas universellement à toutes les femmes[9] : il s’agit de ré-historiciser ces catégories en tenant compte de leur singularité et de leurs différences de contexte.
Ces propositions théoriques nous aident à construire les féminismes d’aujourd’hui. D’abord, le passage de l’identité molaire au pluriel moléculaire implique le refus du sujet centré, des identités, du sexe : le sexe fonctionne toujours en représentation molaire alors qu’il se produit sur un mode moléculaire, comme anomie du sexuel, à n-genres, ou queer.
La distinction entre lucioles molaire et vers luisants moléculaires ne s’applique pas seulement aux sujets genrés, aux hommes et aux femmes produits par les agencements collectifs inégalitaires. Elle concerne aussi la pratique militante qui s’en défend. Cela rend compte de la tendance à la réification des groupes révolutionnaires, qui se normalisent sur le mode identitaire, et se stratifient en groupes assujettis, en perdant leur capacité constructive et imprévisible de groupuscules, de groupes-sujets fabriquant de nouveaux modes de subjectivations. L’homosexualité molaire, comme toutes les positions mineures, court le risque de se reterritorialiser en majeur, et la même critique s’applique à toutes les unités identitaires : « la » femme, « la » lesbienne, « la » femme voilée…
L’association entre féminisme et luttes trans-pédé-gouines, impensable en référence aux communautés, se comprend, comme le montre le recours à Proust, par la déconstruction des représentations de genre, qui passe y compris par leur renforcement mimétique chez les gouines butch ou les drag-queen. Corde raide de la lutte, sans les ailes qui empêcheraient que, quel que soit le côté dont on penche, on réinvestisse finalement du majeur. Reste à comprendre ces constructions homo- ou hétérosexuelles comme le jeu d’une tentative de dénaturalisation qui permet une mobilisation dynamique des catégories du genre : comme une ligne de fuite, qui peut passer aussi bien par la reprise inventive de modèles insistant sur les différences sexuelles que par d’autres biais, l’important étant la construction, la production de nouveaux modes de subjectivations.
La critique politique des constructions de la psychanalyse s’en trouve décidément toujours aussi urgente. Elle implique une critique des modes de subjectivations sexistes, qui touche l’Œdipe capitaliste, masculiniste avec son privilège accordé au Phallus et à la castration, mais aussi les représentations européocentrées du psychisme, légitimant comme nature de l’inconscient des modes de domination répétés de génération en génération. L’ouverture actuelle des féminismes sur les autres clivages de domination de la classe, de la race, de la situation mondiale, signale bien que l’explication binaire par l’oppression masculine, si elle a favorisé l’émancipation des femmes occidentales, fonctionne en même temps comme un acte colonisateur de marginalisation, comme le montre très bien Gayatri Chakravorty Spivak[10]. On ne peut plus construire le féminisme aujourd’hui sur une identité de femme libérée, transhistorique, sauf à reconduire un modèle colonial de femme émancipée imposé en modèle aux femmes du monde entier.
En réalité, il faut repenser les catégories de l’identité dans le cadre de ces rapports de genres, qui restent fondamentalement asymétriques. De même que nous ne pouvons pas échapper au langage, seulement rendre manifeste la manière dont se cristallisent en lui des structures d’inégalités et d’oppression, de même, il n’y a pas de position possible en dehors du monde contemporain, en dehors des agencements concrets juridiques, langagiers, politiques et sociaux avec ou contre lesquels nous agissons, menons nos stratégies, toujours en compromis avec ce que Marx appelait le présent historique. « Notre travail, dit très bien Butler, consiste à formuler à l’intérieur de ce cadre établi, une critique des catégories de l’identité que les structures juridiques contemporaines produisent, naturalisent et stabilisent », au premier chef, mais pas exclusivement, celui des représentations féministes. C’est dans cette perspective que Butler met en question l’exigence de « construire un sujet du féminisme »[11], projet politique qui permet de faire « revivre le féminisme sur d’autres bases », en repensant le cadre des constructions de l’identité. Cela implique aussi une stratégie évitant les clivages du type lucioles et vers luisants, se gardant de la tentation des identités définies et de la reconstruction d’universaux, définissant « la » ou « les » femmes.
Cette position théorique convient parfaitement pour la critique des dualismes, pour la revendication d’une théorie réellement transversale, qui coupe court à la subordination hiérarchique des genres et des espèces, et cesse de tenir le sujet fût-il féminin, pour un élément à émanciper, sans céder en rien sur les revendications féministes concrètes. Ici aussi, l’Anti-Œdipe se montre d’un apport décisif. La discussion ici doit porter sur ce qu’est une limite, sur le type de limite qu’engendrent les représentations genrées, leur construction de l’identité sexuelle et de la rationalité. La limite n’est pas l’endroit où s’affrontent les identités statiques, elle ne s’établit pas entre des entités constituées qu’elle distingue, mais, constructive et prospective, elle agit sur le mode d’une coupure qui constitue les entités relatives qu’elle sépare. La limite du genre est une limite différenciatrice, créatrice de rapports de pouvoir, non une ligne de démarcation qu’il s’agirait de déplacer pour mieux cerner ou pour libérer l’identité féminine.
Si la tentative de Butler s’est heurtée à de nombreuses critiques, soupçonnée de saper l’émancipation des femmes – dès lors que les femmes ne sont pas données, comment pourrait-on les libérer ? –, elle fonctionne en réalité comme un principe régulateur qui permet d’échapper aux binarismes en poursuivant la lutte. Faire porter l’analyse critique sur la manière dont les féminismes ont, prématurément sans doute, mais de manière inévitable dans l’urgence stratégiques des combats, insisté sur la définition d’un sujet stable du féminisme, révèle les conséquences normatives de toutes les constructions identitaires, même lorsqu’elles répondent à des visées émancipatrices.
Le devenir-femme concerne alors tout un chacun, comme le propose Guattari, non que les hommes aient à devenir des femmes, mais parce que tous les devenirs engagent des formes de déterritorialisations et de minorités qui sont dans nos sociétés assumées notamment par les femmes, mais aussi par les Noirs, les intermittents, les chômeurs. En ayant construit une identité féminine pour libérer les femmes, on a construit un élément supplémentaire de clivage, l’utilisation en mode majeur de la catégorie dominée suscitant des clivages et des fragmentations contre productives, maintenant dans l’opposition au féminisme les femmes qu’elles prétendent libérer. C’est donc un pluralisme, et une politique anti-identitaire des féminismes dont nous avons besoin, pour poursuivre la généalogie féministe de ces catégories de femmes.
Le mérite de ces études est double : non seulement elles nous dépêtrent de l’encombrante entité « femme » au profit d’une multiplicité de conduites, mais elles nous permettent aussi rétrospectivement de saluer avec reconnaissance les auteures féministes : les identités féminines diverses qu’elles proposaient, dans lesquelles nous ne pouvions plus nous reconnaître, s’intègrent désormais dans une histoire des pratiques théoriques où les femmes, actrices de la généalogie de leur propre statut se sont montrées déterminantes. De Laurentis, Butler nous permettent de relire les textes féministes exclusifs, branchés sur une identité-femme, avec un nouveau regard : moment nécessaire de la lutte, nécessité aussi de passer de la Femme identitaire au moléculaire, à la multiplicité des devenirs-femmes. Elles nous réconcilient avec bien des auteures, soucieuses désormais d’éviter les écueils de l’universel, auxquels ces femmes pionnières n’échappaient pas toujours : faire de la femme l’Autre de l’Homme, diluer les femmes dans l’universel comme si le phallocentrisme n’avait plus cours en logique, ou à l’inverse, fabriquer à nouveau de l’universel avec du marginal, ce qui a permis d’accumuler des descriptions et des exemples pour cette généalogie féministe.