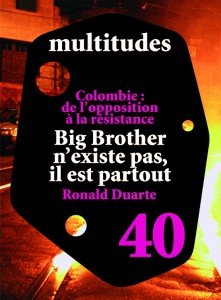À ma droite, dans le box des accusés, un sauvage à l’air très propre sur lui. Un Diable américain. Le plus grand des voleurs de l’ère numérique : Google, condamné le 18 décembre dernier par le tribunal de grande instance de Paris pour s’être adonné à des « actes de contrefaçon du droit d’auteur ». À ma gauche, du côté des plaignants, le bon Dieu et ses deux anges tutélaires : l’éditeur Hervé de la Martinière, à l’origine de la croisade, ainsi que les représentants du Syndicat national de l’édition et de la Société des gens de lettres. Et que chacun choisisse les siens ! Êtes-vous du côté de Barbe Noire, le roi des pirates ? Des bandits menaçant notre civilisation et son socle, la propriété intellectuelle ? Ou du Super-Dupont de l’édition, admirable défenseur de l’art de publier franchouillard ? Sachez-le, vous qui parfois téléchargez : il n’y a rien entre les deux. C’est tout blanc ou tout noir.
Voilà bien un jugement à la française, admirablement dichotomique, digne de l’issue grotesque des débats sur la loi dite Hadopi, pas loin d’être inapplicable depuis que le Parlement européen a voté fin novembre son « Paquet Télécom », avec un volet rendant impossible la coupure de l’accès à Internet sans une procédure « juste et impartiale», tenant compte du droit à l’internaute d’être entendu, de la présomption d’innocence et du respect de la vie privée.
Le e-géant sans vergogne a donc été condamné à 300 000 euros de dommages et intérêts et 45 000 de frais de procédure, et non à 15 millions d’euros comme l’exigeait le propriétaire des Éditions du Seuil dans sa plainte de juin 2006. De fait, aujourd’hui, personne ou presque ne doute de la dangerosité du monstre Google. Et surtout pas nous[1]. Sauf que le jugement du tribunal de Paris, arc-bouté sur une vieille conception du droit, ne frappe pas là où il faudrait ce démiurge du numérique aux ineffables talents de « profileur »[2]. Et que son avocate n’a pas tort, pour justifier de son appel au nom du Diable, d’affirmer que ce jugement « fait une mauvaise appréciation du droit d’auteur » et « constitue un pas en arrière pour les droits d’accès des internautes au patrimoine littéraire français et mondial »…
Le grand « numérisateur » a encore frappé…
Reprenons les termes du jugement pour mieux en analyser les conséquences. L’accusation reprochait au plus fameux des moteurs de recherche de la planète d’avoir numérisé « 100 000 œuvres françaises », dont 9 000 pour Hervé de la Martinière, sans en avoir au préalable demandé l’approbation, alors même que ces livres étaient protégés. Ce à quoi Google répondait qu’il s’était contenté de numériser les livres de grandes bibliothèques américaines, à leur demande, avec qui plus est une logique de citation en ce qui concerne les ouvrages sous droits. Se jugeant compétent sur des actes commis aux États-Unis sur des livres dans la langue de Simenon, le tribunal a estimé finalement qu’en « reproduisant intégralement et en rendant accessibles des extraits d’ouvrages sans l’autorisation des ayants droit », la firme californienne a hissé le pavillon pirate. Autrement dit : le projet Google Book Search, lancé en 2005, contrevient à la loi française sur les droits d’auteur.
Mais de quel méfait parle-t-on ? Fin 2009, Google avait indexé 10 millions de livres, parmi lesquels « 20 % sont libres de droits, 5 % sous droits et 65 % forment une “zone grise” comprenant des ouvrages épuisés (tout du moins aux États-Unis) ou dits “orphelins” de leurs ayants droit, parce que non identifiés ou introuvables. »[3] Les éditeurs, pour la plupart, mettent au placard la majorité de leurs « produits » au bout d’un moment, ceux-ci restant généralement de trois mois à un an sur les rayons puis dans les étagères des libraires. Depuis des lustres, ils jettent donc aux oubliettes beaucoup de leurs livres, rendant ainsi introuvables certains de leurs « incunables »[4], il est vrai pas toujours très rentables quand ils sont sous forme papier du fait des coûts de stockage. Eh bien !, Google, cette société privée, les numérise à ses frais. Ce Barbe Noire permet aux lecteurs du monde entier de découvrir des millions de bouquins rares, épuisés, impossibles à dénicher dans le monde physique, sauf à se rendre à LA bonne bibliothèque qui en préserve un exemplaire papier. Pire, Google resquille : plutôt que de faire la queue comme le règlement l’impose, c’est-à-dire d’attendre des années et de mener mille enquêtes pour obtenir l’autorisation préalable des éditeurs et de la totalité des ayants droit – souvent perdus dans la « zone grise » – avant de reproduire tous ces livres des bibliothèques, il agit en attendant que ceux-ci se manifestent.
Pour ce faire, il s’appuie sur une règle pragmatique du droit américain, le fair use (équivalent de nos cinq exceptions constitutives du droit d’auteur : la citation, la caricature, la copie privée, l’enseignement, la recherche), que l’on pourrait traduire par « usage juste », « loyal » ou « raisonnable ». Selon cette logique, par exemple, Google ne met à disposition du vaste public du Net qu’un plus ou moins grand nombre d’extraits de ses 5 % d’ouvrages clairement sous droits. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Est-ce un mal pour un bien ? Certes, selon les plaignants du procès, certaines de ces citations auraient été reproduites de façon lamentable, qu’il s’agisse d’une piètre qualité technique ou de coupes en multiples tronçons jugés « aléatoires » – Google ayant agi ainsi pour respecter nos lois… Mais qu’importe, sur le fond, la façon dont s’exerce ce fair use : c’est au nom d’une intangible fixité des règles de notre droit que la justice française a tranché contre ce principe de l’usage juste et raisonnable. Et elle a rendu son jugement inepte après trois ans d’instruction, c’est-à-dire une éternité en temps Internet. Sur la Toile, on en rigole encore. Mais c’est un rire jaune…
Moins ringards, les juges américains ?
L’actualité de Google, au premier trimestre 2010, devrait prendre la forme de Google Edition, immense et toute nouvelle librairie numérique qui n’exploitera commercialement qu’une partie des ressources accumulées par la grâce des pratiques de Google Books. Gratuité pour les titres libres de droits, et système d’abonnements pour les œuvres sous droits. Reste à savoir ce qu’il adviendra des disparus et autres OVNI de la « zone grise », au statut flou. Quoi qu’il en soit de ces millions d’orphelins de l’édition, les gardiens du temple hexagonal peuvent dormir tranquille : il y aura peu de livres numériques en français au sein de Google Edition. Et pour cause : en novembre dernier, nos preux chevaliers et leurs confrères teutons ont refusé de signer un accord obtenu à la mi-novembre par leurs homologues anglo-saxons… Outre une enveloppe de 125 millions de dollars (84 millions d’euros) pour apaiser aux États-Unis la Guilde des auteurs et l’Association des éditeurs, les bénéfices nés de la manne livresque devraient aller au tiers à Google, et aux deux tiers dans la poche des éditeurs et des ayants droit. Du moins si le ministère de la justice américain valide le deal en février 2010.
Dans leur verdict, les juges français ont stigmatisé le caractère illicite de la reproduction numérique « made by Google ». Pas touche à mon patrimoine d’éditeur ! Par un curieux paradoxe, le jugement défend une propriété intellectuelle absolue, alors même qu’il traite comme anecdotique la question de l’usage commercial ou non des numérisations réalisées par l’ogre de Mountain View, qui me semble être la question centrale de tout regard critique et de tout règlement de quelque litige. Or, sur ce sujet plus qu’aucun autre, la plupart des gros éditeurs se comportent, ni plus ni moins que Google, comme des prédateurs. Le juge a supposé qu’ils étaient les détenteurs des droits numériques sur les ouvrages qu’ils ont publiés. Or la mention n’existait pas jusqu’il y a peu dans la plupart des contrats d’édition, qui par ailleurs sont souvent ridicules dans leur version standard, prévoyant une cession de droits pour la création de films ou la fabrication de badges et de tee-shirts, y compris quand il s’agit d’œuvres ésotériques qui ne feront l’objet d’aucune promotion… En l’occurrence, la justice française, fort inspirée d’esprit féodal, a considéré que les clauses générales valaient cession de tous droits, sans exception, de la part de l’auteur. Que ce dernier, afin de se faire connaître et de vendre le papier, ait envie de diffuser gratuitement tout ou partie de son œuvre sous forme numérique ? Qu’il puisse décider d’une libre diffusion de sa prose au bout d’un an, son éditeur se contrefoutant de son livre chichement vendu ? Non, lui répond notre justice : l’auteur est le vassal de l’éditeur et ne peut en décider ainsi…
Où se cache la « bibliothèque universelle » ?
Dans une tribune sur « l’avenir numérique du livre », le professeur au Collège de France et Président du Conseil scientifique de la BNF Roger Chartier a quelque raison d’affirmer que la création par Google d’une vaste banque de données n’a pas grand-chose à voir avec une « république universelle des savoirs »[5]. Les horizons d’une institution comme la Bibliothèque nationale de France et d’une multinationale de l’Internet ne sont pas les mêmes, cela va de soi. Google voit d’abord les livres comme d’extraordinaires sources d’informations, d’une fiabilité bien supérieures à l’océan de données de la Toile. Il les perçoit telles des pièces essentielles de la gigantesque base de données, allègrement indexée par ses robots, dont il se veut le démiurgique relais auprès des internautes qu’il aura savamment « profilés » à des fins publicitaires. L’objet livre, en tant que tel, lui importe peu. Google ne s’intéresse pas à sa sauvegarde, sous sa forme d’origine et en rapport à son contexte, ainsi qu’à la façon dont tout support influe sur la lecture elle-même, le numérique transformant un mode linéaire en lecture par sauts de puces, au fil des multiples montagnes de sens et de non-sens de l’ouvrage, avec au mieux quelques parcours fléchés, ou à défaut une ribambelle de repères d’indexation. Mais y a-t-il forcément opposition entre ces deux lectures, du codex à l’hypertexte, de la matérialité du papier à l’immatérialité de nos écrans ?
Quand Lucien X. Polastron, intellectuel de la même génération que Roger Chartier et lui aussi féru de culture médiévale, assure que la numérisation pourrait être l’avenir du livre, sa position se tient tout aussi bien[6]. Lui, pour débuter sa tribune, évite toute réflexion abstraite. Il se met en scène, loin de sa bibliothèque de vieux dictionnaires. Avec son ordinateur ultraléger comme seule « sous-cervelle », il ressent « un besoin pressant de vérifier le sens d’un mot rare ». Il « googlise », et tombe sur « la page adéquate du dictionnaire de l’Académie française dans son édition de 1835, reproduit en fac-similé mais aussi entièrement indexé. Admirable ? Le plus admirable se trouvait en coin d’écran : l’ouvrage avait été numérisé, sans tambour ni trompette, par Google, à la New York Library ».
Google, ce traqueur de données, peut-il être utile à la connaissance ? Même le Président du Conseil scientifique de la BNF, malgré son attachement à l’objet papier et sa juste méfiance vis-à-vis des objectifs de la firme, ne dit pas non. Bien sûr, la conjonction des objectifs d’une grande bibliothèque et du géant de l’Internet suppose de négocier, voire de contraindre l’interlocuteur fort intéressé à accepter que soit préservée toute la liberté de l’institution, notamment en termes d’usage du stock à numériser. Tel était l’un des enjeux des discussions entre la BNF et Google pour la numérisation de nos « incunables ». Depuis la mi-décembre, et l’annonce que 750 millions d’euros des bénéfices du grand emprunt devraient aller dans une cagnotte destinée à financer la numérisation des biens culturels, jusqu’ici parent pauvre de notre politique dite culturelle, la donne semble avoir changé. Et c’est tant mieux. Mais cette somme sera-t-elle suffisante ? Et peut-on croire sérieusement qu’il n’y aura pas à négocier âprement avec l’État comme avec tout partenaire privé ? De la déclaration aux faits et à leur mise en œuvre, il y a un fossé, qui pourrait se traduire en une myriade de tracasseries administratives, voire en années de gâchis…
Dan Brown plutôt que Nietzsche
Il serait inutile, j’en ai la triste conviction, de demander à Hervé de la Martinière son point de vue sur ce débat à distance entre Roger Chartier et Lucien X. Polastron. Nietzsche et les vieux dictionnaires rares d’il y a deux siècles l’intéressent moins que Dan Brown et les livres de recettes de cuisine tout pleins de clichés, dans tous les sens du terme. À l’instar de Pascal Nègre, patron du label Universal qui a savamment doré le blason du cercueil de la musique à force de rejeter les nouvelles logiques du numérique depuis presque quinze années, l’éditeur ne fait que défendre son modèle économique, à l’heure où Le Seuil, justement, licencie comme jamais. En soi, ce n’est pas honteux. Juste pas très malin. Et ce d’autant que l’objet livre ne semble pas encore en corbillard à la porte du Père-Lachaise, prêt à saluer la tombe de Jim Morrison et ses graffitis païens…
De fait, la cécité du monde de l’édition rappelle quelque souvenir à qui a suivi les errements de son grand frère du disque en France. Car ce n’est qu’aujourd’hui que devient crédible la lecture en numérique, avec les logiciels du iPhone, le Kindle d’Amazon et autres lecteurs e-book de Sony. Pour un Léo Scheer, affirmant qu’il « ne faut pas chercher l’exclusivité alors que nous sommes dans une explosion technologique », combien y a-t-il d’Hervé de La Martinière, accrochés à leurs privilèges de possession de tous droits de leurs auteurs « vaches à lait », genre Marc Lévy ? L’industrie du disque s’éteint chaque jour un peu plus de sa recherche de rentabilité à court terme sur chaque « produit », des stars en paillettes de la télé-réalité et du syndrome Hadopi, transmutation malheureuse de la ridicule et oubliée loi DAVSI[7]. Elle n’a pas su tirer parti de la différence de nature entre ses biens rivaux, du vinyle au CD, et la réalité non rivale, c’est-à-dire partageable sans la moindre perte, des fichiers musicaux pouvant s’échanger sur le Net. L’industrie du livre, ce premier vecteur de la connaissance, va-t-elle suivre le même chemin vers le cimetière des éléphants ?
L’expérience des quinze dernières années a démontré l’idiotie de croire en l’utilité d’associer des verrous logiciels, type DRM (Digital Right Management), aux fichiers numériques, qu’il s’agisse de musique, de vidéo ou demain de « e-livres ». La pose de panneaux d’interdiction de passer, donc de copier, sur les routes et autoroutes digitales ne sera jamais la solution. C’est pourtant bien cette idée qui trotte dans la tête de trop d’éditeurs, à juste titre désemparés. Ils ne réalisent pas à quel point la meilleure protection du livre, quelle que soit sa forme, tient justement à sa valeur réelle, et pas seulement monétaire. L’objet livre donne par tout son art un sentiment de richesse qu’a perdu par exemple le disque, à cause du CD et de sa pauvre boîte en plastique, au contraire du vinyle dont on avait annoncé à tort la disparition totale il y a vingt-cinq ans. Il en résulte que le simple « contenu » des ouvrages, hors toute matérialité, a su garder une forte part de sa valeur symbolique et spirituelle, autant que pratique.
Mon fils de treize ans, né à la société avec l’ordinateur, le mobile et les jeux vidéo, lit dans le métro et dans son lit des livres de fantaisie en poche, tout en se nourrissant de mangas comme d’une multitude de lectures éparses sur écran… Le roman, de fait, se marie moins facilement à la lecture numérique et hypertexte que l’essai. Les lecteurs sont-ils aussi aveugles que certains éditeurs pour ne pas s’en rendre compte ?
L’auteur Dan Brown me semble en définitive plus dangereux pour l’édition que Google. Or justement, l’angoisse des gros éditeurs comme Hachette, Le Seuil ou Flammarion est d’abord de perdre leur rentabilité sur ce type de « produits ». Leur terreur, c’est la librairie d’Amazon, qui vient de mettre en vente la version numérique du dernier Dan Brown à 9,99 dollars (7 euros), contre 17 dollars (12 euros) pour sa version papier. Comme si le public des deux supports était le même. Comme si la qualité de lecture était équivalente, dans le métro par exemple. Ou comme s’il n’était pas envisageable d’apporter des trésors de valeur ajoutée à la version numérique d’un livre, pour justifier d’un prix…
De l’amateur et du fair use
Demain ou après-demain, nous n’échapperons pas à l’adaptation des règles du droit d’auteur à notre nouvel environnement numérique[8]. Un peu à la façon des « Creative Commons », ces règles devront clairement prendre en compte mais surtout aller bien au-delà de la simple intention du « partageur » ou du « relais », dont en particulier sa motivation commerciale ou non. A l’idéal, fidèles en cela à au bon et au mauvais esprit du Net, elles fixeront le minimum de contraintes en amont de l’acte, afin de laisser libre cours aux pratiques et multiples contrats dits ou surtout non-dits entre internautes, mais aussi entre internautes et entreprises, qu’elles se nomment Google, Le Seuil, La Fnac, Flammarion, Inculte, Amsterdam, Amazon, etc. Il y a là, dans la définition d’un droit d’auteur plus souple, mieux adapté aux usages auxquels il pourrait répondre non plus a priori mais a posteriori, un enjeu majeur pour les biens non rivaux, qui sont parfois aussi des « biens communs ». Un enjeu, également, quant à la façon dont chacun pourra ou non bénéficier demain de ces biens-là, impossible à réduire à la volonté de quelque entreprise, et ce quelle que soit la nature du bénéfice attendu…
À l’inverse de ces enjeux de réinvention du droit d’auteur et de son application à un réel transformé par l’immatériel, le procès de Google et son jugement grossier révèlent deux des écueils que le secteur du disque n’a su éviter et que celui du livre a (encore) la possibilité de contourner : d’une part la transformation d’un bien culturel en pur produit de divertissement, ce qui ne peut que nuire à sa forte valeur symbolique ; d’autre part le refus de la philosophie du prêt gratuit, donc du partage et des échanges de connaissance qui sont un lien majeur, et à cultiver, entre la culture du livre et celle du Net.
Sous ce double regard, la nécessité d’adapter au plus vite le principe du fair use américain au droit européen prend tout son sens. Le fair use a cette immense vertu de laisser libres les usages a priori, mais de laisser tout loisir d’un jugement a posteriori de ces pratiques[9]. C’est un outil puissant, entre les mains de l’amateur, pour transmettre ses passions et ses savoirs hors toutes contraintes monétaires. Il permet un dialogue entre le droit de posséder et le méta-droit de partager, de donner. Le fair use permet à ceux qui le désirent d’affirmer et de défendre la supériorité de l’accès de tous aux multiples œuvres de culture, notamment « orphelines », face aux nécessités du commerce ou du e-commerce. Et ce d’autant que l’industrie du livre, quels que soient ses supports, gagnera à renforcer tout ce qui conforte la valeur pratique autant que spirituelle des productions de l’esprit, non assimilables à des chaussettes ou des yaourts de supermarché. N’en déplaise aux quelques mammouths de l’édition atteints du syndrome Hadopi, c’est là que se situe l’enjeu majeur des rapports du livre à Internet et au jeune public, loin d’être insensible à la cause de la lecture.