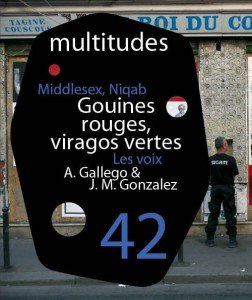La question du commun est au cœur de la discussion sur la démocratie aujourd’hui. Dans des textes récents, Negri pose la question du commun comme une nouvelle manière de penser la production capitaliste. « La production est devenue “commune” – dit-il. Créer de la valeur aujourd’hui c’est mettre en réseaux des subjectivités et capter, détourner, s’approprier ce qu’elles font de ce commun qu’elles inaugurent »[1].
Au cœur du projet révolutionnaire contemporain serait cette reprise du commun comme processus constituant. Cette entreprise nécessite des catégories et des institutions nouvelles, des formes de gestion et de gouvernance, des espaces et des « travailleurs du commun », toute une infrastructure matérielle et immatérielle. La constitution de cette infrastructure pour la reprise du commun, tout comme la production du « commun », est relationnelle : c’est une création de connections et de liens, une mise en réseau de concepts, d’outils, de subjectivités, etc… Cette mise en réseau devrait être elle-même « commune » : accessible, équitable, soutenable etc… La reprise du commun nécessite ainsi de l’espace, du temps à partager, des actions, des objets, des désirs[2].
J’en prendrai comme exemple une instance de notre expérience avec l’atelier d’architecture autogérée (aaa)[3]. Nous avons développé une pratique collective qui encourage les habitants à participer à la réappropriation et l’usage autogéré de l’espace dans la ville. Pour nous, en tant qu’architectes, la reprise du commun passe par une réappropriation tactique et un investissement collectif des espaces immédiatement accessibles afin d’inventer de nouvelles formes de propriété et de vivre ensemble, plus éthiques et plus écologiques. Nous avons identifié un type particulier d’espace – les interstices urbains – comme un possible territoire du commun et comme une nouvelle forme spécifiquement métropolitaine de ce qu’on appelle en anglais des «commons»[4]. Il y a du commun à reconquérir et à réinventer par des fragments, par des petits espaces délaissés ou non utilisés qui, par leur nature temporaire et incertaine, ont résisté jusqu’à là à la spéculation foncière. Pour aaa, ces nouvelles formes de commun spatial réinventent le commun social et urbain mais aussi le commun écologique.
À travers nos projets, nous initions des processus (spatiaux, sociaux, culturels) qui conduisent à d’autres processus (politiques, affectifs, etc.) générés cette fois-ci par les collectifs qui se forment dans ces espaces. Nos projets proposent une compréhension plus large de l’architecture, au-delà de bâtiments et de l’espace physique, affirmant des multiples formes de faire l’architecture, basées sur des relations et des nouvelles formes de collaboration qui valorisent la participation active des usagers.
Nous avons initié des espaces autogérés (comportant des jardins, etc), ou celles et ceux qui y participent peuvent voir, tester, leur mise en relation avec les autres, les effets de leurs actions, l’usage plutôt que la possession, des manières de partager, la responsabilité vis-à-vis de ce qui est à partager, etc… Ce sont, comme dirait Guattari, « des foyers locaux de subjectivation collective ».
Pour la plupart, des femmes
Nous avons eu plusieurs fois l’occasion d’écrire sur cette pratique[5], et nous le mentionnons encore une fois dans ce contexte pour parler du travail de certaines participantes dans nos projets, pour la plupart, des femmes, un travail que je n’identifierai pas en première instance comme féministe mais plutôt comme travail relationnel… Ces participantes actives, impliquées, ces agentes « pour la plupart des femmes » sont essentielles dans nos projets à la constitution du sujet collectif de ce processus de réinvention du commun. Ces observations, fondées sur l’évidence concrète de l’expérience, sur des données et des faits, soutiennent l’hypothèse avancée ici : que la réinvention du commun est un travail relationnel et différencié dans lequel la subjectivité féminine a un rôle actif à jouer ; que ce travail de reconquête, de réappropriation et de reconstruction a besoin à la fois d’espaces spécifiques où il puisse s’agencer, d’espaces actifs, mais aussi de personnes actives, d’agents, de sujets porteurs de cette réinvention.
Les agents de cette réinvention du commun qui, dans nos projets, sont pour la plupart des femmes, forment un sujet collectif elliptique, indéterminé et instable, qui n’appartient pas à un seul genre mais qui se trouve pourtant marquée par la différence sexuelle. Ce sujet peut avoir besoin d’une sorte d’« essentialisme réaliste »[6] pour être pensé, d’un essentialisme qui ne s’oppose pas à un certain constructivisme et à l’idée de « devenir » et de « performativité ».
Pour penser cette subjectivité collective qui réinvente le commun, il faut mobiliser aussi des savoirs féministes – comme par exemple le travail de Luce Irigaray sur l’être-en-relation (de la femme) et sur la différence sexuelle comme articulation fondamentale de notre relation à la nature et à la culture[7]. Pour lier ces positions féministes et la discussion contemporaine sur le relationnel, je vais prendre comme exemple un certain type d’agencement où cette relation nature-culture est doublée par une production de subjectivité et par des processus de devenir individuel et collectif. La production du commun est un processus qui en même temps qu’une infrastructure commune produit une nouvelle subjectivité collective qui est une production locale, relationnelle et différentielle.
Le « relationnel »
La notion de « relationnel » a pris essor dans les discussions de la fin des années 90, notamment dans l’art contemporain, à partir du livre de Nicolas Bourriaud sur l’« esthétique relationnelle ». Bourriaud se réfère dans ce livre à la manière d’évaluer certaines œuvres d’art contemporain à partir des relations sociales que ces œuvres représentent ou suscitent. Il se focalise surtout sur la socialisation du public par ces œuvres, sans qu’il soit intéressé à la nature spatio-temporelle des relations créées et à la manière dont ces relations puissent évoluer, affecter et être affectées par l’espace. Il n’est pas intéressé non plus par les aspects éthiques et politiques de cette relationalité ou par comment une « œuvre relationnelle » peut transformer le contexte socio-spatial dans lequel elle se trouve.
Nous aussi, nous qualifions nos projets de « relationnels » parce qu’ils créent de la connectivité, ils stimulent le désir et le plaisir, mais ils permettent aussi une prise de conscience politique et de responsabilité civique à l’échelle de proximité, donnant la possibilité à des collectifs d’habitants de s’approprier de l’espace dans la ville à travers des activités quotidiennes (ie. jardinage, cuisine, jeux, bricolage, etc).
Plus que des structures et des formes, nos dispositifs architecturaux génèrent des assemblages spatiaux, ou plutôt des agencements, dans le sens de Deleuze et Guattari. Les agencements sont caractérisés par les connections actives entre les éléments compris comme singularités. Ils constituent des puzzles de « processus » et de « relations » plutôt que des structures raisonnées et systématisées par des théories et des sciences.
L’« agencement jardinier »
Dans nos projets, nous avons initié un type d’agencement spécifique, un agencement jardinier. Nous avons construit avec des habitants des projets culturels, sociaux et écologiques qui incluent entre autres, des jardins partagés comme outils d’agencement démocratique de l’espace : un agencement par voisinage, favorable aux échanges, mobile et cyclique, ancré dans le quotidien[8]. L’attribut de « jardinier » de cet agencement est à la fois métaphorique et métonymique, plaçant tous les processus et les relations agencées dans un rapport direct à la nature et à la culture. Cet agencement s’approche des dynamiques écologiques tout en étant adapté aux petites échelles, aux usages et aux pratiques quotidiennes. Nos expériences nous ont montré que le mode d’action par « agencement jardinier » peut produire, dans le temps, un espace constituant pour des modes de fonctionnement collectifs et pour un agir politique local.
Comme nous l’avons mentionné déjà, les agents les plus actifs de ce type d’agencement dans nos projets ont été pour la plupart des femmes… Non pas seulement parce qu’elles étaient porteuses de dynamiques de jardinage, qu’elles étaient des jardinières proprement dites, mais aussi parce qu’elles investissaient et maintenaient avec soin, parce qu’elles « jardinaient » l’infrastructure du projet commun, qu’elles labouraient l’espace et le temps partagé du projet.
Ce n’est pas parce qu’elles ont plus de temps que les autres, du temps pour des activités bénévoles, non rémunérées, mineures, mais surtout parce qu’elles voient une importance et une portée politique et éthique à ces activités, une portée écologique, ou même écosophique, dans le sens de Guattari. Le projet partagé ouvre un espace où la subjectivité féminine trouve son territoire d’invention : un projet duquel l’on prend soin, l’on s’y engage, l’on perçoit les résultats de ses engagements avec les autres. L’on apprend la patience, le silence, l’attention. Les femmes (pour la plupart) ont, comme Irigaray le remarque dans ses travaux récents, une disponibilité et une motivation complexe à la fois ontologique et écologique pour développer des relations « durables » à plusieurs niveaux : à elles-mêmes et entre elles-mêmes, entre elles et les autres, entres elles, les autres et l’environnement construit et naturel à des échelles locales et globales, entre la nature et la culture en général, entre des espaces et des modes d’habitation.
« Être-en-relation »
Irigaray a commencé à parler à partir des années 70 de la subjectivité féminine et de sa capacité d’être-en-relation. Cette pensée de la subjectivité féminine a pris de nouvelles tournures dans les années 90 avec le travail de Rosi Braidotti sur la subjectivité « nomade » et de Judith Buttler sur la subjectivité « performative ». Malgré les grandes différences de positionnement, toutes les trois ont saisi une capacité particulière du sujet femme de se rendre « disponible », de s’affecter à et de se laisser affecter par plusieurs types de dispositions à la fois (ie. sociales, culturelles, politiques, sexuelles, affectives, etc…), de créer des relations et d’être transformée par ces relations.
Dans nos projets, la plupart des femmes sont venues d’abord pour jardiner et après quelques années d’investissement, ont commencé à prendre des responsabilités dans le groupe, en devenant parfois des militantes citoyennes et arrivant aux ‘bords du politique’, comme dirait Ranciere. Leur propre construction personnelle a participé à la fois de la construction du groupe et du processus constituant du projet. Ces trajectoires individuelles se rassemblant, elles ont induit des re-territorialisations douces de tout le projet, constituant des lignes de fuite vers certains types d’activités et d’usages qui sont devenus collectifs, vers des moments d’énonciation collective du projet.
La plupart des femmes faisaient partie de différents micro-réseaux (d’amitié, de temps partage, d’auto-construction, de production et de dissémination, etc), et leur participation a évolué dans le temps. Elles sont devenues des agents de différents agencements, des « nœux nœuds » dans le réseau ramifié du projet. Par cette appartenance multiple et évolutive, elles ont créé des différentiations, des shifts relationnels, influençant de manière décisive le devenir du projet collectif.
Rancière remarquait que le collectif permet l’apparition d’un sujet qui se pense par rapport aux autres, « la formation d’un un qui n’est pas un soi mais la relation d’un soi à un autre ».[9] Et, pour suivre Irigaray, je dirais même qu’avant que le collectif existe, il y aurait des sujets qui se situeraient déjà dans une position d’ouverture vers les autres, dans un rapport à l’autre qui n’est pas encore là, des « êtres-en-relation » qui initieraient en première instance un agencement collectif. La jardinière a ce savoir quand elle se trouve devant le champ pas encore labouré, le jardin pas encore planté. Elle sait ouvrir un espace de partage, un « troisième espace » comme dirait Irigaray, un espace dans lequel l’autre (personne, plante ou animal) peut venir avec son espace à lui, son espace à elle. La jardinière sait se laisser transformer par cette relation, sait labourer à la fois son espace de devenir personnel, son espace à elle, ainsi que l’espace qu’elle partage avec l’autre et les autres, « le troisième espace», sillonnée par des relations et des réseaux.
C’est une forme spécifique de relationalité qui de-territorialise et re-territorialise à la fois. La plupart des femmes ont participé à l’invention des nouvelles activités et processus dans nos projets, des espaces et des dispositifs actifs, des nouveaux objets du commun (ie. des modules mobiles : bibliothèque, cuisine, un laboratoire urbain participatif, des débats, des brocantes et d’autres formes d’économie alternative à ECObox ou des dispositifs écologiques : toilettes sèches, collecteur d’eau de pluie, toiture verte, etc. au 56 rue Saint Blaise.)
« Faire rhizome »
Notre rôle a été de mettre en valeur, parfois d’initier, puis de soutenir, d’étayer ces réseaux émergeant autour des actions, des dispositifs spatiaux, des processus et des affects permettent à la fois des devenirs personnels et des devenirs collectifs afin de saisir cette entité socio spatiale en formation, qui bouge continuellement, qui forme de nouveaux réseaux. « Dans le processus, notre rôle d’initiateurs et d’agents devait diminuer progressivement jusqu’à la disparition pendant que la capacité du réseau de se développer et de se reproduire s’accroissait. D’autres devaient prendre le rôle des jardiniers du réseau. »
Ces réseaux d’actions et d’affects qui sont des mécanismes de construction spatiale démocratique, sont nécessairement rhizomatiques, jouant sur la proximité, le temporel et la multiplicité.
Ecobox, par exemple, a été déménagé et réinstallé plusieurs fois par des usager(e)s, et le système d’organisation et d’occupation a été reproduit par d’autres initiatives indépendantes (citoyennes ou professionnelles) dans le quartier et ailleurs. Nous appelons cela une transmission rhizomatique – où le prototype à la capacité de transmettre toute l’information nécessaire à sa reproduction et où le produit de cette transmission, la reproduction du prototype devient elle-même une nouvelle source de transmission de cette information indépendamment ou en relation choisie avec le prototype initial. Malgré l’existence temporaire des projets sur différents emplacements, l’accumulation de savoir par expérience se transmet et se reproduit dans de nouveaux projets qui, tout en étant nouveaux et singuliers, prennent aussi le relais et la continuation d’un même modèle, d’un même protocole et processus.
« Faire rhizome » est une manière de construire l’infrastructure du commun. Là encore une fois, ce sont des femmes pour la plupart qui se sont impliquées à lancer et entretenir les lignes actives, les tiges du rhizome.
Anne Querrien remarquait, dans un article sur les cartographies schizoanalytiques de Guattari, que « le rhizome » – notion centrale à la pensée de Deleuze et Guattari – est « une notion qui ajoute à celle de réseau, outre celles d’horizontalité et de construction de proche en proche, une dimension souterraine, et de réémergence qui peut faire illusion, faire croire à la tige unique, alors qu’il s’agit de tout un ensemble ». Faire rhizome, – dit Anne – c’est aller vers l’autre, non pas en ennemi ou en concurrent dans une perspective de destruction, mais dans une perspective d’alliance et de construction d’une micro-territorialité temporaire à bientôt partager avec d’autres, par de nouvelles ramifications du rhizome[10].
Dans les processus de nos projets, le rôle de jardinier du rhizome passe horizontalement de l’un(e) à l’autre, des architectes aux usager(e)s et des usagères aux autres usagers.
Convivialité et résilience
Ainsi, dans ce faire rhizome de nos projets, nous avons collaboré avec ceux et celles qui savaient et voulaient faire du travail d’alliance invisible et souterraine, de la propagation « de proche en proche », qui savaient prendre en compte le temps et la cyclicité, qui avaient la patience d’attendre que ça pousse et ça se développe, qui avaient à la fois le savoir de transmission et d’apprentissage.
Ivan Ilitch, parle de « convivialité » comme d’une alternative à la productivité capitaliste : « la convivialité s’oppose à la productivité (…) la productivité se conjugue en termes d’“avoir”, la convivialité en termes d’“être”»[11].
Une pratique relationnelle et coopérative, comme celle que nous avons développée, a une temporalité différente et un but différent de ceux d’une pratique libérale : plutôt que de chercher une valeur matérielle de profit, elle crée les conditions pour une expérience émancipatoire qui change à la fois l’espace et les sujets.
Dans son analyse du ‘social’ à travers sa théorie des réseaux d’acteurs (Actor Network Theory – ANT), Latour mentionne les éléments actifs qui appartiennent à des réseaux d’acteurs humains et non-humains, qui assument le rôle de « médiateurs » : ils transportent, traduisent et transforment le contenu et la nature des liens dans le réseau[12]. De même que les « jardinières (personnes) », nos dispositifs socio-spatiaux et écologiques ont joué le rôle de « médiateurs », de « jardiniers (objets) » dans le « faire rhyzome » du projet. Par exemple, le dispositif de la cuisine urbaine, qui était un objet transportable qui pouvait déployer un espace fonctionnel de cuisine dans des endroits choisis, a amené dans le projet les usagers les plus divers, leurs savoirs et leurs motivations et a connecté le jardin avec d’autres lieux du quartier et avec d’autre lieux imaginaires suggérés par les recettes et les ingrédients de la cuisine. Certains usagers, pour la plupart des femmes, ont inventé, elles aussi, des « médiateurs » : une bibliothèque, des brocantes, des marchés artisanaux etc… Ces médiateurs ont influencé et différencié la nature du projet. On a passé ainsi d’une dominante jardinage et d’activité de temps libre vers une production et une diffusion culturelle, politique et poétique. Ces usagères agentes ont proposé de nouvelles formes économiques, qui valorisent l’échange personnel, la réciprocité et le don ( ie des « zones de gratuité », des brocantes et échangés de savoirs « féminines » à Ecobox ou des pique-niques, des thés collectifs et des projections au 56 etc…).
Latour mentionne aussi les « plug-ins » comme outils pour créer et révéler des agencements. Il utilise l’analogie avec ces logiciels qui, une fois installés dans le système, rendent actif ce qu’on ne pouvait voir avant. Les plug-ins rendent visible ce qui était là seulement de façon virtuelle. Ils peuvent aussi déterminer quelqu’un de faire quelque chose[13]. Ensemble avec d’autres dispositifs tactiques, nous avons initié une cartographie des processus relationnels du projet qui a été comme un plug-in dans le projet ; une activité qui s’est rajoutée au projet afin de nous aider à faire visible et discuter avec les autres les faits et les choses qui seraient autrement restés invisibles et non-articulés (ie. les rôles évolutifs d ‘une personne où d’un dispositif, les changements dans les motivations de certains usagers, les transformations dans les usages, etc…). En apprenant l’importance de ces choses, nous avons commencé à travailler avec elles et à les considérer comme des éléments actifs du projet. C’est cette même cartographie qui a révélé le rôle structurel et agençant de la plupart des femmes dans le projet… Cette cartographie nous a fait comprendre la totalité des relations comme une écologie sociale et politique du projet.
Les réseaux d’acteurs et d’activités générés dans nos projets forment aussi des cycles écologiques dans le sens de Guattari[14] : sociaux, environnementaux, mentaux. Ces activités (de jardinage, d’auto construction, de recyclage, etc.) se développent à partir de cycles quotidiens qui relient dans le temps des personnes, des enjeux et des espaces à travers des intérêts partagés et des relations d’amitié. L’espace est lié ainsi à ses réseaux d’usagers par des cycles quotidiens, qui le transforme pour le rendre plus dynamique et plus réactif à des changements. Ces réseaux sont en effet des formes de résilience dans le projet.
Ces agentes conviviales, des femmes pour la plupart, offrent une incarnation provisoire et modeste de ces nouvelles figures fantasmatiques proposées par ce dossier de Multitudes pour annoncer un activisme féministe d’aujourd’hui. Ce sont des porteuses d’une révolution douce et résiliente, ce sont « celles qui font rhizome » et (re)conquièrent les territoires de la ville par des alliances et non pas par des guerres, en les transformant en des nouvelles formes de commun, en des espaces et des temporalités partagés. Ce sont celles qui initient parfois et maintiennent sans aucune revendication et besoin de reconnaissance le travail infrastructurel et écologique du commun.