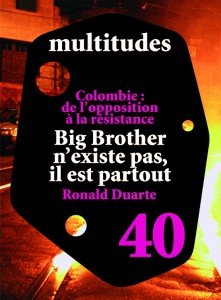Trois graffitis à Bogotá
Le graffiti peut être défini comme une voie pour l’expression artistique, un moyen d’affirmation identitaire des groupes sociaux ou des individus, une solution pour la promotion publicitaire de certains produits culturels, ainsi qu’un support pour faire passer des messages politiques qui seraient aussitôt censurés dans les médias traditionnels à cause de leur contenu contestataire. Les trois premiers usages font partie d’une catégorie plus large, celle de l’art urbain ou street art, alors que le dernier constitue une catégorie à part entière, celle du graffiti politique comme voie privilégiée de l’opinion divergente.
Dans cet article, nous analysons les messages véhiculés par trois graffitis-pochoirs appartenant à un ensemble plus vaste collecté en 2006 à Bogota[1]. La technique utilisée, le pochoir, relève d’une conception préalable et formatée du graffiti, permettant une optimisation du temps de production et de la densité du message.
Au travers d’une logique de détournement de sources iconiques premières, les trois images analysées renvoient à des problématiques très complexes de l’histoire contemporaine colombienne, telles que l’installation du diktat financier sur la sphère sociale, la censure manifeste de la parole politique contestataire, la vulnérabilité des droits de l’homme et la réélection présidentielle.
Divino Baby
Le premier graffiti représente un enfant âgé de 6 à 8 ans, debout, les bras écartés et dirigés vers le haut, indiquant une posture ergonomique excentrée. Il est habillé d’une sorte de tunique ancienne qui contraste avec les oreilles rondes d’une souris, placées sur la tête, renvoyant aussitôt à Mickey Mouse.
Quant au message linguistique, le premier mot du syntagme[2] en bas est écrit en espagnol, alors que le deuxième est en anglais (divino baby). Au plan formel, ce message se caractérise par l’emprunt de la typographie de Walt Disney. Quant au mot à droite, il s’agit d’un palindrome écrit verticalement qui permet de lire le mot zokos. Nous le considérerons par la suite comme la signature des auteurs du pochoir.
Cependant, cette image n’est pas une image première, mais la reprise détournée d’une des images les plus importantes du folklore catholique colombien, le Divin Enfant Jésus. Elle a fait l’objet de plusieurs modifications graphiques participant à la construction d’une certaine désacralisation, dans un sens de malaise. Parmi les changements opérés, il se trouve que le Divino Baby n’a pas de socle, contrairement au Divin Enfant qui est debout sur un petit nuage. De même, l’éclairage autour de l’image modèle n’est pas représenté dans la copie. Enfin, la modification la plus puissante efface une fois pour toutes la connotation de « sacré » : le remplacement de l’auréole par les oreilles de Mickey Mouse.
Étant donné que la gestuelle de l’enfant renvoie aux référents spatiaux nord/sud (plus largement aux pays du nord versus les pays du sud), nous constatons le glissement du destinataire du geste : alors que le Divino Niño adresse le geste à Dieu (pouvoir religieux), le Divino Baby adresse le geste à un pouvoir politico-économique, décodé par la présence des oreilles de Mickey comme métaphore des États-Unis. En outre, la gestuelle et le regard adressé vers le haut de l’enfant du graffiti semblent exprimer une sorte de fascination soumise vis-à-vis de celui qui est supérieur et détient le pouvoir.
La combinaison de l’espagnol et de l’anglais permet de formuler une hypothèse d’ordre identitaire, puisqu’on a gardé le mot espagnol divino, alors que le mot baby a remplacé niño. Or le mot niño entraîne un trait alphabétique typique de l’espagnol, le ñ. S’esquisse ainsi une tension latente entre la colombianité et une identité étrangère, étant donné que l’enfant symbolise la Colombie, un pays qui se trouve dans une position d’hétéronomie et de dépendance.
Ce graffiti fournit des informations sur les émetteurs du message, à partir d’une signature qui n’est pas facile à définir comme telle. Comment pouvons-nous interpréter le mot « zokos » ? Deux explications sont possibles: d’une part, un décryptage formel nous permet de remplacer le K pour un R, donnant lieu au mot « zorros » (renards). On reconstruit ainsi une source en absence, le « Zorro », un héros masqué de l’imagerie populaire américaine qui rend la justice de sa propre main. D’autre part, dans l’espagnol argotique colombien on trouve l’expression «al soco» qui désigne «très vite, très rapidement», faisant sans doute référence à la façon dont les pochoirs sont faits.
Par ailleurs, c’est grâce à l’itération de ce trait dans certains graffitis du corpus étendu que nous reconnaissons dans le palindrome zokos la marque d’une attribution. Elle nous a permis de suivre la trace de ces « pochoiristes », notamment sur Internet, à partir des différentes signatures trouvées sur les graffitis. C’est ainsi que nous découvrons plusieurs groupes d’art urbain à Bogotá : Zocos, Excusa2 Printsystem, Toxicomano Callejero, Bazuco Media Corporation et Chirrete. Parmi les noms cités, il y a aussi bien des graffiteurs indépendants que des collectifs d’art urbain, dont la plupart ont suivi des formations en design graphique, publicité ou communication sociale. En plus de la signature, chaque artiste se caractérise par des traits, couleurs, techniques et sujets qui définissent le style global de son œuvre. Notons néanmoins que la plupart des images restent anonymes, contribuant encore plus au caractère clandestin de cette expression politique alternative.
En outre, lors de la collecte du corpus en 2006, nous avons rencontré un jeune homme, étudiant de communication dans une université privée, qui avait participé à plusieurs « sessions d’intervention » (réalisation des pochoirs), sans pour autant faire partie d’un de ces collectifs. Les interventions se font généralement la nuit, nous a-t-il indiqué, où les graffiteurs sont moins exposés au risque d’être surpris par la police, les groupes de vigilance privée ou même par des citoyens considérant cette expression comme un acte de vandalisme. Le caractère clandestin de cette pratique permet à ses auteurs de créer des messages qui ne pourraient pas passer par des voies institutionnelles. En général, beaucoup des graffiteurs qui se rassemblent dans des collectifs d’art urbain font également du graffiti politique.
L’effet Oxy
Le deuxième visuel est celui qui contient le plus d’éléments graphiques, dispersées dans un ensemble présenté comme une scène. À gauche, une tour qui fait jaillir du pétrole ; en bas, quatre personnages placés tout au long de la marge inférieure. En haut à droite, trois éléments géométriques contenant le message textuel. Quant aux personnages, ils sont représentés avec des corps très abstraits et des têtes de mort, générant un effet de contraste. Ils semblent vouloir s’éloigner de la tour de pétrole, tout en faisant une grimace de crainte. Le message linguistique, pour sa part, permet de lire le syntagme Précaution : L’effet Oxy.
En effet, le derrich de pétrole se présente comme un pouvoir de destruction, un danger qui est à la source de la tentative de fuite et de la gestuelle de crainte des personnages. Les têtes de mort annoncent une sorte de mort indépassable, situant le pétrole comme la cause directe de cet anéantissement. Remarquons que les deux personnages les plus proches de la tour dirigent leurs regards vers le public, vers ceux qui regardent la scène globale, marquant ainsi une fonction phatique qui met les spectateurs dans une position de témoin.
Ce graffiti constitue une parodie de « L’effet Axe », campagne publicitaire qui promeut des produits cosmétiques masculins. Un autre des recours iconiques que nous pouvons identifier est le logo de la multinationale des pétroles Oxy. La reproduction du logo n’a pas subi de distorsion graphique quelconque, évoquant une sorte d’accusation, une imputation directe qui pointe le responsable du danger. De cette façon, se dévoile la relation entre l’avertissement de la première ligne et le syntagme au milieu : l’effet Oxy c’est la destruction de la vie, annoncée par les têtes de mort des personnages qui essaient de s’enfuir.
Enfin, ce graffiti pointe la problématique de la propriété des matières premières en Colombie puisque, malgré la richesse en pétrole de ce pays, il ne lui appartient pas, comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des pays producteurs de pétrole. Nous étayons ainsi une dépossession doublement fondée : elle est passive car les citoyens se sont habitués à ne pas posséder ce qui leur est propre; mais elle est également active car l’installation de ce type de sociétés a supposé des processus d’expropriation des terres par des voies légales et illégales. Le pétrole se révèle ainsi comme une source de mort et de destruction.
Or nous savons que certaines multinationales pétrolières opérant en Colombie ont été et sont actuellement inculpées pour leurs liens avec des groupes paramilitaires et pour leur violation les droits de l’homme. Elles s’associent avec des groupes d’extrême-droite, des véritables armées privées de la terreur, pour avoir accès à la terre qui appartient à des populations campagnardes et autochtones. Elles se voient obligées à quitter leurs territoires suite à l’intimidation militaire exercée par ces groupes, qui assurent par ailleurs l’installation du personnel et la protection des activités économiques de ces multinationales. Malheureusement, la plupart des procès judiciaires ne sont pas menés à terme.
Si la Colombie est passion….
Le dernier visuel met en scène la représentation abstraite d’un cœur humain, à la source des deux gouttes qui s’en échappent, ainsi que de deux lignes en guise de flamme, qui le coiffent. Le message, écrit en espagnol, permet de lire une phrase à construction conditionnelle qui s’enchaîne tout au long des quatre lignes : Si la Colombie est passion… Non à la réélection !
Cette image n’est pas non plus une image première, mais l’emprunt du logo de la marque « Colombia es pasión », définie comme une « marque-pays » qui vise à véhiculer une image attractive de la Colombie à l’étranger. Nous constatons ainsi jusqu’à quel point la logique de marque a réussi à aller bien au-delà de la sphère marchande, rejoignant des territoires de discursivité sociale tels que la construction de(s) l’identité(s) nationale(s)[3]. Le but d’une « marque-pays » est de mettre en valeur les avantages concurrentiels d’un pays, à partir d’un discours publicitaire et marketing axé sur le symbolique et l’émotionnel. Colombia es pasion vise en effet à déconstruire l’image de violence, trafic de drogues et corruption globalement répandue, au travers de l’installation d’une autre série de stéréotypes identitaires[4] censés représenter la véritable « essence colombienne ». Parmi les avantages concurrentiels citées par cette marque, nous trouvons la position géographique stratégique de la Colombie (le fleuve à plus haut débit du monde, l’accès aux deux océans atlantique et pacifique), une stabilité juridique indéniable (quant aux entreprises), l’exemption quasi totale d’impôts et une « armée » de main d’œuvre bon marché ; tout cela afin d’attirer des investissements et des touristes étrangers. La promesse d’accès préférentiel à un « marché en croissance » ferait de la Colombie une sorte de « pays de Cocagne » pour les entreprises multinationales.
Il est nécessaire de revenir à l’image pour expliquer l’autre thématique évoquée, celle de la réélection présidentielle. Le logo de la marque-pays correspond à l’abstraction graphique d’une autre source en absence, le Sacré Cœur de Jésus. Notre graffiti récupère le trait du sang qui coule dans le Sacré Cœur, évoquant ainsi un effet dysphorique, lié à la violence et à la mort.
Une petite analyse étymologique nous permet de comprendre que le mot passion renvoie aussi bien à un contenu dysphorique qu’un contenu euphorique (pathos désigne d’une part, la souffrance et le supplice ; d’autre part, la ténacité et la fermeté). Or si nous remplaçons le mot passion par les mots cités précédemment, nous obtenons des messages tels que « La Colombie est souffrance », une souffrance générée par la réélection. Alors, si la Colombie est vraiment passion (dans le sens positif du mot), elle devrait s’empêcher de réélire un président à la tête d’un gouvernement despotique et répressif.
Rappelons que ce graffiti date de 2006, quelques mois avant les élections présidentielles qui ont lieu tous les quatre ans. Son message s’adressait aux votants potentiels afin de les dissuader de réélire le président en cours, Alvaro Uribe. On sait qu’il a été réélu et qu’il est, pour l’heure, le candidat avec les plus grandes chances pour les élections de 2010.
Les graffitis
politiques : une pédagogie de la réflexion
Pour esquisser les conclusions de cette analyse, nous faisons appel à une définition trouvée dans un des pochoirs du corpus étendu selon laquelle ce dispositif d’expression serait un « système graphique populaire explicite ». « Populaire » dans la mesure où il participe à la démocratisation de la liberté d’expression, dans un contexte où elle n’est assurée que pour certains ; « explicite » du fait qu’il échappe à toute sorte de contrôle ou de censure institutionnelle.
En effet, ces images véhiculent une position explicite de gauche en adressant une critique anxiogène aux pouvoirs étatique, économique et religieux ; en même temps qu’ils encouragent le positionnement des spectateurs vis-à-vis de ces pouvoirs. Les thématiques abordées sont néanmoins présentées avec un ton caricatural mêlé d’un contenu tragique, générant des effets d’ironie et de dérision.
Les buts revendicatifs et le caractère militant du graffiti politique font de lui une voie de lutte privilégiée contre le projet d’homogénéisation identitaire caractéristique des gouvernements de droite. Ce projet, implicite mais certes efficace, condamne à partir de l’invisibilité ou de la répression toute manifestation d’altérité, qu’elle soit politique, sociale ou culturelle. Dans cette perspective, les messages émis par ces graffitis n’affirment ni ne proposent une « identité proprement colombienne », mais plutôt le rejet de cette tentative d’uniformisation des corps et des esprits, des modes d’être et d’habiter l’espace, d’opinions, de projets de vie et d’attentes vis-à-vis du pouvoir institué.
Les émetteurs de ces messages apportent ainsi un point de vue divergent sur des sujets décisifs pour le pays, au travers d’un regard que l’on ne trouve pas dans les médias institutionnels. Ils encouragent de cette façon une prise de position et, par là, au dépassement d’une prétendue neutralité, qui n’est plus que la manifestation de la peur et de la répression déjà intériorisée. Ces graffitis sont également en mesure de générer des tensions et des remises en question des informations données par les médias, entourées d’une auréole de véracité quasi-religieuse.
Étant donné qu’un tel type de résistance imagée se construit face à sa contrepartie, cette expression politique témoigne du rapport instituant/institué[5]. L’institué est compris comme ce qui a pris forme d’institution, étant légitimé au plan social pour dicter les normes, les valeurs, les comportements, les modes de sociabilité, bref, la vision du monde caractérisant une société. En revanche, l’instituant est ce qui rentre dans un rapport de force vis-à-vis de l’institué, susceptible de le transformer. Les graffitis seraient ainsi une forme d’expression symbolique des pouvoirs instituants, caractérisée par une certaine dimension de « pédagogie politique ». En effet, la force de ces messages se situe dans le fait qu’ils comportent une invitation à la réflexion critique sur les sujets qu’ils énoncent, tout en les dénonçant. Ces visuels incitent donc à la réflexion comme voie indépassable de l’affranchissement, de l’autonomie et de l’émancipation.
Sur le même sujet
- André Gorz, la richesse du possible
- Le tumulte plébéien Ou la part du dés-ordre en politique
- Liliana Porter + Ana Tiscornia. Coup de foudre
- Près de trois ans après l’invasion, la parole aux femmes ukrainiennes de Trieste
- Quand Donna Haraway rencontre Lynn Margulis
Héritages symbiotiques et métamorphoses sympoïétiques