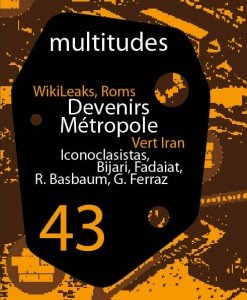Plus de trente ans nous séparaient de la Révolution iranienne de 1979. Nous, Iraniens, n’osions plus, et cela déjà depuis longtemps, évoquer même ce moment sauf pour se lamenter de ses conséquences. Une erreur historique, disait-on. À quelques esprits intrépides près, pour l’intelligentsia de l’intérieur, il ne restait aucun doute que, si la Révolution de 1979 devait représenter quelque chose, c’était l’ascendance d’un mouvement rétrograde, et pour l’intelligentsia d’ici, en Occident, c’était le déclenchement de la calamité de notre temps: le fondamentalisme islamique. Le nom de religion, et de quelle religion par ailleurs !, suffisait pour ôter à cette Révolution toute visée émancipatrice. Personne ne convenait que l’on puisse dissocier le moment révolutionnaire des ruines qui avaient commencé à s’entasser dès l’établissement de l’État islamique. Personne ne voulait croire Michel Foucault lorsqu’il disait si le chiisme s’est imposé en tant que force politique, c’est parce que, dans ce moment d’émancipation, il fut avant tout une « forme d’expression ».
En 1997, quand les réformistes vinrent au-devant de la scène afin de réintroduire les valeurs au nom desquelles ils avaient eux-mêmes participé à la construction de l’État islamique – valeurs comme Vertu, Liberté et Justice − pour ces intègres repentis aussi, guérir l’État post-révolutionnaire de ses vices ne voulait dire autre chose que domestiquer la Révolution, en finir avec l’esprit révolutionnaire : « qu’on oublie la révolution, vive la réforme » ! Au point que, après leur échec, dans leurs discussions sur l’avenir du pays, il y avait place pour toutes les hypothèses imaginables sauf celle de la possibilité d’un soulèvement des masses. Ainsi, la Révolution iranienne était doublement rejetée ; d’une part parce qu’elle était islamique et, de l’autre, parce qu’elle était une révolution.
Approchent alors l’élection présidentielle de 2009 et la séquence de la campagne électorale. Une vraie mobilisation politique. La rue, ce lieu tant problématique pour l’État, où l’on n’a surtout pas le droit de se réunir sans qu’il le désire, devient une scène politique permanente. Sur les grandes places des villes, les gens débattent jour et nuit. Une semaine avant le jour de l’élection, le 8 juin, les partisans de Moussavi forment une chaîne verte d’un bout à l’autre de la rue la plus longue de Téhéran. Le même jour, Ahmadinejad décide de rassembler ses partisans, pour la plupart des bassijis[1] dans l’immense mosquée de Téhéran. C’est un tel rassemblement des bassijis, presque dix ans plus tôt dans la même mosquée, et le discours qu’y a fait le Guide Khâmenei, qui a déclenché l’oppression massive des voix réformistes à l’époque de Khâtami. Cette fois-ci, Ahmadinejad renonce à y aller « pour cause d’embouteillages », lui si avide de l’acclamation et de la foule ! Après tant d’années, c’est la première fois que le peuple entrave derechef dans la rue le chemin du pouvoir. Le Mouvement Vert est déjà en route, avant même l’élection.
Premier ministre de la première décennie post Révolution pendant huit ans, lors de la guerre irano-irakienne et jusqu’à la mort de Khomeini, Moussavi avait disparu de la scène politique pendant vingt ans. En se présentant à la présidentielle, il ranima un fatras de souvenirs : les horreurs de la guerre en même temps que l’héroïsme des martyrs ; l’économie de rationnement mais aussi la justice économique ; la société de vertus et la détresse sociale ; surtout les massacres des dissidents et à la fois la révolte contre l’injustice. En un mot, le peintre révolutionnaire devenu homme de l’État islamique incarnait le souvenir de la Révolution avec tous ses paradoxes. Rien d’étonnant s’il avait choisi comme slogan le « retour aux valeurs de la Révolution ».
Alors là ont commencé les soupçons d’un nouveau pas en arrière, l’idée que la maladie « Ahmadinejad » allait prendre refuge dans l’histoire qui l’a produite. La chose devient plus flagrante quand, après le « coup d’État de l’État », et devant la cruauté des Gardiens de la Révolution, les mêmes versets récités du Coran qu’on entendait devant les Gardes du Chah il y a trente ans sont scandés spontanément, les mêmes formes religieuses sont choisies comme tactiques de lutte et les mêmes slogans – parfois mot pour mot – sont répétés et, singulièrement, la même symbolique. Les jeunes filles et jeunes garçons que les médias occidentaux ont d’emblée identifiés comme représentants d’une nouvelle bourgeoisie iranienne descendant dans la rue pour revendiquer une vie à l’occidentale, comment interpréter le fait qu’ils se réclament le jour dans les rues du troisième Imam chiite et crient le soir sur les toits − encore un emprunt à la Révolution − « Dieu est grand » ?
Cette apparente contradiction doit être prise tout à fait au sérieux si l’on veut comprendre quelque chose d’une singularité nommée « Iran ». D’abord, qu’on arrête de se faire des illusions : la société iranienne – hélas pour nous, marxistes, – continue d’être profondément religieuse. Il est vrai que les nouvelles générations d’Iraniens expérimentent de nouvelles formes de liberté. Aussi, la mutation d’une telle société vis-à-vis d’une religion officielle n’est pas à sous-estimer. Mais, des attitudes de moins en moins soucieuses de la jurisprudence islamique, déduire que la société iranienne divorce définitivement de la religion, c’est ignorer le mode particulier de la religiosité dans ce pays qui a opposé historiquement la foi du mystique au respect de la loi chère au juriste, ignorer que l’islam iranien est traversé par la problématisation constante du statut de la Shari’at et des formes figées de ses pratiques, c’est enfin ignorer que, du point de vue de l’islam orthodoxe, la « théorie du Souverain juriste » (velâyat-e faqih) qui constitue le fondement de cet État chiite ne relève pas moins de l’hérésie que, par exemple, le rejet du voile par les Iraniennes, sans doute aujourd’hui plus généralisé que jamais.
Ajoutons à cette fluidité l’esprit de révolte qui est au cœur de cet « islam tordu », on comprend moins mal le fait que l’Iranien se tourne vers le chiisme même quand il s’agit de lutter contre une domination chiite. Religion contre religion. Dès lors, il ne sera plus surprenant que, victime de tant de discriminations et de contraintes dues à l’idéologie religieuse, la fille iranienne se réclame de la même religion pour s’en émanciper. Nul n’est plus antihistorique que ceux, experts de la politique iranienne ou amateurs de son histoire contemporaine, qui pestent contre cette façon de réactualiser les énoncés d’un évènement dans des conditions différentes en prédisant que « cela nous mettra de nouveau sur le chemin des désastres issus de la Révolution islamique ». À la vérité, ils ne croient ni à la différence historique, ni au présent qui fait advenir quelque chose de nouveau, ni même à l’avenir ; dans leur causalisme pétrifié, le futur ne sera jamais qu’un futur antérieur. Ce qui leur échappe, c’est la subtilité d’une action collective qui retourne contre un État son propre appareil idéologique et, partant, récupère l’un après l’autre les lieux (topiques) d’une Révolution qu’il a usurpée. Tout se passe comme si le peuple iranien répétait la Révolution dans une différence historique irréductible afin de relever le moment d’émancipation politique dont l’histoire de l’État islamique incarne le refoulement et la négation. S’interroger sur la manière dont le processus dialectique de la Révolution échoue dans un premier temps et reste inachevé, voilà la tâche que s’est donnée « La question iranienne 2 ? » qui suit cette introduction.
Encore faut-il démêler les deux mouvements antagoniques constituant la conjoncture de cette relève. On a vu comment le Mouvement Vert s’est déclenché pendant la campagne présidentielle. Dans « Qui est le Sujet du Mouvement Vert » et « Politique de la (non-)violence » ci-après, on verra qu’il était, entre autres, issu d’un changement de discours. Il ne faut pas supposer pour autant que le coup, si grave, de l’État a été une réaction hystérique vis-à-vis d’un mouvement dont l’objectif était en premier lieu de poursuivre ses revendications dans les limites, trop serrées, imposées par le même État. Contrôler, ou même neutraliser les démarches du représentant du mouvement, Moussavi, qui était a priori l’une des figures les plus fidèles à l’État islamique, et celles de son gouvernement éventuel, ne posait normalement aucun problème à un appareil étatique qui s’était montré particulièrement habile en la matière face au réformisme du président Khâtami. D’autant plus que cet effort en tout cas réformiste, fût-il suivi par un autre discours, aurait rehaussé la légitimité d’un État de plus en plus en crise de légitimité. Pour un tel appareil, organiser une présidentielle frauduleuse sous des formes plus vraisemblables n’était pas non plus difficile à réaliser, comme en témoignaient les élections précédentes. Nul besoin donc d’un spectacle si scandaleux, même si c’était pour aménager une « élection bidon ».
Seulement, plus d’un an après la présidentielle, et à mesure qu’on prend connaissance des documents concernant le coup d’État, on peut repérer un projet depuis longtemps élaboré dont l’élection présidentielle n’était qu’une étape, quoique décisive. On sait maintenant que le système sécuritaire-militaire de l’État préparait ce tournant pendant tout le premier mandat d’Ahmadinejad et plus particulièrement depuis deux ans avant l’élection, et qu’il consistait à éradiquer définitivement l’« ennemi ». L’ennemi veut dire toutes les voix qui ne « se fusionnaient pas totalement dans la volonté du Guide » − le mot d’ordre que la propagande de l’État prêche de plus en plus – et celle de son cercle des Gardiens de la Révolution ; des voix à tous les niveaux, des fondateurs majeurs de l’État islamique, grands ayatollahs indépendants et hommes d’État réformistes, aux activistes des mouvements sociaux, aux journalistes et même aux étudiants. Cela dit, ce tournant doit être considéré dans l’ensemble du projet global que l’État islamique n’a en réalité jamais interrompu. Il consiste à débarrasser progressivement l’État des éléments démocratiques « incongrus » que la poussée révolutionnaire et la société fort politisée lui avaient imposés au début, pour qu’il s’accommode à une forme d’État total s’appuyant sur la « théorie du Souverain juriste »(velâyat-e faqih). Dans cette optique, le maintien du pouvoir exécutif entre les mains d’Ahmadinejad constituait seulement l’un des objectifs ; ce qui importait davantage c’était qu’après son premier mandat dévastateur, l’élection présidentielle allait réunir forcément dans un camp tous les critiques, aussi éloignés qu’ils soient les uns des autres, de même qu’elle allait fournir l’occasion de les accuser de complot et d’établir par la suite un nouvel ordre.
Faire table rase de la scène politique, éliminer tout opposant potentiel par une opération rapide avec des moyens policiers extrêmement violents, puis oblitérer l’espace vide en créant de fausses oppositions, voilà ce qu’il faut entendre par le « coup d’État » qu’ont organisé le Guide suprême et son État. D’où les semblants de conflit qui ont proliféré dès le lendemain de l’élection au sein même de l’État entre, par exemple, Ahmadinejad et d’autres hommes du Guide, et le fait que le système médiatique de l’État, contrairement à ses habitudes, les a couverts amplement et continue à le faire. Du reste, dans le même « Politique de la (non-)violence », on verra comment les notions de la guerre et de l’ennemi constituent des éléments indispensables de ce discours de souveraineté. C’est un détail très significatif que l’hégémonie médiatique de l’État accuse Moussavi, avec d’autres hommes d’État d’hier et ennemis d’aujourd’hui, d’avoir obligé Khomeini à mettre fin à la guerre irano-irakienne afin de les dénoncer comme les vrais responsables de la soumission à l’accord de paix. Et encore plus significatif est le fait qu’on entende le Guide et ses Gardiens parler de la guerre comme une « faveur » en regrettant de n’être actuellement engagé dans aucune. Sans pouvoir entrer ici dans les détails de ce discours, tenons-nous en à deux points cruciaux. D’abord, il ne s’agit pas, comme on a d’habitude tendance à le croire, du règne des ignares. Les théoriciens de cet État ne parlent pas la langue de Hobbes et de Schmitt ; leur discours n’en est pas moins rigoureux et cohérent. Deuxièmement, plus l’État s’approche de sa souveraineté idéale, moins il se subsume à la forme classique de la théocratie pour s’étayer davantage sur un messianisme hostile aux ayatollahs et au chiisme institutionnalisé.
Ce projet minutieusement élaboré, n’a pourtant pas pris en compte la résistance du peuple. L’évènement politique de l’année dernière en Iran est dû à la collision entre le Mouvement Vert comme intervention directe du peuple dans la politique d’un côté, et de l’autre, le processus de réalisation du projet d’État dans la conjoncture particulière de l’élection présidentielle. De ce « peuple » qui a formé le Mouvement Vert, il faut bien citer les pauvres et il faut les citer en leur nom propre : l’ouvrier. D’abord, parce qu’après une Révolution qui devait tant aux forces ouvrières, l’État islamique s’est occupé d’emblée de les anéantir. Syndicats et organisations ouvrières devaient être supprimés car le nouvel État était bien conscient de leur force subversive. En plus, il voulait se réserver le droit exclusif de « représenter » les masses. Pendant les années de réforme, les ouvriers essayaient tant bien que mal de s’organiser à nouveau. Mais détruire tout mouvement civil et prétendre incarner en personne la cause des pauvres, dont les ouvriers, voilà ce qui constitue exactement le cœur du populisme d’Ahmadinejad. Sur cette démagogie la langue coupée du porte-parole du seul syndicat ouvrier en dit long. Jamais les pauvres d’Iran n’ont cru, disons au passage, autant à la démagogie d’Ahmadinejad que la gauche en Occident. L’autre raison à ce choix c’est que la pauvreté occupe une place encore plus importante dans la « feuille de route » de l’État. La paupérisation massive d’une partie considérable de la société par des politiques économiques dévastatrices, et en même temps l’octroi d’une somme dérisoire remplaçant tout autre subside, vise à ce que la survie des millions de pauvres dépende du seul État et garantisse ainsi son existence. L’État « s’achète » ainsi une armée de pauvres.
De l’autre coté, s’il faut trouver un précédent immédiat pour le Mouvement vert, il est sans doute à chercher dans le mouvement des femmes, le plus important de ces dernières années en Iran autant pour sa capacité de mobilisation ou sa créativité dans la lutte que pour son expansion jusqu’aux régions les plus retirées du pays. À part cela, il y a un point à notre sens très important pour la politique iranienne que voici : l’État religieux de l’Iran est structurellement incapable d’affronter efficacement les femmes qui ont justement été, et continuent d’être, victimes de ses structures. Par-delà de simples revendications d’une partie de la société, et précisément parce qu’elle problématise l’ensemble des structures génératrices d’inégalité, la cause des femmes semble être une singularité évènementielle. De sorte qu’insister sur cette cause pourra ouvrir à un moment émancipateur universel.
S’il y a un but commun qui rapproche les articles qui suivent, c’est de dissiper les malentendus parfois graves qui composent de proche en proche l’image « extérieure », la tête en bas, de la réalité politique de l’Iran. Ainsi Ahmadinejad devient le combattant de la cause des déshérités, tandis que les Verts se résument en des nantis à la recherche d’un mode de vie plus libertine et leur soulèvement, en la « révolution de twitter ». Sans qu’on se doute que cela est exactement l’objectif poursuivi par la machine de propagande de l’État islamique, machine d’ailleurs si sophistiquée qui mériterait une investigation particulière. Et sans s’apercevoir que seul un espace déjà radicalement politisé serait à même de transformer les caméras de portables, les réseaux sociaux sur l’Internet (Facebook ou Twitter) ou d’autres produits technologiques en armes de lutte. On ignore ainsi que sans cette façon de diffracter leurs ondes, ces outils servent plutôt à l’abêtissement des masses dépolitisées par un État lui-même premier bénéficiaire de la spéculation des produits high-techs sur le marché national. Nous avons donc opté pour une méthode descriptive, non seulement parce qu’une approche théorique de notre sujet, là où il n’en existe presque aucune connaissance objective, serait impossible ou en tout cas inutile, mais surtout parce qu’un défrichage du terrain nous a paru le premier pas vers une compréhension moins fantaisiste de la réalité politique en Iran, le premier pas pour sauver ce phénomène qui s’énonce : « on se soulève ».