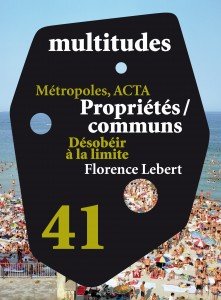L’attribution du prix Nobel d’Économie 2009 à Elinor Ostrom nous rappelle opportunément cette vérité empirique : si la question des droits de propriété est constitutive du fonctionnement des sociétés, celles-ci ne l’ont pas toutes réglée selon un modèle commun, celui véhiculé par la théorie standard des droits de propriété. Celle-ci postule en effet une séparation entre bien et personne qui facilite les transactions marchandes et une évolution, éventuellement conflictuelle et appelant alors une intervention publique, vers l’individualisation des droits de propriété, gage supposé de l’efficacité économique et in fine de l’équité. Des formes de propriété commune existent et fonctionnent, qui n’ont rien à voir avec un accès libre et non régulé, synonyme d’opportunisme et de dégradation des ressources. Leur gestion est soumise à des « règles constitutionnelles », pour reprendre l’expression d’Ostrom, sortes de « métarègles » qui sont au fondement de la vie en commun[2]. Celles-ci définissent les règles collectives et opérationnelles qui vont régler l’accès aux ressources et le partage des bénéfices de leur usage.
Rien n’est jamais sûr toutefois, ni mécaniquement réglé, et c’est le jeu croisé des principes, règles et droits, des autorités et des appartenances qui donnera la réponse concrète, en termes d’accès et de sécurité de cet accès, à la question toujours répétée des droits de propriété. Or l’entrée par les appartenances a souvent été négligée dans l’analyse des droits de propriété ou alors traitée sur un mode substantialiste (« la communauté », « l’ethnie »). Il est plus productif de concevoir l’appartenance comme un bien (une ressource, un « capital social ») à partir duquel d’autres biens peuvent être négociés ou distribués (dont l’accès à la terre et aux ressources naturelles). L’appartenance renvoie en même temps à des normes et des principes, à une économie morale (Scott, 1976) qui définit l’acceptable et l’inacceptable, le bon comportement et le mauvais, dans une logique à la fois cognitive et normative. Il s’agit d’un même pas de décrypter et de juger des situations et des actes – et cela vaut pour toute forme économique. La relation d’appartenance et d’appropriation est multidirectionnelle, au-delà de la définition classique des rapports de propriété comme rapports entre personnes ou groupes au sujet d’un bien. On appartient à un groupe, on appartient à la terre, la terre nous appartient.
Appartenance et propriété intellectuelle
La question de la terre et des ressources qui lui sont associées (ressources naturelles renouvelables ou non, comme les minerais) suppose la définition de l’entité qui est objet d’appropriation – qu’elle soit collective ou individuelle –, et éventuellement de transferts et transactions. Si les acteurs en présence appartiennent à des univers sociaux extrêmement éloignés les uns des autres, tant économiquement que géographiquement et du point de vue des valeurs et des aspirations, les risques de malentendu et de conflit s’accroissent considérablement. Certes, l’économie morale locale a les capacités politiques d’incorporer des étrangers en leur permettant d’accéder à un statut spécifique (une citoyenneté locale souvent incomplète) et à des ressources (foncières en particulier) selon des règles pour partie négociables[3]. Il est alors attendu de ces étrangers un retour en termes de comportement et de participation au bien commun, à la « grandeur de la cité »[4]. Mais les « étrangers » dont il est question, par exemple dans le cas d’achats de terres à grande échelle ou d’exploitation minière, ne sont pas seulement des migrants ruraux issus de l’économie familiale, ce sont aussi des urbains (fonctionnaires, entrepreneurs) ou des firmes nationales ou multinationales dont la logique d’action peut prendre un tour plus ou moins territorialisé en fonction du type de secteur et de ressource qui est en jeu. La territorialisation de l’exploitation capitaliste, associée à sa nature temporaire (même si ce temporaire peut durer) est par exemple forte dans le cas de l’exploitation minière ou forestière. Elle est au fondement d’une inquiétude des populations locales ou « riveraines » et de leur mobilisation pour sécuriser des droits et reprendre le contrôle sur des ressources qu’elles estiment leurs, ou encore pour obtenir des compensations.
La question adressée à tout « étranger » incorporé à une « communauté locale » est au fond : « à quel monde appartenez-vous ? ». Cela vaut pour le migrant Mossi accueilli dans une autre région rurale de son pays, pour le Burkinabé installé dans l’économie de plantation ivoirienne comme pour une filiale de Renault en Turquie, ou encore le Brésilien Vale et l’Anglo-suisse Xstrata qui exploitent le nickel néo-calédonien dans le cadre de montages financiers et politiques bien différents. On traduirait facilement cette interrogation dans le Pacifique par : « à quelle terre appartenez-vous ? ». Et en écho à la problématique des ressources de propriété commune, la question subsidiaire concerne lesdites ressources : communes, certes, mais communes à qui ?
On retrouve très explicitement ce questionnement dans la logique du discours politique kanak en Nouvelle-Calédonie. Il postule la nécessité de la reconnaissance des Kanak comme peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie pour ouvrir la possibilité d’un accueil des autres communautés comme « étrangers » dotés d’un statut politique dans le cadre d’une nation – Kanaky – en construction. Cette double reconnaissance (la reconnaissance des autochtones par les étrangers permettant celle de ceux-ci par ceux-là) s’inscrit à la fois dans le cadre de la souveraineté nationale et dans le cadre d’une souveraineté locale fondée sur un principe d’antériorité – déterminant un corps électoral restreint mais ne se réduisant pas à la population autochtone –, offrant aux étrangers une citoyenneté sans participation politique (du moins pour les scrutins dont l’enjeu est « constitutionnel » pour la Nouvelle-Calédonie). Cette dialectique sous-tend les relations qui se nouent entre communautés locales et firmes multinationales. Celles-ci ne règlent pas définitivement leurs droits à exploiter les ressources minières en passant simplement des accords au niveau national. Elles doivent également négocier leur entrée avec les communautés locales détentrices coutumières des gisements[5], où les relations sont interprétées dans l’idiome de l’accueil et fondent une logique rentière localisée, le bon comportement de la firme, sa volonté d’intégration, s’exprimant par une compensation pour l’exploitation d’un territoire, conçu selon le registre des droits de propriété intellectuelle.
Le pacte pour un développement durable du Grand Sud signé le 11 septembre 2008 par les représentants coutumiers (aire Djubea Kapone et sénat coutumier), le comité Rhéébu Nùù, association de défense de droits autochtones, et la SAS Goro-Nickel, filiale de Vale en Nouvelle-Calédonie, qui doit régler la question des compensations versées par l’industriel aux populations locales, prend la forme d’un récit, qui va « du conflit au consentement » (p. 4) et dont le canevas englobe le rapport au temps et à l’espace des communautés concernées. « Les espaces du grand sud sont habités physiquement et spirituellement suivant une organisation spatiale et des cycles relevant des différents aspects de la tradition ou des mythes fondateurs » (p. 3). Le document insiste aussi sur la « confiance » et le « respect mutuel » dont les discussions préalables à la signature ont été empreintes (p. 6). Il s’agit de financer et de mettre en place un schéma de développement qui impliquera les populations riveraines dans la surveillance environnementale de l’activité minière et métallurgique, les aidera à faire face à ses impacts socioculturels et promouvra un développement économique durable. Une fondation sera créée à cet effet qui « analysera la viabilité, la durabilité, l’intérêt éducatif, social, culturel, économique ou autre des projets [soumis à financement dans le cadre du pacte] et leur compatibilité avec les traditions et coutumes kanak » (p. 10). Les projets seront étudiés par des groupes de travail locaux représentant les communes directement riveraines de l’Île des Pins, du Mont-Dore et de Yaté mais ils devront « prendre en compte les intérêts particuliers des tribus de Païta compte tenu des liens coutumiers existants » (id.). La localisation de la compensation est ainsi raisonnée non pas selon une logique purement foncière et territoriale – les espaces touchés directement par l’exploitation et la pollution qu’elle génère, avec leurs propriétaires et usagers – mais en fonction de réseaux d’alliance dont la territorialisation est plus diffuse et secondaire par rapport aux savoirs, aux liens et à la mémoire qu’ils véhiculent et transmettent.
Dans la même perspective, Lorenzo Brutti montre dans le cas des mines d’or de Porgera en Papouasie Nouvelle-Guinée comment le mode de calcul de la compensation proposé par la firme minière, paiement au clan propriétaire foncier en fonction du niveau de pollution, a été rejeté par les populations locales Oksapmin qui demandaient que les clans non riverains soient également dédommagés dans la mesure où tous partageaient le même lien rituel et cosmologique et la même appartenance au complexe mythique régional Afek (Yuan ku) centré sur la fertilité, au-delà de la seule distribution des droits fonciers « concrets » à un niveau plus restreint d’appartenance[6]. Stuart Kirsch observe le même malentendu dans le cas de la mine de cuivre d’Ok Tedi exploitée par BHP Billiton, le plus gros groupe minier mondial[7]. Aletta Biersack, analysant l’intensification de l’extraction aurifère dans la région proche du Mont Kare, montre que l’or est conçu par les Paiela comme la chair du python totémique garant de la fertilité et clef de voûte de l’étroite imbrication entre société (travaillée par la pénétration du capitalisme), religion (dominée à présent par des courants pentecôtistes et millénaristes) et nature (toujours soumise à recréation)[8]. Bien que vue comme porteuse d’un avenir différent (le développement, la modernité) du jeu à somme nulle de reproduction de la fertilité et de la société qui prévalait, l’exploitation de l’or est comprise comme participant des pratiques sacrificielles constitutives du cycle de la vie, mort et régénération de la terre et d’une « biosphère » qui résulte de la somme des interactions entre nature et cosmologie.
La proposition développée en particulier par Marilyn Strathern de la terre comme propriété intellectuelle est ici utile. Il s’agit plus exactement de concevoir la relation foncière sous deux angles symétriques : la terre comme ressource, potentiellement exploitable et appropriable (« la terre nous appartient »), la terre comme source de vie, principe de fertilité (« nous appartenons à la terre »)[9]. Marylin Strathern n’oppose pas ces deux points de vue sur la base de dichotomies simplistes (occidental/non occidental, capitaliste/non capitaliste) mais propose de réfléchir en termes de créativité plutôt que de productivité : « Penser la terre comme créatrice et ses produits comme des créations »[10]. Le registre de la création, de la capacité créative est exactement celui que le champ juridique subsume sous la catégorie de droits de propriété intellectuelle. Il permet de penser la terre à la fois comme ressource matérielle et immatérielle. Le versant immatériel de la terre s’exprime par sa fertilité, son potentiel reproductif et créateur, tout autant que par un récit fait de cheminements, d’alliances, de savoirs et de savoir-faire constitutifs d’un réseau liant la terre et ses possessions/possesseurs que sont les personnes passées, présentes et futures.
Appropriation et salissure
Lorsque surgit la question de la compensation dans les négociations entre compagnies minières et populations riveraines, c’est donc relativement à l’exploitation de la dimension immatérielle de la terre et à la protection de son potentiel créateur qu’elle est pensée par ces dernières, alors que les compagnies l’intègrent au cadre euphémisé de la « responsabilité sociale d’entreprise ». La notion de compensation renvoie en même temps aux thèmes du dommage et de la dégradation écologique qu’il s’agit de réparer moyennant une prestation au moins équivalente en valeur, critère délicat lorsque les entités en présence sont incommensurables. C’est toute la question de la juste compensation qui doit être donnée en retour à toute extraction d’une portion de la fertilité de la terre. Or de la même manière que le potentiel créateur de la terre incorpore de l’humain sous forme de savoirs et d’efforts antérieurs, la compensation doit inclure la dimension du « bon comportement » attendu de la part de la firme exploitant le gisement minier.
La dégradation, le dommage, la pollution, la ponction sont vécus, perçus, combattus ou négociés par les personnes touchées par l’exploitation minière. Ils font l’objet de compensations formulées dans des termes juridiques – les droits à polluer – et acquérant ainsi un statut de marchandise. Mais la salissure est aussi vectrice d’appropriation selon une logique bien différente. Michel Serres fait ainsi l’hypothèse selon laquelle, à l’origine de la propriété, on ne trouverait pas le contrat rousseauiste, le travail lockien, ni même le vol proudhonien, mais la salissure, urine, déjection, sang, cadavres : un acte « issu d’une origine animale, éthologique, corporelle, physiologique, organique, vitale… et non d’une convention ou de quelque droit positif[11]. Pour Michel Serres, ce droit, naturel au sens propre, cette « possession » originelle[12] a historiquement évolué vers un droit positif en s’adoucissant, en s’euphémisant dans un discours religieux puis juridique, dont un avatar récent serait constitué par les marques (au sens publicitaire du terme) qui polluent les espaces publics, marques défendues par un arsenal juridique dont la notion de droit de propriété intellectuelle constitue un outil majeur. Parallèlement aux marques et autres copyrights, la pollution a pris une autre forme, externalisation du biologique, qui est celle de la pollution industrielle et des décharges de déchets. « Forts différentes, au moins dans l’ordre énergétique, ordures et marques résultent pourtant du même geste de salissure, de la même intention d’appropriation, d’origine animale »[13].
L’appropriation par la pollution avance aussi en détruisant et rendant invisibles les alternatives. En Nouvelle-Calédonie, autant que l’appareil militaire, c’est l’invisibilisation des marques d’appropriation kanak qui a soutenu l’appropriation coloniale de l’espace : invisibilisation par destruction des tarodières et des billons d’ignames sous les pas du front pastoral lancé par une législation très assouplie dans les années 1870, invisibilisation par recouvrement, avec le rejet des stériles et des latérites pauvres au bas des pentes situées sous l’exploitation à ciel ouvert du nickel. À Thio, haut lieu de l’extraction minière depuis plus de cent trente années, les conflits locaux avec la Société Le Nickel, l’entreprise reine du pays, ont régulièrement tourné autour de la pollution générée par une extraction longtemps peu contrôlée[14]. Le différend remonte aux premiers temps du confinement des Kanak dans des réserves (parfois ultérieurement rognées par la SLN) ; il passe aussi par la compensation versée par la SLN à l’église de Thio Mission pour la ruine progressive du toit de l’église due aux émissions soufrées de l’usine de transformation du nickel qui fonctionna à Thio de 1913 à 1931[15]. Éboulements, inondations (les « pieds mouillés » comme on appelait et s’appelaient les victimes de ces catastrophes peu naturelles), destruction de la faune des rivières : les griefs des tribus kanak habitant près des mines étaient récurrents, visant une appropriation de l’espace effectuée sous le signe de la pollution qui les plaçaient en position « d’étrangers dans leur propre pays » pour reprendre les termes de Leah Horowitz[16]. Le lien fort entre appropriation foncière et citoyenneté est ici inversé par les rapports de force coloniaux et industriels.
L’appropriation foncière passe par des modalités diverses : plus que le droit, y compris dans le sens sociologique large d’action socialement autorisée, ce sont les modalités de l’accès concret qui sont déterminantes. Celles-ci empruntent différents vecteurs qui incluent le droit, le capital économique et politique, la force et aussi la pollution. Dans tous les cas, la question centrale touche à l’objet de l’appropriation foncière, à sa double nature matérielle et immatérielle. L’oubli de la seconde ou son invisibilisation à des fins d’appropriation – que l’on pense à l’idéologie de la terre vacante et sans maître aveugle aux marques d’usage et d’appropriation préexistantes –, nourrit ressentiments et conflits.
Échange et environnement
L’activité minière construit l’environnement comme un sous-produit du mouvement d’appropriation et de pollution qui va de pair avec le travail d’extraction. La conservation de la nature place l’environnement au centre de ses préoccupations, au point de parfois réduire les activités humaines à un rôle de facteur perturbateur, alors que dans les conceptions locales de l’environnement (terme peu adéquat d’ailleurs), « l’action humaine modèle un environnement qui est à la fois antérieur et postérieur à cette action »[17]. Or pour certains environnementalistes fondamentalistes, la patrimonialisation de la nature qui doit lier les générations dans un lien fort avec leur environnement naturel tend à se faire contre les générations passées et présentes, mises sur le banc des accusés, au seul profit des générations futures… Cette patrimonialisation, quand elle prend la forme du classement par l’UNESCO en 2008 d’une large partie du lagon néo-calédonien comme patrimoine de l’humanité, pose implicitement la question de la communauté d’appartenance dont ce patrimoine relèverait : les communautés riveraines, auxquelles est délégué un droit de gestion limité, le pays concerné, dont le gouvernement est garant des règles de gestion environnementale, ou l’humanité (si l’on s’en tient au label de ce classement) dont le lagon néo-calédonien constituerait un fragment de patrimoine ?
La négociation de la distribution sociale et spatiale des droits et des pouvoirs relativement à ce patrimoine a été âpre en Nouvelle-Calédonie. Les industries minières ont parfois oscillé entre les deux formes de pollution (matérielle et immatérielle) évoquées plus haut, qui sont intrinsèques à leur activité pour freiner ou domestiquer l’extension d’une nature propre qui leur échapperait. L’alternative est la suivante, entre stratégie exclusive et inclusive : polluer pour exclure du domaine protégé (par exemple en annonçant la construction d’une nouvelle usine sur un site inclus dans les limites du domaine à protéger), apposer son label sur le projet pour s’en approprier les bénéfices symboliques. Par le biais de ces stratégies (de celles-ci et d’autres) se joue la délimitation des espaces et des groupes finalement bénéficiaires de ce classement et de la rente environnementaliste qui peut l’accompagner, mais dont la circulation vers le local – dévolution de ressources et de pouvoirs – peut se perdre dans les méandres politico-bureaucratiques.
Les discours locaux relatifs au dispositif environnementaliste sont très parlants à cet égard. Dans le district de Borendy à Thio, la province Sud met en place une aire marine protégée hors zone de classement UNESCO, processus qui a démarré fin 2007. La démarche se veut participative et des réunions ont été organisées avec les membres des tribus concernées pour évaluer l’intérêt que ce projet soulevait, les éventuelles critiques ou réticences, ainsi que la ou les zones qui seraient protégées. Ces questions ouvraient d’emblée sur une problématique foncière, telle qu’elle est construite par les populations kanak pour lesquelles l’appropriation de l’espace va sans solution de continuité « de la chaîne au récif ». Sans entrer dans le détail des modes d’appropriation, d’usage et de gouvernance du foncier maritime, retenons ici le discours des membres des tribus de Borendy sur les espaces à protéger[18]. Le discours est celui du don : « donner un îlot, un récif au projet ». On peut analyser le recours à ce registre sur plusieurs modes. Il s’agit tout d’abord de mettre en pratique l’idée souvent affirmée que les aires protégées doivent être à tout le monde, que c’est un bien commun. On décèle aussi le souci d’entrer dans une logique de réciprocité avec la province Sud à l’origine du projet, selon un schéma clientéliste d’échange de biens et services qui organise bien souvent les relations sociales dans le cadre d’interventions de développement[19]. Cet échange peut viser à placer le donateur (bailleur de fonds) en position d’obligé, selon l’une des ruses dont le don est coutumier[20]. En même temps, donner est aussi une manière de réaffirmer (ou de faire bouger) une position dans les hiérarchies locales des clans et chefferies (et très prosaïquement de ne pas rester sur le quai quand s’ébroue le train du développement). Enfin, la question que l’on peut se poser concerne le contenu de ce don. La réponse passe par les interprétations précédentes sous-tendues par le caractère bidirectionnel déjà relevé de la notion d’appartenance à la base du lien fort entre groupe humain, foncier (terrestre et maritime) et histoire/mémoire.
De ce point de vue, la logique foncière qui préside à ce « don » n’est pas simplement territoriale, elle comprend les principes et les normes à la base des « bons comportements » qui doivent régler les relations foncières terrestres et maritimes et permettent une superposition d’usages et d’usagers sans qu’il y ait nécessairement stricte définition des frontières. Là encore, le versant immatériel de la terre (et de la mer) apparaît dans toute sa force. Il renvoie en même temps à un thème ethnographique qui a intrigué plusieurs générations d’anthropologues depuis Malinowski et Mauss et touche aux cycles d’échanges cérémoniels océaniens. Ils portent sur des objets (tapas, coquillages, jades, etc.) ou du moins sur certains d’entre eux, car d’autres, de la même classe, mais dont la valeur est supérieure, sont gardés et non donnés. Donner en gardant ou pour garder, cette dialectique mise au jour par Annette Weiner et reprise par Maurice Godelier permet d’analyser d’un même pas les dimensions d’échanges (réciprocité et hiérarchie) et de transmission (identité et reproduction) au fondement des sociétés et que l’on retrouve à l’œuvre dans les « situations de développement »[21].
Au-delà des « créations foncières » (minerai de nickel ou tubercule d’igname) soumises à prélèvement et échanges, c’est la créativité foncière qui est l’objet des débats relatifs à la salissure et à la compensation. Ce potentiel créateur de la terre charrie une histoire faite de strates mêlant autochtonie, antériorité, pactes, investissement en travail et pratiques rituelles, mémoire, savoirs et savoir-faire. La mise en récit de cette histoire toujours en mouvement, incorporant sans cesse des éléments nouveaux aux origines variées (modernité, capitalisme, coutume, christianisme, autochtonie, environnementalisme, etc.) fait de la propriété une affaire de persuasion, comme a su nous en convaincre Carole Rose. En même temps, les déséquilibres et les discontinuités qui traversent l’arène au sein de laquelle elle est négociée expliquent le caractère à la fois inégalitaire et incertain de ce travail narratif qui joue nécessairement sur les deux registres de l’appartenance, que l’on parle de nickel ou de lagon : des ressources communes à quels acteurs sociaux ? Des acteurs sociaux communs à quels mondes ?