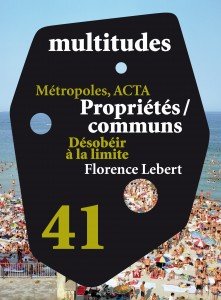L’histoire de l’appropriation privative des objets immatériels a connu trois époques[1].
– Phase 1 (XVIe-XVIIIe). Les droits des créateurs (auteurs et inventeurs) sont inventés à la fin du XVe siècle[2], le régime juridique afférent est consolidé au cours du XVIIIe[3], comme droits temporaires, exclusifs et transférables de vendre copies des œuvres originales (copyright) et d’exploiter les inventions nouvelles, sous condition de publication (brevet).
Durant cette préhistoire, le droit d’auteur et le brevet sont des objets marginaux, qui émergent à l’écart (et dans l’ombre) d’une théorie générale de la propriété construite progressivement au cours du XVIIIe sur le modèle de la propriété des biens matériels. Ces droits ne sont pas toujours spontanément associés à des « propriétés », comme « droit absolu d’une personne sur une chose matérielle »[4].
– Phase 2 (1830-1950). La montée en puissance de ces droits impose le rapprochement avec la propriété. En France, trois thèses sont en présence[5] :
a) Assimilation. Les créateurs sont propriétaires de droit naturel parce que leurs créations sont le fruit de leur labeur et/ou l’expression de leur personnalité, exactement comme les propriétaires de biens matériels, il faut donc aligner les régimes juridiques, en reconnaissant le caractère absolu et perpétuel des droits des créateurs[6].
b) Droit sui generis. Les créateurs sont propriétaires de droit naturel, mais comme leurs biens sont spéciaux (pas de corpus, biens non rivaux etc.), leurs droits sont spéciaux, sui generis (temporaires, sans droit de suite etc.)[7].
c) Privilège exclusif. Les objets immatériels (discours, idées etc.) ne sont pas appropriables, les créateurs ne sont pas propriétaires de droit naturel. La société leur alloue des monopoles temporaires d’exploitation, en rémunération de l’utilité de leurs œuvres et inventions. Ce sont des privilèges, pas des droits[8].
Aucune de ces thèses ne se serait imposée si entre temps, la définition canonique de la propriété n’avait pas changé. Mais il se trouve que vers la fin du XIXe siècle, on commence à douter de la thèse du droit absolu, les personnes morales deviennent propriétaires, de nouveaux objets ont fait leur apparition, provoquant l’effritement progressif du dogme de la « propriété absolue sur une chose matérielle ». Au point que dans la seconde moitié du XXe siècle, on évoque (avec effroi ou gourmandise) « l’extinction »[9] ou la « désintégration »[10] de la propriété.
– Phase 3 (1950-2010). Ce vide théorique a relancé le débat sur les droits des créateurs. Si la propriété n’est plus une « maîtrise absolue » de la chose, pourquoi ne serait-elle pas simplement la garantie légale d’une exclusivité (c’est-à-dire la réservation privative des utilités d’un bien) ? Pour les tenants de cette conception, l’essence de la propriété n’est pas la maîtrise de la chose mais l’exclusion des tiers. Une théorie générale s’est effondrée, elle est remplacée par une autre, mieux construite. D’après ses sectateurs, le dogme propriétaire aurait désormais trouvé sa forme définitive, il n’y aura pas de phase 4.
Dans ce nouveau contexte théorique, les droits des créateurs sont des propriétés (au sens d’exclusivité), quels que soient leur nature (droit de propriété, droit sui generis ou privilège) et leur régime (copyright, brevet etc.) juridiques. On peut désormais parler de « propriété intellectuelle » ; d’ailleurs le mot fait florès[11].
Ce triomphe est nominal, les spécialistes restent divisés quant à la nature des droits, et en pratique les régimes juridiques sont très différents. Ce qui a changé, c’est qu’il est désormais possible de qualifier de « propriété » des privilèges temporaires[12]. Sur le plan théorique, c’est une révolution : la propriété désigne désormais la réservation exclusive plutôt qu’une maîtrise physique et les droits des créateurs en sont désormais l’archétype[13]. Mais pour nominal qu’il soit, le triomphe de l’expression « propriété intellectuelle » est d’une grande importance pratique. On s’accorde désormais à penser qu’il favorise grandement l’extension de ces droits à de nouveaux objets, le renforcement des prérogatives de leurs titulaires, la convergence des régimes juridiques des divers types de créations et le renforcement idéologique de leur légitimité (« propriété », ça fait mieux que « monopole temporaire »)[14]. Nous en sommes là.
Et après, what’s next ? La fin de l’histoire ou le dépassement du capitalisme cognitif ? Une chose est certaine, tandis que le capitalisme de maturité s’institue autour de propriétés intellectuelles étendues et densifiées, un conflit politique acharné oppose ses partisans aux défenseurs des « biens communs», du « domaine public », du « libre (free) » de la gratuité. Sont-ce des résistances de formes anciennes de coopération, pulvérisées par l’expansion du capitalisme informationnel ou une alternative dessinant les prodromes d’une « transformation sociale inédite »[15], marquée par l’émergence du « communisme informationnel »[16] ? De tous ces conflits, celui qui oppose le free software movement aux fabricants de logiciels « propriétaires » est peut -être le plus spectaculaire.
I. Le free software movement et la propriété
Le « free software movement » est un mouvement initié dans les années 80 par Richard Stallman et d’autres programmeurs, réunis dans la Free software fondation (FSF), pour programmer des logiciels et les placer sous une licence dite copyleft. Le manifeste GNU, écrit et publié par Stallman en 1985 (complété régulièrement depuis 1993) expose les principes et finalités du projet, et reste la référence théorique principale du mouvement[17]. Très classiquement, au moins en doctrine américaine, ce droit est analysé comme un droit exclusif de vendre les copies des œuvres, un copyright, dans lequel le manifeste GNU refuse explicitement de voir un « droit intrinsèque », entendre un droit naturel de propriété sur les fruits du travail ou l’expression de la personnalité et fait sien la thèse du privilège exclusif allouant un monopole temporaire d’exploitation aux auteurs, dans la mesure où leurs œuvres sont socialement utiles (cf. phase 2, thèse c).
Deux formes de propriété
Par ailleurs, Stallman ne remet pas en cause la légitimité de la propriété des biens matériels. Il n’en fait certes pas une thèse, mais il ressort de ses remarques que chacun a le droit d’exclure les tiers de la jouissance des fruits de son travail, qu’il est injuste de prendre un objet matériel des mains de son propriétaire (par exemple des spaghettis). L’allocation de droits de propriété privée organise un système de compétition, le capitalisme, qui serait parfaitement légitime s’il fonctionnait toujours correctement (ce qui n’est pas le cas).
On trouve donc chez Stallman deux définitions de la propriété, qui engagent des modes de légitimation distincts : la propriété des biens matériels comme droit « intrinsèque » (absolu et perpétuel) des travailleurs à la jouissance exclusive des fruits de leur travail ; la propriété « instrumentale » des biens immatériels comme privilège exclusif alloué aux créateurs sous forme d’un monopole temporaire d’exploitation de leurs créations, dans la mesure de son utilité sociale. Sur le plan technique, la propriété « intrinsèque » est un droit propre à chacun, opposable même en l’absence de titre, tandis que la propriété « instrumentale » suppose l’institution législative préalable de statuts généraux et impersonnels (« l’auteur », « l’inventeur ») qui varient marginalement selon les systèmes juridiques, dont chaque individu peut se prévaloir dès lors qu’il est en mesure de faire état de la création d’une œuvre, ou d’une invention. Deux formes distinctes de propriété donc, mais dont l’attribut principal est dans un cas comme dans l’autre le droit d’exclure les tiers. Stallman est un représentant fidèle de l’opinion dominante dans la Phase 3.
Propriété intellectuelle : le mot et la chose
Il ne fait donc aucun doute que selon Stallman le copyright et le brevet sont chacun dans leur genre des droits de propriété (au sens d’exclusivité), dont l’allocation aux auteurs et inventeurs organise un système propriétaire (proprietary operating system). Pour autant, il convient de se méfier du mot. Selon lui, la question de la propriété ne se pose jamais en général, il faut distinguer les productions matérielles et immatérielles[18]. Le terme « propriété » est adéquat pour les premières, mais il existe d’excellentes raisons de ne pas l’utiliser pour qualifier le « privilège exclusif », même en l’assortissant de l’adjectif « instrumental ». Ces raisons sont les suivantes :
a) Dans son acception courante, la propriété est un droit (right), et les droits sont souvent considérés comme intrinsèques. Le terme « propriété intellectuelle » suggère que les droits des créateurs sont « intrinsèques », comme la propriété matérielle sur les fruits du travail ou l’expression de la personnalité, alors que ce sont de simples privilèges, dont la légitimité est relative à leur utilité sociale.
b) Cette confusion conduit à tenir pour acquise la légitimité des droits des créateurs, alors que leur utilité doit être évaluée au cas par cas, , selon les types de créations et le contexte social.
c) La constitution américaine garantit la propriété matérielle, pas la « propriété intellectuelle ». Les droits des créateurs y figurent comme temporaires et relatifs aux progrès sociaux qu’ils induisent, ce qui revient à reconnaître les droits du public sur les œuvres et les inventions.
d) La « propriété intellectuelle » donne l’illusion que pourrait exister quelque chose comme un « droit commun » de tous les biens immatériels, alors que les œuvres, inventions, marques etc. posent des problèmes juridiques spécifiques qu’il faut traiter distinctement pour espérer les résoudre. L’illusion contribue en pratique à rapprocher ces régimes disparates, au détriment d’une meilleure adaptation à l’objet dont ils règlent l’usage.
e) Cette illusion pousse en outre à aligner sans justification le degré de protection dont jouissent les propriétaires de biens immatériels sur celui des propriétaires de biens matériels, pour le plus grand profit des industriels de la création.
Stallman note avec sympathie que d’autres expressions ont été suggérées, moins chargées selon lui de préjugés et de confusions, telle que IMP (pour Imposed Monopoly Privileges), ou GOLEM (pour Government-Originated Legally Enforced Monopolies). Ces expressions ont le mérite de préciser qu’il s’agit de privilèges distincts par nature des droits de propriété matérielle, mais elles n’échappent pas au reproche d’englober des régimes juridiques très différents, et de contribuer ainsi à leur nuisible convergence. Il invite donc ses lecteurs à se passer de toute expression unique désignant les diverses exclusivités reconnues aux créateurs sur leurs créations.
Stallman n’a donc, sur le terrain des catégories juridiques, que deux ennemis : l’identification des privilèges exclusifs des créateurs avec des droits « intrinsèques » et l’usage fallacieux du terme « propriété intellectuelle ». Il n’a rien contre l’idée d’une appropriation exclusive des créations immatérielles, une propriété intellectuelle instrumentale (privilège), pas trop inutile et qui ne dirait pas son nom. Nous sommes toujours au beau milieu de la phase 3, avec un raffinement linguistique supplémentaire.
Les livres, pas les logiciels
Ce raffinement linguistique n’est cependant pas anodin, il permet un traitement différencié des livres et des logiciels. Stallman est un partisan de l’allocation de copyright aux auteurs de livres, parce que l’exclusivité concédée permet de rémunérer les auteurs sans trop gêner la libre circulation des livres et des idées qu’ils contiennent. Certes, le prix de vente du livre augmente un peu, mais en gros, l’exclusivité du droit de copie n’exclut que les concurrents commerciaux, et encore, cette exclusion n’est que temporaire, et comme elle offre un moyen simple d’inciter les auteurs à créer, elle est « légère » du point de vue de l’utilité sociale. Tout compte fait, c’est un moyen habile de concilier le droit du public à lire les livres et celui des auteurs à recevoir une rémunération pour leur travail.
En revanche, le copyright sur les logiciels n’est pas socialement utile. Le public n’est plus ici un lecteur qui se contente de lire pour le plaisir, c’est un programmeur, qui contribue lui-même à l’écriture de nouveaux logiciels en modifiant (par extension ou intégration) les existants. Le logiciel n’est pas seulement un produit, c’est un processus d’écriture. De plus, la diffusion des copies des livres est une activité industrielle (il faut avoir une imprimerie), alors que donner le logiciel à un ami est le moyen le plus rapide de le diffuser. Surtout, alors que l’accès au livre donne accès à son contenu (les idées qu’il contient), on ne peut accéder directement au contenu du logiciel (le code source), parce qu’il est très difficile de décompiler le code source à partir du code objet. Enfin, la lecture peut être solitaire, les programmeurs travaillent en communauté, l’usage du copyright interdit le partage au sein de cette communauté pour améliorer les logiciels, et détruit à la fois le plaisir collectif et l’efficience de la coopération. Ainsi, le copyright sur les logiciels est nuisible tant du point de vue de l’efficience économique que de la liberté individuelle, les valeurs de coopération, de désintéressement et de civisme.
Donc : en apparence le free software movement se présente comme « anti-propriétariste », mais en fait Stallman :
a) accorde que la propriété des biens matériels est de droit naturel et ne questionne pas sa légitimité ;
b) récuse le terme « propriété intellectuelle » mais pas une conception « instrumentale » de l’appropriation exclusive, sous la forme d’un privilège temporaire et sous condition d’utilité sociale ;
c) estime cette condition incontestablement remplie pour les inventions et les livres, discute (très vite) le cas des marques et refuse catégoriquement l’application du copyright aux logiciels. Quant au système de compétition qui procède de l’allocation des droits de propriété privée – le capitalisme – Stallman estime qu’il serait parfaitement légitime s’il fonctionnait toujours correctement, ce qui n’est pas toujours le cas, particulièrement parce que la propriété permet la constitution de monopoles qui ruinent le système de compétition. Nous sommes toujours bien dans la phase 3, avec raffinement linguistique.
Il est vrai que ce raffinement linguistique est assez peu anodin pour ouvrir la possibilité d’une zone franche au sein de la phase 3, en bloquant le déploiement de la « propriété intellectuelle » (avec ou sans le mot) dans un domaine stratégique du capitalisme informationnel, le monde du logiciel. Cette position correspond d’assez près à une version particulièrement altruiste et civique d’utilitarisme, à laquelle s’ajoute l’opinion, assez courante chez les juristes[19], que le copyright n’est pas adapté aux logiciels. Rien qui permette pour l’heure d’apercevoir les prodromes d’une « alternative au capitalisme informationnel »[20]. Les choses vont cependant s’animer dès lors qu’il sera question du copyleft, le dispositif alternatif aux « logiciels propriétaires »[21].
II. Qu’est ce que c’est le copyleft ?
Le copyleft se présente comme le contraire du copyright : « c’est une méthode générale pour rendre un logiciel (ou d’autres œuvres) libres, et imposer que les modifications et extensions de ce logiciel soit aussi libres »[22]. Concrètement, cette « méthode générale » recouvre l’invention d’un label qui désigne des instruments juridiques originaux, licences de distribution ou contrats types (dont la qualification est difficile, mais qu’on peut assimiler à des contrats d’adhésion) qui conditionnent l’accès et l’usage de l’œuvre livrée au public au respect de certains principes. La plus célèbre est la licence « GNU GPL (General Public Licence) », qui a servi de modèle à de nombreux autres (GNU LGPL, LGL etc). Le copyleft est donc un « concept général » qui désigne un ensemble de principes qui régissent certaines licences de distribution.
Ces principes consistent dans le respect de quatre libertés (« freedom to run, study, distribute and improve the source code ») et une interdiction. Run offre la liberté d’exécuter le programme pour tous les usages. Study permet le libre accès au code source. Distribute garantit la liberté de donner ou de vendre des copies. Improve confère la liberté de modifier le programme, ce qui suppose là encore l’accès au code source. L’interdiction est celle de ne pas laisser « libre » les modifications. Ce cinquième principe est sans doute le plus important, et le plus paradoxal, puisqu’il consiste à exclure la possibilité de l’exclusion. Sous licence copyleft, on reste libre d’user, étudier, distribuer, modifier un logiciel mais pas d’exclure les tiers des modifications dont on est l’auteur. L’interdiction se traduit donc par une obligation légale d’offrir à tous les quatre libertés. Le copyleft est un copyright inversé.
Depuis la naissance du mouvement, d’autres labels ont vu le jour, les plus connus étant les creative commons et l’open source, au miroir desquels apparaissent les traits spécifiques du free software. Les licences creative commons offrent quatre types de licences :
a) CC – by ou paternité – usage libre, sauf reconnaissance de la paternité. Ce sont des licences « free » (elles respectent les quatre libertés et l’interdiction).
b) CC – nc (pour non commercial – usage libre, sauf utilisation commerciale). Ces licences ne sont pas free, elles ne reconnaissent pas le libre usage commercial. À rebours, le copyleft est donc libre, mais pas forcément gratuit, ce que Stallman illustre d’une métaphore devenue célèbre (« free as in free speech, not as in free beer »)[23]. Ou encore, les logiciels restent des marchandises comme les autres, dès lors qu’elles circulent le plus librement possible[24].
c) CC – nd (no derivs – usage libre, sauf modifications). Ces licences ne sont pas free, elles ne respectent pas la liberté de modifier le logiciel. À rebours, le copyleft est un dispositif agglomérant (toute modification est elle-même modifiable) qui permet la constitution de communautés dynamiques, voire proliférantes, auxquelles on ne peut appartenir qu’en étant soi-même agent actif de sa prolifération.
d) CC – sa (share alike) ou partage à l’identique – usage libre, y compris modification, sous condition de reconduction des quatre libertés). Ces licences sont free (elles respectent les quatre libertés et l’interdiction).
Quant à l’Open Source, c’est un label dissident du free software movement qui ne présente que peu de différences sur le plan technique (la quasi totalité des logiciels open sont free), mais qui s’en distingue dans son refus de la dimension politique et morale du free software[25], en sorte que de nombreux projets peuvent respecter formellement tout ou partie des principes du copyleft et entrer en contradiction frontale avec la promotion de la liberté, telle que la conçoit le projet FSM (ex : Google fait certes un usage intensif des logiciels open source mais apparaît aux yeux de la « communauté du libre » comme liberticide, parce que capable de sacrifier la protection de la vie privée à des exigences de rentabilité).
Le copyleft se présente donc comme une « méthode générale » (assez générale d’ailleurs pour servir de modèle d’organisation à toutes les sphères de la création immatérielle[26]) intimement associée à un projet radical de défense des libertés individuelles et de promotion de communautés productives, ludiques et autogouvernées. Ce projet est explicitement opposé à l’égoïsme mercantile et à la mise en concurrence stérilisante que génère l’adoption de systèmes propriétaires mais, tout aussi explicitement, il refuse de prendre parti contre la forme marchande, ou contre l’appropriation privative des créations de l’esprit en général. On peine à imaginer que la zone franche ouverte dans la phase 3 puisse inaugurer une alternative à la marchandisation de l’information, et a fortiori à l’organisation capitaliste de la production immatérielle. Et ce d’autant que l’efficacité juridique du copyleft repose sur la protection du copyright.
Dans la première version du GNU manifesto (1985) le terme copyleft n’apparaît pas et Stallman présente la licence GNU comme le moyen « d’abandonner » (« give away ») un logiciel au libre usage de tous tiers. Du point de vue de la technique juridique, la licence free serait une déréliction. Dans les versions ultérieures, Stallman corrige cette idée : les auteurs de logiciel libre n’abandonnent pas toutes leurs prérogatives de propriétaires (sauf le nom), puisqu’ils imposent aux futurs utilisateurs des clauses assez strictes de distribution (les quatre libertés et l’interdiction)[27]. Plutôt qu’une déréliction, il s’agit d’une « publication libre » – « release as free software ».
Sur le plan technique, la différence est considérable. L’abandon reviendrait à placer le logiciel dans le domaine public, libre de touts droits. Une telle solution respecterait certes les quatre libertés fondamentales, mais pas l’obligation d’interdiction d’appropriation privative des modifications ultérieures. Il en résulterait selon Stallman qu’un « intermédiaire » pourrait librement priver le public d’accès aux versions améliorées du logiciel, en plaçant sous copyright ses propres modifications. Ce mécanisme est celui des « choses vacantes » (res nullius), inappropriées mais pas inappropriables, offertes donc à l’appropriation privative. Abandonner le logiciel sans prévoir un mécanisme d’exclusion de l’exclusivité revient à le transformer en ressource supplémentaire pour le « système propriétaire » (entendre : les grosses Firmes qui dominent le marché, ou encore, Microsoft). Il ne suffit pas d’autoriser la liberté, il faut encore la protéger contre ses ennemis[28].
Pour ce faire, rien ne vaut de retourner contre eux leurs propres armes : la structure juridique de cette « publication libre (release as free) » est double : un copyright classique auquel s’ajoutent des clauses de distribution, sous la forme d’une licence à laquelle souscrivent les tiers pour pouvoir utiliser le logiciel. L’effectivité juridique du copyleft repose sur un très classique droit de propriété (sauf le nom) conférant le droit d’exclure à son titulaire[29]. On est très loin de l’idée d’abandon.
Il n’est donc pas possible d’envisager le copyleft simplement comme une alternative politique à la propriété intellectuelle, ou comme son « dépassement », puisqu’il tire sa force normative d’un droit de propriété (sauf le nom), entendu comme privilège exclusif reconnu aux créateurs sur leurs créations. Sans copyright, pas de copyleft. C’est parce qu’il est propriétaire de ses créations que le créateur a la liberté d’user librement de son bien, jusqu’à décider de ses conditions de distribution. On accordera toutefois que c’est un usage curieux de la propriété.
III. Ce que le copyleft fait à la propriété
Le copyleft utilise l’arme de la propriété comprise comme exclusivité pour exclure l’exclusion. On se prend à songer à une « subversion », puisqu’il s’agit de faire produire au copyright les effets opposés à ceux qu’on en attend ordinairement. Mais la métaphore (sub-vertere, tourner par en dessous) pourrait s’avérer malheureuse, dans la mesure où, dans le cas présent, c’est le « dessus » (le copyleft), qui tourne, et pas le « dessous » (la propriété).
Les « dessous » du copyleft – droit, privilège, appartenance
« Sous » le copyleft, on trouve d’abord la liberté de choisir le mode de distribution d’un logiciel original. Tout créateur de logiciel peut choisir d’abandonner ses droits au public (sauf les droits moraux dans un système de « droit d’auteur »), de se réserver privativement les utilités de sa création (copyright), ou d’adjoindre à ce dernier une licence libre. Cette faculté lui est offerte par le copyright, c’est parce qu’il est propriétaire de sa création (avec ou sans le nom) qu’il peut librement décider de ses conditions de distribution. Quant à savoir d’où vient ce copyright, les avis divergent. Certains le conçoivent comme un droit intrinsèque de propriété, constitué par l’acte même de création, au titre du droit aux fruits du travail ou à l’expression de la personnalité, d’autres, comme Stallman, comme un privilège exclusif, sous forme de monopole temporaire d’exploitation indexé à l’utilité sociale de la création. Dans cette seconde perspective, le copyright n’est pas constitué par l’acte de création, il est alloué par la société. Mais l’acte de création n’est pas sans portée juridique, il déclenche l’application du statut d’auteur ou d’inventeur prévu par la loi. Il suffit en effet de reconnaître (implicitement ou explicitement, par voie de déclaration ou d’enregistrement) une création comme sienne pour jouir du statut juridique que le législateur associe à ce type de création. Le copyright, le brevet sont des statuts qui viennent sanctionner l’appartenance en propre de la création à son créateur.
Ainsi, l’attribution de droits exclusifs (copyright, brevet) repose sur la reconnaissance d’un rapport fondamental d’appartenance des créations à leur créateur, que ce rapport soit réputé « intrinsèquement » juridique, ou ne devienne juridique que par la médiation de statuts législatifs. C’est sur ce rapport originaire d’appartenance de la création à son créateur que reposent aussi bien le copyright que le copyleft.
Qu’est ce qu’un auteur ? Copyright et appartenance à soi
Le rapport d’appartenance des créations aux créateurs engage deux éléments étroitement entremêlés mais distincts : l’acte de création (écrire un manuscrit, peindre un tableau, décrire un procédé technique nouveau etc.) ; l’acte par lequel le créateur reconnaît que la création est sienne. L’acte de création engage la capacité inventive (ingenium) du créateur, sa capacité à produire un objet original (ou nouveau) ; l’acte de reconnaissance engage son identité personnelle, en rapportant paroles et actions à l’unité d’un soi, sur le mode de l’avoir et non de l’être (non pas : « je suis ces paroles et actions » mais « ces paroles et actions sont à moi », rapport d’identité médiat donc, ou identité dans la différence). La figure du créateur noue ainsi indissociablement liberté créatrice, identité personnelle et appartenance à soi.
C’est sous la plume de Hobbes qu’on trouve cette figure exposée avec la plus grande clarté. Est une personne « naturelle » nous dit Hobbes, « celui dont les paroles ou les actions sont considérées comme lui appartenant », tandis que les personnes morales ou fictives « représentent les paroles et actions d’un autre ». C’est pourquoi on appelle « auteur » les premières et « acteur » les secondes. Celui qui « reconnaît pour siennes [owneth] la parole et l’action » sera donc l’auteur, même si ces paroles sont prononcés par un acteur, parce que celui qui « en matière de biens de toute espèce, est appelé propriétaire [owner], dominus en latin, et kupios en grec) est appelé, en matière d’actions, l’auteur »[30]. La personne se constitue comme personne « naturelle » ou encore acquiert une identité personnelle en devenant « auteur » des paroles et des actions qu’elle reconnaît comme siennes, c’est-à-dire en s’instituant, de sa propre autorité[31], propriétaire de ce qu’elle fait et dit, ou encore propriétaire d’elle-même, en tant que sujet libre, agissant et parlant. C’est parce qu’être auteur, être libre et s’appartenir sont des équivalents que les fruits de la libre activité du sujet ainsi constitué lui appartiennent en propre et que cette appartenance se prolonge (intrinsèquement ou sous condition d’acquisition d’un statut prévu par la loi) dans un droit de propriété, sous la forme d’un copyright ou d’un brevet.
Cette équivalence de l’identité personnelle, de la liberté créatrice et de l’appartenance à soi peut être comprise de manière très différente selon qu’on fait résider le « nœud » dans la conscience de soi (Locke), la volonté libre (Hegel), la production imaginaire de l’idéal du moi (Bentham) etc. Sur le terrain du droit, il importe seulement que l’équivalence soit présupposée, en sorte que les créations produites et reconnues soient l’avoir de leurs créateurs.
On associe souvent la figure du créateur propriétaire de soi à la naissance du droit d’auteur et du brevet, quelque part entre la fin du XVIIe siècle et le début du XIXe (phase 2). Il s’agit là d’une illusion d’optique qui trouve son origine dans la confusion entre les fulgurations intellectuelles de quelques grands esprits (Hobbes, Locke etc) et les figures récurrentes qui peuplent la littérature juridique ordinaire. Si l’on s’en tient à cette dernière, le « créateur-propriétaire-de-lui-même » n’apparaît de manière significative qu’à la fin du XVIIIe siècle pour devenir hégémonique à la fin du XIXe, accompagnant ainsi le triomphe de la « propriété intellectuelle », en quoi il doit être interprété comme le héros allégorique de la phase 3 déguisé en personnage de la phase 2 (lui-même souvent déguisé en bon sauvage, parce que, comme d’habitude, les héros aiment se présenter sur la scène idéologique revêtus de la gloire des siècles passés, et si possible du privilège de l’originarité). La prise en compte du décalage permet de reconstituer la généalogie des figures du créateur de la manière suivante :
La figure de l’artiste naît à la Renaissance, en même temps que naissent le droit d’auteur et le brevet. Son déploiement accompagne la « phase 1 » durant laquelle ces droits vivent une carrière marginale, à l’ombre de la propriété des choses matérielles. Cette figure, magistralement peinte par Panofsky et Kantorowicz[32], emprunte ses traits à Dieu, puis à ses divers substituts terrestres (le Pape, les Rois…), en important dans le domaine des arts libéraux des conceptions en usage dans la science juridique. Les glossateurs estimaient que ce que font les juristes n’a rien d’original ou de nouveau, le droit imitant la nature, jusque dans ses fictions et que seul le souverain a le pouvoir exorbitant de créer des règles nouvelles ou originales, qui ne copient rien. À partir du XVIe siècle (mais déjà chez Dante et Pétrarque) l’artiste, archétype de l’auteur, est représenté comme celui qui crée sans imiter, ex ingenio, par inspiration divine, « ce qui n’a jamais été conçu dans l’esprit d’autrui »[33]. Ce pouvoir de création qui ne s’autorise que de lui-même est emprunté par « équiparation » au pouvoir créateur de Dieu, dont il conserve certains attributs, parmi lesquels celui de conférer au créateur un domaine de souveraineté sur ce qu’il crée.
Mais de l’auteur souverain à l’auteur propriétaire de soi, il faut encore que liberté créatrice (ingenium), identité personnelle et appartenance à soi soient tissées ensemble au point de s’équivaloir, ce qui ne sera pas conçu et énoncé avant le XVIIe siècle (Hobbes), ni tenu pour évident dans la littérature juridique ordinaire avant le XXe. L’artiste souverain et propriétaire de lui-même hante les marges de la phase 2 (cf. le thème de l’auteur bohème, méconnu du public bourgeois philistin) et s’impose durant la phase 3, en devenant l’allégorie du propriétaire en général (l’entrepreneur aux cheveux longs de la Silicon Valley, nouveau Michel-Ange du business). Il fournit désormais le modèle identificatoire dominant, à l’usage de tous les travailleurs en régime capitaliste informationnel[34].
Mais revenons au copyleft. Grâce à Hobbes et ses continuateurs, nous savons ce que sont les « créateurs » titulaires de propriétés intellectuelles. Peut-on dire que les programmeurs stallmaniens sont des « créateurs », au sens de ce qui précède ?
De l’auteur comme hacker
Le programmeur est évidemment un auteur, sans quoi il ne pourrait se prévaloir du copyright sur lequel repose la licence de distribution libre dont il vêt sa création. Mais ce n’est pas tout à fait la figure de l’artiste souverain et propriétaire de lui-même. Sous la plume de Stallman, l’auteur s’est transformé en hacker. Le hacker n’est pas forcément un programmeur, même s’il lui arrive de programmer des logiciels, la notion de hack dépasse très largement la sphère du monde informatique, les exemples qu’en proposent Stallman ressortissent d’ailleurs de la vie quotidienne, de la littérature ou de la musique, de la technologie, voire de la blague potache[35]… Il n’est pas non plus forcément un pirate qui brise les sécurités des systèmes informatiques (un « cracker »), même s’il arrive que certains hackers soient aussi des crackers. Ce qui fait la valeur d’un hack n’est pas la transgression mais un subtil mélange d’habileté technique, de dextérité dans le jeu, d’élégance et de drôlerie. Le hacker n’est certes pas légaliste, mais il n’est pas compulsivement transgressif non plus, il se contente de pousser sa souveraineté artiste jusqu’à l’indifférence aux réglementations en vigueur.
La définition du hack tourne donc autour des idées de jeu, d’intelligence et d’exploration des limites du possible. Le hacker aime résoudre un problème en apparence insoluble de la manière la plus ludique et la plus futée possible. Mais le but du hack est avant tout dans le plaisir de produire une « hack value » élevée et d’être reconnu comme tel dans sa communauté. C’est pourquoi le plaisir du hacker doit être partagé avec d’autres personnes qui apprécient l’art de faire des choses difficiles avec élégance, détachement et facétie. Le hacker n’est pas un créateur isolé qui livrerait ses œuvres à un public abstrait et universel, il est membre d’un groupe sans lequel ses hacks n’auraient ni sens, ni valeur.
L’activité libre n’est plus seulement ici pensée comme création, mais comme jeu créatif, dans lequel ce qui est créatif n’est pas tant de faire advenir à l’existence un produit original ou nouveau, mais la manière dont on y joue. Un hack peut d’ailleurs fort bien ne rien créer, tant que l’acte de créer ce rien est lui-même créatif. L’accent s’est donc déplacé, il ne porte plus sur la puissance démiurgique d’origine divine (puis papale, puis royale …), mais sur le caractère imaginatif d’une activité, productive ou pas. La valeur du hack ne se mesure donc pas en quantum d’utilité (quelle que soit la définition de l’utilité qu’on adopte) ou de temps de travail moyen socialement nécessaire à la production de l’objet créé, mais en intensité d’habileté et de drôlerie de l’acte créatif lui-même.
Il n’y a d’ailleurs pas d’objectivation possible de cette valeur, puisque nous sommes dans la sphère du jeu (au sens de play), espace ontologiquement indécidable dont on sait depuis Freud qu’il s’oppose à la réalité[36], et depuis Winnicott qu’il trace une aire intermédiaire ou transitionnelle entre la subjectivité du joueur et l’objectivité du monde dans (et avec) lequel il joue[37]. Le seul équivalent universel qui soit susceptible de régner dans cette sphère est le plaisir du jeu, et les seules règles qui s’imposent sont celles qu’inventent les joueurs pour le plaisir de jouer. Le hack ne peut donc recevoir d’équivalent monétaire (vouloir acheter un hack détruirait sa « hack value »), c’est par la réputation qu’il acquiert dans sa communauté que le hacker se trouve rémunéré de ses talents.
En quoi l’activité du hacker est immédiatement collective, et n’a de sens que dans l’aire de jeu que constitue la communauté de ceux qui prennent mutuellement plaisir à admirer leurs hacks. C’est bien pourquoi « l’œuvre » du hacker est moins un objet ou un produit qui serait l’expression de la subjectivité créatrice de son auteur que l’institution d’un processus ouvert de créations collectives, qui tire de lui-même sa signification comme « œuvre »[38]. Le hacker est donc bien un auteur, mais la version qu’il en propose consiste à incarner une forme de liberté créative, joueuse, collective et désintéressée. Un souverain propriétaire qui l’est d’autant plus qu’il joue à ne pas l’être, l’Auteur au Carnaval. On dira qu’il ne s’agit que d’une posture, d’une performance ou d’un jeu et que tout ceci n’est pas bien sérieux. Il est vrai que le copyleft ne subvertit pas le copyright, qu’il se contente de jouer à le subvertir, sans rechigner à faire usage de son efficace légale, ce qui ne suffit certes pas à ouvrir une alternative. Mais cette subversion jouée permet d’apercevoir une possible dissociation conceptuelle tout à fait sérieuse entre la propriété et l’exclusivité.
V. La propriété contre l’exclusivité,
aurore de la phase 4 ?
Que le copyright soit conçu comme un droit intrinsèque ou comme un privilège octroyé, il présuppose un rapport originaire d’appartenance (création = appartenance) qui confère au créateur un droit exclusif sur ses œuvres (appartenance = droit exclusif). Stallman reconduit fidèlement la première équation (le hack appartient au hacker) mais pas la seconde, puisque si le créateur a le pouvoir de déterminer les conditions de publication de ses créations, il est libre de faire usage de ce pouvoir pour inclure plutôt que pour exclure les tiers.
Ce que montre le copyleft, c’est qu’avoir ses créations en propre confère le pouvoir de déterminer ses conditions de publication, mais que ce pouvoir ne se confond pas avec le droit d’exclure, ou encore que de l’appartenance à la propriété, la conséquence n’est pas forcément linéaire.
Le créateur a le pouvoir originaire de détruire ses œuvres, de les garder secrètes, de les abandonner, de s’en réserver privativement les utilités, de les partager au sein d’une communauté qui offre toute la gamme des options intermédiaires grâce à la grande diversité des licences disponibles. Il tient ce pouvoir originaire de la faculté d’exclure qui lui est légalement garantie mais dont il n’est pas obligé de faire usage. Originairement, propriété et exclusivité sont donc bien confondues.
Mais dès lors que ce créateur originaire fait le choix de ne pas exclure, en partageant son œuvre au sein d’une communauté par exemple, ce choix est irréversible. À la différence du propriétaire d’un jardin qui peut l’ouvrir au public durant la journée et le clore le soir, le propriétaire d’un logiciel, du fait que l’information circule par dissémination, ne peut plus contrôler ou interdire les usages postérieurs à une « publication libre » de son œuvre. Il reste pleinement propriétaire du logiciel mais ne dispose guère que d’un droit d’exclure formel, pratiquement inutilisable[39]. Choisir l’inclusion vaut renonciation définitive de fait au droit d’exclure. Autrement dit, le créateur originaire, sans cesser d’être propriétaire, a le droit de renoncer une fois pour toute à l’exercice de son droit d’exclure, ou encore : il ne dispose du droit d’exclure qu’en tant qu’il renouvelle continuement son choix initial de réserver privativement certaines utilités de sa création. Le droit d’exclure n’est donc pas tant un « attribut substantiel » de la propriété qu’une option offerte au propriétaire originaire, tant qu’elle est constamment confirmée. Ironiquement, et par contraste, c’est le « droit d’inclure » qui paraît plus « substantiel », puisque le propriétaire originaire a toujours la possibilité de choisir le partage, quand bien même il aurait initialement opté pour un mode exclusif de distribution.
Quant au créateur de modifications ultérieures d’un logiciel original placé sous licence libre, sa situation est encore plus radicale : propriétaire de ses créations, il n’a jamais disposé du droit d’exclure, puisqu’il y a renoncé en accédant au code source du premier logiciel, avant que sa propriété ne soit constituée. Ici, propriété et exclusivité sont strictement et rigoureusement dissociées.
Le copyleft reconduit fidèlement les prémisses anthropologiques (l’appartenance à soi du créateur) et les dispositifs juridiques (la propriété intellectuelle, sauf le nom) du capitalisme informationnel mais il en propose une version assez joueuse pour mettre au jour l’absence d’implication entre la reconnaissance d’un propre anthropologique et le droit de propriété, compris comme exclusivité. Dès lors qu’avoir en propre ne signifie pas qu’on est propriétaire (au sens du droit d’exclure les tiers), contrairement à ce que colporte habituellement la tradition juridique, le propre et le commun ne sont pas nécessairement contradictoires, rien n’interdit qu’on imagine des propriétés inclusives.
Le copyleft n’est donc certainement pas une alternative globale à la propriété, c’est un dispositif ingénieux qui interdit d’élever la conception exclusiviste de la propriété au rang de dogme juridique et rend pensable la coexistence et l’articulation de systèmes propriétaires et de communautés affranchies des systèmes propriétaires, un peu à la manière dont les villes franches du moyen âge surent s’affranchir de certaines obligations fiscales[40], ou encore à la manière dont certains philanthropes firent usage de leur fortune pour fonder communautés et phalanstères… Il s’agit donc moins d’une subversion de la propriété que de la neutralisation des effets jugés politiquement et moralement délétères de l’exclusivisme.
Bien entendu, on peut trouver tout cela un peu décevant. On peut estimer par exemple que l’enjeu philosophique est de réussir à sortir de l’horizon que trace l’équivalence entre l’identité personnelle, la liberté créatrice et l’appartenance à soi pour penser l’acte de création hors des rets de la propriété et de l’identité. Pour ce faire, il faut reconnaître que le copyleft est de peu de secours, le hacker est un propriétaire inclusif, ludique et joyeux, mais c’est un propriétaire tout de même. Faut-il le regretter ?
C’est ce que font les partisans de « l’anti-copyright » ou « creative anti-commons », qui prônent la résolution des contradictions internes du copyleft par la dispersion complète des droits[41]. Il est vrai que le copyleft est à la fois inclusif et exclusif, puisqu’il repose sur le pouvoir d’exclure l’exclusivité, en posant l’interdiction de l’appropriation privative des dérivés d’un logiciel libre. Exclure l’exclusivité, c’est encore exclure. Mais tirer argument de ce paradoxe pour revendiquer la dispersion des droits au nom de la pureté du rejet de toute forme d’exclusivité revient à oublier que les créations abandonnées sont vacantes, offertes à toutes formes de réutilisation, et à l’appropriation privative des dérivés. On peine à comprendre en quoi offrir des ressources gratuites aux systèmes propriétaires est susceptible de hâter la fin du capitalisme informationnel.
Concluons : le copyleft n’annonce pas la fin prochaine de la propriété intellectuelle, et ne la prépare sans doute pas non plus, mais il désigne les limites d’une théorie qui la confondrait trop strictement avec l’exclusivisme, donne à voir les usages inclusifs qu’on peut en faire, et suggère qu’avec un peu d’imagination juridique, elle peut servir des expériences très diverses, explicitement en rupture avec la dynamique concurrentielle du capitalisme informationnel. Ce n’est peut-être pas la fin d’un monde, mais ça donne à penser.