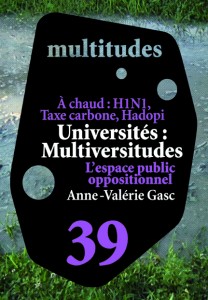Le téléchargement gratuit de biens culturels a occupé le devant de la scène parlementaire, et constitutionnelle, tout au long de l’année 2009 avec la loi Hadopi ou loi « Création et Internet » ou loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ». Un succès qui invite à la réflexion ! La pratique du téléchargement gratuit sur Internet peut être référée à deux environnements bien distincts : celui de l’économie industrielle ou celui de l’économie informationnelle. L’analyse et les jugements qui en résultent sont liés à ce choix initial. Dans la perspective de l’économie industrielle, le téléchargement de biens culturels apparaît comme une alternative à l’achat d’un support physique : la gratuité est vécue comme une spoliation et l’internaute est dénoncé, au mieux, comme un passager clandestin (celui qui consomme un bien sans contribuer à son financement), au pire, comme un pirate. Dans la perspective de l’économie informationnelle, le téléchargement fait partie d’un corpus de nouvelles pratiques qui matérialisent un rapport radicalement nouveau à la culture. L’économie informationnelle enfante une nouvelle relation à la culture et oblige à repenser tant les modalités de cette relation que leurs articulations.
Pour détailler le propos, on s’appuiera sur l’exemple fourni par le secteur de la musique. Le premier segment de ce marché, la musique enregistrée, est en crise : selon les données du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les ventes ont été divisées par deux en six ans, de 1.302 millions d’euros en 2002 à 606 millions en 2008 (vente éditeurs, prix de gros hors taxe). Les maisons de disque ne peuvent que crier au loup face au téléchargement gratuit : l’enregistrement sur support physique (disque vinyle, puis CD) leur a permis de réunir en un même objet matériel contenu et contenant. La mécanique industrielle a pu dès lors dérouler sa logique : produire en quantité afin de bénéficier des meilleurs rendements d’échelle possibles. Le marché s’est progressivement structuré et les quatre grands maillons de l’offre – l’édition musicale (production du master originel), la production industrielle, la promotion, la commercialisation – ont été progressivement réunis en un nombre de mains limité : les quatre premières maisons de disques, les «majors» (Universal, Sony-BMG, Warner et EMI), contrôlent à elles seules près de 80% du marché mondial de la musique enregistrée.
La théorie économique au secours du téléchargement gratuit
Le téléchargement déconstruit ce bel ordonnancement. Il le déconstruit tout d’abord sous un angle théorique. Dans sa contribution à un ouvrage du Conseil d’analyse économique[1], publié par la Documentation française – La Mondialisation immatérielle (2008) –, Francois Moreau aborde la question de la perception des droits d’auteur :
« La conséquence majeure de la numérisation de la filière de la musique enregistrée réside dans la modification des modes de captation de la valeur créée. Demain cette valeur se collectera probablement de moins en moins au moment de l’acquisition de contenus proprement dits (CD ou fichiers numériques à l’unité) car ceux-ci relèvent de manière croissante de la catégorie des biens collectifs. Ils possèdent en effet les propriétés de non rivalité et de non exclusion. L’optimum de premier rang exige alors que le prix unitaire soit fixé au niveau du coût marginal, c’est-à-dire zéro. »
Revenons sur les principaux concepts mentionnés. Non rivalité signifie que le téléchargement n’est pas réservé à un nombre défini d’internautes (la quantité de téléchargements est illimitée contrairement à la production des disques) ; non exclusion signifie que tout internaute peut procéder à un téléchargement (la gratuité fait disparaître la barrière du prix de vente). Le coût marginal, quant à lui, regroupe l’ensemble des dépenses directement et immédiatement suscitées par la production d’un bien donné : l’immatérialité du téléchargement est naturellement synonyme de coûts directs nuls (une première forme de révolution au bénéfice de l’économie informationnelle). La théorie économique valide donc la gratuité du téléchargement. Elle déclare, qui plus est, que cette gratuité emporte un statut de bien collectif pour les œuvres musicales téléchargeables : elles appartiennent à toutes et à tous, la culture rejoint le collectif…
Déconstruction industrielle et reconstruction informationnelle
Le téléchargement déconstruit le bel ordonnancement industriel non seulement en théorie mais aussi, et surtout, en pratique. Il le fait maillon par maillon. Le premier maillon, celui de l’édition musicale, voit fleurir les sites qui proposent aux internautes de financer eux-mêmes, à travers un système de bourse, l’édition du master de leur artiste préféré. Le site MyMajorCompany a ainsi servi de relais au chanteur de variétés français Grégoire pour l’édition de son premier album en lançant une souscription d’un montant global de 70.000 euros (les parts avaient une valeur de 10 euros chacune). Premier bouleversement copernicien : la création d’une relation directe entre les artistes et leurs publics dès le stade de l’édition.
Le deuxième maillon, la production industrielle, est évidemment rendu inutile par la dématérialisation. Le point est d’importance : le fondement même de l’économie industrielle, la production quantitative de biens matériels, est mis hors-jeu. Les plates-formes numériques de téléchargement de titres musicaux, du type i-Tunes, réalisent, contre espèces sonnantes et trébuchantes, les duplications de fichiers voulues. Si des acteurs industriels disparaissent, d’autres apparaissent. Fabricants de matériel informatique (ordinateurs, appareils de lecture) et fournisseurs d’accès Internet sont aux premiers rangs : ce sont eux qui mettent en œuvre ces plates-formes numériques. Deuxième bouleversement copernicien : les internautes ont à disposition immédiate – hic et nunc –, et pour un achat effectué en toute légalité, des catalogues dont la taille est à l’échelle de l’économie informationnelle : 10 millions de titres pour la plate-forme i-Tunes.
La promotion, le troisième maillon, change de nature, les réputations se font et se défont désormais sur Internet :
« Inutile de chercher une place pour les concerts des New-Yorkais Clap Your Hands Say Yeah ou des Britanniques Arctic Monkeys au Trabendo à Paris mi-février, il n’y en a plus une seule. Tous les billets étaient déjà écoulés avant même la sortie de leurs albums respectifs. (…) Depuis plusieurs mois, des titres des deux groupes de rock circulent tous azimuts sur le Net, remplissent les baladeurs numériques et s’échangent par mail. Dans les deux cas, ils ont mis en ligne gratuitement quelques chansons sur leurs sites. Puis le buzz [le bouche à oreille sur Internet] a explosé, relayé par les MP3 blogs, ces sites d’amateurs éclairés qui commentent leurs coups de cœur, les concerts et proposent des chansons à télécharger. Clap Your Hands avait même réussi à vendre 30.000 albums autoproduits directement sur son site (Libération, 28 janvier 2006). »
Le cas du groupe Clap Your Hands Say Yeah est emblématique. Il prend en charge son propre lancement ainsi que le lancement de son premier album. Nul besoin de maison de disque ! Le téléchargement se signale ici comme un instrument promotionnel au service de la création (lancement d’un nouvel album) et de la musique vivante (les concerts). On parle dès lors d’échantillonnage (et non plus de piratage). Une étude prospective de l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe (Idate), parue en 2008, Nouveaux marchés de la musique : Numérique, gestion des droits, spectacle, anticipe une hausse du marché mondial de la musique sur la période 2007-2011 (3,9% de croissance annuelle en moyenne) avec, à la clé, de très fortes secousses. Une part de marché de la musique enregistrée qui descendrait à 41% en 2011 contre 50% aujourd’hui (de 33,5 à 28,5 milliards de dollars) tandis que celle du spectacle vivant, les concerts, progresserait de 38% à 48% (de 25,5 à 33,4 milliards de dollars). En octobre 2007, Madonna, star parmi les stars, abandonne Warner pour signer un contrat de dix ans avec le leader mondial de l’organisation de concerts, Live Nation. Tout un symbole ! Troisième bouleversement copernicien : l’offre et la demande de musique se déplacent, la musique enregistrée s’efface au profit de la création et de la musique vivante. Entraîné par le mouvement, le téléchargement gratuit se pare d’une nouvelle fonction : il contribue à la notoriété des artistes. La commercialisation, le dernier maillon, donne l’opportunité au téléchargement d’élargir sa palette :
« Le téléchargement de fichiers numériques amplifie les comportements d’achat : les amateurs de musique utilisent les fichiers numériques pour découvrir de nouveaux genres de musique, de nouveaux artistes et albums, ce qui tend à accroître leurs achats, tandis que les étudiants peu intéressés par la musique utilisent les fichiers numériques comme des substituts directs aux CD. Nous avons également montré que le canal de téléchargement possède sa propre influence : les communautés constituées autour d’un intranet exercent un impact positif sur les achats de CD [2]. »
Quatrième bouleversement copernicien : place, pour les amateurs de musique, au partage de la critique, à l’élaboration d’un savoir musical commun. Des sites dédiés rassemblent les amateurs de telle ou telle musique, de tel ou tel artiste. Ce sont autant de foyers culturels fondés sur le téléchargement gratuit… Une composante symbolique forte émerge : la consommation musicale est de plus en plus collective (les concerts, les sites d’amateurs, le partage des critiques) et de moins en moins individuelle. Si l’économie industrielle a été une économie de l’individu, l’économie informationnelle est une économie du collectif (un collectif à dimensions éminemment variables, en recomposition constante).
Une révolution copernicienne
au service de la création
Internet et, plus généralement, les technologies de l’information et de la communication sont ainsi à l’origine d’un véritable décentrage du marché global de la musique, d’une révolution copernicienne. Dans le modèle industriel, les maisons de disque sont au centre du jeu : elles imposent leurs règles et contrôlent le marché en regroupant en leur sein l’ensemble des fonctions d’édition, de production, de promotion et de commercialisation. Elles sont un passage obligé pour les artistes : elles les « labellisent ». Internet déstructure ce bel ensemble pour en constituer un nouveau, dont on a envie de dire que « le centre est partout et la circonférence nulle part ». Les sites d’amateurs éclairés, les sites d’artistes, les plates-formes numériques de téléchargement, les relations tissées jour après jour entre artistes et publics sont autant de centres différents les uns des autres… Logique d’uniformité et de quantité d’un côté, logique de diversité et de foisonnement créatif de l’autre. Domination des maisons de disque et de la musique enregistrée, hier ; dialogue de pair à pair entre artistes et publics, revitalisation de la création et de la musique vivante, demain. Deux environnements qui n’accordent pas la même valeur et le même intérêt au téléchargement gratuit de biens culturels. La loi «Hadopi» a clairement choisi de tourner le dos à l’avenir…