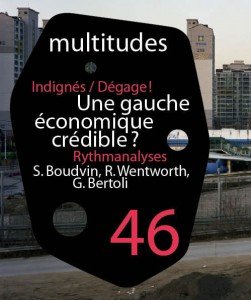Réflexions prospectives à partir de la nouvelle donne monétaire
Il n’aura pas fallu plus d’un an pour que le sauvetage de la Grèce tourne au vinaigre. Il est en effet désormais établi que la Grèce ne sera pas en mesure de se refinancer auprès des marchés à partir de la moitié de l’année 2012, comme l’avait prévu le premier programme de sauvetage de l’UE et du FMI en mai 2010. Après l’échec de ce premier programme, des nouvelles mesures en cours de négociation à hauteur d’environ 120 milliards d’euros devraient superposer au premier sauvetage des nouveaux prêts publics bilatéraux, le renouvellement de l’exposition d’une partie des créanciers privés ainsi que des engagements en matière de privatisations à hauteur de 50 milliards d’euros. Le tout étant assorti des mesures d’austérité les plus brutales jamais appliquées dans un pays de l’OCDE depuis la guerre.
Il n’est pas inutile de rappeler le contexte dans lequel s’est déroulé ce sauvetage. La zone euro se trouvait au bord d’une crise systémique. Et ce premier programme avait été l’un des éléments clés des mesures annoncées à l’issue d’une réunion d’extrême urgence des ministres de finance de l’EU le 10 mai 2010 dont la conférence de presse devait impérativement avoir lieu avant l’ouverture des marchés quelques heures plus tard.
La suite de l’histoire est bien connue. L’État grec a été mis sous perfusion de 110 milliards d’euros de prêts bilatéraux consentis par les autres États Membres de la zone euro pour lui permettre de continuer à couvrir ses besoin de financement pendant deux ans. Par la même occasion, un paquet de soutien potentiel de 500 milliards d’euros a été adopté pour d’autres pays de la zone euro : 440 milliards d’un mécanisme intergouvernemental, un deuxième mécanisme de 60 milliards garantis par le budget de l’Union Européenne, complété par des engagements du FMI pour 250 milliards d’euros. En outre, la Banque Centrale Européenne s’est engagée à procéder à des achats non conventionnels de titres de dette souveraine des pays fragilisés de manière à soutenir les prix de ces actifs sur les marchés secondaires. Depuis lors, à l’instar de la Grèce, l’Irlande et le Portugal ont été acculés à faire appel à des programmes de sauvetage UE-FMI rejoignant trois autres pays hors zone euro (Lettonie, Hongrie et Roumanie) qui ont demandé le soutien de l’UE et du FMI à l’automne-hiver 2008-2009.
Une situation grecque toujours critique
Un an plus tard, la situation de la Grèce reste critique. La dette publique continue à augmenter à un rythme infernal et devrait atteindre 160 % du PIB en 2012. En dépit d’un programme d’austérité – qui ne va pas sans évoquer les thérapies de chocs appliquées par le FMI en Amérique Latine pendant la « décennie perdue » des années 1980 –, les déficits ne se résorbent pas au rythme établi par le programme. Alors que le gouvernement grec a respecté ses engagements en matière de réduction des dépenses publiques, les recettes n’augmentent pas comme prévu. Ce qui vaut à la Grèce des récriminations incessantes sur les dysfonctionnements structurels de son système d’imposition et plus particulièrement son évasion fiscale généralisée depuis des décennies. Mais même les défenseurs les plus acharnés de la thérapie de choc reconnaissent que la difficulté à résorber le déficit est aussi due à la gravité de la récession qui dépasse les prévisions les plus pessimistes. La contraction des dépenses publiques débouche sur une diminution de la demande et donc du PIB, et aboutit in fine à l’augmentation du ratio dette/PIB. Cette dynamique de dette-déflation – déjà constatée dans le passé dans d’autres pays soumis à des thérapies de choc – fait craindre à juste titre que le programme n’enfonce la Grèce dans une décennie perdue.
BCE, Commission Européenne et FMI continuent pourtant de prétendre publiquement que la dette publique grecque est « soutenable », la crise actuelle étant une crise de liquidité et non pas de solvabilité. Cependant, le fardeau de la dette grecque doit être impérativement allégé pour une grande majorité d’économistes de tous bords, sous peine de continuer à enfoncer le pays dans une dépression économique sans précédent[1]. Et d’accroître le risque d’une cessation de paiements dans un futur proche, bien plus coûteux qu’un allègement organisé et concerté de la dette actuelle.
Le tabou de la restructuration de la dette
L’option d’une réduction du fardeau de la dette publique grecque et des autres pays périphériques reste à ce stade un tabou officiel dans l’UE. L’échec fracassant du premier plan d’ajustement grec ne donne dès lors aux autorités européennes d’autre choix que de continuer à se substituer aux marchés en poursuivant le financement des déficits grecs. Mais aussi en refinançant les stocks d’emprunts qui arrivent progressivement à échéance. De ce fait, les plans de sauvetage de la Grèce, mais aussi de l’Irlande et du Portugal, débouchent sur un transfert des risques par une socialisation des coûts potentiels de la crise de très grande ampleur. Les créanciers privés sont en effet progressivement remboursés et remplacés par des créanciers publics. Ces derniers exigent des pays « bénéficiaires » des taux inférieurs à ceux qui leur seraient demandés par les marchés, mais aussi bien supérieurs aux taux auxquels les fonds sont empruntés par les pays créanciers. Les niveaux d’endettement et donc les risques continuent à s’accumuler, mais se trouvent désormais concentrés dans les mains des contribuables.
Cela constitue de fait un nouveau sauvetage (bail-out) non avoué des institutions financières des pays du noyau de la zone euro. Comme le faisait observer lucidement l’éditorial du Financial Times du 17 novembre 2010, quelques jours avant le sauvetage de l’Irlande, l’UE ne veut pas abandonner le petit jeu diabolique qui consiste à ce que les pays du noyau de la zone euro prêtent à ceux de la périphérie de manière à ce que les banques et les pouvoirs publics de ces derniers remboursent les créances des banques des pays du noyau. Soit in fine l’externalisation des coûts de l’assainissement des bilans des banques des pays du noyau sur les contribuables. Ceux, d’abord, des pays périphériques soumis à des mesures d’austérité brutales. Et ensuite ceux des pays du noyau de la zone euro, qui se trouvent en deuxième ligne et devront assumer les coûts d’une inévitable restructuration future ou pire d’un défaut d’un ou plusieurs pays sous perfusion.
Dans le cas grec, les deux programmes additionnés se solderont par le transfert d’environ deux tiers de la dette des créanciers privés vers des créanciers publics entre mai 2010 et la fin de l’année 2014[2]. Une telle méthode ne peut que susciter l’inquiétude lorsqu’on commence à douter du fait que les thérapies de chocs permettront d’amorcer la réduction programmée des déficits, et à terme des ratios d’endettement. À l’instar des médecines médiévales consistant à saigner le patient, la purge préconisée risque au contraire de se solder par un affaiblissement fatal de celui-ci… et par le transfert de la facture des soins aux nouveaux créanciers du malade!
Un renforcement confédéral paradoxal
Une telle socialisation des coûts risque donc d’aboutir précisément à ce que les principaux pays créanciers des pays de la périphérie de la zone euro cherchent par tous les moyens à éviter. C’est-à-dire, une « Union des transferts » quasi confédérale. Avec la circonstance aggravante – aussi bien pour les fédéralistes que pour les eurosceptiques – que ce serait une « Union des transferts » involontaire et socialement injuste. Elle se ferait à l’avantage des détenteurs actuels des bonds de dette souveraine et au détriment de la majorité des contribuables de tous les pays, créanciers et débiteurs. Pour paraphraser Habermas, ce serait l’apothéose d’un processus technocratique d’intégration fonctionnelle sans intégration civique et donc sans légitimité démocratique. À politique inchangée, c’est le scénario vers lequel l’UE marche à vive allure.
Faire participer le secteur privé ?
Il n’est donc pas aussi étonnant que, après des mois de discours xénophobes quotidiens alimentées par les tabloïds d’outre-Rhin demandant sang et larmes aux Grecs pour payer la dette publique, ce soit pourtant le gouvernement allemand qui ait tenté de lever – sans succès – le tabou de la restructuration. La participation du secteur privé au sauvetage de la Grèce de l’accord Sarkozy-Merkel intervenu en juin 2011 revient en fait à demander le renouvellement volontaire des prêts arrivés à échéance d’une partie des créanciers privés, à hauteur d’environ 30 milliards d’euros avant la fin 2013. Or le premier programme d’ajustement prévoyait pourtant un refinancement des crédits privés à hauteur de 90 milliards d’euros dans le même intervalle puisque la Grèce allait retourner se financer aux marchés dès 2012!
En tout état de cause, les tentatives visant à faire participer les créanciers privés viennent donc tout naturellement des pays où les contribuables se trouvent proportionnellement les plus exposés aux coûts potentiels liés à la socialisation progressive des créances grecques. Après les premières tentatives maladroites et in fine contreproductives de l’automne dernier de la Chancelière Merkel[3] visant à faire participer les créanciers privés aux coûts des sauvetages, son ministre des finances Wolfgang Schauble a laissé de nouveau entendre plus récemment que ce tabou devrait être levé, avec une levée de boucliers et fin de non recevoir particulièrement virulente de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Le chantage de la BCE
C’est donc désormais la BCE qui véhicule le discours le plus virulent à l’encontre de toute forme d’allègement du fardeau de la dette grecque avec, fin mai 2011, une véritable campagne de terreur concertée au plus haut niveau à l’encontre de toute forme de restructuration de la dette. Même un simple rééchelonnement aurait selon l’institution des effets catastrophiques sur la confiance et déboucherait sur la ruine du système financier grec et d’éventuelles contagions des autres pays difficiles. La perspective d’un nouveau Lehman & Brothers a même été évoquée avec succès par les médias comme conséquence quasi-automatique.
Au début de juin 2011 le gouverneur de la Banque de France et le directeur de la BCE Lorenzo Bini Smaghi sont passés du traditionnel discours entretenu depuis 2010 par Jean-Claude Trichet sur les effets néfastes de toute restructuration à un discours de chantage. En cas de restructuration, la BCE refuserait de refinancer les banques grecques et toute autre banque en contrepartie des titres de la dette souveraine grecque, puisque les agences de notation dégraderaient aussitôt la dette de l’État grec au statut de déchet (junk). Une telle menace mise à exécution déboucherait effectivement sur l’effondrement du système financier grec et ne manquerait pas de déclencher des effets contagion transfrontaliers. Mais, ce faisant, le discours de terreur acquiert une dimension auto-réalisatrice.
Un tel refus est en effet discrétionnaire. Rien dans les statuts de la BCE ne l’obligeant à ne plus refinancer les banques grecques puisque elle a la latitude de décider quels seront les actifs acceptés en gage de ses opérations de refinancement. Une telle latitude a été par ailleurs l’un des instruments des choix de la BCE pour contribuer à la gestion de la crise. Depuis octobre 2008 elle a ainsi considérablement élargi la gamme et la qualité des actifs acceptés en contrepartie de ses refinancements des banques de la zone euro. Il est d’ailleurs remarquable que ce scénario apocalyptique n’ait été accompagné d’aucune étude d’impact chiffrée. Les quelques études disponibles à ce stade appuient en revanche l’hypothèse selon laquelle une restructuration menée de manière bien organisée et assortie d’un mécanisme de soutien explicite des autres États membres serait en mesure de limiter les effets de contagion et d’éviter l’effondrement du système financier grec.
La BCE au centre de la tourmente
La BCE exige dès lors publiquement, sans aucune pudeur et bien au-delà de l’esprit du mandat qui lui est attribué par les traités européens, la poursuite pure et simple de la socialisation de cette dette au nom de la stabilité financière. Il est vrai que, prosaïquement, la BCE est fortement exposée aux risques découlant de toute forme de restructuration de la dette grecque. Son bilan est en effet chargé de créances vis-à-vis de la Grèce, une perfusion sans laquelle les banques ne sauraient survivre car soumises à une véritable hémorragie des dépôts des particuliers grecs, passée d’abord par la sortie des dépôts des plus riches, ensuite par le désengagement progressif des moyens et des petits épargnants qui cherchent à placer leur épargne à l’étranger. La concentration du risque de crédit lié à la dette publique grecque entre les mains des banques privées grecques elles-mêmes est donc devenue particulièrement aigüe. Plus personne, y compris les particuliers qui en ont les moyens, et en tout cas plus aucune banque étrangère ne veut prêter de l’argent à ces banques. Et de l’autre côté du bilan, la demande de crédit privée s’effondre aussi avec l’ampleur de la récession économique.
Les montants engagés par la BCE dans les opérations de refinancement des banques grecques sont supérieurs aux prêts bilatéraux officiels consentis par les autres États Membres pour la période 2010-2012, comme pour l’Irlande et le Portugal. Les États Membres de la zone euro, garants financiers et détenteurs du capital de la BCE, sont de fait collectivement exposés à des coûts potentiels énormes. Mais un tel sauvetage implicite a largement échappé à l’attention des opinions publiques et n’est soumis à aucun contrôle politique et parlementaire. Il découle des opérations normales menées par la BCE en toute autonomie dans le cadre de sa politique monétaire[4]. Sauf que ces opérations ont pour vocation d’assurer un niveau de liquidité adéquat du système bancaire dans des circonstances normales, et nullement de porter à bout de bras des institutions exsangues et coupées du financement des marchés interbancaires. La politique statutaire de la BCE est en effet fondée sur la règle consistant à apporter des liquidités à des banques solvables en contrepartie d’actifs adéquats et de bonne qualité. L’apport de liquidités au système financier doit être neutre du point de vue distributif avec, dès lors, la possibilité d’assurer une séparation effective entre politique monétaire et politique budgétaire et fiscale. Aussi, la prémisse de la neutralité distributive se trouve au fondement de la justification de l’indépendance des Banques Centrales.
Force est de constater que, à partir du moment où la survie des systèmes bancaires des pays faisant l’objet d’opérations de sauvetage dépend des liquidités fournies par la BCE, il est impossible de séparer l’enjeu de la liquidité de celui de la solvabilité. Cela est d’autant plus évident que le passif des banques grecques repose sur les prêts consentis par la BCE au taux d’intérêt nominal de 1,25 % (et donc d’un taux réel négatif), alors que l’actif est composé d’une forte proportion de titres de dette publique qui apportent des taux bien supérieurs. Dès lors, le soutien substantiel apporté par la BCE permet à ces banques non seulement d’éviter la faillite quasi immédiate mais aussi d’utiliser le différentiel de rendements pour reconstituer leurs capitaux propres mis à rude épreuve par la récession, et ce aux frais du contribuable. Dans ces circonstances, il s’avère difficile de soutenir la prémisse de la neutralité distributive de la politique monétaire. Et ce n’est donc pas étonnant si l’on continue officiellement de diagnostiquer et traiter la crise, comme crise de liquidité et non pas de solvabilité. Accepter le contraire, comme vient de le faire fin juin 2011 le gouverneur de la Banque d’Angleterre, reviendrait dans les circonstances actuelles à faire vaciller la séparation entre politique monétaire et politique fiscale sur laquelle repose toute la justification de l’indépendance des Banques Centrales depuis la fin de Bretton Woods.
Ce qui se joue donc derrière les menaces et le refus virulent (et à ce stade efficace) de la BCE d’envisager un quelconque autre scénario que celui de la socialisation de la dette publique grecque va donc bien au-delà d’une considération purement économique. Il y a de bonnes raisons de croire qu’une restructuration ordonnée de la dette grecque, même de type « plan Brady à l’européenne »[5], voire des dettes irlandaise et portugaise, n’aboutirait vraisemblablement pas au scénario apocalyptique annoncé par la BCE. Mais elle se traduirait par une remise en question fondamentale des acquis politico-institutionnels sur lesquels repose le système financier de la zone euro. Plus particulièrement en ce qui concerne la BCE elle-même, un tel scénario déboucherait sur une remise en question fondamentale de son indépendance même et donc de sa logique de fonctionnement. Pour se préserver, la BCE continue dès lors à prétendre que la Grèce et les autres pays fragilisés de la zone euro sont solvables, même si cela passe par le fait de rendre prioritaires des politiques d’austérité par rapport aux politiques et procédures qui règlent l’allocation des ressources publiques dans un État de droit. La contrepartie de l’indépendance de la BCE devient dès lors un cadre de politiques économiques d’exception, où le remboursement des créanciers acquière une préséance sur les autres postes des dépenses publiques[6].
La nouvelle donne monétaire : quelques pistes prospectives
L’hypothèse de travail défendue ici est que la séparation entre politique monétaire et politique budgétaire et fiscale, sur laquelle repose la justification de l’indépendance des banques centrales depuis la fin de Bretton Woods, a désormais atteint une limite qui nous oblige à repenser la place de la politique monétaire dans une optique de sortie de crise. C’est ce que nous appelons ici la nouvelle donne monétaire.
Il s’agit sans doute non pas tant de revenir vers le système de type « Trente glorieuses » de monétisation centralisée et contre-cyclique d’une partie des déficits publics (deficit spending), mais de mettre en place le chantier d’une déprivatisation décentralisée de la monnaie. Cela constitue à mon sens une étape allant de pair avec la restructuration des dettes souveraines insoutenables dans la zone euro. La possibilité d’avoir des majorités rouges-vertes de part et d’autre du Rhin à partir de 2012-2013 constitue à cet égard une fenêtre politique dont il faudra pouvoir se servir.
Pour appuyer une telle hypothèse de travail, il y a lieu dans un premier temps de déconstruire le cadre théorico-conceptuel sur lequel s’appuie le récit de la neutralité budgétaire de la politique monétaire. Cela nous amènera à décoder la crise actuelle, à la fois politique et épistémologique. Il s’agira ensuite d’énumérer un ensemble de chantiers théoriques et politiques à mettre en place à partir de la nouvelle donne monétaire.
La crise de la zone euro comme crise épistémologique et politique
Comme le met en exergue l’économiste Axel Leijonhufvud[7], à partir du moment où l’hypothèse de la neutralité distributive de la politique monétaire est battue en brèche, il devient impossible de défendre la doctrine de l’indépendance des banques centrales dans des sociétés démocratiques. Il en ressort que l’enjeu de la remise en cause d’une telle hypothèse est aussi bien théorique que politique. Les éléments mis en perspective ci-dessus à partir de la situation de la zone euro nous permettent d’emblée de problématiser l’hypothèse sur une base factuelle en temps de crise. Mais il convient de compléter cette analyse par une problématisation du cadre épistémologique sur lequel repose une telle hypothèse de neutralité en temps normaux.
La crise financière globale a eu du moins le mérite d’avoir amorcé un débat intense sur les limites et impasses du paradigme dominant dans la théorique macroéconomique. Dans deux articles en ligne remarquables, les économistes Willem Buiter et Rajiv Sethi[8] font la synthèse de ces limites et impasses pour mettre en perspective les outils conceptuels développés aux marges du paradigme dominant qui s’avèrent utiles pour comprendre la crise. Rappelons qu’il s’agit ici d’une critique interne différente de celle désormais classique de la discipline économique faite notamment par les sociologues et qui se base sur l’irréalisme des hypothèses et modèles. Les auteurs renvoient dos à dos les nouveaux classiques et les nouveaux keynésiens qui depuis les années 1980 partagent un même arrière-plan conceptuel, qui est celui des modèles dynamiques stochastiques d’équilibre général. Quand bien même ces deux écoles tirent des conclusions opposées sur le rôle stabilisateur de l’État, il n’en reste pas moins qu’elles partagent un appareillage théorique qui ne permet pas de répondre à un certain nombre de questions, puisqu’il ne permet même pas de les poser !
Parmi les hypothèses de base du cadre dominant en macroéconomie on trouve le paradigme de la complétude des marchés et la place de choix accordée à des modèles linéaires. Ces hypothèses permettent notamment d’appréhender dans la tradition ouverte par Frisch et Slutsky les fluctuations économiques comme étant le résultat de chocs exogènes (non expliqués par le modèle) à la structure de l’économie dont des changements des préférences des agents ou des changements technologiques. L’idée clé ici est que des impulsions irrégulières et erratiques sont intégrées et transformées dans des oscillations relativement régulières et auto-stabilisantes par la structure de l’économie. Une approche différente des cycles économiques utilise au contraire des modèles non linéaires pour capturer d’autres faits stylisés ou phénomènes types. Et plus particulièrement des divergences créées par des chocs modestes et des chocs plus forts, des effets corridor ou des effets seuil générateurs d’instabilité, des fluctuations endogènes bornées ou encore de l’incertitude et de l’instabilité endogène créée par des interactions prévisibles et des tendances réputées stables.
Parmi les phénomènes types que des modèles non linéaires permettent de styliser dans le sillage d’économistes tels que Robert Shiller, George Akerlof ou Hyman Minsky, il ya lieu de mentionner des processus cumulatifs qui s’avèrent explosifs une fois qu’un certain seuil est franchi, soit des bulles, et plus particulièrement des bulles financières ou encore des dynamiques de dette-déflation. Dans la même optique, ces cadres conceptuels permettent de thématiser des phénomènes tels que l’insolvabilité et des effets macroéconomiques déstabilisateurs et non auto-correcteurs découlant des niveaux d’endettement privé et plus généralement des effets leviers présents dans l’économie.
Il résulte également de la problématisation de l’approche mainstream prévalente notamment dans les banques centrales qu’il ne suffit pas de contrôler l’inflation pour éviter des effets distributifs découlant de la politique monétaire. Durant les années de stabilité qui ont précédé la crise, caractérisées par des faibles taux d’inflation, on a assisté dans plusieurs cas au gonflement spectaculaire des prix dans le secteur immobilier. Et à une augmentation tout aussi explosive des niveaux d’endettement des ménages et des entreprises. Ces deux processus ont été favorisés par les faibles taux d’intérêt directeurs appliqués par les banques centrales, notamment durant les périodes de retournement de la conjoncture.
Depuis la moitié des années 1970, les banques centrales ont de fait renoncé à contrôler la croissance de l’offre de monnaie pour se tourner vers le contrôle de l’inflation par l’instrument du taux d’intérêt tout en laissant l’essentiel de la création de monnaie-crédit au système bancaire. Le résultat d’une telle politique a été la fausse perception d’une période prolongée de stabilité déstabilisatrice, selon l’expression désormais célèbre de Minsky et le gonflement des bulles financières insoutenables et non thématisées comme telles. Cela a aussi débouché sur des effets distributifs ayant joué à l’avantage des « intermédiaires » financiers. Le tout a permis la captation des externalités positives pendant les années de croissance et de fausse stabilité et le relâchement des externalités négatives découlant de la crise systémique, lorsque les processus autoréférentiels et accumulatifs de la demande et de la dette privée atteignent des seuils de discontinuité.
Une autre conséquence de la problématisation du cadre épistémologique dominant en macroéconomie est que, dans une économie financiarisée, la séparation entre politique monétaire, d’une part, et fiscale et budgétaire, de l’autre, est fictionnelle non seulement en temps de crise, mais aussi en période « normale » et de « stabilité ». Le gonflement des bulles financières alimentées par la croissance de la dette privée a permis la dispersion de produits toxiques et l’accumulation du potentiel de crise systémique dans le système économique. À l’instar des gaz à effet de serre dispersés par l’homme dans l’atmosphère et partiellement absorbés par l’océan, les bilans des banques centrales ont absorbé une partie des produits toxiques créés pendant les années fastes. Mais, dans les deux cas, des effets de deuxième tour (second round effects) ne manqueront pas de se manifester dans le futur et d’accroître l’incertitude, lorsque les flux entre océan et atmosphère se feront dans l’autre sens. En tout état de cause, les pouvoirs publics et les banques centrales n’auront pas les moyens de gérer une prochaine crise systémique d’ampleur analogue à la précédente. Ce qui rend d’autant plus urgent que l’on soit en mesure de dépasser le partage fictionnel sur lequel se fonde la légitimation de l’indépendance des banques centrales depuis la fin des Trente glorieuses. La nouvelle donne monétaire résulte justement du fait qu’après avoir mis en place des mesures exceptionnelles, qui ont sans doute empêché une nouvelle dépression économique, il est peu vraisemblable que les banques centrales retrouveront leur périmètre de responsabilité d’avant la crise.
Quelques chantiers prospectifs
Dans la boucle que nous venons de faire sur la nouvelle donne monétaire, la restructuration de la dette publique grecque devient une nécessité si l’on veut éviter que l’UE poursuive après 2012 des politiques punitives et suicidaires pour la Grèce et le restant de l’UE, mais aussi un enjeu politique majeur. Celui de viser à amorcer une déprivatisation décentralisée de la monnaie. À long terme, une telle déprivatisation comporte des mesures que nous ne pouvons que citer dans ce cadre, telles que la mise en place d’un système bancaire avec 100 % de réserves (full reserve banking system) et le financement d’un revenu garanti de base par émission monétaire.
Dans un premier temps et plus pragmatiquement, cela passe par toute une série de chantiers à mettre en place une fois que l’on commencera à accepter l’évidence de l’échec du nouveau programme grec et des programmes mis en place en Irlande et au Portugal. Et que l’on commencera aussi à prendre la mesure des bombes à retardement espagnole et italienne.
L’inévitable restructuration de la dette grecque devrait se faire idéalement en 2012 mais, étant donné le verrouillage qui prévaut à l’heure actuelle, le plus vraisemblable est qu’il n’intervienne qu’en 2013. Une telle opération de restructuration pourrait se faire sous forme d’un plan Brady à l’européenne où les titres de dette actuelle seront échangés aux prix des marchés avec des titres émis par le futur Mécanisme de Stabilité Financière ayant une cotation AAA. Le tout devra être accompagné d’un mécanisme de backstop visant à assurer une recapitalisation adéquate des banques par le biais de mécanismes d’échange de dette par des actions (debt to equity swaps)[9].
Étant donné le délestage des créanciers privés qui sera intervenu dans l’intervalle, la décote (haircut) des créanciers extérieurs restants ne pourra qu’être significative et atteindre environ 75 % si l’on veut ramener la dette publique à un niveau gérable. Un échange pour des bons de même valeur faciale du futur mécanisme de stabilité mais ayant des coupons (taux d’intérêt) plus faibles et une durée de vie plus longue pourrait ensuite être accordé aux autres créanciers, dont les banques grecques et les créanciers publics[10]. Une telle décote des créanciers extérieurs semble sans doute sévère mais il faudra faire remarquer que ces créanciers externes auront déjà réussi à se délester sans frais d’une bonne partie de leurs créances au détriment du secteur public et qu’ils auront eu cinq ans de subsides implicites et explicites pour assainir leurs bilans. Il faut par ailleurs signaler que les banques allemandes et françaises ont déjà signalé qu’elles pourraient absorber sans trop d’encombre les pertes liées à une restructuration profonde de la dette publique grecque. Dans la mesure où il s’agit in fine de définir un des critères permettant de jauger l’insoutenabilité de ratios de dette publique, il y a lieu de prendre exemple sur l’Islande. Celle-ci a fait du principe de capacité de paiement une base légale explicite de remboursement des créances externes en limitant leurs montants à une proportion de la croissance de son PIB. D’autres variantes de plafonds définis en fonction d’un ratio dette/PIB maximum pourraient être déclinées en fonction des spécificités nationales.
De manière parallèle à la restructuration, trois dispositifs complémentaires visant à amorcer quelques pas vers une délimitation positive du rôle actuel de la BCE et n’exigeant aucune ingénierie juridique lourde pourraient être mis en place rapidement. Tout d’abord, un schéma de limitation des prérogatives quasi-budgétaires de la BCE, similaire à celui mis en place par la Banque d’Angleterre, qui assortit tout mécanisme non conventionnel de refinancement des banques à l’octroi par l’autorité budgétaire d’une garantie publique explicite. Cela devrait amener les gouvernements des États membres à exercer un contrôle plus étroit des banques sous perfusion. Un tel mécanisme devrait également obliger la BCE à définir l’évaluation des actifs acceptés comme contrepartie, de commun accord avec l’autorité budgétaire, ouvrant un espace de contrôle politique.
Il y aura lieu d’explorer également l’introduction de coefficients de réserves obligatoires différentiés par pays et de manière générale l’adoption d’une boite à outils commune sur la base notamment de l’évolution de la croissance du crédit et de la surveillance qualitative et quantitative des développements de la liquidité dans le système de crédit, des bulles dans les marchés financiers et des autres actifs non comptabilisés dans l’index des prix à la consommation. La définition des taux de ces coefficients et autres outils d’intervention devrait elle-même être décidée de commun accord avec l’autorité budgétaire.
Troisièmement, la Commission Européenne a annoncé la création en 2012-2013 de project bonds européens visant à financer dans les années à venir, à hauteur de plusieurs centaines de milliards d’euros, des projets d’infrastructure et d’investissement de long terme. Face aux contraintes drastiques auxquelles feront face les finances publiques dans les années qui viennent, ce sera l’une des rares sources additionnelles de financement d’investissements publics. Dans la mesure où le futur mécanisme de financement d’investissements comporte d’emblée une dimension de socialisation des risques de par les garanties publiques sous-jacentes, il importe d’en faire un véritable levier de création d’externalités positives. Il s’agit dès lors d’élaborer des mécanismes démocratiques révisables de mise en équivalence monétaire des bénéfices apportés par les externalités positives et les coûts générés par les externalités négatives associés aux projets financés. Une politique active d’achat de ces obligations européennes par BCE permettrait également de garantir un niveau des prix compatible avec les taux d’actualisation recherchés.
Ces quelques chantiers, loin d’être exhaustifs, précisent donc un certain nombre de pistes de travail dont des prochains gouvernements européens progressistes ne pourront pas faire l’économie, sous peine de revenir à des partages rendus caduques par la crise.