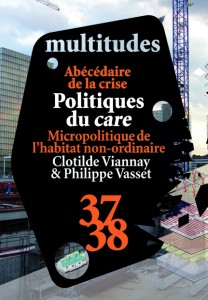L’existence du squat, que l’on peut définir comme le fait d’habiter dans un logement vide sans disposer de titre légal d’occupation, est aisément analysable au prisme des mutations de la ville post-fordiste. Les squats alternatifs, qu’ils soient orientés vers une démarche artistique ou vers un engagement militant (l’un n’étant pas exclusif de l’autre), constituent autant de tentatives d’habiter autrement dans un contexte fragilisant, sur le plan économique comme statutaire. On rencontre ainsi dans toutes les grandes villes d’Europe des collectifs, composés en majorité de jeunes gens, pour lesquels le squat permet de remédier aux difficultés d’accès au logement ordinaire, en même temps qu’il constitue une expérience communautaire favorisant d’autres rapports à soi et aux autres (l’autogestion, la solidarité, l’autonomie face aux pouvoirs établis). On trouve par ailleurs dans les squats nombre de personnes mobiles. Travailleurs saisonniers, employés à durée déterminée sur un chantier, mais aussi commerçants informels ou travellers européens, toutes ces « fourmis » de la mondialisation[1] sont susceptibles de transiter un jour ou l’autre par le squat, à défaut de trouver des formes légales d’habitat présentant la souplesse requise par la brièveté des séjours (et par l’absence de problématique de « réinsertion sociale »). Mais les squats, ce sont encore et surtout des lieux dans lesquels habitent les « travailleurs pauvres » d’aujourd’hui, autres figures centrales du capitalisme dérégulé.
Les squatteurs, des travailleurs pauvres parmi d’autres
Les « travailleurs pauvres » sont actuellement estimés par l’INSEE à 1,2 millions de personnes, soit 6 % de la population française. Employés ou indépendants, ils travaillent plus de six mois de l’année (les deux tiers travaillent toute l’année), mais appartiennent à un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté[2]. Si la catégorie recoupe des situations hétérogènes, et concerne par exemple les « intellectuels précaires », la plupart ont de faibles niveaux de diplômes et leurs emplois sont peu qualifiés : aides à domiciles, femmes de ménage, travailleurs en intérim constituent l’essentiel de ce prolétariat contemporain[3].
Les « travailleurs pauvres » sont donc ceux dont les revenus – salaires et prestations sociales – ne parviennent pas à couvrir les frais de la vie quotidienne ordinaire. Ceux qui, en somme, subissent de plein fouet la crise économique ou, de manière plus structurelle encore, le démantèlement de la société salariale à l’œuvre dans les pays occidentaux. Comment accéder au logement de droit commun lorsque, dans le même temps, les impératifs budgétaires et la paupérisation des habitants des HLM conduisent les bailleurs sociaux à sélectionner toujours plus strictement les candidats, et que les prix du secteur privé ne cessent d’augmenter ?
La question, qui se pose pour une large part de la population (les vastes « classes moyennes » ne sont pas épargnées), ne peut être cependant abordée d’un strict point de vue économique. Si les squatteurs sont des travailleurs pauvres parmi d’autres, ils sont en effet plus souvent étrangers, ou perçus comme tels, que la moyenne de la population. Le squat est l’une des conséquences des choix politiques pris en matière d’ « accueil » des migrants ; il révèle l’existence de populations sciemment exclues des sphères du travail et de l’assistance[4], par crainte notamment d’un « appel d’air » redouté. C’est maintenant au niveau européen que sont adoptées les lois restreignant l’accès aux droits des immigrés. En raccourcissant la durée des permis de séjour, en restreignant le droit au regroupement familial, en vidant de son contenu le droit d’asile, l’Europe travaille à faire triompher les impératifs économiques sur les droits fondamentaux – à disposer d’une main d’œuvre docile, et bon marché.
Une vie ordinaire bouleversée
Le squat fait donc partie des multiples formes de logements précaires dans lesquelles les « vaincus » du néo-libéralisme trouvent à se réfugier. Le récit de la rue Cavaignac, sur lequel nous nous appuierons désormais, l’illustre de manière frappante, en même temps qu’il montre la banalité de la vie des habitants d’un squat, dans sa quotidienneté.
Nous sommes au 3-5 rue Godefroy Cavaignac, dans le 11ème arrondissement de Paris[5]. Dans cet immeuble vétuste de 6 étages habitent une vingtaine de familles et quelques hommes célibataires. Trois appartements sont occupés par des « Français »[6], qui disposent d’un bail soumis à la loi de 1948. Tous les autres habitants sont originaires d’Afrique subsaharienne (Mali, Guinée et Sénégal) et occupent les appartements sans droit ni titre. Les premiers squatteurs de la rue Cavaignac sont essentiellement des familles monoparentales (donc des femmes seules avec des enfants), en situation régulière et disposant d’un emploi, mais mal, voire très mal-logées : hébergées par des parents dans des situations d’extrême surpeuplement, occupant des chambres insalubres, ballottées d’hôtels de tourisme en foyers. Avec l’aide de l’association Droit Au Logement, l’immeuble est « réquisitionné » et les familles s’y installent à la fin de l’année 1999. Il faut dire que la majorité des appartements sont vacants : selon les habitants, le propriétaire (une société civile immobilière) conserve l’immeuble vide afin de pouvoir le revendre au prix fort – l’occupation des appartements complique la vente, et peut en faire baisser le prix. Entre 1999 et 2008, quelques personnes ont déménagé, d’autres sont arrivées. Mais la plupart sont restées les mêmes. De fait, les alternatives sont rares : la plupart des habitants ont de tout petits salaires, ce sont des gardiens de parkings, des agents de sécurité, des femmes de ménage. Noirs, qui plus est[7]. Autant dire que malgré les demandes de logement social réitérées chaque année, les espoirs de déménagement sont presque inexistants. Cet immeuble laissé vacant constitue alors un espace dans lequel se mettre à l’abri, où s’installer.
Tidiane, par exemple. Né au Sénégal d’un père guinéen et d’une mère sénégalaise, Tidiane a grandi au Mali, dans une famille aisée et cultivée. Il est arrivé à Paris en 1998, afin d’entamer des études supérieures de gestion. Il loge d’abord chez son frère aîné, partageant la chambre de l’un des fils. Mais son frère lui demande de payer un « loyer » que Tidiane trouve excessif. Surtout, il est autoritaire, et les relations entre les deux hommes s’enveniment, jusqu’à ce que Tidiane soit mis à la porte. Il est alors hébergé pendant quelques semaines par un cousin. Mais là encore, la situation ne peut guère durer. C’est alors qu’un étudiant de son université lui parle d’une chambre vide, située au-dessus de l’appartement qu’il habite (légalement). Tidiane visite la chambre du dernier étage. Petite, en fort mauvais état, la chambre a pourtant l’attrait de l’indépendance, le goût de la liberté. Trois jours plus tard, Tidiane répare la porte branlante, fait un grand ménage, puis remplace les papiers peints, contacte EDF, se débrouille pour meubler : le voilà dans ses meubles. Une dizaine de mètres carrés, avec un coin pour la toilette, et les WC sur le palier.
Huit ans plus tard, Tidiane habite toujours rue Cavaignac[8]. Il arrive en effet, moins rarement qu’on ne le croit, que les squats, caractérisés par l’instabilité, parviennent à se stabiliser. L’immeuble peut s’avérer totalement abandonné, le propriétaire accepter la signature d’une « convention d’occupation précaire » avec les habitants[9], ou les occupants se voir accorder un délai avant expulsion par le magistrat en charge du litige. C’est le cas de la situation qui nous occupe : le tribunal saisi par le propriétaire afin d’expulser les habitants sans droit ni titre a estimé en 2002 que ces derniers pouvaient demeurer dans l’immeuble en attendant d’être relogés, moyennant le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation[10]. Les occupants se considèrent alors, bel oxymore, comme des squatteurs légaux. Si d’un point de vue juridique, leur situation conserve certaines particularités – et le contrat dont ils disposent n’est pas aussi protecteur que l’est un bail[11] –, au quotidien, la vie se déroule « normalement » : les parents travaillent, les adolescents suivent des études, les enfants sont scolarisés dans le quartier. Les factures d’eau et d’électricité sont régulièrement payées, les espaces domiciliaires pleinement appropriés et rien ne distingue en apparence les appartements des squatteurs de ceux de leurs voisins : les habitants se sentent, à tout point de vue, chez eux.
Mais cette tranquillité va se trouver bientôt bouleversée. L’incendie survient très tôt, jeudi 18 octobre 2007. Dans la cage de l’escalier A, une poussette prend feu. L’immeuble n’est équipé d’aucun système de protection et le feu se propage à toute allure. De justesse, et avec l’aide des pompiers, les habitants parviennent à s’extraire de l’immeuble. Les vies sont sauves, mais le choc est brutal. Plusieurs personnes ont été intoxiquées par les fumées. Des mois après, les récits sont encore empreints d’émotion, chargés d’angoisse. Après l’incendie, les habitants sont accueillis par le CAS (Centre d’Action Sociale) de la Ville, qui leur fournit les objets de première nécessité. Très vite, l’information circule, relayée par les pompiers, la police, la SIEMP : l’immeuble n’a pas été trop gravement endommagé et après quelques menus travaux, les familles pourront bientôt le réintégrer. Elles seront ensuite relogées dans le parc social. En attendant, des chambres en hôtels sont attribuées. Mais les familles refusent de s’y rendre.
Distance sociale et impuissance publique
Le refus des hôtels par ceux qui se désignent maintenant comme « sinistrés » est source d’incompréhension. Georges Sarre, alors maire du 11ème arrondissement, fait distribuer en novembre une lettre à ses administrés dans laquelle il mentionne que « l’ensemble des personnes qui désiraient un hébergement ont reçu un soutien financier et une proposition de logement à l’hôtel. Malheureusement, certaines ont refusé ces solutions et ont établi un campement de fortune, dans des tentes placées sur le trottoir, au pied de l’immeuble »[12]. Pour les habitants, cette lettre relève de la manœuvre électorale : déjà en campagne (les municipales de 2008 ont lieu dans 4 mois), le maire d’arrondissement veut rassurer un électorat susceptible d’être dérangé par la présence des familles dans la rue. Mais plus globalement, les événements de la rue Cavaignac sont révélateurs d’une distance sociale entre certains institutionnels et les « sinistrés », qui se traduit par une forme d’indifférence, teintée parfois de mépris, et mêlée d’une incapacité à lire la situation au prisme des réalités vécues par les familles.
Car si les hôtels sont refusés, c’est sur la base de deux raisons que, pour peu qu’on les entende, on estimera difficilement oiseuses. Les hôtels d’abord sont situés à Villepinte, Longjumeau, Clichy-sous-Bois, Vincennes[13]… Très loin donc du 11ème arrondissement de Paris. Dormir à Longjumeau, amener les enfants à l’école métro Voltaire et travailler à la Défense très tôt le matin, tout en rentrant tard le soir (car tels sont les horaires des femmes de ménage) : l’équation est tout simplement insoluble. En outre, un problème de fond va se poser, relatif aux effets personnels demeurés rue Cavaignac. Quelques jours après l’incendie, la préfecture a autorisé les familles à réintégrer l’immeuble pour récupérer quelques affaires. Mais la plupart d’entre elles ne sont pas présentes ce jour-là : parce qu’elles travaillent, elles n’ont pu être jointes ou se libérer à temps. À nouveau, l’administration semble totalement ignorante des conditions de vie des habitants, et de ce que les « pauvres » ne sont pas disponibles à tout moment de la journée.
C’est aussi à l’aune de l’impuissance des pouvoirs publics face aux propriétaires privés que doivent se lire les événements de la rue Cavaignac. Pendant des années en effet, la Ville de Paris a adressé des mises en demeure à la société immobilière propriétaire de l’immeuble. Malgré les promesses formulées, celle-ci ne consentira jamais à effectuer les travaux de rénovation nécessaires à la mise en sécurité du bâtiment. En 2004 commence alors une procédure d’expropriation qui, en raison des recours entrepris par le propriétaire, n’aboutira qu’en 2007. La Société Immobilière d’Économie Mixte de Paris (SIEMP) va bientôt devenir propriétaire de l’immeuble de plein droit, et donc bénéficier de l’usufruit. C’est précisément à ce moment-là que se déclare l’incendie. Pour tous les acteurs en présence, son origine criminelle ne fait guère de doute[14]. Mais l’enquête de police visant à déterminer les causes et les responsables de l’incendie aboutira-t-elle un jour ? Nul ne le sait.
Les empêchements à agir des pouvoirs publics et le cynisme du propriétaire se donnent à nouveau à voir quelques jours après l’incendie. Le propriétaire poste alors des vigiles de sécurité devant l’immeuble, puis fait installer des portes blindées. Les habitants sont désormais interdits d’entrer. Et les pouvoirs publics, juridiquement démunis, sont dans l’impossibilité de contraindre le propriétaire à les laisser passer. La panique s’empare des « sinistrés », qui voient tous leurs biens personnels – les meubles, les bijoux, les titres de séjour…– confisqués, inaccessibles. Privés de tout, y compris de l’essentiel, les enfants doivent aller à l’école sans leurs cartables, les parents se déplacer sans leurs papiers. Il faut dans l’urgence trouver des habits, racheter des affaires de toilette, sans cesse improviser. Le sentiment de dépossession et d’injustice est à son comble. C’est dans ce contexte que les habitants décident d’organiser des tours de garde au pied de leur immeuble, afin que les entrées soient constamment surveillées et que leurs affaires ne leur soient pas dérobées.
Camper dans la rue, refuser l’hôtel : se mobiliser
Les premières nuits, les familles dorment à même le sol, sur des bâches. Rappelons que nous sommes au mois d’octobre. Une voisine (par ailleurs militante à Sud Rails) achète alors une vingtaine de tentes, qui formeront le « campement ». Un comité de soutien se forme progressivement : habitants et employés du quartier, militants politiques, syndicaux et associatifs[15] et quelques élus d’arrondissement se rassemblent. Un site Internet[16] puis une liste de diffusion sont créés, des réunions s’organisent. La lutte du comité porte d’abord sur la récupération rapide des effets personnels, et sur la réintégration des familles dans l’immeuble. On redoute en effet que les hôtels proposés par le maire d’arrondissement soient considérés comme une solution en soi et qu’ils signent la fin du projet de retour rue Cavaignac. D’ordre pratique, cette question de la réintégration est aussi profondément symbolique : il s’agit de réaffirmer la légitimité des familles à être là, dans cet immeuble et dans ce quartier, de faire donc en sorte que la figure du « squatteur » fasse place à celle du « sinistré ».
Mais très vite, il faut aussi agir sur d’autres fronts. Communiquer à destination du voisinage, des élus locaux, des médias, du grand public ; faire en sorte que les familles se mobilisent et que le groupe ne se défasse pas, lorsque l’épreuve est telle qu’elle favorise le repli et la stratégie individuelle[17] ; suivre la plainte en justice déposée contre le propriétaire pour la rétention des affaires, ainsi que l’enquête de police sur les origines de l’incendie ; identifier et interpeller les bons interlocuteurs : la Ville de Paris, la mairie du 11ème, la préfecture, le CAS, la SIEMP… Le 30 novembre 2007, le campement est finalement levé. Après deux mois passés dans l’espace public de la rue, l’épuisement est général. La perspective d’une réintégration rue Cavaignac s’éloigne : les travaux n’avancent pas, et il paraît de plus en plus évident que la Ville n’a pas intérêt à reloger les familles dans un bâtiment qu’il faudra tôt ou tard rénover de fond en comble. Surtout, les habitants ont pu récupérer leurs affaires (seul demeure le problème du mobilier), et obtenu des chambres d’hôtel situées cette fois dans le quartier. Mais même « bien » situé, l’hôtel est difficile à supporter. Tidiane l’explique avec force :
1« L’hôtel, j’aime pas et j’ai jamais aimé. Mon souhait, c’est d’avoir mon appartement, être chez moi, point barre. Parce que là tu t’organises, tu peux vraiment faire les choses comme tout le monde, quoi ! C’est-à-dire être chez toi, payer à la fin du mois ton loyer, t’es chez toi, tu t’organises quoi, tu essaies de faire ta vie ! Mais à l’hôtel, c’est une situation vraiment temporaire, tu peux même pas amener tes affaires parce qu’il y a pas suffisamment de place pour ça, et tu es obligé de faire face à beaucoup de contraintes, tu peux pas faire à manger, tu manges dehors, tu passes ta vie dehors, du coup ça devient beaucoup plus cher… Et puis tu ne peux pas t’organiser, par exemple en ce qui me concerne, tu peux pas avoir accès à Internet, et je travaille avec ça. C’est terrible !, ça te casse. Tu n’es plus efficace dans ton travail, tu n’es plus efficace dans tout. Tout change. Moi j’ai eu du mal à m’adapter, mais je me dis : tu n’as pas le choix. Il faut, pour continuer à vivre, continuer à avancer, continuer à vivre. Au début c’était très dur, mais je n’ai pas eu d’autre choix que de m’adapter, en attendant une solution définitive. Mais je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Maintenant imagine, le 5ème mois va commencer bientôt[18]… J’aurais pas imaginé que ça pourrait durer autant, franchement. Je me disais que ce serait 3 mois au maximum, et le 5ème mois va commencer. C’est une absurdité totale. Et puis nous sommes quand même avant tout des sinistrés : nous n’avons jamais cherché à avoir cette situation ! C’est pas une situation ni provoquée, ni voulue. Et maintenant nous sommes en train de payer le prix fort d’une injustice réelle. Et je n’ai malheureusement pas d’autre choix que de patienter, d’attendre jusqu’à ce qu’on puisse me trouver un logement définitif »[19].
Des sinistrés finalement relogés… À l’exception des plus fragiles
Près d’une année de lutte sera nécessaire pour que les habitants du 3-5 rue Cavaignac soient relogés. Il aura encore fallu convaincre la puissance publique de ce que les familles récemment arrivées rue Cavaignac devaient elles aussi avoir accès à un logement pérenne, argumenter contre l’idée selon laquelle les habitants demanderaient un traitement « privilégié », rappeler encore et toujours leur statut de « sinistrés »… Les HLM finalement attribués par la Préfecture de Paris et la RIVP[20] sont situés dans le 11e, le 13e, le 18e et le 20e arrondissement. Tous sont donc dans Paris intra-muros, ainsi que s’y était engagée la SIEMP.
Le travail du comité et la mobilisation des familles ont donc porté leurs fruits. Pourtant, près de deux ans après l’incendie, le bilan demeure mitigé. Plusieurs familles en effet vivent encore à l’hôtel ou chez des proches, et sont encore et toujours dans l’attente d’un relogement. Ce sont celles dont les situations s’avèrent, du point de vue institutionnel, « problématiques ». Ainsi de ces deux femmes qui, bien qu’habitant rue Cavaignac et étant en mesure de le prouver (témoignages, pièces administratives…), étaient locataires d’un autre appartement. La première, diabétique et invalide, louait une pièce de 10m2. La seconde, mère de deux enfants, était elle aussi locataire d’une pièce minuscule et insalubre. Dans les deux cas, elles expliquent qu’elles ne pouvaient renoncer à une domiciliation, alors que la rue Cavaignac ne présentait pas toutes les garanties de sécurité en matière de courrier et que des procédures administratives et juridiques décisives (pour percevoir une allocation handicap notamment) étaient en cours. Bien que gravement malade pour l’une, et seule en charge de deux jeunes enfants pour l’autre, ces deux femmes n’ont pas été considérées comme « prioritaires » par la Ville, et il semble peu probable à l’heure actuelle qu’elles soient un jour relogées.
Une autre personne n’a pu bénéficier d’un relogement en raison de sa situation administrative : il s’agit d’un « sans-papier », que la Préfecture se refuse à régulariser. Or en l’absence de titre de séjour, aucun accès au logement social n’est autorisé[21]. Hadja quant à elle, âgée d’une vingtaine d’années, n’a pas de problème de titre de séjour. Sa situation est pourtant particulièrement dramatique. Victime de violences infligées par sa mère, puis par le père de ses deux enfants, Hadja est fragile, socialement et psychologiquement. Placée sous tutelle, elle s’est vue retirer la garde de ses enfants suite à l’incendie de la rue Cavaignac. Elle entre alors en conflit avec les assistantes sociales du CAS, qui refusent désormais de s’occuper de son « cas », tandis que la SIEMP a dans un premier temps estimé qu’insuffisamment autonome, Hadja devait être hébergée dans une structure sociale. Le « ping-pong » institutionnel a ainsi duré des mois, jusqu’à ce que le comité, soutenu par un élu du 11ème arrondissement[22], parvienne à obtenir un appartement, situé à Aubervilliers. Avec cette HLM, Hadja peut espérer recouvrer la garde de ses enfants. On s’étonnera tout de même qu’elle soit la seule, parmi les anciens habitants de la rue Cavaignac, à être ainsi déplacée hors de Paris. Comment l’interpréter ? Absence de logement disponible, ou volonté délibérée de la Ville de se « débarrasser » d’une situation complexe et conflictuelle ? Il nous est en l’état impossible de trancher. Mais le constat est bien celui de l’éloignement, qui risque de fragiliser encore Hadja et ses enfants, en délitant les relations de proximité tissées dans le 11e arrondissement.
Enfin, une famille polygame rencontre elle aussi toutes les difficultés à être relogée. On sait tous les problèmes techniques, sociaux, juridiques et normatifs que pose habituellement le relogement des familles polygames[23]. Ici, les choses sont encore compliquées du fait du handicap moteur sévère dont pâtit la première épouse. La seconde épouse a la charge quotidienne de cette femme, mais aussi de ses enfants, et de l’ensemble des tâches domestiques. Sans travail rémunéré, ne parlant pas français, elle est par ailleurs elle-même très dépendante de son mari. L’interdépendance est donc généralisée. Comment dès lors maintenir une forme de lien qui ne compromette pas la vie quotidienne de la première épouse, tout en permettant à la seconde d’acquérir une certaine autonomie ? Après bien des atermoiements, l’administration décide d’accorder un appartement au couple estimé « légitime » (le mari et sa première épouse) et à leurs enfants, et de loger la seconde épouse dans un studio mitoyen. Mais les logements enfin attribués sont situés à l’étage, dans un immeuble sans ascenseur, et donc parfaitement inaccessibles à la première épouse… La procédure est interrompue et à ce jour, elle n’est pas encore débloquée.
Le temps passant, le comité de soutien de la rue Cavaignac s’est peu à peu défait. Comme dans toute mobilisation, l’usure gagne, l’indignation s’étiole, les priorités changent. Quelques nouvelles sont encore échangées, mais les familles comme les militants réinvestissent une vie privée qui a souvent pâti de ces mois de lutte, se tournent vers d’autres activités, d’autres mobilisations parfois. Il faut tout le volontarisme de l’un d’entre eux, et le respect de la parole donnée de la part d’un élu, pour que les dernières familles soient encore soutenues. Mais il n’est plus possible d’installer un campement : la force du collectif appartient au passé. Les situations sont à présent traitées de manière « individuelle », et les portes de l’administration de plus en plus difficiles à forcer. Pourtant, on l’aura compris, les plus fragiles des habitants de la rue Cavaignac sont aussi ceux qui demeurent, éminemment, mal-logés.
Conclusion
Les squatteurs n’ont rien d’exceptionnel. Loin d’être les « marginaux » que l’on dépeint souvent, ils sont au contraire idéal-typiques de la ville occidentale contemporaine, en tant qu’elle produit des zones de relégation et de non-droit, des citadins moralement disqualifiés et économiquement précarisés. Les habitants des squats subissent, comme tant d’autres, les mécanismes de paupérisation liés au développement d’un libéralisme « sauvage », dont la spéculation immobilière n’est pas la moindre des manifestations.
Les événements de la rue Cavaignac illustrent l’impunité dont jouissent ces spéculateurs, mais aussi les difficultés à agir des pouvoirs publics. Autant de paramètres qui favorisent la pérennisation de l’insécurité domiciliaire et nous interrogent sur les modalités par lesquelles un droit de propriété exercé de manière abusive, criminelle parfois, pourrait être limité. Il montre aussi qu’une pluralité de conditions est nécessaire au succès des mobilisations collectives en faveur des mal-logés : proximité du comité de soutien et des familles, expérience antérieure des militants susceptible d’être capitalisée, présence de relais politiques locaux fortement engagés, pérennité et régularité de la concertation, renouvellement des modes d’action, souplesse et adaptabilité des revendications… La lutte est longue et difficile, elle exige à la fois beaucoup de pragmatisme et de ténacité, d’idéalisme et de sens des réalités.
Ce récit indique enfin que le relogement des squatteurs se fonde principalement du point de vue institutionnel sur l’argument de l’« urgence » : seul un péril imminent (présence d’amiante, incendie) menaçant directement la vie des occupants semble de nature à mettre en mouvement la machine politico-administrative. Mais la qualité de « ménage prioritaire » est bien aléatoire : dès lors que les problématiques se cumulent au regard de l’administration française, les rouages se grippent et, l’inertie bureaucratique aidant, la machine finit par se bloquer. Il faut alors toute l’opiniâtreté de quelques « engagés » pour que les plus vulnérables ne soient pas définitivement écartés du droit au logement. Dans cet engagement à toute épreuve réside, peut-être, quelque chose d’une forme d’exceptionnalité.
Notes
[ 1] Alain Tarrius, La mondialisation par le bas : les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Paris, Balland, coll. Voix et regards, 2002.
[ 2] Christine Lagarenne, Nadine Legendre, « Les travailleurs pauvres en France : facteurs individuels et familiaux », Economie et statistique n°335, 2000, p. 3-25.
[ 3] Jouenne, 2005.
[ 4] On pense en particulier à la suppression du droit de travailler aux demandeurs d’asile en 1991 et de tout accès à l’aide sociale (en dehors d’une aide médicale d’urgence) aux sans-papiers en 1993.
[ 5] Le récit qui suit se fonde sur une série d’entretiens conduits avec des habitants et des membres du comité de soutien, que complètent des observations conduites au cours de réunions du comité et l’analyse de documents administratifs. Je remercie l’ensemble des familles et des membres du comité de soutien pour leur contribution, et plus particulièrement Philippe Craste pour sa gentillesse, sa disponibilité, et ses explications éclairantes sur les événements de la rue Cavaignac.
[ 6] Selon la terminologie employée par les familles africaines.
[ 7] C’est-à-dire d’autant moins en capacité d’accéder au logement ordinaire qu’ils subissent des discriminations ethno-raciales, de la part des bailleurs sociaux comme privés. Sur les discriminations dans le parc HLM, voir les travaux de Valérie Sala-Pala, « Le racisme institutionnel dans la politique du logement social », Sciences de la société vol. 65, 2005, p. 87-102..Sylvie Tissot « Logement social : une discrimination en douce », Plein droit n°68, 2006, en ligne à l’adresse http://www.gisti.org/doc/plein-droit/68/douce.html. Et ceux de Patrick Simon, Malika Chafi et Thomas Kirszbaum pour ce qui concerne le parc privé : Les discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social, note de synthèse du GIP GELD n°3, La Documentation française, 2001.
[ 8] Il est maintenant inscrit en doctorat et est employé à temps partiel pour la Ville de Paris comme animateur.
[ 9] La chose est rare en France. Les quelques conventions dont nous ayons connaissance ont été pour la plupart accordées à des squats d’artistes par la municipalité parisienne.
[ 10] S’élevant à 76 euros pour une personne seule. La Préfecture complétait cette somme, versée au propriétaire.
[ 11] Ainsi les locataires de la rue Cavaignac détenteurs d’un bail seront-ils directement relogés, ce qui ne sera pas le cas des squatteurs, comme on le verra.
[ 12] Lettre reproduite sur le site de la rue Cavaignac à l’adresse http://godefroycavaignac.viabloa.com.
[ 13] Voir la « lettre ouverte » à Georges Sarre signée par « l’assemblée générale du 27 novembre [2007] des familles sinistrées et du comité de soutien », publiée à l’adresse http://godefroycavaignac.viabloa.com.
[ 14] L’adjoint au maire de Paris en charge du logement, Jean-Yves Mano, déclare ainsi à propos de l’incendie : « Le propriétaire a intérêt à ce que l’immeuble soit vide. C’est une occasion rêvée pour lui de récupérer l’immeuble, juste avant l’expropriation. Il peut penser qu’avec les événements récents, il pourra dire : «je n’ai plus de squatteurs, je peux faire les travaux maintenant». Mais la mairie est déterminée à récupérer cet immeuble. On a affaire à des gens qui exploitent la misère humaine ». Interview parue dans le quotidien électronique Le post le 26 octobre 2007. http://www.lepost.fr/article/2007/10/26/1042447_ces-gens-la-exploitent-la-misere-humaine.htm
[ 15] Le PC, les Verts, LO, la LCR, le DAL et le CAL notamment sont représentés dans le comité de soutien.
[ 16] h http://godefroycavaignac.viabloga.com/.Celui-ci sera essentiellement alimenté pendant les premières semaines de la mobilisation, jusqu’à ce que les tentes soient enlevées.
[ 17] Sur les modalités de mobilisation des familles africaines mal-logées, on renvoie aux travaux très complets de Cécile Péchu, Droit au Logement, genèse et sociologie d’une mobilisation, Paris, Dalloz, 2006.
[ 18] L’entretien se déroule le 13 juin 2008.
[ 19] Sur les conditions de vie dans les hôtels et les garnis, on consultera la somme réalisée par Alain Faure et Claire Lévy-Vroelant qui mettent en exergue la précarité de cet habitat mais aussi le rôle qu’il a historiquement joué dans l’accueil des nouveaux arrivants dans la ville, dans Une chambre en ville. Hôtels meublés et garnis, 1860-1990, Paris, Créaphis, 2007.
[ 20] Régie Immobilière de la Ville de Paris.
[ 21] Un autre « sans-papier » habitant rue Cavaignac a pour sa part été régularisé, et relogé. Il semble que la personne précédente ait vu sa demande rejetée en raison de son arrestation préalable pour séjour irrégulier.
[ 22] Il s’agit de Jacques Daguenet, élu communiste.
[ 23] Pauline Gaullier, « La décohabitation et le relogement des familles polygames. Un malaise politique émaillé d’injonctions contradictoires », CNAF, Recherches et prévisions n° 94, 2008, p. 59-69.