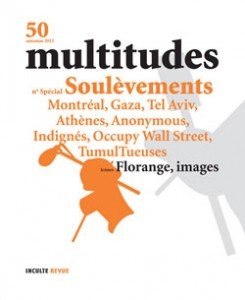Cher(e) Occupier,
Depuis longtemps, j’ai envie de t’écrire, mais j’ai voulu attendre de voir comment les choses se développent. Tout d’abord, je me présente. Fils d’immigrés qui ont réalisé le rêve américain, ceci est une lettre de démission de ce rêveTu as joué le jeu : « si on travaille dur, si on fait nos études, si on est honnête et moral, on réussira ». Te voilà endetté, surdiplômé et trop qualifié pour les rares emplois et salaires, licencié, non-syndiqué, te raccrochant de toutes tes forces à une certaine idée de la classe moyenne qui semble n’être plus qu’une chimère du passé.[[Marco Roth, « Lettres de démission du rêve américain » in eds. K. Gessen, A. Taylor, E. Schmitt, N. Saval, S. Resnick, S. Leonard, M. Greif, C. Blumenkranz, Occupy Wall Street: textes, essais, et témoignages des indignés (trans. L. Motet et J. Strauser), Paris : Édition des Arènes (2012), p. 50. Voir également, http://wearethe99percent.tumblr.com/.
J’imagine que tu en as assez des prétendus intellectuels qui, nostalgiques des avant-gardes du passé, rêvent de fonctionner comme votre bras théorique. J’imagine que tu crains qu’ils n’utilisent Occupy au seul profit de leurs agendas idéologiques ou pire, pour prendre la posture prestigieuse de l’engagement dans un monde qui n’est plus celui des années 60.
Mais je ne veux pas « théoriser » Occupy ni reposer la question du rôle des intellectuels dans la révolution. Afin de comprendre le monde nouveau qui en train de prendre forme, il faut, peut-être, arrêter de « faire de la théorie » (do theory) mais plutôt « défaire la théorie » (undo theory). Défaire la théorie, c’est mettre en cause toute position subjective ou politique qui se proclame absolue. Défaire la théorie, c’est constater que rien ni personne n’a le monopole de la vertu ni du savoir. Défaire la théorie, c’est défaire la dialectique, la pensée de l’État, et toute forme de science qui naturalise les hiérarchies sociales. Il s’agit d’occuper la théorie même afin de chercher un nouveau plan épistémo-politique. Votre revue Tidal, que j’ai lue et étudiée, est certainement un beau début (qui partage l’esprit de Multitudes). Dans cette revue, on voit clairement (et cette clarté étonne) Judith Butler défaire la théorie en disant, à juste titre, que les intellectuels ne sont pas des pouvoirs prescients et que la théorie ne peut pas dicter leurs actes à ceux qui s’identifient à des activistes. De plus, Butler nous rappelle que souvent les activistes sont des théoriciens et les théoriciens sont parfois des activistes ; dans ce chiasme complexe, la seule chose qu’on peut faire, c’est construire la cartographie des événements, de leurs effets, de la façon dont ils transforment les gens — et également la cartographie des lieux de l’injustice et de l’inégalité.[[Judith Butler, “So What are Our Demands,” in Tidal 2: Spring is Coming (March, 2012), p. 11. voir occupytheory.org Cette lettre, mon ami, est une esquisse de ces cartographies et également une occasion de penser Occupy avec toi. Passons, alors, du « je » au « nous. »
Wall-Street est un signifiant pour l’ontologie capitaliste et notre guerre est une guerre contre-ontologique, une guerre entre deux plans du monde, entre deux morphologies sociales. Notre guerre contre l’ontologie virale du capitalisme pose la question suivante : qu’est-ce qu’un humain, un corps, et un esprit ? Pouvons-nous les redécouvrir ailleurs ou plutôt les reconstruire au-delà du capitalisme mondial ? Et cet « ailleurs » n’est pas seulement l’espace concret que nous occupons, mais également l’imaginaire politique que cette occupation engendre. Ces questions sont également imbriquées dans l’autre question contre-ontologique que vous posez : Qu’est-ce qu’un État et quelles sont ses conditions nécessaires ? Il s’agit d’une question « méta-politique » ou d’une politique de la politique. Et à une question méta-politique ou contre-ontologique, on ne peut pas répondre avec une réponse discursive, mais seulement avec une réponse créative, une réponse qui émane de la rue. « La réponse » se trouvera dans notre désir d’élargir la vie politique au-delà des cadres normatifs, de défier l’ontologie capitaliste à travers la construction de lieux de pouvoir et de souveraineté qui existent au-delà du marché et de l’hégémonie des 1%.
Occupy est une machine critique. Cette critique lutte contre le simulacre de Wall-Street (l’ontologie capitaliste est une pseudo-ontologie), contre les fantômes de Wall Street et le capitalisme vampirique que Marx a bien décrit dans le Capital, dont le jeu est de te convaincre qu’il n’existe pas. Or, comme il a été écrit dans « Communiqué I », nous sommes des refugiés et exilés dans notre propre pays, malades d’une nausée spirituelle, d’une vie polluée par le bruit et le junk, avec des imaginations colonisées par des banalités[[Anonymous, “Communique I,” Tidal 1: Occupy Theory, Occupy Strategy, December 2012 (pas de numéros de page). Voire: occupytheory.org. Mais nous ne sommes plus des « suckers », ni une masse silencieuse qui préfère être dupée (Baudrillard avait tort).
Ainsi, Occupy oppose une volonté de vérité, d’authenticité, contre un monde trop virtuel. Nous incarnons des énergies sociales qui, pour Durkheim, sont « vraies ». Nous cherchons la sensualité et nous comprenons l’excès éthique et joyeux qui existe au-delà du junk. Sommes-nous l’excès négatif, la part maudite du système qui le perturbe et le démontre ? Ou sommes-nous de joyeux nomades en auto-créant une immanence pure. Bref, il faut préciser si notre critique procède par le jeu du négatif et la négation ou par une ligne de fuite qui affirme autre chose — le surhomme ou le retour du refoulé ?
L’affirmation est un art de maîtriser. Il y a une grande différence entre le « oui » de Nietzsche, le rire de Bataille et les jeunes anarchistes et hippies qui pensent que « le drum circle »[[Et oui, il est fort probable que ceux que sont dans le “drum circle” sont des membres du CIA. est une activité politique. En quoi notre « oui » consiste-t-il exactement ? Il exige de ne pas dégénérer dans l’imbécilité d’homo festivus et notre goût pour l’égalité ne doit pas se réduire à la parodie bobo de l’égalitisme. Rien de pire que la manifestation de 2002 contre Le Pen envahie par des ravers qui croyaient aller à une Love Parade. Notre manifestation n’est pas une révolution libidinale, mais plutôt une grève contre une corruption de l’énergie libidinale. Or, pour reprendre Philippe Muray, notre fureur doit être effectivement dirigée contre cet Homo Festivus et son euphorie perpétuelle, pauvre symptôme de l’impératif capitaliste à la jouissance perpétuelle. Cet impératif a participé à la création des 99%. Restons sombres, respectueux et toujours rigoureux dans notre rage. Et comme Marco l’a suggéré, comme nos compatriotes qui ont souffert pendant la dépression américaine, nous devons être stoïques, armés de notre aliénation et de notre pauvreté vertueuse.[[Roth (2012), p. 56
Notre vision de la démocratie réelle (qui reste à définir) s’oppose aux really existing democracies où la fusion ultime entre le capitalisme et la démocratie déclenche la société de dette. David Graeber nous rappelle que la dette et la honte étaient la même chose dans l’ancien monde. Mais, ce sont les 1% qu’on devrait humilier. J’ai été impressionné quand vous êtes allés Uptown pour manifester devant leurs immenses appartements et penthouses pendant qu’on crève dans les banlieues et dans nos placards déjà trop chers. Dans le sillage de Marcel Mauss, vous avez encore une fois montré qu’au-delà l’économie monétaire, il existe toujours, souterrainement, une économie symbolique organisée autour de la réciprocité et de l’humiliation. Mais on verra à quel degré les 1% sont détachés de cette autre économie. On verra s’ils comprennent que nos vraies dettes nous lient à autrui dont la capacité de fleurir permet notre propre floraison. C’est la base du socialisme. Putain de prêts étudiants….
Et hormis la puissance de notre position morale (qui n’est pas une forme de la dépolitisation, mais la tentative de relier l’éthique et la politique), il existe bien entendu la puissance de la foule. De plus, la foule comme emblème de la modernité politique est également un indice de la justice. Il s’agit de la politique-somatique dans laquelle la foule devient un corps, ou un organisme robuste qui possède une intégrité que les 1%, atomisés, solipsistes et « anti-sociaux » ne pourront jamais incarner. Dans la foule s’engendrent le dépassement de soi et la mise en lumière d’un autre plan de sentiment moral et social qui reste dormant dans le temps vulgaire du capitalisme occidental. Mais, afin de saisir ce point de l’effervescence, il faut absolument que, pour reprendre Canetti, la foule ne dégénère pas en meute, en « décharge instinctuelle » ou une simple masse humaine agglutinée. Contre le contrôle de la foule (crowd control), il faut que nos foules ne se présentent pas en tant qu’hystérie réactionnaire. Notre guerre ne se fait pas au nom du ressentiment, mais au non de la décence commune. C’est-à-dire que nos foules résultent d’un besoin vital d’association et non pas d’un simple goût pour le délire contagieux. Nous ne sommes pas les malades de la société ; nous sommes le corps social qui cherche la bonne santé en exorcisant la maladie des 1%. Dans les foules circulent des énergies mystérieuses et liminales. Quand elles sont bien canalisées, elles peuvent précéder la société à venir.
Comme toi, j’ai été outré de voir le flic New Yorkais, Anthony V. Bologna, gazer les deux filles qui protestaient dans la rue pacifiquement. Je sais que cet incident n’est qu’un exemple de la brutalité à laquelle vous êtes soumis chaque jour. Selon Giorgio Agamben, la police n’a plus un rôle simplement administratif. Elle signifie la souveraineté en tant que dispositif de violence contre le corps, un régime de la représentation, le droit de la loi (et la capacité de suspendre la loi), et l’autorité sur bios.[[Voir Giorgio Agamben, “Sovereign Police” in Means without Ends: Notes on Politics, trans. V. Binetti et C. Casarino, Minneapolis: University of Minnesota (2000), pp. 104-105 Or, il faut rappeler que quand un parent frappe son enfant, il perd toute souveraineté et démontre son impuissance totale, qu’il est embarrassant pour lui d’avoir recours à la violence. Bref, j’ai vu que vous êtes en train de discuter du rapport entre Occupy et la violence et « la diversité des tactiques. » Je suis tout à fait d’accord avec Rebecca qu’il faut rejeter les outils du maître, la faillite morale des flics et la faiblesse de leur violence.[[Rebecca Solnit, « Rejeter les outils du maître pour construire un plus belle demeure, » in eds. K. Gessen, A. Taylor, E. Schmitt, N. Saval, S. Resnick, S. Leonard, M. Greif, C. Blumenkranz, Occupy Wall Street: textes, essais, et témoignages des indignés (trans. L. Motet et J. Strauser), Paris : Édition des Arènes (2012), p. 204. Comme Gayatri Spivak, je sais également que notre mouvement a un caractère distinctement américain et doit s’inscrire dans la grande tradition de la désobéissance civile de notre pays. Pourtant, dans la constitution de notre pays, il est clairement écrit que chaque citoyen a le droit de légitime défense.
En plaidant pour la désobéissance civile, Spivak fait appelle à la grève générale de Georges Sorel,[[Gayatri Spivak, “General Strike,” Tidal 1: Occupy Theory, Occupy Strategy, December 2012 (pas de numéros de page un des théoriciens de la violence les plus controversés du 20e siècle. Mais en citant Sorel, Spivak fustige la dimension la plus importante de la pensée de Sorel, notamment les dimensions mythiques et religieuses de la grève générale. Pour Sorel, la grève était un champ de forces et un mythe qui agit sur la réalité. Le socialisme s’achèvera dans le mythe de la grève générale, qui déclenche un drame manichéen entre le bien et le mal. Et dans le mythe, la grève trouverait son autorité politique absolue, sa noblesse et son héroïsme. Le mythe est le côté affectif de la politique, la transfiguration totale du temps historique à travers l’explosion des passions politiques. Mais le temps du mythe politique est bien fini, n’est-ce pas… ? On se demande quand même si Occupy peut devenir une nouvelle religion post-religieuse, laïque, civique et américaine, fondée sur une soif pour la justice, les vertus ordinaires et la convivialité.
Peut-être que 99% n’est pas qu’un chiffre, mais une représentation symbolique ou un totem dans lesquels notre moralité sociale et notre contre-ontologie sont projetées. Il faut toujours se méfier des prêtres, mais j’ai été étonné quand quelqu’un a pris le micro pour dire : « si vous croyez que prier Dieu va faire changer le système, vous vous trompez. Les choses ne changent que quand le peuple descend dans la rue. Sortez des églises, venez dans la rue. »[[Cité in Svetalana Kitto et Celeste Dupuy-Spencer, “Fouille,” in eds. K. Gessen, A. Taylor, E. Schmitt, N. Saval, S. Resnick, S. Leonard, M. Greif, C. Blumenkranz, Occupy Wall Street: textes, essais, et témoignages des indignés (trans. L. Motet et J. Strauser), Paris : Édition des Arènes (2012), p. 155 Je ne crois pas en Dieu, mais je sais, comme toi, qu’il n’aime pas les banquiers, l’intérêt, le crédit, et la fausse-monnaie. Mais qui est le peuple dont ce prêtre parle ?
Ils vous accusent d’être trop bourgeois et trop blancs. Quant à la première accusation, oui, il est vrai que plupart des grandes révolutions ont été menées par les bourgeois, mais en synchronie avec la classe-ouvrière. Pour un mouvement comme le nôtre, il faut toujours un bourgeois déclassé et un prolétaire en colère, endetté et désespéré. Or, il faut que le bourgeois trahisse sa propre classe afin de se rapprocher de la classe ouvrière pour créer le peuple. Les deux doivent également trahir leur désir néfaste de rejoindre, un jour, les 1%. Autrement dit, comme je l’ai expliqué dans un article sur George Orwell que j’ai écrit avec mon ami John, le peuple est un projet politique ; ce qui rend un tel peuple possible, ce sont des évolutions sociales tendant à produire une classe moyenne qui ne se définit plus uniquement par son snobisme mais d’aussi par son éducation et ses fonctions techniques. Cette classe moyenne, les ouvriers aspirent à en faire partie, non pas en se soumettant aux impératifs du snobisme mais à leurs propres conditions.
Quant à la deuxième accusation, il faut également que vous trahissiez votre race ‒ sans tomber dans la pseudo-sentimentalité d’un cosmopolitanisme light qui invoque notre humanité commune. Cette humanité est aussi un projet politique. Le capitalisme est raciste et nous devrons être antiracistes et à la recherche de l’universel concret, et pas multi-culturalistes en privilégiant la particularité d’une façon managériale qui imite la mauvaise fois raciste de la mondialisation. Il ne suffit pas d’avoir un mouvement des jeunes blancs contre des vieux blancs. En effet, comme notre collègue Manissa l’a remarqué, il faut activement lutter contre les vestiges du privilège blanc au cœur du mouvement même qui reproduit le racisme structurel.[[Manissa Maharawal, “Tenir tête,” in in eds. K. Gessen, A. Taylor, E. Schmitt, N. Saval, S. Resnick, S. Leonard, M. Greif, C. Blumenkranz, Occupy Wall Street: textes, essais, et témoignages des indignés (trans. L. Motet et J. Strauser), Paris : Édition des Arènes (2012), p. 68 Mais il ne s’agit pas d’un appel condescendant à la diversité libérale (qui est souvent tout simplement l’inclusion superficielle du non-blanc). Or, en ne se réduisant pas à une reconnaissance de la singularité d’autrui, Occupy peut établir les dynamiques sociales qui ouvrent la voie à une liberté et une sécurité partagées : la construction dans la sphère publique et sur le plan du sujet post-ethnique ‒ ce qu’on appelait « le peuple ». Je suis aussi triste de voir que les Chinois, les Mexicains, les Indiens et tous les immigrés ne se sentent pas accueillis par le mouvement. Faut-il demander pourquoi ?
Vous parlez beaucoup de l’autonomia et de l’horizontalité, mais on se demande si « le peuple » est vraiment un corps sans organes politique (antihiérarchique, antidialectique, antibureaucratique, etc.) Ce qui me fait peur, c’est que l’autonomie et l’horizontalité soient instrumentalisées pour éviter la prise de positions et les engagements (votre ambivalence à l’égard des ouvriers est justifiée au nom de l’horizontalité). Il ne faut pas se cacher derrière l’immanence. Par ailleurs, on se demande également si Occupy, avec ses assemblées générales, ses mic-checks, ses bibliothèques et ses centres médicaux, n’est pas la cristallisation d’une République contre l’Empire mondial. Quoi qu’il en soit des débats entre les communistes, les socialistes, les anarchistes, les punks et les démocrates libéraux qui laissent craindre une fragmentation politique, il ne faut pas éviter la question internationale. Peut-être que la formation d’une Internationale peut attendre, mais Occupy doit absolument créer des liens avec les autres indignados, indignés, révoltés, etc., afin de créer une machine de contre-attaque qui imite l’organisation de l’Empire. Or, New York n’est pas un hub mais une cellule dans un mouvement qui est décentré, aléatoire et rhizomatique comme l’Empire même (ce que notre collègue Rira appelle « la matrix » dans laquelle on ne devient jamais trop attaché à un espace ou une action en particulier).[[Rira, “Matrix as the Core Element,” Tidal 1: Occupy Theory, Occupy Strategy, December 2012 (pas de numéros de page). Voire: occupytheory.org
Pourtant, bien qu’Occupy soit une expérience « acéphalique », je suis d’accord avec Zizek que l’histoire nous montre que les grands mouvements politiques qui ont réussi avaient des chefs. Mais, le chef peut être également un « leader », un représentant, ou un porte-parole. Or, on peut avoir un chef en restant acéphalique. D’abord, on peut envisager à travers les assemblées générales un système de poids et de contrepoids qui assure que personne n’a trop de pouvoir ou n’en abuse. Or, avec Pierre Clastres dans La société contre l’Etat, on peut également imaginer comment la société (ou Occupy) peut contrôler la chefferie en détachant le chef du pouvoir. Pour Clastres, le chef est transparent aux énergies de la société même qu’il ne contrôle pas ; il est le chef qui ne commande pas et son rôle est le rôle purement protocolaire d’un agent de discours ou de vaisseau pour sa société. Un jour, vous serez convoqué pour parler avec les hommes politiques. Qui enverrez-vous ?
Pour conclure, l’avenir de notre mouvement dépend de sa capacité à formuler une position systémique qui lutte contre les contradictions structurelles enracinées dans « le système. » Or, les luttes contre le racisme, la pauvreté, la marginalisation sociale, le changement climatique, le développement durable néocolonial et les crises de nos écoles et universités, sont toutes des luttes contre le capitalisme mondial en tant qu’Empire. Ainsi, Arundhati Roy a raison d’observer que la puissance d’Occupy se trouve dans sa position au cœur de cet Empire, une position qui est à la fois spatiale (subversion de la géographie néolibérale), temporelle (refus de la fin de l’Histoire), psychique et sociale (la recherche pour l’effervescence et de nouveaux paradigmes de la solidarité transversale), économique (la création de nouveaux modes de partage et de reprise de l’économie des mains des économistes), et surtout post-politique (la reconstruction du peuple). Parmi les tâches immédiates figure la consolidation pratique et théorique de ces multiples « occupations » afin d’établir les fondements d’une nouvelle dynamique sociale. Or, Occupy ne peut pas se contenter d’être simplement une révolte, un ethos politico-théorique, ou une subversion discursive. Il doit plutôt s’ériger comme un contre-exemple, une expérience dans la recherche pour la vie commune, un laboratoire alchimique ou notre abjection collective et notre fureur se transforme en nouvelles formes de communauté éthique ‒ une communauté bien sûr à jamais inachevée, toujours « inavouable » et « à venir. »
On se verra dans la rue,
À toi,
Romi
PS: Ne traîne pas trop avec les gens du Tea Party. Tu risques de tomber dans l’abîme d’un non-conformisme ni droite ni gauche qui ne te mènera nulle part.