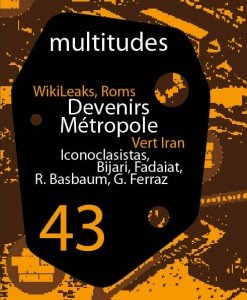Jamais un accident industriel, si grave soit-il, n’a encore arrêté l’industrialisation ni ses entrepreneurs. Loin de freiner le développement technologique, l’accident se révèle être au contraire le garant de sa durabilité. Cette opération est réalisée par les services dits de gestion des risques, dont les complexes calculs théoriques consistent, en pratique, à transformer un accident en élément de sécurité. « Pour nous, un accident est toujours source d’enseignement », explique un ingénieur des services de contrôle de l’État[1]. Les accidents connus et analysés alimentent ainsi d’immenses bases de données qui sont utilisées pour identifier les risques, calculer les probabilités de dommages et adapter les mesures de sécurité en conséquence. La sécurité n’est alors ni le contraire, ni l’absence d’accident, mais plutôt son corollaire. Moins les industries sont sensibles, c’est-à-dire moins les accidents sont visibles ou potentiellement considérés comme graves, moins la sécurité est garantie. C’est le cas de toutes les petites industries qui n’ont pas forcément d’ingénieurs sécurité par rapport aux grandes installations dangereuses qui polarisent, elles, l’attention des services d’inspection de l’État. Mais c’est aussi le cas de ces dernières au regard du nucléaire, car il n’y a pas assez de retours d’expériences pour calculer les probabilités dans les études de danger : « Il faut transposer, faire avec ce que l’on a. Les bases de données ne sont pas autant documentées que dans le nucléaire[2] ». En conséquence de quoi, plus l’accident est jugé grave et touche un domaine sensible, plus les mesures de sécurité vont pouvoir être renforcées en profondeur : « C’est souvent après un accident assez important que la loi évolue[3] », résume un délégué syndical de la CGT. Ce fut en effet le cas des deux principales lois réglementant les installations industrielles dangereuses : les directives Seveso et la loi Bachelot, respectivement adoptées suite à l’accident de la ville italienne de Seveso en 1976 et suite à l’accident AZF de Toulouse en 2001. On retrouve ici la marque d’une certaine philosophie des effets pervers. Ces pratiques qui établissent la sécurité grâce à l’accident contribuent au final à légitimer la catastrophe, puisqu’elles démontrent que seule la catastrophe présente une source d’énergie suffisamment dense pour qu’un changement ait lieu. Dans ce contexte, il est alors inévitable que le désastre apparaisse comme salvateur et la catastrophe comme désirable[4]. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la formule du poète Hölderlin : « Le danger ressuscite ce qui nous sauve[5] ». Et à l’inverse, la sécurité n’en finit pas de ressusciter ce qui nous menace. Il s’agit donc de comprendre comment la sécurité entretient, par sa manière d’opérer et de fonctionner, les logiques mêmes qu’elle dénonce ainsi que les maux qu’elle combat.
Accident ou incident ?
Les grands enjeux des petites différences
La sécurité est d’abord un langage. En règle générale, industriels et ingénieurs du risque n’aiment pas le terme d’accident, qu’ils jugent trop anxiogène, synonyme de mort et de catastrophe. Par coutume, ils préfèrent lui substituer l’euphémisme incident, synonyme de presque-accident. Certains poussent la déformation professionnelle jusqu’à parler « d’incident grave » ou « d’incident à haut potentiel » pour éviter de briser un tabou. Et si incident est encore trop fort, on parlera de presque-incident ou de pré-incident. La frontière séparant l’accident de l’incident est parfois assez nette : « quand sur le sol il reste une flaque, ça signifie que quelque chose n’a pas été fait jusqu’au bout. Du produit sur le sol, c’est une situation de presque-accident[6] », explique un ingénieur de la raffinerie Innovène de Lavéra (Martigues). Dans le langage des industriels, un accident signifie l’arrêt de l’installation et donc de la production, qu’un incident ne va au contraire pas entraver mais seulement gêner. Sécurité rime avec productivité, c’est pourquoi il est important de distinguer les termes. Quand le directeur de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer explique, aux riverains venus assister à la première réunion d’information publique de l’industriel, qu’il n’y a pas eu « d’accident avec arrêt à Fos depuis 1999 » et que « la sécurité est depuis longtemps un indicateur important pour mesurer l’activité de la raffinerie[7] » ; il n’y a donc dans son esprit nulle contradiction avec la suite de ses propos qui annoncent « trois incidents procès déclarés en 2005 ». Pas d’accident avec arrêt total de l’installation, mais des incidents avec arrêt d’une unité de dépollution. L’absence d’accident permet de présenter plus sereinement les incidents et devient une source de fierté dans une stratégie de légitimation de l’industrie : « Notre premier objectif c’est d’être accepté par la population », explique le directeur d’Esso après avoir affirmé que « dans la région, quand je passe devant nos cheminées, je suis assez fier ». C’est alors que la frontière entre accident et incident devient plus subjective, mais les enjeux ne sont pas uniquement de l’ordre de la communication car en matière de sécurité, la réglementation n’est jamais loin. Or dans la loi, chaque mot compte. Les termes sont alors l’objet de négociations entre industriels et services de l’État dont en voici un exemple.
Pendant un groupe de travail, des représentants de l’État proposent aux industriels de modifier un outil de communication appelé « fiche G/P », pour gravité/perception. Il s’agit de donner « à chaud » une note à l’accident pour permettre aux autorités d’en évaluer rapidement l’ampleur. C’est un autre exemple de bénéfice collatéral de l’accident, puisqu’il a été mis en place à la demande du préfet suite à la catastrophe de la raffinerie Total de Martigues en 1992 (6 morts). Son grand intérêt étant, pour la préfecture, de pouvoir être informée avant les médias de tout incident perceptible à l’extérieur de l’usine.
Fiche G/P, 2 février 2005 :
Plusieurs industriels proposent de changer les termes. Ils souhaitent que dans la définition du G0, le terme « opération » soit remplacé par celui d’ « évènement » et que dans la définition du G1, « incident courant » soit remplacé par « incident mineur », puis par « évènement mineur ». Ces gesticulations resteraient ésotériques si un industriel n’en avait pas lâché subitement la raison : « J’espère qu’on ne sera pas obligé de passer à l’article 38 à partir du G2 ». L’article 38 est celui d’un décret qui oblige les industriels à déclarer leurs accidents à l’inspection des installations classées. Précision importante : « un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées[8] ». On comprend donc mieux les enjeux derrière l’usage des mots. Si un industriel ne déclare pas un accident dans ce qu’il est convenu d’appeler « les meilleurs délais », il est hors-la-loi et peut être condamné comme tel. Mais si l’évènement en question n’est qu’un incident, alors sa non-déclaration est parfaitement légale et ne peut lui être reprochée. La réglementation impose ainsi son langage aux industriels.
La relative hiérarchie des menaces
Quatre vocables sont couramment employés pour distinguer le degré de gravité, d’anormalité et de fréquence d’un dysfonctionnement. Il y a la catastrophe, l’accident, l’incident et l’émission. Tchernobyl, Seveso, Bhopal ou AZF vont être décrits comme des catastrophes ou des accidents selon l’effet recherché : dramatisation, dénonciation et jeu émotionnel pour les premières ; objectivation, regard technique et analyse pour les seconds. Les catastrophes sont moins que centennales au niveau de l’étang de Berre. Il y en a eu trois. La première en 1936, sur le site de la poudrerie de Saint-Chamas, un des accidents industriels les plus graves de l’histoire de France qui a fait 53 morts et 150 blessés : « des hommes sont soulevés de terre, projetés à des dizaines de mètres, ensevelis sous des amas de pierres et de boue, des arbres arrachés, des débris volent de partout, des cris, des hurlements, un ciel de fumée noire[9] ». Cette même poudrerie a explosé une deuxième fois en 1940 et fait 11 victimes. Plus récemment, en 1992, l’explosion d’un nuage de gaz à la raffinerie Total de La Mède (Martigues) a provoqué la mort de six employés. Sur la quarantaine d’usines Seveso que compte la zone industrielle de Fos-sur-Mer et de l’étang de Berre, les accidents ont lieux plusieurs fois par an : une pluie d’hydrocarbures arrose les alentours de la raffinerie, un incendie gagne des sacs de souffre et la fumée toxique est rabattue par le vent dans un atelier, une fuite de chlore nécessite le confinement des ouvriers… Puis, à mi-chemin entre l’accident et la pollution, c’est-à-dire entre la crise, la rupture brutale et le flux continu, on trouve les incidents : « On ne va pas appeler ça accidents, mais des incidents, il y en a tous les jours[10] », explique un ingénieur des services de l’État. Pour le nucléaire, cinq incidents par mois. Pour la raffinerie Innovène de Lavéra comme pour l’usine modèle en matière de sécurité de la zone industrielle, la Lyondell de Fos-sur-Mer : « Des [presque-accidents] il faut comprendre, il y en a environ 800 par an sur notre site. S’il faut rapporter toutes les petites anomalies, imaginez 800 fois le nombre d’industries, car et on est comme les autres[11] ». Les émissions de gaz, de poussières et les rejets en mer sont eux continus. Ils n’ont rien d’accidentels et font partie intégrante du procès de production, au point de devenir au contraire un gage de bon fonctionnement : « La cheminée de la cokerie, c’est un signal indien. Elle fume toutes les sept minutes quand il faut éteindre le coke. Si elle ne fume pas, c’est que la cokerie est éteinte, ce qui n’est jamais bon signe[12]. » Alors, la pollution devient au niveau de la zone industrielle endémique et rémanente : elle restera dans les sols et les nappes bien au-delà du démantèlement des usines. Elle est le plus bas niveau de danger. Ni les émissions, ni la pollution ne remettent en cause la sécurité et la production.
On le voit, les quatre vocables, les quatre formes que l’on donne à l’accident sont relatives. Les mots sont politiques et définissent des responsabilités. Cette relativité peut servir à faire passer un accident pour moins grave qu’il ne l’est, ou au contraire pour accuser et dénoncer l’irresponsabilité d’un industriel. Et c’est cette relativité que craignent les ingénieurs du risque, dont le métier n’est précisément pas de faire de politique, mais de quantifier et d’évaluer le danger techniquement, scientifiquement, objectivement : « Il est impossible de communiquer sur 800 presque-accidents en un an, ce sera mal interprété et on sera tout de suite dans le catastrophisme[13] ». Cet industriel a peur que des presque-accidents soient perçus comme une catastrophe, alors même qu’il juge utile d’en parler, notamment pour sensibiliser le personnel des entreprises sous-traitantes qui viennent travailler sur le site. Il estime ainsi que l’annonce d’un presque-rien produit des effets pires que l’accident lui-même. C’est quand l’annonce devance l’effet, quand le simulacre précède le réel, que les cercles deviennent vicieux. L’industriel ne fait pas confiance aux habitants : « Pour ceux qui travaillent sur les risques, c’est parfaitement clair, mais pas pour l’extérieur[14] ». Pour éviter les malentendus, la décision est prise de ne pas en parler « à l’extérieur », c’est-à-dire au grand public. Face à cette culture du secret, les habitants n’apprennent qu’indirectement ce qu’il se passe à l’intérieur des sites industriels, quand ils n’y travaillent pas eux-mêmes, et deviennent méfiants car les informations finissent toujours par passer, même sous une forme déformée. Ils deviennent de moins en moins enclins à croire et écouter les paroles d’un industriel, même pourvu de bonnes intentions, et de fait l’appréhension de l’industriel de ne pas divulguer ce genre d’informations se trouve auto-justifiée. Ce genre de processus est bien connu des analystes des effets pervers. Celui qui passe pour le père de la sociologie des sciences, Robert K. Merton, lui a donné les noms de prédiction créatrice et de prophétie auto-réalisatrice[15]. Quand le simple fait d’évoquer une possibilité finit fatalement par la provoquer. Quand la prophétie s’accomplit d’elle-même, du simple fait d’être annoncée.
L’ubiquité de la catastrophe
Le catastrophisme des presque-accidents montre que tous les stades de l’accident, indépendamment de leur gravité, sont tenus pour inquiétants. La catastrophe est présente à tous les stades. Les émissions polluantes elles-mêmes prennent la forme d’une catastrophe. La pollution porte en elle la menace, non d’une mort brutale, d’une explosion, mais d’une mort lente. « Pour nous, l’accident n’est pas limité dans le temps[16] » explique un militant associatif. La pollution est une catastrophe déconcentrée et diluée dans le temps. Une catastrophe au ralenti, au régime de temporalité insidieux et différé. « La mort ne sera au rendez vous que dans 20 ou 30 ans[17] », disait une jeune militante pendant une réunion publique contre l’incinérateur de Marseille à Fos-sur-Mer. Une mort sans traces, un crime parfait dont on ne pourra retrouver l’auteur puisque tout pollue, du tabac et des pots d’échappement jusqu’à l’industrie lourde. La pollution n’est pas contingente. Elle passe, elle arrive, elle est présente de toute façon. Mais l’accident sur un site industriel lui non plus n’est pas contingent. Il y en a de toutes façons et tous les jours. Le détraquement est inhérent au fonctionnement des installations. Charles Perrow a développé en ce sens toute une théorie des « accidents normaux[18] ». Il postule qu’en raison de la complexité des systèmes de production industrielle, les accidents ne peuvent plus être attribués à une cause unique, mais résultent de l’enchainement imprévisible d’incidents de natures différentes (facteurs humains, organisationnels, matériels, propriétés chimiques, etc.). En ce sens, ils ne peuvent être indéfiniment évités. Poussant son raisonnement jusqu’au bout, il en concluait qu’il fallait abandonner la technologie nucléaire, car le risque était trop grand. Position qui lui valut, on s’en doute, de vives controverses. L’accident d’AZF peut être interprété comme relevant du procédé décrit par Perrow : « pour moi c’est une accumulation de petites conneries qui ont fait l’accident[19] », explique un ingénieur du risque, sans qu’il soit ici besoin d’entrer plus en détails. Même mode opératoire pour la morbidité de la pollution : pour développer un cancer du poumon quand on est fumeur par exemple, il faut que plusieurs dysfonctionnements cellulaires soient activés à la suite les uns des autres. On peut ne pas avoir de cancer, mais les premiers incidents qui rendent possible son développement ont déjà eu lieu. Il n’y a jamais que la mort que portent en eux la pollution ou l’accident qui est contingente. Avec la pollution autant qu’avec les incidents, dans une zone industrielle, la catastrophe est partout, sursitaire et ubiquitaire. Il n’y a donc pas lieu de distinguer et d’appréhender différemment émissions, incidents ou accidents sous prétexte que certains seraient moins graves ou plus inacceptables que d’autres. Ces trois formes sont trois aspects d’une seule et même réalité. Tous les degrés de l’accident fonctionnent comme des catastrophes. Tous sont également inquiétants.
Le cercle vicieux de la sécurité peut-il être vertueux ?
Beaucoup d’individus consacrent une grande partie de leur temps et investissent beaucoup de leur personne dans la prévention et la gestion des risques en hiérarchisant menaces et accidents pour en tirer des principes d’actions, des lignes budgétaires, des aides à la décision. Des seuils sont établis. Selon le degré de concentration ou de dilution de la catastrophe, les actions et les moyens ne seront pas les mêmes. Faute de reconnaître que d’autres hiérarchies de la menace peuvent exister quand on considère l’ensemble des usines d’une zone industrielle et l’ensemble des préoccupations des individus d’une société, des conflits éclatent, qui ne sont pas des conflits de représentations, mais bien des conflits de pratiques. Il n’y a pas d’institutions où les questions de risques majeurs et les questions de pollutions sont abordées de concert, sur un pied d’égalité et de façon transversale. Et si c’est le cas, elles sont toujours séparées en différentes commissions. L’exemple typique est celui des Commissions locales d’informations et de concertation (CLIC). Créés suite à l’accident d’AZF du 21 septembre 2001 à Toulouse, ces commissions sont l’une des rares structures dites de concertation sur les questions de risques industriels qui soient obligatoires pour les industries les plus dangereuses, classées Seveso seuil haut. À l’exception des sites de traitement des déchets (décharges, incinérateurs), ces CLIC n’ont pas d’équivalent pour la pollution, c’est-à-dire pour ce qu’il est convenu désormais d’appeler le « risque sanitaire ». Placées sous l’autorité du préfet, les CLIC obligent les industriels à présenter leurs mesures de sécurité devant d’autres acteurs : services d’État, collectivités, syndicats ouvriers, ainsi que devant un collège d’associations et de riverains triés sur le volet. Or ces CLIC ont pour consigne de ne traiter que des risques majeurs et de mettre en place des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT), et non de répondre aux questions concernant la pollution. Alors, quand les représentants des riverains formulent à plusieurs reprises la demande suivante : « nous souhaitons remettre en question le cadre des domaines de compétence du CLIC. Dans ce cadre, on pense toujours aux catastrophes, à AZF, au gros accident. Pour nous, l’accident n’est pas limité dans le temps. On voudrait parler du risque sanitaire. La loi de juillet 2003 parle de salubrité. Il faut que la santé publique soit prise en compte au même titre que l’accident majeur[20] », un représentant de l’État leur oppose les deux arguments suivants : « Dans le passé on avait figé la situation, on ne l’avait pas améliorée. Il faut quantifier ces risques qui font peur aux populations » et « Le PPRT c’est pour les risques accidentels. S’il y a un accident grave, on va compter les morts. Ce ne sont pas les mêmes enjeux ». Autre réunion, autre fonctionnaire, mais même position : « Un camion de fuel qui se renverse. C’est trois fois rien, enfin trois fois rien… C’est pas un accident majeur comme on en a l’habitude. (…) L’important, c’est l’alerte immédiate. On voudrait avec vous mettre en place des critères “à chaud”, et introduire dans le risque cette notion de quantité, pour dire qu’une tonne de fuel, c’est moins grave qu’une tonne de chlore. Il faut dire : attendez, on n’est pas dans le même problème et c’est de l’information qui est utile, à la fois pour les journalistes et pour les autres[21]. »
Ce ne sont pas les mêmes enjeux… On n’est pas dans le même problème. Voici donc comment la sécurité nous apprend de quoi il faut avoir peur. Il faut avoir peur de l’accident majeur et pas de la pollution. Il faut avoir peur du chlore et pas du fuel. Vous nous parlez de santé publique, bien sûr que c’est légitime, mais nous on vous parle de compter les morts. Mais au lieu de sécurité, il s’agit là d’une certaine vision de la sécurité, plus connue sous le nom de « culture du risque » : une hiérarchie des menaces qui veut nous apprendre de quoi avoir peur. La culture du risque est plutôt une version faible de la sécurité qui se contente d’enseigner les consignes : ne pas téléphoner en cas d’accident pour ne pas occuper les lignes dont ont besoin les secours pour s’organiser, ne pas sortir de chez soi et calfeutrer portes et fenêtres en attendant que l’alerte passe comme l’orage, ne pas aller chercher ses enfants à l’école et s’exposer ainsi au danger qui rôde à l’extérieur, mais faire confiance aux secours ainsi qu’aux dispositifs de confinement des écoles, etc. En hiérarchisant les menaces, la culture du risque oublie au passage que ce qu’elle tient pour « moins grave » est pour les autres une catastrophe. Elle donne une définition restrictive de l’accident et dresse un programme qui n’est pas celui de la sécurité – sine cura : sans trouble, sans inquiétude – mais de son simulacre. La culture du risque ne répond pas à toutes les inquiétudes, elle se contente de les sélectionner selon un principe qui permet de garantir la pérennité de la production. Elle va exacerber les peurs d’accident majeur qui détruisent les moyens de production et minimiser les menaces de pollution qui sont inhérentes à la production. Autrement dit, elle va à la fois faire peur et rassurer, ce qui contribue à monter les menaces les unes contre les autres. L’énergie, la force de changement des catastrophes est ainsi dissipée et alors seule une véritable catastrophe permet aux actions, aux politiques, d’être débloquées. Faut-il en arriver là pour que la sécurité se mette en place ? On peut se demander si la culture du risque ne court-circuiterait pas au final la sécurité et s’il n’y aurait pas en contrepartie un principe salvateur des effets pervers. Car contrairement à la « culture du risque », le programme de la sécurité voit lui des catastrophes partout. Il ne cherche pas à rassurer, mais à faire peur. Pour lui, rien n’est jamais pire que l’indifférence et l’accoutumance au danger car la disparition de la peur entraîne avec elle celle de la sécurité. La sécurité ne peut alors fonctionner que si elle arrive à faire disparaître le sentiment de sécurité tandis que la culture du risque ne vise elle qu’à procurer ce sentiment de sécurité. L’éthique de la gestion des risques se trouve prise à son propre piège, nous dit Henri-Pierre Jeudy : « elle ne peut se constituer comme telle qu’en puisant dans le pouvoir fictionnel du désastre[22] ». C’est ainsi que ce qui fait office de sécurité ressuscite sans cesse ce qui nous menace. La situation serait sans doute différente si toutes les formes de catastrophes étaient reconnues à égale valeur, et en particulier si la pollution et le risque sanitaire étaient considérés par tous comme un risque majeur.