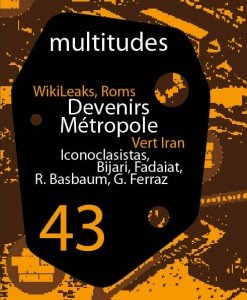Vers un espace public supranational ?
Les métropoles de la mondialisation, villes globales ou villes sans frontières, organisent les flux marchands, et recherchent la mobilité. Hier, la mobilité du travail a jeté le prolétariat urbain dans les rues de Paris et Londres, aujourd’hui elle s’exprime aussi dans le statut du travailleur transfrontalier au sein de l’Union européenne. Une enquête récente que j’ai menée sur les obstacles que rencontrent ces salariés m’a fait réfléchir au rapport qu’entretient aujourd’hui le concept de métropole avec la grande région européenne la plus importante de l’Union européenne, SarLorLux. Entre Paris, Bruxelles et Francfort (Main), elle compte onze millions d’habitants et mobilise deux cent mille salariés transfrontaliers naviguant chaque jour entre la Lorraine, la Sarre, le Luxembourg, la Wallonie ou encore le Palatina. Parmi ces flux divers, le principal pôle est la capitale du Luxembourg qui n’est pourtant pas la métropole de la grande région. Je me demande ici si pareille absence de métropole pourrait être la forme contemporaine de la métropole, ville sans frontières, lieu de la mondialisation.
Le vaisseau des morts
Avant de creuser cette piste, je pars de l’expérience des transfrontaliers pour appréhender le phénomène, à commencer par le plus littéraire d’entre eux. Dans Le vaisseau des morts, B. Traven saisit la posture de ces douaniers européens qui traitent un travailleur − sans papiers adéquats − selon le régime politique d’une police obsédée par l’idée de renvoyer les gens ailleurs : « Voudriez-vous aller en France ? » – « Non, je n’aime pas la France, les Français veulent sans arrêt se placer aux jeux et n’arrivent pas à tenir en place. En Europe, ils font l’occupant, et à Alger ils nous préoccupent toujours. Et ces placements incessants me rendent nerveux ; ils pourraient manquer de soldats et, comme je n’ai pas ma carte de marin, me prendraient pour un égaré. » – « Que pensez-vous de l’Allemagne ? » (…) – « Non, je n’aime pas les Allemands. Lorsqu’on leur présente l’addition, ils font leur mine préoccupée, et lorsqu’ils ne peuvent pas la payer, on les occupe. Et comme je n’ai plus ma carte de marin, on pourrait me confondre et l’on m’obligerait à payer à leur place »[1]. L’épisode, plus ou moins véridique, se déroule à l’époque de l’entre-deux-guerres. Non pas aujourd’hui.
Lors de notre étude sociologique récente sur la mobilité des travailleurs transfrontaliers, de ses obstacles bureaucratiques et des moyens pour y remédier au sein de la grande région SarLorLux [2], les limites imposées par la tradition se sont dressées rapidement, partout. Les individus transfrontaliers se heurtent aux bornes du monde administré dans tous les domaines, du droit du travail aux régimes de retraite en passant par la fiscalité, les transports et parfois le code de la nationalité.
Voici une scène digne des romans de B. Traven : La personne bien réelle de Walter Bastian, allemand habitant en Lorraine, était technicien des télécommunications[3]. Après avoir perdu son emploi, il retrouve une offre acceptable grâce à une agence privée qui se rétracte au dernier moment parce qu’elle ne touche pas de subvention publique allemande pour des habitants français. Conformément au statut des travailleurs transfrontaliers, c’est la législation sociale du pays de résidence qui s’applique. Il passe donc au Pôle emploi local qui ne peut pas l’aider, car Monsieur Bastian maîtrise à peine le français qui est aussi la langue des stages de formation, etc. Il trouve une autre proposition de recrutement à Sarrebruck, mais l’agence pour l’emploi allemande refuse encore la subvention habituellement versée pour tout placement sur le marché du travail. Il vit actuellement avec le RMI, en se sentant traité comme un moins que rien en tant que transfrontalier.
Un autre travailleur transfrontalier qui devait se faire soigner par un ophtalmologue a témoigné du fait que les sécurités sociales, française et allemande, se sont disputées ad vitam aeternam pour savoir laquelle devrait payer pour l’examen de l’œil valide, laquelle pour l’œil atteint par un accident du travail. La question étant de savoir si c’est l’habitant français ou le salarié français en Allemagne qui demande des soins, et à quel œil cela s’applique. Dans ce cadre, nul citoyen européen, nul être humain n’existe.
Mille livres et brochures énumèrent les obstacles à la mobilité, les entraves à la liberté des salariés réguliers, les inégalités structurelles qui se manifestent ici, alors que ses principes organisateurs naissent à Paris, Berlin, Bruxelles ou dans les pays du Sud[4].
Mobilité, discrimination, subsidiarité
Le principe même de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et de leur libre choix du lieu de travail a dû être rappelé par la Cour européenne à l’occasion du verdict Petroni de 1975 qui souligne qu’aucune discrimination ne devrait être subie par les transfrontaliers. Aujourd’hui, des citoyens européens, français ou roumains, subissent une stigmatisation massive des États membres en tant que Tsiganes, en même temps que l’espace Schengen organise le refoulement de migrants extérieurs à l’Europe[5]. Le problème dépasse le cadre de l’organisation métropolitaine de la grande région et de ses banlieues, mais s’y affirme comme un problème intérieur. Je m’interroge sur les affinités entre migrants et travailleurs européens réglementés. De part et d’autre, j’ai vu le déni du droit, le renvoi d’un pays à l’autre, d’un service à l’autre, la discrimination pratique. Comment nommer ce lien entre sans-papiers et galériens du papelard, entre nomades du monde et salariés qui font la navette, entre la face légale et informelle du prolétariat urbain, entre la multitude des villes et celle du globe ? Les travailleurs transfrontaliers seraient-ils les banlieusards de la métropole européenne ? Ainsi, j’ai vu des quais de gare bondés au milieu de la campagne wallonne à Libramont, peuplée de travailleurs transfrontaliers en partance pour le Luxembourg, à 75 km de là. Des employés lorrains vont dans la même direction, alors que les ouvriers partent plutôt vers l’Allemagne tous les matins. Les responsables politiques de la grande région tentent depuis dix ans de fabriquer des structures de gouvernance par-dessus les frontières, avec l’aide de l’Union Européenne, ce qui signale une relation entre l’existence de ce type de travail salarié et la construction d’institutions publiques nouvelles au milieu de la mondialisation. Dans le langage conceptuel de mes propres recherches, cela pose la question d’une traduction de « l’expérience sociale non réglementée » vers un espace public sui generis[6].
Les mots et les principes du discours européen hérités de la doctrine catholique, du Pape Léon XIII à Chantal Delsol (1993), renvoient à autant de frontières infranchissables. Je veux parler de la subsidiarité, de la souveraineté, ou encore du « droit privé international ». La subsidiarité inscrite dans les traités actuels veut qu’il n’y a pas de solution supranationale pour le droit social, le droit du travail et du non-travail, mais des gestions au cas par cas, au plus près des niveaux institutionnels immédiatement concernés : municipalité, région, État-nation, etc.[7] D’où une concurrence entre plusieurs souverainetés, notamment nationales, qui nécessitent des jurisprudences complexes selon les règles du droit privé international entre États. Le manque de poésie de ce langage canonique, son absence d’ironie à la Enrich Heine, est symptomatique de son caractère bureaucratique.
Villes sans frontières
La mondialisation capitaliste a défait les frontières du travail à travers la flexibilité, la désynchronisation des rythmes sociaux, l’extension des métiers de services, les échanges cognitifs, les flux migratoires, la précarité et encore le chômage de masse. Elle avait d’abord engendré une urbanisation industrielle polarisée entre des East End prolétariens et West End bourgeois à Londres ou Paris, puis une organisation urbaine segmentée à la manière des villes-usines de Wolfsburg ou de Sochaux. Elle poursuit aujourd’hui le modèle d’une « ville sans frontière » en tant que substrat qui agence les flux marchands dans le cadre de la globalisation. Hambourg, ancienne ville de la Hanse développe ces tendances qui sont déjà déployées à Los Angeles ou Dubaï[8]. L.A. n’a plus de centre mais se diffuse autour de cercles de la peur concentriques (des zones d’insécurité) à partir d’un noyau initial à l’abandon, tout en étant ouvert à l’Amérique du Sud (avec la présence massive d’immigrés hispanophones). Dubaï a aboli les frontières entre le premier et le « tiers-monde », entre la mer et la terre (avec ses îles artificielles). Ces villes sont à l’image de la crise globale, frappés de plein fouet par le crash et la violence sociale. Est-ce que, dans ces conditions, on peut encore songer à l’organisation de capitales nationales à la manière de phares dressés face au monde, monopolisant un espace public bourgeois cantonné à ses frontières historiques, à la manière du Grand Paris ? Certainement pas, ce qui ne fait que poser l’étendue de la question.
Pour circonscrire le phénomène à la grande région SarLorLux, il convient de se focaliser sur son noyau central composé de Metz, la cité luxembourgeoise et Sarrebruck. Soit, du point de vue institutionnel, une capitale régionale aux pouvoirs réduits par l’État central (Metz), une capitale d’un État-nation disposant de tous les pouvoirs régaliens sur un territoire réduit (Luxembourg), et enfin la capitale d’un Land de la République fédérale en possession de prérogatives larges en matière de police, transports, éducation et régulation du marché du travail malgré sa petite population d’un million d’habitants (la Sarre). Cela crée décalages, disparités et une dispersion des atouts urbains sans nom. Par exemple, la participation lorraine à des projets transrégionaux dépend en règle générale de l’accord de la Préfecture de Metz, donc de Paris, alors que Sarrebruck et le Luxembourg négocient des accords bilatéraux. La région lorraine qui mobilise le plus de travailleurs transfrontaliers, de l’ordre de 90.000 par jour, représente donc l’institution la plus faible. Ainsi de Sarrebruck, on met le même temps pour aller à Metz ou à Paris. De même, la ville lorraine la plus proche, Forbach, à dix kilomètres de Sarrebruck, n’est pas joignable en tramway à cause de problème juridiques internationaux, mais reliée à Paris par voie expresse en TGV.
Sur le plan de l’éducation et de la recherche, la principale ville dispose de l’Université la moins grande puisque le Luxembourg ne s’est doté que récemment d’une Faculté privée, assez sélective. Les pôles universitaires européens les plus importants existent en dehors de la grande région, à Strasbourg ou à Francfort sur le Main, malgré des facultés à Sarrebruck et Metz. Les statistiques du taux de chômage et du PIB parlent, elles aussi, le même langage de la disparité et des inégalités entre pôles métropolitains, par exemple entre le Luxembourg riche et une Lorraine ou une Wallonie frappée par les crises économiques successives depuis le démantèlement de la sidérurgie et des mines à la fin des années 1970 jusqu’à la récession récente[9].
Contrairement à une métropole européenne classique qui connaît son quartier étudiant, sa zone industrielle, ses lieux de pouvoir politique et économique, ses quartiers occupés par la grande bourgeoisie ou des classes populaires, aucune des villes de la grande région n’y répond de manière cohérente. Tout se passe comme si la grande région avait dispersé les aspects d’une métropole sur son vaste territoire, évoquant le leitmotiv contemporain de la « ville sans frontières ». Les banques et quartiers bourgeois les plus visibles se trouvent au Luxembourg et les banlieues semblent constituées des petites villes des campagnes wallonnes ou lorraines où se recrutent les transfrontaliers peu ou modérément qualifiés. L’économie informatique se condense dans la Sarre, le capital financier est placé au Luxembourg, sinon à Francfort. L’usine des voitures Smart est en Lorraine, mais l’assemblage automobile des grands groupes se passe du côté allemand. Le centre Pompidou brille à Metz, une Académie d’art plastique à Sarrebruck. La principale liaison de train à grande vitesse va de Paris à Francfort, comme si les villes de la grande région n’étaient que des haltes passagères. Leur forme d’organisation politique, sociale et culturelle ne permet manifestement pas aux onze millions d’habitants de la grande région de constituer une métropole en puissance.
Un espace public supranational ?
Dès que des acteurs régionaux envisagent d’ébaucher un droit social européen à l’échelle des grandes régions de l’Europe, Commission européenne et États nationaux invoquent les règles fondamentales de la souveraineté et de la subsidiarité. Cela en précisant que La forme juridique que l’UE inventa pour faciliter la mise en place de projets transfrontaliers ponctuels (par ex. une ligne de bus), le Groupement européen de coopération territoriale (GECT), ne saurait servir de fondement à des structures communes en droit social. Les obsessions identitaires des délégations nationales pourraient faire sourire si la passion n’était pas aussi triste. Dans l’histoire européenne, les frontières nationales qui sillonnent la région se sont pourtant montrées extraordinairement mouvantes. Changement d’appartenance de la Lorraine et de la Sarre, placées un temps sous protectorat de l’ONU après la dernière guerre mondiale, nationalités successivement française, néerlandaise et belge du Luxembourg, avant la partition historique au milieu du XIXe siècle. Fluctuations du territoire wallon et création de la Belgique, aujourd’hui menacée d’implosion. Transformation du Palatina, de province bavaroise en un État de la République fédérale, etc. Rappelons surtout que la grande région fut au cœur de la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, crée sur une base supranationale avec le soutien des syndicats… en 1951.
Comment nommer, comment conceptualiser cet espace urbain et social de la grande région, qui pourrait préfigurer un espace public supranational s’il n’était pas livré à la décomposition administrative, nationale et politique ? Thomas Pohl, qui a retourné cette question dans tous les sens dans une thèse au sujet d’Hambourg, s’avoue vaincu, il ne voit nulle trace d’une Théorie critique de la ville globalisée : « Les tentatives de formulation d’une macro-théorie générale semblent appartenir au passé » conclut-il[10]. Je ne partage pas ce constat pessimiste qui fut aussi répandu en sociologie du travail, il y a plus de dix ans, avant que des actualisations critiques voient le jour[11]. Ce verdict s’explique pour partie par le choix de l’auteur d’écarter les théories critiques au profit des théoriciens de la seconde modernité, Beck et Giddens. Certes, le blairisme appartient au passé, sur le plan sociologique et politique. Henri Lefebvre, Toni Negri ou Mike Davis méritent en revanche des prolongations conceptuelles, auxquels j’ajoute la sociologie critique de l’École de Francfort qui les a pour partie inspirés[12]. Le même flottement concerne les concepts sociologiques bourdieusiens. Pohl remarque qu’on ne peut pas constater en Allemagne des différences notables entre l’habitus des différents milieux sociaux en fonction de leur lieu d’habitation, contrairement au constat bourdieusien des écarts entre ville et campagne, Paris et la « Province », où l’habitat marque l’habitus. Si on veut choisir cette approche, il convient d’appréhender le changement culturel à partir de l’expérience sociale des travailleurs dans leur propre contexte régional, au lieu de tenter des déductions théoriques qui n’assurent pas une analyse comparative des sociétés française et allemande.
Flexibilité du travail et temps de la ville
L’un des paradoxes de la recherche de Pohl à Hambourg est qu’il voudrait montrer l’impact de la flexibilité du travail sur l’espace urbain au sein de la mondialisation, mais que ses propres mesures quantitatives le persuadent que l’ancien régime temporel issu du fordisme prime nettement sur les rythmes flexibles, du fait d’une relative stabilité des relations de travail. Il cherche, à juste titre, le lien entre sociologie du travail et sociologie urbaine. En analysant les rythmes sociaux de la ville de Hambourg de manière statistique, il voudrait retracer une supposée flexibilisation massive des horaires de travail. Dans cette perspective, ne faudrait-il pas partir de l’analyse des rythmes à la fois du salariat organisé et des précaires pour évaluer ensuite leur interaction avec les flux urbains ? En partant de l’organisation flexible de la production matérielle et immatérielle, il est au moins possible de signaler l’étendue des basculements en cours dans l’espace urbain et public.
Ainsi, l’introduction massive de la flexibilité du temps de travail, au cours des années 1990, présente une relation étroite avec le changement structurel de l’espace public bourgeois-civique. Elle s’est imposée à travers la délégation de la négociation des normes collectives du travail aux grands groupes, via des accords d’entreprise, qui a renversé le pouvoir normatif[13]. Celui-là est passé du niveau public (parlement, code du travail en France ou conventions de branche en Allemagne) vers le domaine privé des entreprises pour favoriser la contractualisation individuelle. Ce renversement politique fut symbolisé en France par une décision du Conseil constitutionnel stipulant que la seconde loi Aubry au sujet des 35 heures ne devait pas corriger les résultats des accords d’entreprise déjà conclus. En Allemagne, l’accord Volkswagen condense ce processus, tandis que la ville-usine que cette entreprise a créée à Wolfsburg illustre la relation entre le changement des horaires de travail et le changement des rythmes sociaux de la ville. La flexibilisation des horaires des 50.000 salariés (soit la moitié de la population urbaine) y a déclenché une vaste désynchronisation déstabilisant la vie sociale (tissu associatif, clubs de sport, familles) et provoquant une vague de dépressions.
Alors que cette interaction semble assez évidente sur le plan d’une ville moyenne structurée fortement par le fordisme, qui apparaît comme un îlot au milieu de la campagne, la situation devient beaucoup plus complexe dans une métropole. Les effets des rythmes de production, des flux communicationnels et de l’accélération des échanges marchands deviennent difficilement mesurables. L’important arsenal statistique de Pohl lui permet de dire que les rythmes de type fordistes ou post-fordistes cohabitent, mais sans autre précision. Il serait pourtant intéressant d’examiner comment le temps marchand se confronte au temps cyclique de la ville, pour reprendre les concepts de la rythmanalyse d’Henri Lefebvre (1994). Il devient ainsi possible de conceptualiser moments et espaces à partir desquels s’affirment des résistances manifestes à la gestion urbaine qui accompagne les impératifs du temps marchand sur le plan institutionnel (constructions d’aéroports, de centres commerciaux, transformation des vieux ports en quartiers des médias, transformation de l’habitat en immeubles standing ainsi que oppositions à la gentrification, squats, etc.). La vie quotidienne est le niveau où se croisent les deux temporalités, marchande et cyclique, par exemple le supermarché et la fête de quartier, le bureau et la crèche. Dans les années 1960, Lefebvre considérait comment les organisations du travail, de la ville et d’autres institutions s’emboîtent sur le plan micro-organisationnel de la quotidienneté qui charrie tous les détails des échanges réifiés de la société bourgeoise.
Une autre approche qui lie habitat, travail et espace urbain a été impulsée par Hägerstrand[14] (1975) en Suède depuis les années 70. Il part du domicile comme point fixe pour évaluer le rayon d’action individuel des salariés. Leur mobilité signifie une liberté plus ou moins grande que la planification urbaine devrait amplifier dans une perspective humaniste selon l’auteur qui a eu une influence certaine sur les prises de décision politiques dans son pays. En contrepoint du rayon d’action individuel, sa démarche consiste à analyser les entraves et les limites d’accès, par exemple les lieux privés (entreprises) ou les frontières nationales et administratives. Cette approche peut être référée aux obstacles qui se dressent à l’intérieur de la grande région SarreLorLux. Cependant, son orientation purement quantitative ne tient pas compte des représentations subjectives des salariés et acteurs, dont l’espace mental ne correspond jamais avec la matrice rationnelle de l’espace urbain/régional[15].
Le centre du monde
En somme, la dimension subjective de l’action n’est pas centrale dans les recherches quantitatives, comme on l’a vu pour l’exemple d’Hambourg. Il est certain que la quête d’expériences non réglementées qui échappent aux statistiques implique une prise de position critique dans la mesure où la prise en compte de la subjectivité rebelle (Eigensinn) des acteurs développe rapidement des effets déstabilisants sur les dispositifs de gestion urbaine ou politique. Chez Lefèbvre, le droit à la ville est autant un concept qu’une revendication du mouvement social, impulsée de l’expérience de mai 68. Le droit à la ville fait d’ailleurs écho à la revendication autogestionnaire de l’ancienne CFDT « Vivre et travailler au pays », qui fut par exemple avancée en Basse Normandie depuis les années 70. Ce leitmotiv souligne l’unité du monde vécu, à l’encontre des segmentations imposées par les délocalisations des sites de production et l’accroissement des temps de transport.
Le droit à la ville et à la région pourrait favoriser la formation d’un espace public oppositionnel susceptible d’organiser une prise de parole et un échange d’expérience par-delà les divisions administratives de la vie quotidienne et les séparations nationales des espaces publics bourgeois-civiques. Ce type d’expression publique présente l’opportunité d’une médiation horizontale, des expériences singulières à l’échelle d’une vaste région, là où l’espace public bourgeois-civique reproduit une concentration de pouvoirs vers les centres d’activité économique des capitales, comme on le voit à Londres. Saskia Sassen a défini ces villes globales à partir de l’importance des flux financiers qui s’y condensent[16]. À l’échelle d’une grande région, ce principe organise la disparité spatiale, sociale et politique, au lieu de favoriser la construction d’un espace partagé de la métropole.
L’alternative à la « ville globale » serait une métropole cosmopolite ouverte, sur sa grande région, au Nord comme au Sud. Une ébauche de ce projet se trouve à Montevideo (que Thomas Moore a pris pour modèle de son Utopia), où se mêlent les influences de Porto Alegre au Nord, Buenos Aires au Sud, celles de la culture européenne, indigène et oppositionnelle. Ce lieu symbolise la rencontre de Lautréamont, Torres Garcia et Pepe Mujica, ancien Tupamaro devenu Président de la République. L’espace urbain de la ville se caractérise par son ouverture, par ses grands axes qui traversent les époques et les styles architecturaux, rythmé de places animées, et qui débouchent partout sur la mer et les plages du Rio de la Plata, sinon sur le port en activité. Loin des préoccupations ethnocentriques qui hantent l’Europe actuelle, une idée fait son chemin : « Aujourd’hui, il nous faut constater que Montevideo est le centre du monde »[17].