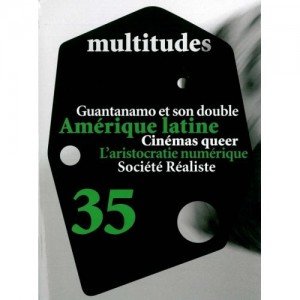Le Manifeste anthropophage d’Oswald de Andrade (1928) est aujourd’hui encore une source d’inspiration pour l’un des anthropologues les plus créatifs : Eduardo Viveiros de Castro. Cette référence lui permet d’expliciter les implications politiques globales et actuelles de ses recherches sur le cannibalisme tupi dans la perspective du relationnisme amérindien. « La clé de l’anthropophagie tupi-guarani », écrit Viveiros de Castro, se trouve dans « la capacité (qu’ont les Indiens) de se voir comme Autre – point de vue qui est, peut être, l’angle idéal d’une vision de soi-même ». En décrivant les transformations de la société tupi comme étant « admirablement constante dans son inconstance », Viveiros de Castro analyse de manière extrêmement originale la transformation du cannibalisme tupinambá à la suite de la colonisation européenne.
D’une part, il affirme la dimension fondamentale du cannibalisme dans les sociétés tupi : « Dans le cas tupinambá, le cannibalisme coïncidait avec le corps social tout entier : les hommes, les femmes, les enfants, tous devaient manger leur contraire. En effet, c’était lui qui constituait ce corps dans sa densité et son extension maximales, lors des festins cannibales. Sa pratique, en revanche, impliquait une exclusion qui semblait mineure et temporaire, mais qui était décisive : le tueur ne pouvait pas manger sa victime. (…) L’abstinence du tueur indique une division du travail symbolique dans le travail d’exécution et de dévoration où, tandis que la communauté se transformait en une meute féroce et sanguinaire mettant en scène un devenir-animal et un devenir-ennemi, le tueur supportait le poids des règles et des symboles, enfermé dans un état liminaire, prêt à recevoir un nouveau nom et une nouvelle personnalité sociale. Lui et son ennemi tué étaient, en un certain sens, les seuls êtres humains véritables dans toute la cérémonie. Le cannibalisme était possible car l’un ne mangeait pas. » « Le cannibalisme n’était pas la condition sine qua non du système de vengeance guerrière, mais sa forme ultime. »
D’autre part, Viveiros de Castro met l’accent sur le fait que, dans les suites immédiates de l’arrivée des Portugais, les Tupinambá ont très vite abandonné cette pratique qui était pour eux fondamentale, sous la pression des jésuites. La disparition de cette pratique, dès 1560, aurait dû signifier « la perte d’une dimension essentielle de la société tupinambá : l’identification aux ennemis, c’est-à-dire son autodétermination par le biais de l’autre, son altération essentielle ». En fait, dit Viveiros de Castro, « les Européens sont venus occuper la place et les fonctions des ennemis dans la société tupi, de telle manière que les valeurs qu’ils portaient et qui devaient être incorporées finissaient par éclipser les valeurs qui étaient intériorisées par la dévoration de la personne des contraires ». La « persistance de la vengeance guerrière (…) atteste que le motif de la prédation ontologique a continué à occuper les Tupinambá pendant quelque temps encore. Cela confirme aussi, comme le montre l’ethnologie des Amérindiens contemporains, qu’il n’est pas nécessaire de manger littéralement les autres pour continuer à dépendre d’eux comme source de la substance même du corps social, substance qui n’était rien d’autre que ce rapport cannibale aux autres ».
L’anthropophagie comme théorie révolutionnaire
C’est ici que Viveiros de Castro fait intervenir sa lecture des Sermões du père Antonio Vieira. Celui-ci écrivait en 1675 : « Voilà la différence qu’il y a entre certaines nations et d’autres dans la doctrine de la foi. Il y a des nations naturellement dures, tenaces et constantes, lesquelles reçoivent difficilement la foi et abandonnent les erreurs de leurs ancêtres ; elles résistent par les armes, elles doutent avec la raison, elles répugnent avec la volonté, elles se ferment. [Enfin, elles donnent un grand travail avant de se rendre. Mais, une fois rendues, une fois qu’elles ont reçu la foi, elles restent fermes et constantes, comme une statue de marbre : il n’est plus nécessaire de travailler avec elles. Il y a d’autres nations, au contraire – et c’est le cas de celles que l’on trouve au Brésil – qui reçoivent tout ce qu’on leur enseigne avec une grande docilité et facilité, sans argumenter, sans répliquer, sans douter, sans résister. Mais ce sont des statues de feuillage qui, une fois que la main du jardinier s’en est allée, perdent immédiatement leur forme et reviennent à l’état brut ancien et naturel, redeviennent buissons comme avant ». L’inconstance est la véritable constante des « sauvages ». « Au Brésil, souligne Viveiros de Castro, la parole de Dieu était accueillie avec ferveur d’une oreille et ignorée avec désinvolture de l’autre. L’ennemi, pour les Portugais, ce n’était pas un dogme différent, mais une indifférence au dogme, un refus de choisir. » Dans les mots du père Vieira : « D’autres gens sont incrédules jusqu’à croire ; les brasis même croyants sont incrédules. »
Viveiros de Castro n’utilise pas ces « commentaires » des jésuites comme le ferait la victimisation multiculturaliste, en y dénonçant une stigmatisation des Indiens. « Nous savons que les jésuites avaient désigné les coutumes comme leur principal ennemi. Barbares de troisième classe, les Tupinambá n’avaient pas à proprement parler de religion, uniquement des superstitions. » Par contre, « nous, les modernes, nous n’acceptons pas une telle distinction ethnocentrique. Nous dirions : les jésuites n’ont pas vu que les ‘mauvaises coutumes’ des Tupinambá constituaient leur véritable religion ».
Les missionnaires progressistes d’aujourd’hui refont l’opération des jésuites à l’envers. Cette fois, ce sont les Indiens qui sont porteurs des nouvelles notions de « bien » et de « beau », auxquelles il faudrait se convertir . Les anciens et les modernes constituent les deux faces d’une même machine anthropologique occidentale, comme le diraient Descola ou Agamben.
Viveiros de Castro se demande quelle était la raison qui amenait les Tupinambá à être « inconstants par rapport à leur propre culture-religion ». Pourquoi étaient-ils constants dans l’inconstance ? Ce qui est intéressant, souligne Viveiros de Castro, c’est justement d’appréhender « le sens de ce mélange de volubilité et d’obstination, (…) d’enthousiasme et d’indifférence par lequel ils ont reçu la bonne nouvelle ». En fait, la réponse se trouve dans la transformation du cannibalisme après l’arrivée des Européens. « Les Tupi ont désiré les Européens dans leur altérité pleine, qui leur semblait une possibilité d’auto-transfiguration, un signe de réunion de ce qui avait été séparé à l’origine de la culture, capable donc d’élargir la condition humaine, voire de la dépasser. » En mobilisant Clifford, Eduardo Viveiros de Castro ajoute : « l’inconstance de l’âme sauvage, dans son moment d’ouverture, est l’expression d’un mode d’être, ‘la valeur fondamentale qui est affirmée, c’est l’échange et non l’identité’ ». La disparition du cannibalisme dans sa dimension littérale le confirmait dans sa dimension générale, ontologique ! « La capture d’altérités extérieures au socius et sa subordination à la logique sociale ‘interne’ (…) était le moteur et motif principal de la société [des Tupinambá. (…) Vengeance cannibale et hospitalité enthousiaste exprimaient la même propension et le même désir : absorber l’autre et, dans ce processus, s’altérer. » La société tupi n’existait pas en dehors d’une « relation immanente à l’altérité », et cela dans la mesure où leur religion, « enracinée dans le complexe de l’exocannibalisme guerrier, projetait une forme où le socius se constituait dans le rapport à l’autre, où l’incorporation de l’autre dépendait d’un sortir de soi. L’extérieur était dans un processus incessant d’intériorisation et l’intérieur n’était rien d’autre qu’un mouvement vers le dehors ».
Le Manifeste anthropophage anticipe politiquement les découvertes théoriques de l’anthropologie contemporaine. Lors d’une conférence prononcée en 1945, Oswald de Andrade déclarait : « Il est primordial que l’on restaure le sens de communion avec l’ennemi vaillant dans l’acte anthropophage. L’Indien ne dévorait pas par gourmandise mais plutôt dans un acte symbolique et magique où se trouve et réside toute sa compréhension de la vie et de l’homme. » Il écrit aussi dans une communication envoyée à Rio de Janeiro en 1954 : « L’Indigène ne mangeait la chair humaine ni par faim ni par gourmandise. Il s’agissait d’une sorte de communion de la valeur qu’avait en soi toute une position philosophique : l’anthropophagie nous rappelle que la vie est dévoration ». Et il concluait par un « appel à tous les chercheurs de ce grand thème pour qu’ils prennent en considération la grandeur du primitif, son solide concept de vie comme dévoration et pour qu’ils développent toute une philosophie qui est en train de se faire. »
L’anthropophagie oswaldienne, dit Viveiros de Castro, a été la « réflexion méta-culturelle la plus originale jamais produite en Amérique latine jusqu’aujourd’hui. (…) L’anthropophagie a été la seule contribution vraiment anti-coloniale que nous ayons engendrée. (…) Elle jetait les Indiens vers le futur (…) ; ce n’était pas une théorie du nationalisme, du retour aux racines, de l’indianisme. Elle était et elle est une théorie réellement révolutionnaire. »
Le métissage comme ligne de fuite
Dans sa conférence de 1923 à la Sorbonne sur les transformations culturelles que connaissait alors le Brésil, Oswald déclarait : « Le Brésil, sous le ciel déiste, prend conscience de son futur. » Plus de deux décennies plus tard, lors d’une conférence dédiée aux transformations de l’intérieur du Brésil, en 1948, il ne définissait le mouvement anthropophage comme un indianisme que pour mieux le distinguer de l’exaltation romantique des Indiens. Oswald a été le grand « théoricien de la multiplicité », souligne Viveiros de Castro, et « maintenant tout le monde est en train de découvrir qu’il faut hybrider et métisser ».
Quelle est l’actualité du mouvement anthropophagique oswaldien ? On la trouve par exemple dans les mouvements de critique de la propriété intellectuelle : « Les Creative Commons sont en train d’essayer de consacrer au niveau juridique le processus d’hybridation, l’anthropophagie, le pillage positif, le pillage comme instrument de création. Je suis en train d’essayer de faire en sorte que le pillage et le don puissent s’articuler ». Les implications politiques sont évidentes. En répondant à la question de savoir s’il préfère le pillage au don, l’anthropologue brésilien répond : « Nous devons devenir des Robin des Bois. Piller pour donner. L’idéal, c’est même de prendre aux riches pour donner aux pauvres. (…) L’anthropophagie, qu’est-ce que c’est ? Prendre aux riches. Autrement dit, ‘nous allons prendre à l’Europe ce qui nous intéresse’. Soyons l’autre dans nos propres termes. Prendre l’avant-garde européenne, l’amener ici [au Brésil, et la donner aux masses. » Le métissage comme ligne de fuite et constitution de la liberté.
L’anticipation oswaldienne a donc consisté à saisir la dynamique brésilienne, à cheval entre l’héritage de la colonisation européenne et sa projection dans l’avenir. Oswald a vu dans le Brésil qui entrait dans la modernité un « pays du futur », non pas du point de vue de la dynamique de construction d’une trajectoire nationale de développement, mais dans la perspective du développement du rapport brésilien (indigène) à l’altérité coloniale.
La révolution anthropophagique, au fur et à mesure qu’elle projetait les Indiens dans le monde, se fondait sur une théorie de la multiplicité et non de la « diversité ». L’anti-colonialisme n’était pas un nationalisme et moins encore un isolationnisme, mais une machine de guerre pour prendre à l’Europe des riches « ce qui nous intéressait ». L’anti-colonialisme vers l’extérieur impliquait en réalité un anti-colonialisme dirigé contre le « colonialisme interne qui traite les peuples indigènes comme des obstacles à la standardisation de la nationalité ». L’anti-colonialisme anthropophagique implique le dépassement de toutes les démarches qui attribuent les impasses brésiliennes aux seuls déterminants exogènes. La réponse que l’Amérique latine doit apporter à l’aliénation culturelle consiste à creuser plus encore le métissage et l’hybridation avec les flux mondiaux.
L’œuvre d’Oswald est traversée par une puissance dont dérivent les dimensions simultanément esthétiques (artistiques) et politiques. Cette puissance dessine une ligne de fuite d’une très grande continuité. Parmi les innombrables références qu’on pourrait citer, nul article ne pourrait pas être plus adéquat à notre propos que « Sol de meia-noite » (publié en 1943). Il affirme que « l’Allemagne raciste (…) a besoin d’être éduquée par notre mulâtre, par le Chinois, par l’Indien le plus arriéré du Pérou ou du Mexique, par l’Africain du Soudan. Elle a besoin de se mélanger une fois pour toutes. Elle doit être déconstruite dans le melting-pot du futur. Elle a besoin de se métisser ». Le métissage, l’hybridation constituent une ligne de fuite. L’exode est un terrain de lutte : « Fuir, mais en fuyant chercher une arme. » Ensuite, Oswald relie immédiatement cette ligne à la constitution de la liberté : « Pour la liberté, nous aussi, ceux d’Amérique, sommes capables de donner la vie. Toute l’histoire de notre continent, surtout l’histoire riche, dramatique et coloriée de l’Amérique latine, est marquée par des gestes libertaires. » Si, en 1943, le combat contre le fascisme occupe tout l’horizon, dès 1944, Oswald qualifie son concept de liberté de manière plus générale et cite la fameuse phrase de Spinoza : « Le but de la République n’est pas de dominer, ni de maintenir les hommes sous la peur ou de les soumettre à d’autres hommes. Le but de la République n’est pas non plus de transformer des hommes rationnels en bêtes ou en machines, mais le contraire. En un mot, le but de la République, c’est la liberté » (TTP, XX, 6).
Oswald a toujours lié son engagement esthétique, politique et littéraire à un effort de libération affirmative, non dialectique. C’est en cela qu’il se distingue des autres modernistes, ceux qui glisseront dans le nationalisme xénophobe et fasciste, qu’il ne cessera pas de mitrailler d’une ironie irrésistible.
Son langage n’est pas seulement connotatif, il est mixé et métissé. C’est dans cette dynamique de résistance et de création que sa « brasilianité » apparaît incompatible avec une quelconque forme de xénophobie nationaliste. Elle était déjà présente déjà dans le Manifeste de la Poesia Pau-Brasil (1924) et elle s’est radicalisée dans le Manifeste anthropophage de 1928. C’est dans le premier livre qu’il revendiquait le caractère constituant de l’erreur : « Como falamos. Como Somos ». La poésie d’exportation doit donc se baser sur une « langue naturelle et néologique » à la fois. « Nous avons une base double – la forêt et l’école.»
Alors que les académiciens illustres essaient de construire une langue indépendante de l’Europe, un portugais brésilien, Oswald est déjà préoccupé par le « jargon des grandes villes brésiliennes, où commence à s’épanouir, surtout à São Paulo, une surprenante littérature des nouveaux immigrants ». São Paulo et ses plantations de café constituaient la grande inspiration, d’abord des modernistes, ensuite des anthropophages. Et São Paulo fonctionnait comme le grand creuset où les différentes races devenaient une seule soupe. Oswald disait que les races se « soupaient » (caldeavam-se). Rien à voir avec l’apologie d’une soupe où toutes les différences s’estomperaient en faveur d’une identité qui, même métisse, serait homogène et nationale. Ce qui intéresse l’anthropophagie, c’est la multiplication des différences, la liquéfaction et le mélange des identités – mais pas de les faire passer en soupe.
« Tout est Brésil »
La démarche d’Oswald émerge entre les tout premiers efforts déployés pour construire l’idée ou l’image d’un peuple brésilien (à la fin du XIXe siècle) et l’affirmation mature de ce projet, tout au long des années 1930. Oswald se trouve donc au milieu – et comme au tournant révolutionnaire – entre Os Sertões (1901) d’Euclydes da Cunha et Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre. Schématiquement, on pourrait dire que, dans Os Sertões, la puissance du métissage (la composition ethnique du sertanejo) apparaissait encore de manière brute, dans la monstruosité des conditions de vie des habitants du Sertão et la brutalité des combats qui opposaient les sertanejos de Canudos à l’armée républicaine et nationale. Mais, chez Euclydes, il y avait déjà une rupture : le pessimisme d’un Machado de Assis était dépassé par l’apparition d’un espoir du peuple, et par sa mystique. Dans Os Sertões, ce sont une nouvelle terre et un nouveau peuple qui s’annoncent. Chez Freyre, avec Casa Grande e Senzala, nous entrons dans une analyse sociologique bien plus sophistiquée, qui correspond à l’arrivée au pouvoir de Gétulio Vargas et aux débuts du projet national-développementiste.
C’est dans ces termes qu’Oswald voit lui-même les choses. En 1923, déjà, il citait l’auteur d’Os Sertões : « Une excellente contribution nous a été offerte par un homme de science, Euclydes da Cunha, écrivain puissant, ingénieur et géologue, qui, en tant qu’officier de l’armée, a participé à la répression d’une révolte mystique qui a convulsionné l’État de Bahia. Et il a fixé dans son livre Os Sertões la scène, l’âme et la vie de cette population qui descendait de l’aventurier et de la métisse. » Les références à Gilberto Freyre sont très nombreuses. Sa sociologie est explicitement politique, y compris dans les conflits qui traverseront le mouvement moderniste jusqu’à la scission entre les modernistes qui deviendront « anthropophages » et ceux qui constitueront le groupe Verde & Amarelo (vert et jaune, les couleurs nationales) et qui s’appelleront Anta par la suite.
Dès 1937, Oswald cite Freyre dans un article publié dans le quotidien O Estado de São Paulo dédié à la scission du modernisme comme l’un des intellectuels, avec Sérgio Buarque de Hollanda, qui se « dirigeaient » vers la gauche. Huit ans plus tard, Oswald écrit : « la voix cultivée de l’auteur de Casa Grande e Senzala [affirmait que l’Anthropophagie [avait sauvé le mouvement [moderniste de 1922 ».
Pour Oswald de Andrade, le lien entre Freyre et Euclydes da Cunha est tout à fait clair : « D’une certaine manière, Casa Grande e Senzala, affirme-t-il en 1948, est un complément d’Os Sertões de Euclydes, parce qu’il étudie la fixation des usines à sucre (engenhos) alors que la gravure euclidienne exprime la résistance de l’élément mystique autour d’un chef nomade. »
Oswald maintient un projet anti-colonial brésilien face au court-circuit nationaliste et nativiste des modernistes qui avaient adhéré au mouvement fasciste connu sous le nom d’Integralismo. Oswald passera toute sa vie à dire que l’Anthropophagie était la ligne de partage des eaux entre la droite et la gauche modernistes. « Nous avons abandonné les beaux salons et sommes devenus les chiens du modernisme (…). Des chiens qui ont mangé de la prison, qui ont souffert la faim (…). C’est que l’Anthropophagie sauvegardait le sens du modernisme et payait le tribut politique lié à la décision de marcher vers le futur. »
L’hybridation n’est pas un projet abstrait, mais une pratique. Il est tout à fait vraisemblable qu’Oswald ait découvert le Brésil dans une chambre d’hôtel, « probablement à Paris », de la même manière que Freyre a découvert le Brésil à Columbia, aux États-Unis. C’est d’ailleurs dans ces termes que Paulo Prado s’exprime dans son introduction à la Poesia Pau Brasil e 1924 : « Pendant un voyage à Paris, du haut d’un atelier de la Place de Clichy – nombril du monde – [Oswald a découvert, ébloui, sa propre terre. » Après avoir fustigé avec violence « la xénophobie triste » d’une « macumba pour touristes » des modernistes de droite, Oswald affirme avec force son inspiration étrangère : « s’il y a quelque chose que j’ai rapporté de mes voyages en Europe dans l’entre-deux guerres, c’est le Brésil lui-même ». C’est à la lecture de Montaigne qu’il doit son intuition anthropophagique.
De même, Viveiros de Castro s’oppose violemment à la notion « d’idées venues d’ailleurs » développée par Roberto Schwarz. Les idées sont sur place et se propagent par dévoration, par hybridation. Oswald parle de Sergio Milliet comme d’un naufragé dont « nous avons facilement dévoré les innocentes chairs genevoises ». Le Brésil n’est rien d’autre que « pure déglutition ».
Roberto Schwarz reconnaît que « rien [n’était moins ouvert aux influences étrangères que le modernisme de 1922 ». En même temps, Schwarz articule cette vision positive de l’ouverture avec la construction de la notion de « culture populaire ». D’un côté, le modernisme transformait la réalité populaire en élément actif de la culture brésilienne, du projet national. De l’autre, il y avait un « nationalisme programmatique qui s’enfonçait dans le pittoresque ». Schwarz insiste : « la question n’est pas d’être pour ou contre une influence externe, mais de la considérer – de la même manière que la tradition nationale – dans une perspective populaire ».
C’est cette construction du national-populaire ou de l’idée de peuple brésilien qui constitue le véritable enjeu. Un enjeu qui, dans le Brésil républicain post-abolition de l’esclavage, signifiait appréhender la manière de s’affronter au casse-tête d’un vaste mélange d’ethnies, de populations et de langues dont les lignes d’horizon se connectaient aux flux migratoires et au passage des formes de dépendance coloniales (ou néo-coloniales) à celles de l’impérialisme. Le violent conflit interne au modernisme, entre le virage gauchiste et communiste d’Oswald et le fascisme tropical de Cassiano e Plínio n’était ni un débat académique ni une dispute intellectuelle tranquille, mais une rupture sociale et politique, traversée en profondeur par d’innombrables lignes de couleur, de classe, d’ethnie et de langue. La complexité du conflit se redoublait du fait de la transition de l’esclavage au travail libre. La transition était marquée par des rapports de force dans l’agriculture, qu’Oswald résumait en citant Pline le Jeune : « Latifundia perdidere Italiam » – les latifundios ruinaient le Brésil et réduisaient l’impact et la portée de la transition hors de l’esclavage.
Or, c’est bien sur les conditions de la sortie de l’esclavage qu’il faut revenir pour voir si le déplacement du casse-tête de la construction du « peuple » brésilien et de la nationalité proposé par les anthropophages et ensuite par la sociologie de Freyre a été capable de saisir les conflits qui caractérisaient le passage et les nouveaux rapports sociaux de production. En parlant de l’expérience du gouvernement Lula (en 2005), Viveiros de Castro différencie deux types de « solutions », deux types de projets « dits nationaux ». D’une part, nous avons « un projet national classique, dans le mauvais sens du terme, qui est celui d’inventer (ou découvrir) cette chose appelée l’identité nationale ». D’autre part, il y a le projet auquel il appelle : « nous devons ‘dés-inventer’ le Brésil ». Dans cette deuxième perspective, il ne s’agit pas d’un projet national, mais post-national, non pas « vive le Brésil », mais « tout est Brésil ». Ce partage reproduit le conflit qui opposait les anthropophages au groupe fasciste et xénophobe de la Anta.
La problématique du métissage n’a-t-elle pas été capturée par le pouvoir, pour gérer le racisme à travers les flux ? Quelle était la nature de l’anthropophagie culturelle et politique Tupinambá dans son rapport, non pas à l’altérité des colonisateurs portugais, mais à celle des esclaves « importés » d’Afrique ? Quelle anthropophagie, quel devenir Brésil ont été mobilisés par les esclaves libérés devant l’altérité des flux d’immigrés étrangers qui ont commencé à peupler massivement les plantations de café ?
Racisme et métissage dans le Brésil contemporain
Au Brésil, dès la fin des années 1990, l’hégémonie du discours de la « démocratie raciale » a été fortement mise en question par une nouvelle génération d’études sociologiques et statistiques qui, à la suite des travaux dédiés à l’étude des inégalités, ont établi la corrélation manifeste entre stratification sociale et « couleur » de la peau. L’accent que le discours néolibéral mettait sur la question des inégalités pour donner une légitimité sociale au renoncement à la croissance au nom des politiques de stabilisation macro-économique était relayé par les efforts pour définir de nouveaux instruments pour quantifier les éléments qualitatifs du développement.
On s’apercevait de plus en plus nettement que le pourcentage des noirs (pretos) et des métis (pardos) présents dans les couches des pauvres et extrêmement pauvres était toujours supérieur à leur part démographique dans la population totale. La corrélation entre inégalité sociale (en termes de niveau de revenu et de hiérarchisation sociale du travail) et couleur de la peau est rapidement devenue un constat « objectif ». D’autres éléments de preuve ont été apportés, qui montrent une multiplicité des lignes de discrimination clairement racialisées, difficilement compatibles avec le maintien du consensus officiel sur l’harmonie des relations interraciales au Brésil depuis l’abolition de l’esclavage.
Ces questionnements « statistiques » ont fini par renforcer les tentatives d’ouvrir des brèches innovantes dans les politiques de combat contre le racisme. C’est autour des conditions d’accès à l’enseignement supérieur que s’est concentré ce nouveau débat. Les universités publiques (fédérales et des États fédérés) n’accueillent que 2,5 % des jeunes en âge de les fréquenter. Le système privé en absorbe 7 %. Au total, en additionnant les deux segments, on arrive tout juste à 10 %. L’accès au système public – qui assure un enseignement de qualité entièrement gratuit – est régi par un examen d’entrée que parviennent à réussir seulement les candidats qui ont pu payer des classes préparatoires (ou des lycées privés). Les candidats issus des lycées publics ont très peu de possibilités d’accéder aux facultés publiques et pratiquement aucune possibilité (sauf rarissimes exceptions) d’accéder aux filières les plus prestigieuses. La corrélation entre couleur de peau et exclusion est visible à l’œil nu sur n’importe quel campus public, y compris à Salvador de Bahia où la population noire et métisse constitue la grande majorité de la population.
Au début des années 2000, l’Assemblée législative de l’État de Rio de Janeiro a voté une loi établissant une discrimination positive à l’examen d’entrée de la prestigieuse Université de l’État de Rio (UERJ). Cette mesure a été adoptée par un nombre croissant d’universités fédérales dans le cadre de leur régime d’autonomie et a été transformée par le gouvernement Lula en un projet de loi qui vise, entre autres, l’expansion générale du nombre d’étudiants et la démocratisation des conditions d’accès.
Or, cette généralisation des mesures d’action affirmative, auxquelles s’ajoute, à l’initiative toujours du gouvernement Lula, l’institution d’un ministère de l’égalité raciale (qui a élaboré un Statut de l’égalité raciale), a suscité un véritable tollé. Les deux projets de loi, l’action affirmative et le Statut de l’égalité raciale, ont été bloqués. L’opposition à ces projets est menée, de manière extrêmement violente, par les grands médias.
À l’affirmation traditionnelle selon laquelle il n’y aurait pas de racisme au Brésil, s’est ajouté un discours qui, s’appuyant sur les thèses de certains anthropologues, définit l’action affirmative non seulement comme inefficace (ou inutile) mais aussi comme un dangereux instrument de construction du racisme. Ainsi, lorsque le directeur de l’information de la plus importante chaîne de télévision (privée) publie un livre intitulé Nous ne sommes pas racistes !, ses prétentions intellectuelles et universitaires sont « labellisées » par l’introduction rédigée par une anthropologue de l’Université fédérale de Rio. L’opposition aux revendications du mouvement noir et aux projets de loi du gouvernement Lula est transversale et ratisse aussi dans les rangs de la gauche, à tous les niveaux, y compris au sein du gouvernement, du Parti des travailleurs et de l’extrême gauche.
Le refus des politiques d’action affirmative se base sur une double assertion : le Brésil est un pays dont le métissage généralisé n’empêche pas qu’il y ait des discriminations, mais, d’une part, il les limite de manière drastique et, d’autre part, l’action affirmative ne ferait qu’aggraver et amplifier les dimensions raciales de ces clivages. L’action affirmative finirait par expliciter les dimensions racistes des discriminations. L’action affirmative et le statut de l’égalité raciale réintroduiraient le racisme au Brésil à travers des politiques d’inspiration nord-américaine, inspirées par un modèle ségrégationniste qui n’aurait rien à voir avec le modèle du métissage typique du Brésil. Il s’agit donc d’une nouvelle génération « d’idées venues d’ailleurs ».
Le discours théorique mobilisé contre l’action affirmative constitue la base de la pensée littéraire et sociologique brésilienne. Une pensée Républicaine. Une pensée qui, après les balbutiements des débuts du XXe siècle, s’est affirmée avec force dans les années 1930, avec Gétulio Vargas et l’Estado Novo (1937). Le combat contre le racisme constituerait une menace pour le métissage car celui-ci empêche de décider qui est blanc et qui est noir. Une sociologue écrit : « Le coût d’une imminente tension raciale, que nous observons aujourd’hui dans les contextes où les politiques d’action affirmative ont été introduites, peut être très élevé pour un pays comme le Brésil dont l’ontologie raciale ne se structure pas selon des standards rigides de classification raciale ».
Pourtant nous n’avons constaté aucun affrontement racial dans les universités qui ont appliqué les politiques de quotas. Quel danger supplémentaire court une démocratie raciale lorsque, pour fournir un seul exemple, en 2007, dans le seul État de Rio de Janeiro, la police a tué 1700 personnes lors d’affrontements à l’arme à feu ? Mais deux anthropologues de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro insistent : « Parler d’Afro-descendants dans le contexte brésilien, c’est imaginer un Brésil ontologiquement divisé entre Noirs et Blancs. La construction d’un Brésil de deux races implique nécessairement le rejet du métissage et de la démocratie raciale en tant que valeurs positives. »
Certaines justifications de l’action affirmative opposent d’ailleurs les trajectoires socio-économiques des Noirs brésiliens à celles des immigrés étrangers. Selon ce discours, le « succès » des Brésiliens descendants des immigrants européens, japonais ou orientaux, serait dû à des actions affirmatives qui les auraient privilégiés alors que les anciens esclaves étaient exclus du marché du travail. Le repli identitaire noir se présente alors comme un discours spéculaire par rapport à celui du pouvoir, associant la condition des Noirs brésiliens à l’horizon impuissant d’une oppression totalisatrice. Ce discours prétend qu’au moment de l’abolition, les Noirs émancipés (« libertos ») auraient été abandonnés à eux-mêmes. La « preuve » de cet abandon serait leur substitution, sur le marché du travail, par les travailleurs immigrés internationaux. La détresse des anciens esclaves serait donc due à leur « exclusion » de l’emploi une fois que celui-ci passait sous le régime du salariat.
De cette manière, l’identitarisme n’est plus un moment spécifique de construction de nouveaux rapports de force, mais une fin en soi. Ce repli semble donner une certaine légitimité aux critiques menées contre les politiques de « discrimination positive » et court le risque de jeter à la poubelle les approches en termes de métissage. L’abolition tardive de l’esclavage (en 1888) s’est produite à la même époque que l’arrivée des grandes vagues d’immigrants internationaux. Les articles d’histoire de la littérature ou de critique dédiés au modernisme soulignent ceci avec force. On fait référence à un pays qui se modernisait et disposait « d’un excès de terres et d’un manque de population, aucune industrie ou ville peuplée et manufacturière ». L’abolition de l’esclavage semblait le fait de l’importation de l’étranger d’un courant « d’idées venues d’ailleurs », qui ne trouvaient pas leur place dans une société patriarcale qui semblait ne jamais pouvoir sortir de la très longue période esclavagiste. « Même s’ils étaient libérés du spectre de l’esclavage formel, nos critiques devaient faire face aux masses de quasi-citoyens jetés à la rue, mélangés avec les immigrants qui, depuis longtemps, arrivaient clandestinement, au cœur du trafic réactivé depuis la fin des années 1930, en rejoignant le grand nombre des déclassés sociaux. » Roberto Schwarz se réfère ici à la situation des années 1930, lorsque le gouvernement Vargas avait déjà bloqué les flux d’immigrants.
Le Manifeste anthropophage peut-il nous permettre de revenir de façon innovante sur le débat actuel autour de la lutte (et des politiques) contre le racisme ? Le débat présent sur le racisme et le métissage au Brésil peut-il nous permettre de mieux saisir la puissance du mouvement Anthropophage dans le devenir-Brésil du Monde (par exemple des banlieues parisiennes) ?
Le devenir-Sud du monde contre « le Sud qui a gagné »
Il y a trois éléments du discours sur le métissage développé par Oswald que nous retrouvons chez Gilberto Freyre et chez les autres sociologues qui ont renouvelé, de manière hégémonique à partir des années 30, l’approche de la question ethnique brésilienne. En premier lieu, il y a le thème des caractéristiques spécifiques de la colonisation portugaise. En reprenant, mais en positif, les recherches de Paulo Prado et Sérgio Buarque de Holanda, Oswald de Andrade et Gilberto Freyre affirment la dimension « africaine » et métisse des Portugais. Le deuxième élément est celui du mélange des trois races. Le troisième élément nous semble être celui de la différence entre l’esclavagisme nord américain et le luso-brésilien. Le texte d’Oswald qui, peut-être, concentre le plus ces éléments est un article de 1943 dans le quotidien O Estado de São Paulo, « Aqui foi o Sul que Venceu ». Alors que la société patriarcale de la Louisiane a été vaincue, au Brésil le Sud a gagné, la « culture agraire et sentimentale » a été le théâtre de la « bonne volonté et du melting-pot ». « Dans le continent américain, le Brésil est le Sud sensible et cordial qui a gagné ». Oswald se demande aussi si, quelque part dans le Brésil méridional et surtout à São Paulo, les thèses racistes d’Oliveira Viana rencontrent une confirmation quelconque. Ce dernier affirmait que le Brésil avait su maintenir une muraille raciste (blanche) dans le caldeamento (la soupe du métissage) et, pour y répondre négativement Oswald doit rappeler que « São Paulo, avant d’être industriel, c’était le café et donc la fazenda et la terra ».
En fait, lorsque Oswald suit de près Freyre, il est obligé de mettre au cœur de la brasilianité de São Paulo la tradition patriarcale et esclavagiste des grandes plantations de café. Il perd, ou laisse temporairement de côté, l’originalité de sa démarche moderne et anti-moderne à la fois. Il laisse de côté la modernité qu’il avait vue et vécue dans ce creuset des langues et des races de toute la planète qu’était devenue la métropole pauliste, une métropole anthropophage qui continuait son brassage, depuis la moitié du XIXe siècle par la capture de flux millionnaires d’immigrations internationales.
Mais le métissage oswaldien anthropophage était une posture de combat, révolutionnaire, dans le champ d’une autre modernité, alors que pour Freyre, c’était le terrain d’une conciliation, de la gestion fine des rapports charnels qui joignaient la Senzala à la Casa Grande, l’esclave au maître. Des rapports qui vont entraîner un processus de blanchiment que les immigrations européennes pourront favoriser. En revanche, la positivité du métissage et l’anthropophagie éliminent toute dimension biologique et naturelle de la race et refusent le concept même de race ! Gilberto Freyre a développé une troisième approche, fortement influencée par l’anthropologie de Boas, dans laquelle la dimension biologique reste ouverte aux déterminations du milieu. La race ne disparaît pas, elle devient artificielle ou historique, un résultat plutôt qu’une cause.
Cette position s’est consolidée dans l’idéologie officielle de l’harmonie raciale (ou démocratie raciale) brésilienne. Il s’agit de capturer la dynamique monstrueuse du métissage pour la fixer dans une nouvelle race. Résultat du milieu naturel et culturel (les tropiques et le patriarcat esclavagiste), elle est une race métisse, celle qui est invoquée par l’élite brésilienne pour continuer à dire que le racisme n’existe pas : « somos todos pardos », nous sommes tous gris !
Rien à voir avec Oswald. Pour Oswald, il fallait raviver une « roche vive qu’Euclides avait sentie dans la Stalingrad jagunça de Canudos ». Pour lui, l’hybris monstrueuse du rapport entre l’esclave et le maître n’est pas en soi libératrice et salvatrice du régime patriarcal. Au contraire, le monstre est le terrain qu’il ne faut pas refuser, mais il est le terrain du combat. C’est en faisant référence à l’actualité de Os Sertões qu’Oswald explicite ses différences, toujours en 1943, d’avec Gilberto Freyre. « Il y avait chez Freyre une tendance au luso, avec le but d’élever le blanc suspect de la première Amérique au standard de nationalité. Une sorte de réplique et de contrepoint à l’orgueil mamelouque (métis) des paulistes de quatre cents ans. Les deux ne voient pas que les néo-immigrés – syriens, italiens, juifs – amenaient ici des millénaires riches de civilisation et d’activité créatrice et surtout le blason simple du travail ».
La dynamique du métissage est constituante, et donc elle est exactement le contraire de sa fixation dans un nouvel ensemble homogène. Son terrain est celui du devenir, de la multiplication des couleurs, et non de la réduction à la grisaille derrière laquelle s’organisent les modulations chromatiques du biopouvoir. C’est la continuité du métissage et donc la multiplication des couleurs contre l’image grise du peuple métis. Les jeunes noirs et métisses qui luttent pour l’action affirmative, et qui produisent en elle, ont constitué, sur ce terrain, une innovation critique, à la fois, du discours officiel de la démocratie raciale et du multiculturalisme qui, pendant des décennies, représentait la tranchée défensive du mouvement noir. L’arc-en-ciel des couleurs du Brésil trouve dans l’actualité de la lutte anthropophagique un nouvel horizon constituant : le devenir-Sud du monde.
Références bibliographiques
Andrade, Oswald de,
« O esforço intelectual do Brasil Contemporâneo » (1923), in Boaventura, 1991.
« Manifesto da Poesia Pau-Brasil » (1924), in Andrade, 2004.
« Pau Brasil » (1925), in Andrade, Completas, São Paulo, Globo, 2003, 89.
« O Divisor de Águas Modernistas » (1937), Boaventura, septembre 1991.
« Atualidade d’Os Sertões » (1943), in Andrade, 2003.
« Carta a Monteiro Lobato » (1943), in Andrade, 2004.
« Sol da meia-noite » (1943), in Andrade, 2004.
« Aspectos da pintura através de Marco Zero » (1944), conférence prononcée le 15 août 1944, exposition Brasileiro-Norte-americana de Arte Moderna, in Andrade, 2003.
« O caminho percorrido » (1944), conférence prononcée à Belo Horizonte, in Andrade, 2004.
« Informe sobre o Modernismo » (1945), conférence prononcée le 15 octobre 1945 à São Paulo, in Boaventura, 1991.
« O sentido do Interior » (1948), in Boaventura, 1991.
« O Antropófago » (1950), in Boaventura, 1991.
« Sex-appel-genário » (1950), discours de remerciement, Automobile Club de São Paulo, 26 mars 1950, in Boaventura, 1991.
« A Reabilitação do Primitivo » (1954), titre donné par l’éditeur à une communication écrite que devait lire le peintre Di Cavalcanti à l’occasion de la « Encontro dos Intelectuais », Rio de Janeiro, in Boaventura 1991.
Feira das Sextas, Obras completas, Rio de Janeiro, Globo, 2003.
Ponta de Lança, Obras Completas, Rio de Janeiro, Globo, 2004.
Anthropologies…, Paris, Flammarion, 1982. Le recueil comprend notamment le « Manifeste de la poésie Bois-Brésil » et les « Manifestes et textes anthropophages ».
Araújo, Ricardo Benzaquen de,
Guerra e Paz : Casa Grande & Senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30 (1994), São Paulo, Editora 34, 2de éd., 2005.
Boaventura, Maria Eugênia (dir.),
Oswald de Andrade, Estética e Política, Obras Completas, São Paulo, Globo, 1991.
Candido, Antonio,
« Caracterização das memórias de um sargento de milícias », São Paulo, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n° 8, 1970.
« Literatura e subdesenvolvimento » (1969), in A Educação pela Noite e Outros Ensaios, Rio de Janeiro, Ouro sobre azul, 2006 (première parution, en français, in Cahiers d’histoire mondiale, Unesco, XII, 4, 1970).
Clastres, Pierre,
La Société contre l’État, Paris, Minuit, 1974.
Cocco, Giuseppe & Negri, Antonio,
« A insurreição das periferia », Valor Econômico, 23 décembre 2005.
GlobAL. Luttes et biopouvoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire de l’Amérique latine, Paris, Éd. Amsterdam, 2007.
Cunha, Euclides da,
« Entre o Madeira e o Javarí » (1904), in Contrastes e confrontos, Obra completa, vol. 1, Rio de Janeiro, Aguilar, 1966.
Grin, Monica,
« Experimentos em ação afirmativa: versao crítica em dois tempos », Dossiê Ação Afirmativa, Econômica Revista do Programa em Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, vol. 6 , n° 1, 2004.
Hasenbalg, Carlos & Silva, Nelson do Valle (dir.),
Origens e Destinos: desigualdades sociais ao longo da vida, Rio de Janeiro, Topbooks, 2003.
Henriques, Ricardo,
Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condições de vida na década de 90, Rio de Janeiro, Ipea, Textos para a discussão n° 809, 2001.
Jaccoud, Luciana & Beghin, Nathalie (dir.),
Desigualdades Raciais no Brasil : um Balanço da Intervenção Governamental, Brasília, DF, Ipea, 2003.
Kamel, Ali,
Não somos racistas, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2006.
Schwarz, Roberto,
Cultura e Política, 1964-1969, São Paulo, Paz e Terra (première parution : « Remarques sur la culture et la politique au Brésil, 1964-1969 », in Les Temps modernes, Paris, n° 288, juillet 1970).
« As idéias fora do lugar », in Ao vencedor as batatas, São Paulo, Duas Cidades, 1977 (première parution : « Dépendance nationale, déplacement d’idéologies, littérature », in L’Homme et la Société, Paris, n° 26, 1972).
« Pressupostos, salvo engano, de Dialética da Malandragem » (1977), in Que horas são? Ensaios, São Paulo, Companhia das Letras (disponible à l’adresse : www.pacc.ufrj/literária/schwarz)
« A Carroça, o Bonde e o Poeta Modernista » (1987), in Que Horas São? Ensaios, São Paulo, Companhia das Letras.
« Cidade de Deus » (1999), in Sequencias Brasileiras, São Paulo, Companhia das Letras.
« Cuidado com as ideologias alienígenas », interview de 1976, in Abdala Jr. & Cara (dir.), 2006.
Viveiros de Castro, Eduardo,
Araweté: os deuses canibais, Rio de Janeiro, Jorge Zahar/Anpocs, 1986.
« Prefácio », in Arnt e Schwartzman, 1992.
« Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro », São Paulo, Hedra, Sexta Feira, n° 4,1999, in Viveiros de Castro, 2002.
A inconstância da alma selvagem, São Paulo, Ed. Cosac & Naify, 2002.
« Une figure humaine peut cacher une affection-jaguar », réponse à une question de Didier Muguet, Paris, Multitudes, n° 24, printemps 2006, p. 41-52.
« Filiação Intensiva e Aliança Demoníaca », São Paulo, Novos Estudos, n° 77, mars 2007.
Entretien avec Pedro Cesarino et Sérgio Cohn, Rio de Janeiro, Programa Cultura e Pensamento, MinC, Revista Azougue-Saque/Dádiva, n° 11, janvier 2007.
Desenvolvimento econômico e reenvolvimento cosmopolítico: da necessidade à suficiência, conférence donnée dans l cadre de la Série de Colóquios : Cultura, Trabalho e Natureza na Globalização, Rede Universidade Nômade – Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 19 septembre 2008.