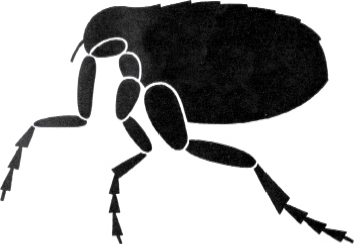« En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d’ancêtres. »
Breton, Second manifeste du surréalisme, 1930
L’heure est-elle venue de la naissance d’une avant-garde ou les temps sont-ils encore ceux de la récapitulation ? Le romantisme – L’Athenaeum – est « notre lieu de naissance », et désigne ce qui revient dans tout désir de révolution. Un romantisme est en jeu dans toutes les expériences qui dépassent la politique, mais sans lesquelles la politique n’atteint pas les existences (les « formes de vie »). Imaginer ou construire un romantisme qui porterait le sens de ce dépassement-là, de cette outrance, suppose de penser les conditions d’énonciation d’un nouveau rapport, et d’observer la situation d’un possible recours. Mais sur cette voie les avis diffèrent : qu’il s’agisse de la mise en quarantaine de notre capacité de rêverie ou d’un désœuvrement indépassable, l’articulation du romantisme à la révolution est grippée.
Pour prendre la mesure de cette interruption – qui est une recherche autant qu’une question, une réserve autant qu’une tentative d’effraction – il faudrait mieux saisir, par exemple, ce qui oppose le rapport d’Annie Le Brun au romantisme allemand, à celui de Maurice Blanchot puis de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Mais cela n’y suffirait pas. Si tout, et nous y reviendrons, diverge dans leurs analyses, celles-ci restent marquées par une même volonté de naïveté qui est exactement le sens inactuel du romantisme – ce qui, de son existence fragmentaire, ne passe pas. « On ne congédie pas une naïveté ». On ne peut que l’aggraver, et cela n’ira pas sans difficultés car c’est alors – et presque instantanément – à l’irréciprocité du noir et du désœuvrement qu’on se trouve confronté. C’est-à-dire à l’impossible rencontre de l’imprécation de l’imaginaire et d’une déprise exigée par la conscience de « l’histoire des fictionnements ». Quand Le Brun aggrave la postérité du surréalisme aux conditions des désordres du temps (de ses catastrophes), l’expérience du romantisme désœuvré a déterminé chez Nancy (avec Georges Bataille) une ontologie de l’en-commun qui inscrit sa marque dans l’espace (le sens) qui sépare l’œuvre de la politique, et qui veille, en quelque sorte, sur la possibilité de cet écart (d’où naît toute la fragilité de la démocratie). Les travaux de Lacoue-Labarthe ont autrement étourdi la vision romantique en explorant les factures et les fractures des procédures mimétiques de la modernité (jusqu’à la transgression d’Hölderlin, jusqu’à la folie de Nietzsche).
Être moderne – et c’est encore une affaire d’avant-garde – implique la redisposition des forces d’imitation, implique en somme « le libre jeu du legs » évoqué par Jean-Christophe Bailly à propos de la création de la revue Aléa. Pourquoi insister sur ce point ? Sans doute pour tenter d’observer ce qu’un recours au romantique suppose quant à l’histoire des avant-gardes, et aux liens que celles-ci ont tissés avec les différentes périodes de l’histoire du romantisme. Aggraver la naïveté, soit, mais à condition de faire part aussi à l’excès de conscience qui nous caractérise. Bataille écrivait ainsi sans détour dans « La religion surréaliste » : « Ce qui caractérise l’homme moderne, et peut-être en particulier l’homme surréaliste, c’est que dans son retour au primitif il est contraint à la conscience et s’il vise même à retrouver en lui les mécanismes de l’inconscience, ce n’est jamais sans avoir conscience de ce qu’il vise ». Un tel revers – une telle étendue – atteint la promesse poétique (la ruine). Il détermine le sens d’une triple absence dont il nous revient de penser les effets – ou de dire en quoi nous les aurions dépassés : absence de mythe, absence de communauté, absence de poésie – chacun désignant la possibilité d’un mythe, d’une communauté, d’une poésie (faite de leur commune absence).
Il manque peut-être de l’ironie à la naïveté qui voudrait faire du noir la lumière d’un nouveau romantisme. Il manque aussi un peu d’esprit historique (ou même un peu de mauvaise foi) à qui prétend sortir de l’oubli postmoderne le désir d’une nouvelle mythologie seule susceptible d’enchaîner – au moyen d’un imaginaire négatif – sur les pouvoirs technologiques. S’il nous revient d’évaluer le trajet parcouru par la charge du désœuvrement sur la littérature et même sur les expériences politiques, s’il nous revient de surmonter, peut-être, quelque chose de l’interruption du poème qu’elle semble avoir déterminé (et le désœuvrement n’est qu’un des mots par lesquels tout ce qui s’est pensé comme césure, rupture épistémologique, pulsion de mort, imagination finie, désastre, s’est trouvé nommé), il nous sera résolument impossible de partager la mélancolie mythologique cultivée par Le Brun. Sans doute la nature abusée par l’hyper-industrialisation capitalistique exige-t-elle la présence poétique. Sans doute alors (sans doute aujourd’hui) la littérature devra-t-elle faire état des biens qu’elle a dérobés (ces cinquante dernières années) à la vie. Mais ni le poème ni le mythe ne sauront seuls répondre à ce dont souffre l’homme du souterrain condamné à errer en pleine lumière, car il s’est trouvé que le mythe des origines a contribué à la destruction de tous les sous-sols, et que c’est en pleine lumière qu’on a oublié avec quelle force il pouvait parler contre nous. Parce qu’elle forme à elle seule la dernière avant-garde romantique, et qu’elle l’affirme comme ultime négation contre tous les dédommagements dont la pensée contemporaine s’est parée (dédommagements par équivalence des rapports), il n’y a que Le Brun à pouvoir déclarer, sans détours ni médiation, un intérêt pour le mythe qu’il n’y a que les romantiques et les surréalistes à n’avoir déclaré avant elle : « c’est d’ouvrir sur l’irréalité qui nous habite, que le mythe aura tant fasciné cette génération comme celle des premiers romantiques, les uns et les autres pareillement persuadés de pouvoir y trouver de quoi faire échec à la réalité qui se mettait en place. Alors pourquoi s’efforce-t-on de ne pas s’en souvenir aujourd’hui que, catastrophe après catastrophe, se dévoilent les impasses auxquelles a conduit le choix technologique ? Et alors que, pour masquer la gravité de la situation, sont promues d’innombrables philosophies, plus consolantes les unes que les autres, pourquoi s’applique-t-on à ne surtout pas savoir ce que, d’un siècle à l’autre, la notion de mythe a servi à véhiculer ? »
Si délibérément exagérées soient ces accusations, si trouble soit leur visée, elles permettent de sentir, en creux, ce qu’il s’agirait plus froidement d’observer. Il s’agirait de sentir à quel point, suivant ses incitations, le poème romantique a été atteint par la « volonté de neutralisation »que Le Brun attribue à Blanchot. Prenant parti pour la nature et le sensible contre la littérature « produisant sa propre théorie », Le Brun vise l’épuisement de la critique et la destruction d’un imaginaire vital qu’elle emprunte à Breton, très directement. Dans cette procédure, il n’y a pas jusqu’à Novalis qu’elle subvertisse (attribuant à Heidegger l’autorité d’une parole où Novalis l’a précédé au détail près : « déliée de sa libre propriété, la parole peut se soucier uniquement d’elle-même »).
Ce que Le Brun souligne, et souligne fortement, c’est la mauvaise réputation du mythe. S’il y a dans son interprétation du grand refoulement mythique une réactivité qui ne nous revient pas, le geste poétique et l’entretien romantique qu’elle poursuit avec le surréalisme présentent l’avantage de construire des zones de partage, des fractures dans ce qui pourrait être nommé l’héritage contemporain de la pensée romantique. Aussi faudrait-il construire la possibilité d’une autre voie qui soit en mesure de suppléer au désœuvrement (ou de l’aggraver) sans précipiter pour autant l’imagination dans la recherche d’un nouveau mythe écologique.
Pour n’être pas romantique, Bataille ne fit aucun crédit à l’imagination. Pour avoir été presque surréaliste (en étant celui que Breton n’aura jamais exclu qu’à travers ceux qui l’avaient rejoint), il s’est trouvé qu’il dise un mot sur la poésie, qu’il en théorise la possibilité et l’économie avec une vigueur qui voulait débaucher tout ce que la poésie surréaliste ambitionnait de rêve et d’amour fou.
Cela eut lieu plusieurs fois. C’est-à-dire que Breton aura pour lui une fonction à peu près analogue à celle que Sartre aura autour de « l’expérience intérieure » : celle d’une opposition qui met en lumière l’essentiel. Opposition fructueuse donc, rivalité et pratiques incessantes de renversements qui firent dire à Breton quelque chose d’assez considérable (jusque dans l’accent de dépit) : « Je m’amuse d’ailleurs à penser qu’on ne peut sortir du surréalisme sans tomber sur M. Bataille, tant il est vrai que le dégoût de la rigueur ne sait se traduire que par une soumission nouvelle à la rigueur. »
Autant le dire ainsi : la mauvaise foi donne le ton (Bataille a porté le surréalisme à des nues icariennes quand Breton attribuait à son ennemi le beau rôle du « philosophe excrément »). Mais il y a plus. Il y a dans les mots de Breton quelque chose qui fait entendre qu’il n’y a pas moins de rigueur chez Bataille qu’il y en a chez lui ; qu’il n’y a qu’à la rigueur (à ce qui est souverain) qu’on se soumet délibérément. Pour n’être pas romantique, Bataille ne fit aucun crédit à la belle naïveté du mot liberté. Imagination, liberté, ne sont pas les mots qui décideront pour lui du sens de la poésie. C’est-à-dire qu’il refusera toujours que la poésie se présente comme la promesse d’une consolation ou d’une révolution – si impétueuse et noire soit-elle. Derrière les barreaux de la prison il n’y a rien. C’est le sens qu’il faut donner à la révolution pour qu’elle ait le goût de l’impossible qui dit seul pour lui la vérité de l’homme entier. À la triple absence qu’il annoncera dans les années 1950, auront ainsi précédé trois images de prison. La première – « il y a ainsi, dans chaque homme, un animal enfermé dans une prison, comme un forçat, et il y a une porte, et si on entrouvre la porte, l’animal se rue dehors comme le forçat trouvant l’issue » – dit que c’est l’animalité que l’homme enferme en lui ; qu’elle est la seule condition que l’homme doit libérer ; qu’il n’est d’échappée hors de la prison de l’Esprit que celle portée par l’évidence des sens (ou même des besoins). Porter la liberté au niveau de l’animalité c’est dire qu’elle est aussi essentielle et première qu’elle est basse et brutale. Il n’y a rien derrière les barreaux de la prison qui ne libère l’homme d’autre chose que de la possibilité (impossible) qu’est pour lui l’animalité qu’il retient. La liberté (et la révolution) ne doit donc ici rien à l’amour, à l’art, ni à la poésie auxquels Breton confie le ressort de la pensée humaine « à reprendre le large ». La deuxième – « L’homme a échappé à sa tête comme le condamné à la prison » – figure dans l’acte de naissance d’Acéphale. Elle déclare cette fois que tous les verrous ont sauté, que l’homme est « hors de ses gonds », et si l’adresse au surréalisme est absente du projet d’Acéphale, elle n’en décrit pas moins à quelle fureur expose l’acéphalité (fureur d’une révolte appelée par celle que l’homme est d’abord pour lui-même, ainsi dé-figuré). La dernière – « je ne crois pas avoir haï rien autant que la poésie. De la même façon je suppose qu’un prisonnier pourrait haïr beaucoup plus la fenêtre grillée que les murs de sa prison » – accuse plus franchement l’hypocrite échéance.
Romantiques, Bataille et Breton l’ont été néanmoins pour avoir voulu que la littérature implique la révolution – comme Dionys Mascolo écrira plus tard que « l’existence de la littérature fait conclure à la nécessité du communisme ». Ils l’ont été pour avoir voulu que la littérature comme la révolution soient « réversibles à la vie ». C’est le sens total qu’ils ont donné chacun à cette implication – jusque dans la constitution des groupes et des communautés qui en assuraient la cohésion (et la rigueur), jusqu’aux revues qui témoignaient de son rayonnement. S’ils ont partagé la même nécessité d’éblouir (cette maladie qui touche quiconque « se croit obligé de jouer un rôle par rapport au soleil »), s’ils se sont pareillement distingués par la recherche d’une littérature au caractère exceptionnel, ils ne l’ont pas démontrée de la même façon. Il y a dans la violence de ceux que la misère rend exceptionnels une possibilité de révolte que la poésie projette autant qu’elle reporte, que la poésie tend à idéaliser. Or, de la même manière que Bataille exige de prendre la mesure pratique de la littérature de Sade dans la vie (en y faisant entrer tous les éléments hétérogènes de l’existence), il entend que la littérature prenne la pleine mesure de ce qui est exclu sans le relever – sans attendre des masses qu’elles s’élèvent. Aussi aura-t-il systématiquement attaqué « l’écœurante sentimentalité poétique » en faisant peser contre tous les « sur » et tous les mots d’« Esprit », une écriture de la révolte littérale faite de la mise en circulation des « corps étrangers » seuls susceptibles de créer des « ruptures de continuité ». Christian Prigent dit bien : « une force de déprédation qui oblige le langage poétique à se défaire et se refaire autrement. » Poésie, littérature même, sont pour Bataille les mots que la bourgeoisie surréaliste a trouvé pour donner à la révolte la dignité de langue qui manque à ceux qui la veulent et dont on attend qu’ils la déclenchent. Si le surréalisme a fonctionné comme chargeur de potentialités imaginaires – c’est l’imminence d’une décharge fulgurante que visait l’écriture hétérologique de Bataille.
Passée l’époque des avant-gardes et des règlements de compte (passées les années 1930), la distinction entre l’écriture bataillienne et la poésie surréaliste est moins nette – les enjeux portés par la nécessité de leur différence ne sont plus immédiats. Si la proposition communiste reste au cœur des débats littéraires, l’après-guerre est le temps d’une récapitulation qui porte un regard attentif et presque réconciliant sur les erreurs de jeunesse (quoiqu’il n’y eût jamais de renégats exactement, des exclusions certes, des déceptions et des trahisons mais pas d’explications – c’est le moins qu’on puisse dire de Bataille comme de Breton qu’ils soient restés souverains face aux expériences qu’ils avaient traversées et initiées). Ce n’est donc pas de la même façon qu’on aborde la poésie suivant qu’on met en elle un désir de révolution ou suivant qu’on fasse état de ce qu’il y a d’inactuel à désirer qu’elle porte l’impossible en toute saison. Avant-garde ou récapitulation, romantisme et/ou désœuvrement, la question ici est bien celle de la possibilité d’actualiser un geste, un sens, qui est celui de la littérature (mais aussi celui de l’art, de la poésie, du cinéma, de l’amour) exactement – et de tout temps. Il s’agit bien de s’interroger sur la possibilité d’accentuer la charge collective d’un espace de pensée et d’écriture dont le tracé répond déjà à la nécessité d’exprimer cela – cette charge, cette force de communauté, de sa possibilité à son impossibilité. Autrement dit : est-il possible d’ouvrir sans ré-œuvrer la question de la « possibilité de la littérature » ? Ou doit-on s’en tenir à « la question de la possibilité de la possibilité » ?
La Haine de la poésie reprend et accentue le motif de l’attaque portée au « sur » de la poésie surréaliste et même de la poésie en général, mais dans une mesure qui dépasse largement l’adresse aux adversaires (quoiqu’il s’agisse ici, comme dans « La religion surréaliste », de rappeler le caractère « pénible » sans lequel la poésie n’atteint pas la vérité de ce qui est). Pour introduire un texte qui lie intimement le récit, la fiction, et la forme poétique, Bataille insiste, avec d’autres mots, sur la force évocatrice de ce qu’il appelait les « éléments hétérogènes de l’existence ». La poésie peut dire « l’impossible », et ce doit même être sa fonction : « Il me semblait qu’à la poésie véritable accédait seule la haine. La poésie n’avait de sens puissant que dans la violence de la révolte. Mais la poésie n’atteint cette violence qu’évoquant l’impossible. »S’il se glisse encore ici et dans certains passages de Sur Nietzsche, du Coupable, une haine pour la « niaiserie poétique » ou pour « l’aspiration des larves » à l’absolu, Bataille fait un pas de plus en cueillant la poésie là où elle échoue, là où elle est mise en échec. Dans ce passage, que s’est-il opéré ? Quand il écrit que « la poésie qui ne se hisse pas jusqu’à l’impuissance de la poésie est encore le vide de la poésie » , ou autrement que « l’éclat de la poésie se révèle hors des beaux moments qu’elle atteint : comparée à l’échec de la poésie, la poésie rampe », faut-il entendre que la poésie ne peut atteindre l’impossible, ou que l’impuissance de la poésie atteint seule « l’évocation par les mots de possibilités inaccessibles » ? On pourrait dire, pour le plus évident, que la poésie dont Bataille attend qu’elle donne des mots aux possibilités inaccessibles suppose la ruine de la poésie qui prétendrait les avoir trouvés – c’est-à-dire de la poésie qui aurait admis que soient rendus homogènes des éléments de sens qui ne sauraient être intégrés à quelque forme que ce soit. On pourrait dire aussi, pour le plus sensible, qu’il n’y a de poésie que dans la répercussion formelle de notre impuissance ou de notre insuffisance à dire « ce qui est en jeu dans la totalité de la pensée ». À un certain point, Bataille renouvelle la question de Hölderlin (qui vaut comme verdict) : « À quoi bon des poètes en temps de misère ? » – et « l’aggrave » en la poussant jusqu’à « l’absence de poésie ».
Après avoir tout rejeté ou presque, de la promesse surréaliste, après s’être systématiquement démarqué du mouvement, Bataille récapitule et se réclame d’un surréalisme qu’il s’est entre-temps « approprié ». Plus encore : il tisse, dans « La religion surréaliste », la trajectoire romantique du mouvement comme s’il y avait appartenu – voire comme s’il en avait été l’instigateur. C’est dire combien il reconnaît maintenant avoir partagé avec le surréalisme presque l’essentiel : l’aspiration au mythe, à la communauté et la volonté d’atteindre l’impossible par les mots. Mais à cette triple affinité, qui a porté le surréalisme à l’état de religion et qui a porté Acéphale à la même tentative, répond ce qu’il y a de « pénible » à soutenir la valeur du mythe quand « la valeur matérielle a cessé de garantir l’authenticité du rite ». Une telle situation – qui renvoie à l’impossibilité de la poésie – noue les expériences de Bataille et celles du surréalisme à un caractère « désœuvré » et à un « sentiment d’impuissance », nés de l’impossibilité de lier la valeur poétique à la « valeur réelle du rite ». Notre impuissance, – il faut le comprendre et le verdict s’assombrit – ne vient pas seulement de ce que nous soyons séparés de l’homme primitif dont le surréalisme voulait retrouver les pratiques animiques, elle vient surtout de ce que, dans cette recherche, nous vivions sans échéance. La promesse de l’à-venir est suspendue à une impossible régression : « Nous ne pouvons être que conscients et c’est en nous enfonçant dans la conscience que nous pouvons tenter de transgresser les difficultés du monde actuel. »
Désœuvrés, impuissants, ainsi sommes-nous abandonnés à l’excès de présence ouvert par ces pénibles absences. Il se peut qu’elles donnent le sens d’une fête, d’une exaltation née d’une nuit sans nuit, d’une nuit à ciel ouvert. N’empêche. N’empêche qu’il reste dans ce désœuvrement-là une impuissance qui ne nous revient pas vraiment non plus. Si elle poursuit quelque chose de la fragilité du geste romantique, si elle suppose une interruption qui porte ses conséquences jusqu’à la « question de la possibilité de la possibilité de la littérature », elle suppose autre chose aussi, que l’on perçoit vaguement dans la discussion qui suit la conférence sur « La religion surréaliste » quand Bataille dit : « ce sont des passions insatisfaites plus que des passions arrivées à l’extrême de la consumation qui créent dans le monde un désordre considérable. »
Il conviendrait donc de distinguer au moins deux versions du désœuvrement : l’impuissance, et l’exigence fragmentaire. La première expose à la communication dans l’absence d’issue, la seconde à l’infinité du dialogue. Sans remettre à la poésie la vaine consolation d’une vie meilleure, ni prétendre accéder à « l’extrême de la consumation », nous choisirons d’aggraver le désœuvrement (de l’entreprendre, de l’entamer, de l’entraver). Façon d’écrire, de lire, d’aimer et d’ouvrir, sans ré-œuvrer. Façon de continuer. Et d’ajouter ce qui manque de désir à l’impuissance.
Sur le même sujet
- Après le 7 janvier 2015, quelle place pour le citoyen musulman en contexte libéral sécularisé ?
- Multitudes queer
- Pour l’Etat japonais, l’ennemi ce sont les habitants des régions contaminées
- Note sur le militantisme de l’après-mars à Copenhague
- Intermède : extrait d’un roman
Dans le Neuromancien de William Gibson, les IA du cyberespace et la découverte de l’IA Muetdhivers