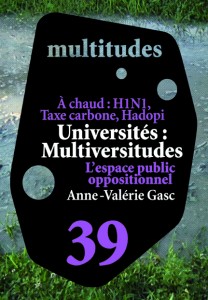Le miroir russe de l’université européenne
L’université russe (puis soviétique, puis de nouveau russe) est un emprunt culturel relativement récent et parfaitement européen. Toutefois, son origine tardive, une cohabitation quelque peu pénible avec un régime autocratique tsariste, puis communiste, le rideau de fer ainsi que la guerre froide ont contribué, avec d’autres circonstances historiques, à creuser un hiatus entre le tronc européen et son rejeton russe. Un hiatus que la potion magique bolognaise semble promettre de combler prochainement – au moins, si l’on en croit les hauts fonctionnaires du Ministère de l’enseignement supérieur russe qui annoncent haut et fort que non seulement la Russie est parfaitement prête à entrer dans l’enceinte bolognaise, mais que l’intégration de la Russie au réseau de Bologne fera le bonheur tant de la Russie que de l’Europe. Des voix plus humbles expriment l’espoir que cette intégration aidera à soigner le corps malade de l’université russe. Un petit examen s’impose, aussi bien du remède que du souffrant.
Move baby !
Depuis le début du siècle, l’éducation supérieure figure parmi les objets du GATS (General Agreement on Trade in Services) au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce. Je pourrais m’arrêter ici, car sapienti sat : tout est dit par cette petite phrase qui éclaire (sinon tue), qui du moins contient in nuce tout le reste de cet article, comme d’ailleurs toute analyse, possible et imaginable, brève ou détaillée, de ce processus qui nous entraîne (sous prétexte que « le monde a changé ») d’une université à l’ancienne, au sein de laquelle la science se posait des questions et cherchait des réponses, à une université nouvelle, à laquelle les pouvoirs ou les entreprises posent des questions et dont ils attendent des réponses rapides et – please – pas trop compliquées.
En effet, malgré les cris d’alarme poussés par des milliers d’enseignants et de chercheurs, malgré des centaines de constats, bilans et communiqués issus de nombreuses facs, malgré la critique acharnée d’un Educational International ou autres associations, le processus d’assimilation de l’éducation supérieure à des services marchands semble irréversible, et la phrase « On ne peut plus rien changer » est devenue de loin la plus fréquente dans nos universités. On force les universitaires à se résigner, à se soumettre à « l’inévitable », puis on s’étonne que ces enseignants résignés et soumis soient inertes, découragés et incapables d’enflammer les masses estudiantines par l’exemple même de leurs fortes personnalités. En ce sens, l’éducation supérieure devient enfin partie intégrante de la cité, et le sentiment d’impuissance qui règne de plus en plus dans nos sociétés a gagné désormais un nouveau terrain en s’installant au cœur de l’université.
Avant d’aborder le cas particulier de la Russie, il convient de saisir à quel point, dans la façon dont se concocte la sauce bolognaise à laquelle se fait cuisiner l’enseignement supérieur européen, l’université n’est déjà plus une. À l’exemple des « deux cultures » de jadis, deux mondes divisent désormais l’université : celui de l’enseignement-recherche et celui de l’administration. Le langage des documents issus du Processus de Bologne montre clairement que ceux-ci s’adressent aux bureaucrates de l’université par-dessus la tête des enseignants. Dans ces documents, ainsi que dans les sommets internationaux, on se parle entre ministres et conseillers de ministres et, si l’on daigne interroger le bas peuple concerné, on ne descend jamais au-dessous des recteurs. Ces documents sont d’ailleurs pour la plupart écrits sur le ton triomphal des bilans bancaires dont la grandiloquence ne révèle que l’ampleur des déboires : une analogie qui, par les temps qui courent, ne peut qu’inquiéter.
La grogne généralisée des enseignants contre les réformes de Bologne ne s’est pourtant pas cristallisée en une véritable opposition, comme l’aurait exigé la gravité de la situation. À l’époque où l’État perd beaucoup de son ancienne puissance en faveur des multinationales et délègue de plus en plus de fonctions à l’Europe, l’opposition reste nationale et, donc, de plus en plus désarmée, impotente, sous-représentée et renvoyée à l’adage, tout prêt et désormais omniprésent « Ce n’est pas nous, c’est Bruxelles ». Il n’existe pas d’opposition internationale européenne. Les seules voix dérangeantes qu’on entend sont celles de l’opposition nationaliste, plus ou moins proche de la droite, voire de l’extrême-droite. Plus l’Europe se déclare unie, plus les clivages et tensions se voient, donc, réduits à des clivages nationaux !
Mais revenons à l’université. La rhétorique mise en place essaye de nous faire croire que le processus de Bologne crée ou a créé un Espace européen de l’enseignement supérieur, autrement dit que celui-ci n’existait pas auparavant. Pour se convaincre du contraire, il suffit de regarder les parcours des Lehr- und Wanderjahre de la plupart des intellectuels et savants européens des derniers siècles. Ceux-ci traversaient souvent les frontières pour suivre l’enseignement de tel ou tel maître. Les obstacles ne manquaient certes pas. Se déplacer était aussi une mise à l’épreuve de la volonté et de la maturité, qui entrainaît un risque de ralentissement de la durée d’études, etc. Pour partir, il fallait vraiment le vouloir. Et alors ? Pas de mal ! Or, aujourd’hui, même ceux qui n’en éprouvent pas le moindre besoin ni la moindre envie partent. Il faut partir ! Move baby ! Les universités d’accueil ont créé des organismes ad hoc pour accompagner cette nouvelle clientèle. Il en résulte que les étudiants en visite sont mis en quarantaine par rapport à la masse des étudiants « indigènes » avec laquelle ils communiquent peu, d’autant que les enseignants sont peu enclins à intégrer ces « touristes » dans leur travail. Souvent, le séjour dans une université à l’étranger ne signifie même pas que l’intéressé fasse un effort pour apprendre la langue du pays. À quoi bon ? On parle tous l’anglais de cuisine (ou plutôt de cantine).
Un processus sans tête (ni queue ?)
Qui est responsable de ces réformes ? Qui les dirige ? Rien n’est moins clair. Ce n’est pas sans raison que ce « responsable » porte pour nom officiel : le Processus de Bologne (the Bologna Process). Cela affirme son caractère anonyme, adespotos, sans auteur, sans maître ni roi, son caractère aussi irresponsable qu’inéluctable. On peut critiquer une assemblée, une organisation, un ministère, mais seuls des chevaliers aguerris dans les combats contre des moulins à vent oseraient s’aventurer à combattre un processus !
Suivant ce modèle, l’anonymat est entré définitivement à la mode à l’université. De nombreux départements éditent des brochures publicitaires sans évoquer le seul nom d’un seul enseignant. Si autrefois on faisait valoir la présence de tel ou tel professeur réputé, maintenant, dans un esprit parfaitement égalitariste, on présente la fac comme une machine anonyme à délivrer des crédits (ECTS), puis des diplômes. Les crédits étant les mêmes partout, on ne voit pas l’intérêt de leur conférer une couleur locale. Comme l’argent, ils ne doivent pas avoir d’odeur. De toute façon, dans le choix d’une université étrangère, ce n’est pas la renommée scientifique qui est décisive, mais la proximité des installations sportives et l’organisation des loisirs. Il suffit pour s’en convaincre de regarder le design des sites web des universités : au texte près, ils ressemblent pour la plupart aux sites des agences de voyages et des portails de loisir, tant les personnages photographiés sont hilares, bronzés et comblés. La comparaison des destinations préférées des étudiants avec celle des touristes est très instructive à cet égard. Faisant fi de tous les benchmarkings, ce n’est pas le nombre de lumières de la science, mais le nombre de jours ensoleillés qui détermine indistinctement les deux flux : la première place européenne dans les deux palmarès est occupée par l’Espagne.
Il est facile de prédire que, bientôt, quiconque n’aura fait ses études que dans une seule université sera considéré comme un fainéant. Puis : quiconque aura fait ses études de Bachelor et de Master dans la même spécialité sera considéré comme un bêta privé de la moindre fantaisie. On nous dit qu’il faut favoriser la mobilité des étudiants. Personne n’explique pourquoi le critère de la qualité s’est vu d’un coup remplacé par celui de la mobilité, à moins qu’il faille nécessairement croire aux effets bénéfiques de la mobilité sur la qualité. Faut-il, une fois n’est pas coutume, donner raison au complotisme et soupçonner un lobby des voyagistes?
On peut déjà supposer que les établissements élitaires (Grandes Écoles en France, Ivy League aux États-Unis) feront tout pour garder, sinon fortifier, les enceintes autour de leurs tours d’ivoire qui empêcheront la libre circulation des crédits et de leurs porteurs. Tandis que pour le reste de la population, on créera l’illusion d’une augmentation des chances sous l’effet de ce bougisme effréné.
C’est l’atmosphère d’une université, au sens météo et au sens d’ambiance, qui compte : ça doit être sympa, quoi. Est-ce toujours sympa pour les enseignants ? Le nouveau discours gestionnaire est en train d’envahir l’université et de polariser ses habitants. Par ces temps de grand flou et de tensions autour des « critères de compétence », se sentent dévalorisés et écartés surtout ceux des enseignants qui sont les moins capables ou les moins désireux de manier – ou de se reconnaître dans – ce langage de « rayonnement », « visibilité », « vitalité », « excellence » ou autre « ouverture[1] ». Parallèlement, et de plus en plus, le contrôle échappe aux professeurs, et se voit peu à peu transféré aux mains de secrétaires pour lesquel(le)s la tâche se simplifie, effectivement, au fur et à mesure que les traits spécifiques des parcours, des départements et des facultés s’effacent. À partir du moment où il y a des crédits partout, il n’est pas sorcier de se livrer à quelques opérations de calcul élémentaire. Tandis que les documents officiels européens parlent de la nécessité de conserver la « diversité » de nos universités, la logique gestionnaire, à travers ses agents, exerce une forte pression dans le sens d’une homogénéisation des programmes et des mécanismes de reconnaissance des crédits. L’Europe a choisi la facilité de comparaison, et donc la quantité aux dépens de la qualité. Elle a choisi de tout mesurer par le temps investi (un semestre égale 30 crédits, un point c’est tout) – un procédé qu’on aurait pu qualifier de parfaitement marxiste, si Marx déjà n’avait pas compris et stipulé qu’à la différence de la production marchande, la science se développe en vertu d’autres lois, celles du temps libre, qu’il est impossible de quantifier de la même manière.
La grande sauce bolognaise
Mais pour l’instant les universités sont différentes. Leur qualité varie énormément. C’est un fait. Est-ce un bien ? La question est vaine, puisqu’elle insinue un argument à la fois bureaucratique et bêtement égalitariste : pourquoi le cas A devrait-il être traité différemment du cas B ? Il en va pourtant ainsi : A et B sont et persisteront à être (un certain temps) différents. Il serait, au bas mot, naïf de croire que les institutions d’enseignement supérieur vont s’uniformiser de fait, pour peu que l’on attribue à la « même » prestation de chacun le même nombre de points. Et il est heureux qu’elles restent différentes, puisque la seule manière d’unifier vraiment leur qualité serait évidemment « par le bas ». Si, donc, on envisageait vraiment la « promotion de la coopération européenne en matière d’évaluation de la qualité [2] », si on tenait vraiment à « la culture de la qualité » – ce qui, au passage, est une expression inepte car elle compte au moins deux mots de trop, et ressemble fâcheusement aux célèbres Ministères (de la Paix, de la Vérité, etc.) –, il ne faudrait pas égaliser les crédits, mais, au contraire, introduire des coefficients : un crédit délivré par tel département de l’université A en vaut 3 du département corrélatif de l’université B. Mais non, ce serait compliquer les choses, et surtout cela contreviendrait au principe égalitariste selon lequel tout se vaut. Il serait, hélas, injuste de présenter le conflit actuel comme une résistance héroïque de la forteresse universitaire face aux forces extérieures qui l’assiègent pour lui imposer une limitation des libertés académiques au nom de la cohésion entre le savoir et la logique du profit. Le discours entrepreneurial a pénétré désormais jusqu’au cœur de l’université déchirée par des tensions – d’ores et déjà – internes entre les consentants (pour diverses raisons) et les irréductibles (pour diverses raisons).
Parallèlement, dans le quotidien universitaire, on observe une diversification du corps estudiantin. Il devient de plus en plus difficile de constituer un groupe d’étudiants et de leur faire passer une épreuve commune ou, encore moins, organiser un travail long, ne serait-ce que de quelques semaines. À la place d’un groupe, on trouve un ensemble d’individus (clients ? consommateurs ?) dont chacun présente un cas qu’il veut irréductible : l’un est en bachelor, l’autre en mastère, le 3e en bachelor à option, le 4e en mastère raccourci, le 5e, étudiant d’Erasmus, a le droit d’être largué puisqu’il n’était pas là le semestre passé (il s’en fiche, d’ailleurs, car il ne sera pas là non plus le semestre prochain), etc. Comment en est-on arrivé là ? En France, où la moindre tentative de modification des programmes scolaires provoque des salves d’articles, des douzaines de livres, suscite des débats parlementaires, mobilise les foules dans la rue, pour le meilleur et pour le pire, cette métamorphose radicale de l’enseignement supérieur n’a pas suscité la moindre discussion ante factum. D’un jour à l’autre, les réformes dites de Bologne, signées par les ministres sans aucune consultation avec les premiers concernés et sans passer par une phase de ‘projet’, de ‘proposition’ ou de comparaison entre plusieurs projets, sont devenues le mot d’ordre. Cette nouvelle sauce bolognaise, exemplairement démocratique et qui en dit long sur la manière dont l’Europe unie veut s’imposer, a donné, donne chaque jour et, surtout, va encore donner des plats désastreux.
La situation russe : regnum corruptum
Et que va-t-elle donc donner, pour peu qu’on accommode ses recettes aux plats russes ? Esquissons d’abord les problèmes qui lui sont propres, pour mieux comprendre la situation dans laquelle la Russie a choisi le cap de Bologne, et pour mieux saisir les attentes qu’elle nourrit (à tort) à son endroit.
Le facteur majeur du fonctionnement de l’éducation supérieure russe actuelle, comme dans bien d’autres domaines, est la corruption. Je crains que son ampleur et son omniprésence soient difficiles à imaginer pour un universitaire (ou un citoyen) occidental. Le commerce le plus répandu et complètement banalisé consiste dans la vente par les enseignants aux étudiants des textes des travaux (de séminaire, mais aussi des mémoires) que ceux-ci doivent par la suite rendre à ceux-là. L’autre option consiste dans les cours privés et payants proposés par les enseignants d’une chaire à leurs étudiants, cours, cela va sans dire, obligatoires (pour ceux qui veulent passer les examens). Les enseignants incorruptibles, si tant est qu’il s’en trouve, sont facilement contournés avec la complicité des décanats.
Aux études gratuites héritées de l’époque soviétique ont de plus en plus succédé les études payantes : d’une part, de manière parfaitement officielle, avec une variété de possibilités, payement au semestre, à l’année ou forfaitaire (avec tous les abus qu’on peut imaginer et, surtout, qu’on ne peut même pas imaginer) ; d’autre part, de manière détournée : officiellement gratuites, elles sont de fait souvent plus chères que les études payantes. D’où la blague hyperréaliste : « On n’est pas assez riche pour envoyer notre enfant dans une fac gratuite[3] ». Le système, très répandu, des « tuteurs », ou répétiteurs, est un des nombreux moyens de « légaliser » cette corruption. Le répétiteur soit fait partie de l’établissement et garantit donc la réussite, soit paye à son tour pour que son protégé réussisse. La corruption (qui, certes, ne date pas d’hier) est souvent avancée comme un problème national. Le nouveau président a fait des déclarations sur ses intentions de la combattre. Mais, pour le moment, on ne voit pas comment ce serait possible, ni sur quelle partie de la société il pourrait s’appuyer pour y parvenir. Le système judiciaire est le champ où la corruption sévit le plus. D’ailleurs, l’incroyable popularité des études de droit (à côté de l’économie et du management) en Russie, reflétée par l’augmentation en flèche du nombre de facs de droit, confirme hélas le fait : il faut savoir que la charge de juge est extrêmement lucrative (la preuve en est que, logiquement, pour l’occuper, le candidat doit d’abord… l’acheter, et cher !). Faut-il encore ajouter que la qualité des études de droit est pour la plupart en deçà de toute critique ?
La mesure avec laquelle on a essayé, récemment, de lutter contre la corruption en amont, c’est-à-dire au passage entre l’école et l’université, a été l’EUE (Examen Unifié d’État) : elle n’a fait toutefois que déplacer le problème, secouer les habitudes et contraindre à inventer de nouvelles ruses. Certaines universités essaient de combattre la corruption en la légalisant. L’étudiant qui a échoué paie non pas à l’enseignant, mais à la caisse de l’établissement, et non pas un pot-de-vin, mais le prix de quelques cours supplémentaires, à l’issue desquels il est admis à l’examen (avec, cette fois, garantie de réussite).
La fuite par l’université
Le plus étrange dans cette situation est que les Russes sont toujours avides d’éducation supérieure. C’est même un peu énigmatique. Les universités et autres académies se multiplient, bien que les diplômes ne vaillent plus grand-chose. D’ailleurs, on peut en acheter autant qu’on veut près des stations de métro, sur les marchés, dans les passages souterrains (et maintenant sur la Toile ; le phénomène touche d’ailleurs aussi l’Occident, mais heureusement dans une bien moindre mesure). Et les écoliers d’hier s’entassent tout de même dans les établissements d’enseignement supérieur. Ils ne rechignent pas même devant les enseignes les plus louches. Toutes les facs sont prises d’assaut. Enfin, presque toutes : les ingénieurs sont nettement moins nombreux. On boude les sciences exactes en Russie, tout comme on les boude en Europe, et pour les mêmes raisons. L’argument d’un emploi assuré ne marche plus : ces études sont une vraie galère, peu compatible avec le « développement personnel », le plaisir et le divertissement[4]. Et ceci d’autant plus que mille et une facs proposent des horizons d’études bien plus cools. De nouvelles branches, l’une plus fumiste que l’autre, foisonnent sur le marché. On a l’embarras du choix entre marketing, fundraising, management culturel, publicité (en vrai cursus, avec BA, MA et doctorat), PR (qui se dit en russe ‘piar’), ressources humaines, agrémentés de bribes de sociologie et du cache-misère d’une très vague kulturologia. On est souvent particulièrement fier de ces nouvelles branches, signe d’accès aux derniers progrès de l’humanité (et à ses fléaux les plus inopportuns).
Un facteur extérieur semble relativiser l’engouement pour l’université dont parlent les observateurs et dont semble témoigner la statistique. Il s’agit du service militaire qui, depuis la guerre en Tchétchénie, mais aussi, dans une moindre mesure déjà depuis la guerre en Afghanistan sous Brejnev, représente un vrai danger pour la vie, puisqu’aux pertes, très lourdes, « pacifiques » (meurtres, passages à tabac, suicides suite au bizutage, etc.) s’ajoutent les pertes proprement militaires. Cela a contribué à modifier les comportements. Les études supérieures constituent en Russie un moyen comme un autre (plus honnête, bien que souvent plus cher) d’éviter le service militaire, à côté de la dispense achetée au commissariat local de l’armée et du faux certificat médical acheté au médecin.
L’université russe entre sauce bolognaise et ragoût soviétique
Ce bref rappel de la gravité des problèmes suffit peut-être à expliquer pourquoi, malgré toutes les critiques que mérite le Processus de Bologne, l’intégration à l’espace européen représenterait probablement un bienfait pour l’éducation supérieure russe. (Est-ce que cette intégration sera aussi bénéfique pour cet espace européen lui-même, c’est une autre question qui ne sera pas la mienne ici.) De toute façon, depuis une quinzaine d’années, de nombreux établissements adoptent les règlements de telle ou telle université ou faculté européenne ou américaine, suite à une convention commune, prévoyant des échanges et/ou une aide financière du partenaire. Il serait effectivement bénéfique d’harmoniser ces initiatives isolées. L’intégration au processus de Bologne (qui, elle, a commencé formellement en septembre 2003) est souhaitée par la Russie à tous les niveaux, du ministre au dernier étudiant. En l’acceptant, la Russie n’aura pas, au moins, à choisir entre l’Europe et l’Amérique, puisque l’Europe elle-même a opté pour le système anglo-saxon.
Ce que l’Europe fait pudiquement et dit à contrecœur ou en inventant des euphémismes (« augmentation de la force compétitive du système éducatif européen » pour ne pas dire « système plus rentable »), la Russie le proclame haut et fort. Ici, les hauts fonctionnaires chargés des réformes de l’enseignement supérieur annoncent qu’ils espèrent que les réformes feront de l’université une véritable entreprise, un véritable élément de l’économie de marché. À Bologne, Bruxelles et ailleurs en Europe, on applique au système de l’éducation supérieure, avec un enthousiasme certain, des termes puisés directement dans le vocabulaire entrepreneurial (cf. les innombrables manifestes de la « philosophie » des firmes) : « dynamisme », « compétitivité », « stratégie », « innovation », « excellence », « défis », « performance »…, etc. Est-il étonnant que, dans la bouche et sous la plume des Russes, des expressions, telles que « le marché des services éducatifs », acquièrent un goût carrément érotique. On sent que l’énonciateur, par le fait même d’utiliser cette expression à la place de l’obsolète « éducation nationale », se voit initié aux recettes du progrès et élevé aux sommets de la culture humaine. La sauce bolognaise est la bienvenue pour oindre nos pirojki.
Il est impossible pour la Russie, encore plus impossible que pour l’Europe, d’échapper à la marketisation de l’université, en raison de l’amalgame qui s’opère automatiquement entre l’université à l’ancienne et celle de l’époque soviétique. Et on est d’autant moins enclin à reconnaître la dette due à cet ancien système, que celle-ci est grande. Car, tout comme la réputation de l’université occidentale use et abuse du capital symbolique acquis avant ce tournant managérial, l’éducation supérieure russe s’est greffée sur le système soviétique et profite du savoir-faire de son personnel, dressé dans un esprit sacrificiel : la religion de l’Avenir (radieux, si on y met du sien) était friande d’abnégations de toutes sortes. Après la fin de l’URSS, c’est le présent qui a accaparé la place de l’ancienne déité et les sacrifices qui lui étaient dus. En effet, au moins à première vue, l’affranchissement du communisme n’a servi qu’à la dilapidation des acquis, modestes mais certains, du système éducatif soviétique. On a le droit d’être méfiant à l’égard des rating-lists, mais ce n’est sans doute pas pour rien qu’en 2007 l’Université de Moscou et celle de St-Pétersbourg, les deux dernières universités russes qui figuraient dans le benchmarking mondial, en ont été évincées.
Les pauvres universités du riche capitalisme
Il est curieux, si l’on y pense, que l’Europe, ravagée pendant des siècles par des épidémies, guerres religieuses et autres misères et disparités sociales, ait pu se permettre une institution universitaire jouissant de l’autonomie, tandis que l’Europe pacifiée, riche, des droits de l’hommes et de la parité des sexes, respectueuse des handicapés, minorités, etc., se dit obligée de renoncer à la liberté académique, à la curiosité et au culte de l’inutile, si nécessaires aux sciences fondamentales comme aux petits départements (langues rares et mortes et autres fleurs désuètes de l’esprit) qui seront décimés par la « nouvelle compétitivité » universitaire. La riche Europe se dit trop pauvre pour permettre à ses chercheurs et enseignants de ne pas penser chaque instant à la rentabilité de leurs branches.
On est en droit de poser les mêmes questions, sur une autre échelle, à la Russie. Celle-ci a su pendant des années de disette, de répression, d’isolationnisme, construire un système éducatif ô combien imparfait, mais dans un certain sens très efficace (qui permet, encore aujourd’hui à certains frustrés de proclamer que « nous avons le meilleur système d’éducation nationale au monde »). Il peut sembler étrange que, débarrassée du rideau de fer et du régime communiste, la Russie doive voir le niveau éducatif de son peuple dégringoler. Les Russes ont beau se plaindre de la fuite des cerveaux, une fuite en Amérique ou en Europe est moins nocive pour le pays que la fuite dans les affaires. Les chercheurs et enseignants partis en Amérique reviennent régulièrement délivrer des cours et animer des séminaires ; ils organisent des colloques dans leurs universités et y invitent leurs compatriotes. Tandis qu’une fois parti dans le monde des « affaires », on ne revient pas à la science.
Peut-on consoler les Russes en leur disant qu’ils ne sont pas les seuls chez qui l’université elle-même devient une « affaire », et de surcroît assez douteuse ? L’université européenne est déboussolée. À force de lui imposer les finalités futiles et secondaires (comparabilité des résultats ou encore tourisme estudiantin), elle a complètement perdu le Nord. Il aurait pu être très bénéfique pour le système d’enseignement supérieur post-soviétique de s’ancrer dans les valeurs séculaires de la recherche et de la formation occidentales, si celles-ci ne se trouvaient pas, hélas, dans un état de corrosion avancée.