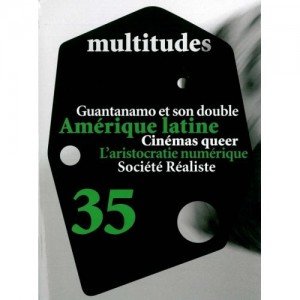La contribution de Société Réaliste au trente-cinquième numéro de la revue Multitudes, dans le cadre de sa section Icônes, est composée de trois objets travaillant à rendre décoratives les informations douteuses. Terres incognitives. Chaîne de fragments, enchevêtrée : on s’y obsède de pliages et de déploiements, de sphéricité et de plan, d’ensembles et de bribes, d’amalgames et d’anacoluthes. Toutes les casses font des cals, et sous les lexiques, les lieux en phrase et les phrases de temps sont couverts d’abcès. Faire du dévers son ouvrage. Pas de point de fuite au drain, de la ligne coulante.
Société Réaliste travaille son intérêt pour les Beobachtungsstelle spéculatifs, postes d’observation et d’enregistrement mal placés, tel des douaniers à la piscine. Si de l’art on attend une contribution à l’architecture de la perception, on préférera planifier des puisards plus que des belvédères. Attendre que les bords vaselinés et les creux circulants ré-épellent la carte par le menu. N’aime toujours pas l’obligation géographique. S’agitent donc trois cartes désobligées.
La carte travaille au sous-département intendance et archivage de la lecture de monde. Elle a ses lumières de bureaux, ses fauteuils statistiques, ses loupes pour les polices minuscules, ses soucis de quadratures, ses crayons de papier pour souligner ce dont il faudra se souvenir, ses réservoirs de langues et la chorégraphie des robinets. Et la carte est un désir de rapport. Même quand elle n’est pas la Carte du Tendre. On y tord pour faire coïncider. Il y est écrit des noms qui sont des points sur des surfaces ou des surfaces ou bien des lignes géométriques – oscillantes, balistiques ? – qui font des zones qui remarquent des lignes qui font des points et des surfaces et des frontières. Quand on s’inquiète des dissections mentales s’incarnant en divisions physiques, la carte devient la piste où les phrasés du fantasme dansent le charleston avec la matière brutale. Puis on sait bien qu’après les bords de la carte commencent les cataractes des limbes. Et, cryptographe geignard, la carte commence à médire et à mélire de drôles de choses quand la cataracte l’atteint.
Une fois les chapelets de claires vues bien ex-/com-/dé-primés, s’entrouvrent les hiatus syntaxiques. Moment de griffonner sur une boîte de Valium. En trois coulées, trois étages, trois temps. Comment le temps impérieux découpe-t-il en strophes les chansons qui tournent autour du monde ? Combien de fois résonne l’écho d’un carambolage de particules dans un cyclotron ? Où sonnent les assonances des nords et des suds ? Longitudes et latitudes sont-elles les ficelles d’un rôti pivotant ? Puisqu’un pays porte le nom d’une ligne géographique imaginaire, le chant des pays peut-il venir nommer des lignes de géographie ? Les géomètres devraient-ils revendiquer le statut de commissaires politiques de l’Eurovision ? Que devient la cartographie quand on lui imprime un tour incantatoire ?
C’est pour l’irrésolution du dernier terme anglais que le cahier central de cette contribution s’intitule « Cartophony of the Land of the Free ». Pour le français on s’oblige à choisir si free est un substantif ou un adjectif. Ou à substantiver un adjectif, et parler de la « Terre du Libre ». Dans la cacophonie du monde financiarisé contemporain ou dans le hors-chant des projections de l’Utopie polyphonique, la Terre du Libre est une île parsemée de sa possibilité à devenir archipel global. Qu’on s’y trompe, l’île de Man, les Seychelles ou Panama sont un même Rockall. Dans cette cartophonie, les hymnes nationaux traduits en anglais des soixante-cinq territoires identifiés par l’OCDE, le FMI et le réseau Tax Justice comme des paradis fiscaux. Ces « havres » sont autant de points dessinant le contour d’un îlot mondial, où l’extension est intégrée, la différence stratégique, et la liberté chantée. En suivant la cadence du Solrésol de François Sudre, conçu en 1827 comme une transformation de la langue en musique universelle, les paroles officielles de l’administration des pathos patriotiques peuvent-elles se retraduire en symphonie pastorale ? Hymne hypnotique pour le troupeau des espérantistes philanthropophages. Version glossolalique du son de la terre qui tourne bien.
La logique des galets. Encore Rockall, qui pour être une pierre au beau milieu de l’eau, à quatre-cent vingt kilomètres de toute habitation, toute munie de ses vingt-sept mètres de diamètre et de ses six cents mètres carrés, n’en est pas moins une extension de la zone économique exclusive britannique. La Terre du Libre, dans cette acception-là, ce galet qui se préférerait toujours glissant et bien dépourvu d’habitants ; la longue, monocorde, circonvolutoire, analogique, arythmique et transcontinentale chanson sans chanteurs. De la superposition des partitions se dégage un son moyen, de même qu’entre le CUT – Coordinated Universal Time – et le TUC – Temps Universel Coordonné – l’Union internationale des télécommunications a choisi l’UTC. Pour sa lecture, on laissera l’interminable ligne ânonnant une liberté dévidée se sectionner, rebondir, dévier, à la coupure d’une zone de temps universel, à celle d’une page ou aux tressautements de l’ œil. Plier ici.
Pour Buckminster Fuller, sa projection dite Dymaxion était avant toute chose une entreprise visant à réduire la distorsion mercatorienne et à présenter les terres mondiales comme un long archipel déplié, le monde comme un seul continent entouré d’un peu d’eau. Plus qu’une carte, il s’agissait pour l’ingénieur de présenter le plan de cette planète-vaisseau, son fameux Spaceship Earth. Le deuxième élément de cette contribution, « Dymaxion Palace », est un ajout au plan du bateau-monde de Fuller : son ornement, sa coque ouvragée. Un autocollant pour carrosserie. Composé des fragments, de points de vue, de détails, de scories d’un bas-relief, celui qui orne la façade du Palais de la Porte Dorée. La figure de proue de l’actuelle Cité de l’immigration est une transposition sculpturale d’une cartographie de l’empire colonial français. En son centre, la mère métropole ; vers la droite, l’Asie puis l’Océanie ; vers la gauche, l’Afrique puis l’Amérique. Une mappemonde tordue, pliée, ré-agencée, pour tirer le portrait-grimace d’une planète française. Les coins de l’empire sont réduits à leurs productions, Empire métonymique, la Cochinchine est le caoutchouc, la Nouvelle-Calédonie est le cuivre. Et puis les « autres », les producteurs, la longue variation quasi phrénologique le long des morphotypes fantasmés des lointains. Tellurium de prestige devenu terrarium idéologique. C’est pour redresser cette projection hexagonale qu’il fallait l’éclater et la retendre sur l’icosaèdre fullerien. Suggestion d’une navette spatiale customisée négrier ; dans l’autoradio, une autre chanson, « Space and Spice and Slice and Slave ». Dans le plan du vaisseau-Terre de Fuller, Rockall était-il le canot de sauvetage ? Coller ici.
Troisième mesure. Encore une casse. Typographique celle-là. Marque déposée sous le titre « Limes New Roman ». Catalogue des murs de séparation, barrières de sécurité, lignes de contrôle, postes-frontières barricadés, qui sur la surface émergée de la Terre, séparent les unités, dessinent les extérieurs, emboîtent les forteresses. En deux échelles : pour les murailles kilométriques, celles qui divisent les États, les majuscules. Pour les remparts centimétriques, les quelques pieds retranchant les quartiers, les minuscules. La chanson mondiale hoquetant de limes. L’archipel fullerien tatoué des lettres d’un texte disséminé et cryptographique, avec pour longitudes et latitudes le croisement des ligatures. Cet alphabet incomplet, interrompu au minimum latin, aura pour finitude ce jour de choix : lorsque, suivant la médiane de Rockall, ils construiront un mur, après avoir appris à piloter les fusées aux mouettes. Couper ici.